Pas tout à fait mais ils sont plus constitutifs de ce que nous sommes que nous l’imaginons. Nous vous avons récemment présenté cette histoire des frontières et les travaux conjoints entre Chinois et Français sur ce sujet. Mais il faudrait également noter ce que cette histoire de l’humanité en mouvement doit à l’historiographie de l’URSS, les Russes dans leur relation avec l’Eurasie, un thème encore présent mais que l’histoire de l’antiquité des éditions de Moscou avait introduit dans l’histoire des nations. Encore aujourd’hui l’immense Russie joue cette unification et conserve la force du chamanisme c’est pour une part ce qui est essentiel en Asie centrale. La Chine apporte ses trains, ses échanges mais la Russie a plus un lien politique et culturel avec l’empire des steppes. Ce qui se joue aujourd’hui dans l’ancien espace du pacte de Varsovie semble souvent porter une partie de ces civilisations mouvantes. La culture jésuite du pape l’aide sans doute à percevoir cela. Il est des cultures plus nomades comme les Arabes ou les Juifs qui bien qu’actuellement tentant de s’accrocher à l’État nation de l’occident portent en elle cet espace civilisateur des frontières et gorgée comme je l’ai été de cette histoire j’ai toujours regretté que l’on ne considère pas l’histoire des juifs selon ce modèle étrange de la steppe, comme le chamanisme m’est toujours apparu comme une des clés de la Russie avec cette capacité à être européenne et asiatique, quel dommage qu’il faille tant de guerres pour accoucher de cette rencontre civilisatrice. (note et traduction de Danielle Bleitrach)
Les chercheurs soutiennent aujourd’hui que les premiers empires nomades ont été les architectes de la modernité. Mais avons-nous la juste mesure de leur succès ?
Par Manvir Singh 25 décembre 2023

La discipline de « l’histoire globale », qui déplace l’histoire des États-nations vers des processus transrégionaux, était censée laisser derrière elle l’ethnocentrisme de ce qui l’avait précédée. La nouvelle bourse d’études de la steppe montre à quel point c’est une tâche délicate. Oeuvre © d’art Fine Art Images / Bridgeman Images
En septembre, le pape François est devenu le premier dirigeant de l’Église catholique à se rendre en Mongolie. Cela a dû être une halte pleine d’humilité. Le pays compte moins de 1500 catholiques. La cérémonie d’accueil, sur la place principale d’Oulan-Bator, a attiré quelques centaines de spectateurs, soit moins d’un millième de la taille de celle qui s’était rassemblée pour le voir à Lisbonne un mois plus tôt. L’un des participants était sorti pour faire son Tai Chi du matin et s’est retrouvé sans le savoir à l’événement.
Tout le monde n’a pas compris pourquoi le Souverain Pontife était là. Lors d’un banquet pour l’entourage du Vatican, un traiteur a demandé à un journaliste du Times : « Est-ce qu’il y a encore des catholiques ? ». Mais le Pape est venu préparé. S’adressant à des diplomates, à des dirigeants culturels et au président mongol, il a célébré la liberté religieuse protégée par l’Empire mongol aux XIIIe et XIVe siècles – « la remarquable capacité de vos ancêtres à reconnaître les qualités exceptionnelles des peuples présents sur son immense territoire et à mettre ces qualités au service d’un développement commun ». Il a également célébré la « Pax Mongolica », la période de stabilité imposée par la Mongolie à travers l’Eurasie, citant son « absence de conflits » et son respect « des lois internationales ».
De nombreux chrétiens des siècles passés auraient été stupéfaits par les paroles de François. La première mention des Mongols en Europe occidentale provient d’un moine bénédictin qui, en 1240, a enregistré le témoignage que les Mongols étaient « une immense horde de cette race détestable de Satan […] assoiffés et buvant du sang, déchirant et dévorant la chair des chiens et des êtres humains. Cinq ans plus tard, le pape Innocent IV envoya à Güyük Khan, le troisième dirigeant de l’Empire mongol, une lettre exprimant « notre stupéfaction » que les Mongols « aient envahi de nombreux pays appartenant à la fois aux chrétiens et à d’autres et les dévastent dans une horrible désolation ».
Les musulmans, eux aussi, considéraient les Mongols comme des sauvages assoiffés de sang. Lorsque Hulagu Khan a pris d’assaut Bagdad, en 1258, les cadavres ont été entassés dans les rues. Les égouts auraient coulé rouge au cœur de la civilisation musulmane, tandis que la grande bibliothèque de Bagdad, la Maison de la Sagesse, brûlait. Pour de nombreux historiens, le pillage a marqué la fin de cinq siècles d’épanouissement culturel et scientifique – l’âge d’or islamique. En novembre 2002, Oussama ben Laden a affirmé que l’administration de George H. W. Bush avait été plus destructrice que « Hulagu des Mongols ». Des mois plus tard, à l’approche de la guerre en Irak, Saddam Hussein a qualifié les États-Unis et leurs alliés de « Mongols de notre époque ».
L’image des Mongols en tant que brutes a survécu à leurs conquêtes. Dans une pièce de Voltaire, ils apparaissent comme des « fils sauvages de rapine » qui entreprennent de « faire de ce splendide siège de l’empire un vaste désert, semblable au leur ». Aujourd’hui, le nom du fondateur de l’empire reste tellement lié à la tyrannie et au fanatisme qu’il est devenu un cliché de décrire les politiciens comme « quelque part à la droite de Gengis Khan ». En Russie et en Europe de l’Est, le « joug mongol-tatar » désigne non seulement la période de domination mongole, mais aussi d’autres formes de despotisme. Quelques jours après les commentaires de François, le consultant politique ukrainien Alexandre Kharebin a utilisé cette expression pour décrire la Russie de Poutine.
Mais le pape François est loin d’être le seul à remettre en question les vieux tropes. « Nous avons trop facilement accepté le stéréotype des Mongols suprêmement violents qui ont conquis une grande partie de l’Eurasie avec une facilité stupéfiante », écrit Marie Favereau dans « La Horde : comment les Mongols ont changé le monde » (Harvard). Son travail rejoint d’autres volumes récents : « Empires of the Steppes : A History of the Nomadic Tribes Who Shaped Civilization » de Kenneth W. Harl (Hanover Square), « Nomads : The Wanderers Who Shaped Our World » d’Anthony Sattin (Norton) et « The Mongol Storm : Making and Breaking Empires in the Medieval Near East » de Nicholas Morton» (Basic) – dans un effort de plusieurs décennies pour remanier les récits sur la barbarie des nomades, et en particulier des Mongols. Ces travaux portent une sorte de restauration steppique. Au lieu d’hommes-bêtes ivres de sang, nous rencontrons des administrateurs rusés qui soutenaient le débat, le commerce et la liberté religieuse. Oui, ils ont envahi les villes, mais la formation de l’État l’a souvent exigé. Et, oui, ils ont réduit en esclavage, mais beaucoup de sociétés aussi, et beaucoup étaient bien plus cruelles.
La restauration de la steppe est typique de ce que les historiens appellent le tournant mondial, un projet plus vaste de déplacement de l’histoire loin des États-nations et de la diffamation colonialiste et vers les peuples et les processus qui nous ont créés. C’est un relevé d’ombres, un tracé d’espace négatif. Il se concentre sur les peuples qui, selon les mots de Sattin, « ont longtemps été confinés aux anecdotes et aux réflexions après coup de nos écrivains et de nos historiens ». Ce sont quelques-uns des groupes les plus décriés dans les chroniques historiques : les non-civilisés ; les barbares à la porte ; les tribus qui semblent surgir d’un portail démoniaque, détruisent tout ce qu’elles voient, puis se retirent dans les ténèbres. La restauration de la steppe les repositionne. Elle les traite comme des sujets à part entière, comme des peuples qui ont leur propre histoire, qui ont formé des sociétés non moins complexes que les États sédentaires auxquels ils ont été confrontés, et qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons.
La steppe eurasienne est un vaste rideau de prairies qui s’étend de la Hongrie à la Mandchourie. Sa taille est presque impossible à imaginer : une vue de verdure et de feu dont les extrémités sont plus éloignées les unes des autres qu’Anchorage ne l’est de Miami ou que Le Caire ne l’est de Johannesburg. Son importance historique provient d’un curieux quadrupède qui y vit depuis environ cent mille ans : le cheval. Dotée de longues pattes, de poumons puissants, de tendons élastiques et d’un intestin capable de digérer l’herbe dure, la créature prospère dans la steppe ouverte. Les chevaux étaient bien équipés pour résister à l’ère glaciaire, leurs sabots durs étant capables de percer la neige et la glace pour y trouver les herbes en dessous.
« Le cheval a été le moyen de transport le plus efficace et le plus durable que les humains aient jamais utilisé », écrit Sattin, un journaliste britannique, dans « Nomads », « et la capacité de monter à cheval a transformé la vie sur terre, peut-être nulle part plus que dans la steppe. » Les chevaux ont été élevés en captivité dans la steppe occidentale il y a au moins cinq mille ans. La roue a été inventée à peu près à la même époque, et les deux innovations, combinées, ont permis au pastoralisme nomade de prospérer.
Les habitants de la culture Yamnaya ont été les premiers à tirer parti des nouvelles technologies et à dominer une grande partie de la steppe. Partis du nord de la mer Noire vers 3000 av. J.-C., ils utilisaient des chevaux et des charrettes à roues pour parcourir des distances étonnantes ; des généticiens ont trouvé des cousins germains enterrés à près de 900 kilomètres l’un de l’autre. Eux et leurs descendants se sont également répandus en Europe, en Inde, au Proche-Orient et dans l’ouest de la Chine, comme le raconte Harl, professeur émérite d’histoire à Tulane, au début de « Empires of the Steppes ». La langue Yamnaya est l’une des premières ramifications du proto-indo-européen et un ancêtre de langues telles que le grec, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le vieux celtique, le russe, le persan, l’hindi et le bengali. (Aujourd’hui, plus de trois milliards de personnes parlent une langue indo-européenne.) Environ 70% d’entre nous ont une ascendance Yamnaya dans notre ADN. Plus que les Grecs, les Romains ou les Chinois, c’est le nomade Yamnaya dont l’héritage survit dans nos mots et nos corps.
Au cours des millénaires qui ont suivi l’expansion de Yamnaya, la composition de la steppe eurasienne a changé. Au VIIe siècle av. J.-C., un peuple connu sous le nom de Scythes en occupait l’extrémité occidentale. Les Scythes, dont les archers à cheval maniaient des arcs composites et montaient sur des selles avec des étriers en cuir, contrôlaient une grande partie des steppes entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ils ont également contribué à la chute de l’Empire assyrien et, selon Hérodote, ont vaincu deux fois le roi de Perse. Voyagez dans les steppes orientales et faites un bond en avant de quelques siècles, vers 200 av. J.-C., et vous trouverez les Xiongnu, qui, pendant un certain temps, ont perçu des tributs de la Chine Han en échange de la paix.
Comme pour tant de nomades des steppes, une grande partie de ce que nous savons sur les Scythes et les Xiongnu provient de ce que les peuples sédentaires ont écrit à leur sujet. (Sattin nous dit que le nom Xiongnu dérive d’un mot chinois signifiant « progéniture illégitime d’esclaves ».) Harl et Sattin combinent ces récits avec des preuves génétiques et archéologiques plus récentes pour construire une histoire plus riche. Il s’avère que les Scythes et les Xiongnu étaient des confédérations multiethniques. Les Xiongnu englobaient un éventail de tribus à travers une étendue de steppe à peu près aussi large que la partie continentale des États-Unis. Sous la direction d’un souverain charismatique nommé Modu Chanyu, ils ont établi un appareil de gouvernement complexe, avec des scribes chinois, une hiérarchie bureaucratique et, selon Harl, leur propre système d’écriture. « En construisant le premier ordre impérial dans les steppes, Modu Chanyu a écrit le scénario des conquérants ultérieurs des steppes, d’Attila le Hun à Gengis Khan », écrit Harl.
Parmi les nomades étudiés das les « Empires des steppes », Harl est le plus impressionné par Gengis Khan et ses Mongols. Attila le Hun a contribué à la chute de l’Empire romain d’Occident, tandis que les campagnes du conquérant ultérieur Tamerlan ont contribué à propulser l’essor de l’Inde moghole, de la Russie moscovite et de l’Iran safavide chiite. Mais la superpuissance à cheval sur les steppes établie par Gengis Khan a eu une durée de vie et une expansion uniques. C’est à travers l’Empire mongol, écrit Harl, que la fabrication du papier, l’impression au bloc et la poudre à canon se sont déplacées de l’Est vers l’Ouest, accélérant la diffusion des connaissances et catalysant la conquête des mers par l’Europe. « L’économie mondiale de l’ère moderne est donc née grâce à l’héritage mongol », déclare-t-il.
L’idée que les Mongols ont été les architectes de la modernité est un pilier de la nouvelle érudition. Sattin présente un argument similaire à celui de Harl, ajoutant la boussole à la liste des innovations envoyées vers l’ouest, bien qu’il reconnaisse que d’autres nomades, tels que les Arabes, ont contribué à les livrer aux Européens. Les deux auteurs peuvent s’appuyer sur des travaux antérieurs tels que Gengis Khan and the Making of the Modern World (2004) de l’anthropologue Jack Weatherford, une introduction charmante, poétique et élogieuse aux Mongols qui, plus que tout autre livre, a contribué à faire avancer la restauration des steppes.
Tous ces chroniqueurs racontent une histoire similaire de l’ascension des Mongols. Un chasseur-nomade modeste, débrouillard et parfois impitoyable nommé Temujin, ayant été abandonné par son clan à l’âge de neuf ans, unifia les tribus des steppes orientales pour la première fois en quatre siècles. En 1206, lors d’une réunion des chefs des steppes, il reçut le titre de Gengis Khan, qui signifie quelque chose comme souverain « féroce » ou « océanique ». (Le mot anglais « Genghis » provient de traductions de sources persanes.) Au cours des deux décennies suivantes, lui et ses disciples sont devenus les premiers à rassembler sous un seul dominion les terres situées entre la mer Caspienne et l’océan Pacifique, une zone presque aussi large que la steppe elle-même.
Après sa mort, en 1227, le domaine de Gengis Khan a continué à grossir jusqu’à couvrir environ vingt pour cent de la masse continentale du monde, de la Syrie à la Corée. À l’est, son fils Ogedei soumet le nord de la Chine. Lorsque Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis, s’empara du sud, il unifia le pays et fonda la dynastie Yuan. Les événements de l’Ouest, quant à eux, figurent dans « La Tempête mongole » de Morton et « La Horde » de Favereau.

Les deux livres sont des réalisations scientifiques remarquables, et l’éventail des sources que leurs auteurs consultent témoigne du cosmopolitisme mongol. Morton, historien à l’Université de Nottingham Trent, se concentre sur le royaume situé entre le delta du Nil et l’Anatolie, où les Mongols ont comploté avec et contre les califes, les croisés et les commandants turcs. Favereau, historienne à l’Université Paris Nanterre, raconte l’histoire de la Horde d’Or, qui a commencé dans le secteur nord-ouest de l’Empire mongol et, après son éclatement, est devenue un régime politique autonome qui s’étendait sur une grande partie de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale.
Pour Morton, les invasions mongoles étaient un cas de force majeure localisé. Tout comme un astéroïde a tué les dinosaures non aviaires et inauguré l’ère des mammifères, les Mongols ont déclenché une tempête de feu en Méditerranée orientale qui a consumé des prétendants tels que les États croisés, le califat abbasside et l’Empire ayyoubide, créant des ouvertures pour les parvenus, notamment les Mamelouks d’Égypte et les Ottomans d’Asie Mineure, deux groupes eux-mêmes descendants de peuples des steppes.
Favereau préfère un cadrage plus grandiose, comme le suggère son sous-titre, « Comment les Mongols ont changé le monde ». Les lieux et les peuples qu’elle cite comme exemples de ce changement de monde, cependant, semblent plus appartenir au Pacte de Varsovie qu’à la Société des Nations. Elle retourne le plus souvent chez les Rus’, les ancêtres culturels des Russes, des Ukrainiens et des Biélorusses modernes. La campagne mongole contre les Rus’ dura quatre hivers, de 1237 à 1241. Pas plus de cinquante mille soldats n’ont été envoyés pour conquérir une population de plusieurs millions. Pour ce faire, les Mongols ont exploité les faiblesses de leurs adversaires. L’État de la Rus’ s’était fragmenté, en proie à des querelles entre ses princes. En attaquant pendant les mois froids, les Mongols ont surpris les Rus’, qui ne s’attendaient pas à entrer en guerre à cette période de l’année. Les Mongols ont adapté la technologie de siège chinoise pour aplanir les murs de terre et de bois. À la fin de la campagne, les Mongols contrôlent une vingtaine de villes de la Rus’. Beaucoup, y compris l’ancienne capitale, Kiev, avaient été saccagés. La plupart ont capitulé en quelques jours.
Une histoire commune de la domination mongole, en particulier dans les études nationalistes russes, est celle d’un assujettissement punitif – d’un peuple étranger dont le joug a étranglé le développement. Favereau soutient le contraire. « Les principautés russes ont connu une vitalité économique extraordinaire pendant leur vassalité à la Horde », écrit-elle, en montrant une quarantaine de villes ou plus construites dans le nord-est de la Russie au XIVe siècle. Elle reconnaît que les Mongols considéraient les Rus’ comme des sources de revenus, mais elle soutient que leur stratégie était plus commerciale que répressive. Les Mongols reliaient la Rus’, directement ou indirectement, aux marchés des régions de la Volga et de la mer Caspienne, de la mer Noire et de la mer Baltique, ainsi qu’à la Chine, au Moyen-Orient et à la Méditerranée. « Sécurité et libre passage des marchands et des marchandises ; traitement privilégié pour les élites, le clergé, les commerçants et les artisans ; régimes fiscaux et fonciers soigneusement planifiés ; et surtout gouvernance indirecte comme l’étoffe de la prospérité, pour les sujets russes comme pour les Mongols », écrit-elle. Loin de ralentir la croissance de la Russie, les politiques mongoles ont peut-être contribué à la financer.
La restauration de la steppe montre les forces – et les limites – de la nouvelle discipline resplendissante de « l’histoire globale ». On dit souvent qu’elle a vu le jour au début du XXIe siècle, mais cette approche a émergé dans l’effervescence d’un monde sans frontières et connecté au commerce. En 2005, Thomas Friedman a publié son traité sur la mondialisation, « Le monde est plat ». L’année suivante, trois universitaires ont lancé The Journal of Global History. Dans le premier numéro, l’historien britannique Patrick O’Brien déclarait que l’histoire mondiale visait à laisser derrière elle « l’arrogance de Rome » ainsi que « le triomphalisme scientifique et technologique de l’Occident ». Plutôt que de construire des histoires autour de la grandeur de l’Europe (ou du califat, ou du confucianisme), il a plaidé pour une étude des « connexions » et des « comparaisons » qui mettrait également en lumière « les multiples réalisations d’un plus grand nombre de peuples, de communautés et de cultures sur de longues périodes de l’histoire humaine ».
La discipline naissante a dû surmonter des siècles d’orgueil historiographique. Écrire sur d’autres peuples a longtemps été au service de l’auto-glorification. Les « Histoires » d’Hérodote, écrites vers 430 av. J.-C., couvraient des événements sur trois continents, mais culminaient avec des démonstrations de supériorité grecque, célébrant les victoires des cités-États grecques libres sur les Perses autocratiques et barbares. Les histoires dynastiques chinoises comme « l’Histoire des Han » (111 apr. J.-C.) et la « Nouvelle Histoire des Tang » (1060 apr. J.-C.) ont approuvé une idéologie sinocentrique. Les populations étrangères étaient considérées comme civilisées dans la mesure où elles adoptaient les normes chinoises. L’érudit arabe du IXe siècle, Ya’qoubi, a commencé son histoire du monde par l’Irak, « parce que c’est le centre du monde, le nombril de la terre », et bien qu’il ait écrit sur les grandes puissances préislamiques – la Perse, Byzance, etc. – c’était pour montrer comment elles ont contribué à la plus grande politique de toutes : le califat abbasside basé à Bagdad.
L’impérialisme européen a tout bouleversé. Alors que les puissances occidentales faisaient irruption dans le monde politique et psychologique des peuples, une pléthore d’ethnocentrismes a cédé la place à l’eurocentrisme. Les histoires du Japon, de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique et du Moyen-Orient ont été forcées de faire face aux réalisations de l’Occident. La préoccupation était la plus extrême, naturellement, dans les écrits des Européens. Dans « Conférences sur la philosophie de l’histoire » (1837), Hegel a déclaré que « l’histoire du monde voyage de l’Orient à l’Occident, car l’Europe est absolument la fin de l’histoire, et l’Asie le commencement ». De 1893 à 1901, les historiens français Ernest Lavisse et Alfred Rambaud ont édité une série de douze volumes, « Histoire Générale » ; seulement dix pour cent de ses pages étaient consacrées au monde non occidental.
Plus d’un siècle plus tard, la portée géographique de l’histoire du monde s’est élargie, mais le succès de l’Occident reste le grand résultat qui mérite d’être expliqué. Des livres ambitieux comme « Guns, Germs, and Steel » (1997) de Jared Diamond, « Civilization : The West and the Rest » (2011) de Niall Ferguson et « Why Nations Fail » (2012) de Daron Acemoglu et James A. Robinson envisagent tous sérieusement les sociétés non occidentales, mais dans le but d’exposer, pour citer le titre d’un autre livre populaire, de Ian Morris, « Pourquoi l’Occident règne – pour l’instant ».
L’histoire mondiale était censée transcender toutes ces formes d’esprit de clocher, et cet objectif, dans un premier temps, semble s’être réalisé dans la restauration des steppes. Les nomades, nous dit-on, ont créé des villes, imposé la paix et garanti la liberté religieuse. Ils ont encouragé le commerce et l’interaction culturelle, en recombinant les idées, les peuples et les technologies, ce qui a eu des conséquences bouleversantes dans le monde.
Pourtant, un paradoxe traverse ces livres. Les peuples des steppes sont les plus remarquables, semblent-ils nous assurer, lorsqu’ils ressemblent à des sociétés riches et sédentaires. Ils ont un rôle dans « l’histoire mondiale » dans la mesure où ils affectent l’ascension et la chute des régimes politiques sédentaires, souvent européens. Et c’est ainsi que la restauration de la steppe finit par affirmer les normes qu’elle s’est fixé pour défier.
Réfléchissez à la façon dont l’importance historique est déterminée. Les érudits se moquent régulièrement du commentaire de Hegel selon lequel l’histoire s’est terminée en Occident, et pourtant la restauration de la steppe montre à quel point la notion reste enracinée. Favereau et Harl ont passé des années à déterrer les histoires des peuples des steppes. Favereau centre néanmoins son analyse sur l’Europe ; Harl termine là-dessus. Sattin, dans son introduction, termine une liste des façons dont les nomades ont créé les « grands empires » avec leur contribution à la Renaissance européenne. Dans le dernier chapitre du livre, il termine un résumé de l’œuvre en citant la Renaissance et la domination et la commercialisation du monde par l’Occident. Même les histoires mondiales, semble-t-il, trouvent leurs épilogues en Europe.
Et ainsi de suite. Contrairement à l’affirmation selon laquelle les Scythes et les Xiongnu « étaient primitifs et isolés », écrit Sattin, « nous savons par les sépultures que leurs chefs vêtus de robes de soie chinoise garnies de fourrure de guépard, s’asseyaient sur des tapis persans, utilisaient du verre romain et avaient un goût pour les bijoux grecs en or et en argent ». De même, Harl nous assure que les nomades qui ont conquis les villes helléniques ont « rapidement apprécié » la haute culture grecque qu’ils ont rencontrée. Tout cela est bien intentionné, mais, comme l’historiographie d’antan, ces passages renforcent une hiérarchie des civilisations, dans laquelle les Grecs, les Romains, les Perses et les Chinois se tiennent au sommet. La façon dont vous cessez d’être barbare est en commerçant avec ces gens ou en embrassant leur culture, et non en perpétuant vos propres traditions.
La nouvelle histoire mondiale s’est empressée d’établir que les nomades des steppes présentaient des caractéristiques clés des civilisations classiques et des démocraties libérales : l’écriture, l’urbanisation et les valeurs apparemment progressistes. Mais tant que ces avancées seront considérées comme des signes de sophistication, les nomades ne seront pas à la hauteur. Harl dit que les Xiongnu ont développé une nouvelle écriture, mais, contrairement à l’écriture de leurs voisins Han, aucun vestige largement accepté n’a survécu. Les Mongols ont construit des villes, mais ces villes étaient réputées décevantes par rapport aux normes sédentaires ; le missionnaire franciscain Guillaume de Rubruck remarqua que la capitale de l’empire, Karakorum, n’était « pas aussi grande que le village de Saint-Denis, et le monastère de Saint-Denis vaut dix fois plus que ce palais ». Et, oui, Gengis Khan a permis un certain degré de liberté religieuse, mais les Mongols qui ont maintenu leur foi chamanique considéraient naturellement toutes les autres croyances inférieures à la leur.
L’objectif déclaré de l’histoire globale de décentrer l’histoire mondiale nécessite une compréhension plus sophistiquée de ce à quoi ressemble la sophistication. Dans le cas des sociétés nomades, nous devons passer de l’aspect statique à l’aspect flexible, de la complexité sociale incarnée par la brique et la bureaucratie à quelque chose qui réside dans les réseaux : une capacité toujours réactive d’action collective à grande échelle. C’est ce qui a rendu les nomades impressionnants, après tout, c’est ce qui les a rendus uniques. Ils vivaient dans d’énormes sociétés itinérantes. Ils englobaient divers groupes ethniques et pouvaient se mobiliser pour la guerre presque instantanément. Ils ont envahi les empires à leurs frontières et les ont gouvernés, parfois pendant des générations. L’organisation mongole atteignit son apogée dans ces hordes : des unités mobiles autosuffisantes qui contenaient jusqu’à cent mille personnes et qui transportaient des maisons, des statues, des ateliers, des palais et des lignes d’approvisionnement. D’un œil serein, nous pourrions les appeler des « villes en mouvement », mais l’expression passe à côté de leur nature presque aqueuse, de leur capacité à se restructurer autour des naissances, des départs et des échauffourées politiques.
Les historiens se sont efforcés de montrer que, selon les mots de Sattin, « l’histoire des nomades n’est ni moins merveilleuse ni moins significative que la nôtre ». Mais nous continuerons à nous traiter comme la mesure de tout à moins que nous n’apprenions à réviser notre sens de l’importance. C’est peut-être le plus beau cadeau qu’une histoire plus globale nous offre : la grandeur redéfinie.
Manvir Singh, professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Californie à Davis, travaille sur un livre sur le chamanisme.
Vues : 278






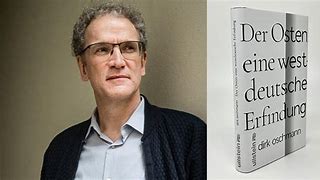
Michel BEYER
J’ai eu le privilège d’effectuer un voyage en Ouzbekhistan en 1984, voyage organisé par l’association France/URSS. Samarcande était le point central de notre séjour dans ce pays. Magnifique ville, la place Le Reghistan avec ses divers monuments consacrés à l’Islam est superbe. Près de Samarcande, Tamerlan, un des chefs mongols les plus prestigieux y a son tombeau. C’est dire si la culture mongole a marqué ce pays.
Coïncidence, hier, hors sujet, j’ai abordé le culte du cheval aux USA, affirmant que le cheval n’est apparu aux Amériques, qu’à partir de 1510 avec Cortes. Celui-ci d’ailleurs en a usé et abusé. Montant, équipé de son armure, un cheval fougueux. Il a fait placer près de celui-ci une jument en rut. Vous imaginez le charivari. Les indiens étaient subjugués. Cortes était un dieu juché sur un dragon. Jean-Marie Le Clézio explique très bien cet épisode dans son ouvrage “Le Rêve mexicain….”. Dans l’imaginaire, cheval et indien font cause commune depuis des millénaires. C’est archi-faux. Les colons blancs de la conquête de l’ouest ont une antériorité de culture du cheval nettement supérieure aux indiens.
Mais revenons à notre article:” La steppe eurasienne est un vaste rideau de prairies qui s’étend de la Hongrie à la Mandchourie. Sa taille est presque impossible à imaginer : une vue de verdure et de feu dont les extrémités sont plus éloignées les unes des autres qu’Anchorage ne l’est de Miami ou que Le Caire ne l’est de Johannesburg. Son importance historique provient d’un curieux quadrupède qui y vit depuis environ cent mille ans : le cheval. Dotée de longues pattes, de poumons puissants, de tendons élastiques et d’un intestin capable de digérer l’herbe dure, la créature prospère dans la steppe ouverte. Les chevaux étaient bien équipés pour résister à l’ère glaciaire, leurs sabots durs étant capables de percer la neige et la glace pour y trouver les herbes en dessous.
« Le cheval a été le moyen de transport le plus efficace et le plus durable que les humains aient jamais utilisé », écrit Sattin, un journaliste britannique, dans « Nomads », « et la capacité de monter à cheval a transformé la vie sur terre, peut-être nulle part plus que dans la steppe. » Les chevaux ont été élevés en captivité dans la steppe occidentale il y a au moins cinq mille ans. La roue a été inventée à peu près à la même époque, et les deux innovations, combinées, ont permis au pastoralisme nomade de prospérer.(texte)
Tout est dit dans cette partie du texte. Sans le cheval, il n’y aurait vraisemblablement pas eu de conquêtes mongoles. En bien ou en mal, cela n’a pas d’intérêt. C’est comme cela que l’histoire a tourné.
Le Pape a parlé devant 1500 personnes. Il est facile de dire qu’il a parlé dans le désert. Les catholiques du monde entier sont intéressés par la parole du Pape, mais aussi des millions de gens non-catholiques.
Ce Pape peut avoir parfois des positions irritantes. Mais depuis JeanXXIII, c’est celui qui est le plus prêt des masses. Le nouveau Président de l’Argentine est un ultra-réactionnaire. Je suis persuadé que le Pape François sera féquemment en opposition avec son Président.