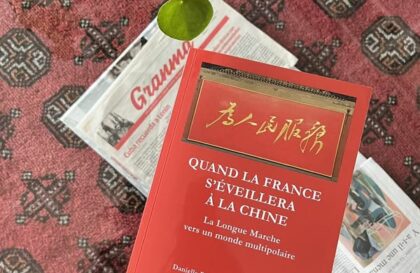On retrouve sans cesse dans un monde multipolaire et dans la Chine en proie à l’accélération des changements qui peuvent être un facteur de dissolution des rapports sociaux et engendrer une anomie (incapacité aux relations collectives) une référence à la profondeur historique et aux civilisations. Ce qui à la fois fait partie de notre histoire, celle du continent eurasiatique autant que celle de l’humanité mais qui dans le même temps se construit dans des voisinages antérieurs à l’intervention occidentale. C’est la construction d’une référence aux origines à laquelle il va falloir nous habituer, percevoir à quel point nous ne sommes plus que des protagonistes comme les autres. (note et traduction de Danielle Bleitrach)
Un pont entre la Chine et l’Inde à travers l’Himalaya
Par Qian Feng 04 juil. 2025 
Illustration : Chen Xia/GT
Sous le vaste ciel du plateau Qinghai-Tibet, le mont Kangrinboqe se dresse avec son sommet enneigé pointant vers le ciel, tandis que le lac Manasarovar reflète la lumière de mille ans de foi. À l’été 2025, la route de pèlerinage longtemps interrompue pour les pèlerins indiens a été rouverte, et le premier groupe de pèlerins a depuis terminé son voyage. Cette route renouvelée a le potentiel de servir à la fois de « thermomètre » et de « catalyseur » pour améliorer les relations sino-indiennes, ainsi qu’une étape modeste vers la reconstruction du lien entre deux civilisations anciennes.
Le mont Kangrinboqe et le lac Manasarovar, en tant qu’espaces sacrés qui transcendent les frontières religieuses, incarnent les aspirations spirituelles partagées des dévots bouddhistes hindous et tibétains. Dans les textes hindous, le mont Kangrinboqe est connu sous le nom de « mont Kailash », la demeure où Shiva pratiquait ses pratiques ascétiques, et où les pèlerins peuvent purifier leurs péchés et atteindre la libération. Cette croyance remonte à l’ère védique et est profondément ancrée dans la mémoire culturelle collective des hindous. Comme l’a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, les visites des pèlerins indiens au Xizang pour le pèlerinage religieux sont « une partie importante des échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays ». En ouvrant son sanctuaire spirituel aux croyants indiens avec grandeur, la Chine démontre son engagement à protéger les diverses cultures religieuses et incarne la sagesse orientale de « l’harmonie dans la diversité ». Cette action s’adresse directement au cœur du dialogue civilisationnel, qui est le respect des croyances spirituelles, représentant l’empathie la plus profonde entre les civilisations.
La restauration de la route de pèlerinage, marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l’Inde, revêt une importance symbolique importante. Réfléchissant à la Déclaration conjointe de 2014 entre la République de l’Inde et la République populaire de Chine sur la construction d’un partenariat de développement plus étroit, le chemin de pèlerinage était autrefois un pilier clé de la coopération culturelle entre les deux pays. Cependant, il a été bloqué ces dernières années en raison de différends frontaliers. La réactivation de ce mécanisme est considérée par certains observateurs comme une étape possible de la « désescalade » à la « réengagement », ce qui pourrait aider à créer un espace tampon pour un dialogue politique de haut niveau.
Lors d’une réunion en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai 2024 à Astana, au Kazakhstan, les ministres des Affaires étrangères chinois et indien sont parvenus à un consensus selon lequel le statu quo entre les deux pays de 2020 à 2024 n’était « dans l’intérêt d’aucune des parties ». Cette déclaration fait subtilement écho à la reprise des pèlerinages. En s’engageant dans des échanges peu sensibles sur le plan politique, les deux pays peuvent contourner les défis géopolitiques et prendre la tête de l’engagement culturel. Cette approche de « leadership culturel suivi d’un engagement politique » pourrait servir de point de référence pour explorer les moyens de gérer des relations bilatérales complexes à l’avenir.
Le pèlerinage est fondamentalement un dialogue spirituel qui dépasse les frontières nationales. Lorsque les pèlerins indiens prient avec leurs paumes jointes au pied du mont Kangrinboqe, et que les mères tibétaines présentent des foulards khata aux invités de loin, ces actes créent des scènes vivantes de diplomatie entre les peuples. Cette subtile intégration culturelle, tout comme la symbiose de la fleur de lotus et de la fleur de Gesang, favorise une nouvelle vitalité dans la diversité. Lorsque les échanges culturels fonctionnent comme un aspect relativement stable des relations bilatérales, ils peuvent contribuer à créer un environnement plus propice au rétablissement de la confiance politique.
La fonte des neiges du mont Kangrinboqe se jette dans le Gange et le fleuve Yarlung Zangbo, enrichissant le sol fertile de deux grandes civilisations. Du point de vue de la civilisation humaine, dans ce monde incertain, la culture reste le lien le plus durable.
Lorsque différentes civilisations apprendront à coexister malgré leurs différences, l’humanité finira par trouver le bon chemin pour aller de l’avant. De même que les pèlerins mesurent le chemin de la foi avec leurs pieds, les futures relations sino-indiennes doivent être construites sur la confiance mutuelle, pas à pas, avec patience et sagesse.
L’auteur est chercheur principal à l’Institut stratégique national de l’Université Tsinghua. opinion@globaltimes.com.cn
Views: 0