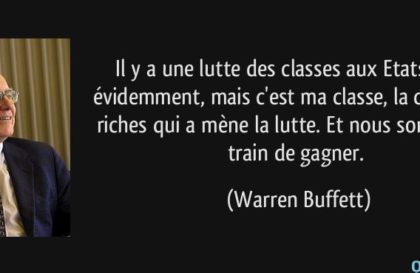Le mythe du « libéralisme » s’effondre à la fois devant la nécessité de l’intervention de l’État pour faire face à l’inflation, et sous celui des pouvoirs « démocratiques » avec des dirigeants qui n’ont plus de majorité. Les décisions qu’ils prennent en particulier ceux de se soumettre aux exigences militaristes de surarmement et aux braquages douaniers du suzerain US provoquent le désaveu populaire mais aussi celui des chefs d’entreprise qui dénoncent « l’illégitimité » (hypocrisie) d’un tel pouvoir. Le parallèle avec le soutien de Trump aux prix des œufs, mais aussi plus profondément la contestation que provoque dès aujourd’hui la signature de l’accord de l’UE avec Trump par von der Leyen, témoigne de la crise profonde de la classe capitaliste face à son État.
par Yoneyuki Sugita 25 juillet 2025

Alors que le Japon négociait l’accès au marché agricole avec les États-Unis, le ministre de l’Agriculture Shinjiro Koizumi était occupé à mettre en œuvre une politique visant à abandonner les appels d’offres concurrentiels et à fixer les prix du riz par décret gouvernemental.
Cette contradiction entre la position de négociation du Japon et sa politique intérieure témoigne d’une érosion dangereuse des normes de crise qui menace à la fois les relations commerciales bilatérales et les principes du capitalisme de marché et de la démocratie.
Le 22 juillet, le président américain Donald Trump a annoncé un accord commercial « massif » avec le Japon qui engageait Tokyo à ouvrir son marché aux produits agricoles, y compris le riz. Pourtant, alors même que ces négociations étaient en cours, Koizumi avait déjà abandonné les mécanismes du marché concurrentiel.
Plus précisément, il a mis en œuvre des contrats discrétionnaires pour vendre le riz stocké par le gouvernement à des prix prédéterminés d’environ 2 000 yens (13,60 dollars) le sac de 5 kilogrammes.
À court terme, le gouvernement japonais a obtenu des résultats remarquables. Le riz stocké au prix d’environ 2 000 yens les cinq kilogrammes est arrivé sur le marché pour la première fois le 31 mai 2025, les ventes à grande échelle commençant le 1er juin.
Cela s’est fait à un rythme exceptionnel, ne prenant que 5 à 6 jours entre l’annonce du contrat discrétionnaire le 26 mai 2025 et la disponibilité réelle au détail. Cependant, dans une perspective à plus long terme, la politique de Koizumi représente un revers important.
Koizumi a justifié l’intervention en disant que, parce que la situation du riz au Japon était en crise, il était impératif pour le Japon de mener une intervention gouvernementale immédiate.
En effet, les prix du riz ont bondi de plus de 98 % d’une année sur l’autre, mais cette hausse représente une fluctuation normale du marché et ne constitue guère le type de véritable urgence qui justifierait un contrôle direct des prix par le gouvernement dans une économie capitaliste libérale.
L’aspect le plus troublant de cette politique est qu’elle crée un précédent pour la future gestion de crise réelle.
Face à la pression publique exigeant que le gouvernement agisse face à la flambée des prix du riz et au défi de gouverner en tant que parti minoritaire, le gouvernement dirigé par le Parti libéral-démocrate (PLD) a ignoré les mécanismes du marché et est intervenu directement dans la fixation des prix, signalant que l’opportunisme politique l’emporte sur la rationalité économique.
Si des hausses de prix rapides justifient une intervention gouvernementale d’urgence, pratiquement toute volatilité du marché pourrait théoriquement déclencher un contrôle des prix par l’État. On peut s’attendre à ce que les bureaucrates qui suivent des approches fondées sur des précédents utilisent et appliquent ce précédent à l’avenir.
Les vraies crises impliqueraient l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement à la suite de catastrophes naturelles, de conflits militaires et autres. Les prix du riz au Japon sont restés dans les limites de la volatilité habituelle du marché et n’ont jamais atteint un niveau de crise. Ce que Koizumi a fait, c’est une redéfinition du concept de « crise ».
Le concept de « crise » est dépourvu de normes ou de critères objectifs, ce qui permet aux politiciens de la définir librement et arbitrairement en fonction de leurs jugements subjectifs et politiques.
Non seulement cette approche ne résout pas les problèmes sous-jacents, mais elle crée également des attentes selon lesquelles le gouvernement interviendra chaque fois que les résultats du marché s’avéreront impopulaires.
Ce changement de politique met en évidence une contradiction dans l’approche du Japon en matière de libéralisation du commerce. D’une part, le Japon promet l’accès au marché des États-Unis pour maintenir un système économique capitaliste libéral. D’autre part, le Japon viole les mécanismes du marché chez lui.
Cette contradiction reflète les circonstances politiques uniques du Japon. Bien que l’agriculture représente environ 1 % du produit intérieur brut (PIB) du Japon, les régions agricoles ont une forte influence politique.
Cela s’explique par l’avantage unique du système électoral où les votes ruraux ont plus de poids que les votes urbains en raison des disparités de valeur des votes, et par le pouvoir politique disproportionné du Groupe des coopératives agricoles du Japon, bien qu’il représente un secteur économique en déclin.
Cette dynamique se traduit par des politiques faussées qui mettent davantage l’accent sur les calculs électoraux que sur l’efficacité économique.
La décision de M. Koizumi pourrait également saper le rôle de leadership du Japon dans les relations internationales, en particulier dans la défense du maintien d’un régime de libre-échange centré sur l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et des accords similaires.
Le Japon peut-il légitimement critiquer les États-Unis pour leurs tendances protectionnistes croissantes ou la Chine pour ses politiques économiques dirigées par l’État alors que le Japon lui-même met en œuvre sa propre forme de fixation centralisée des prix ?
L’immaturité politique de Koizumi a sacrifié les avantages à long terme pour des gains à court terme. En effet, les reportages télévisés ont montré les masses se réjouissant sans réserve, disant : « Nous sommes heureux que les prix du riz aient baissé. »
La communauté internationale devrait considérer la politique japonaise de fixation des prix du riz non pas comme une question agricole isolée, mais comme un défi préoccupant aux principes du marché au sein de la communauté des démocraties développées.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a connu une croissance rapide et un développement économique remarquable sous un système capitaliste démocratique. Le gouvernement a traditionnellement ajusté les prix du riz par le biais de mécanismes d’incitation indirects, tels que des politiques de réduction de la production de riz.
Cependant, nous vivons aujourd’hui à une époque où un ministre annonce publiquement que le gouvernement pourra acheter du riz à environ 2 000 yens les cinq kilogrammes avant même qu’il n’atteigne le marché.
Le président Trump, qui a publié une série de décrets et mis en œuvre des politiques tout en contournant les procédures du Congrès, et le ministre Koizumi, qui a libéré les stocks de riz du gouvernement par le biais de contrats discrétionnaires et fixé les prix sans l’approbation préalable de la Diète ni contrôle législatif, sont taillés dans la même étoffe dans leur mépris des processus démocratiques.
Les enjeux pour le Japon vont bien au-delà de la politique agricole. À une époque de montée du nationalisme économique et du scepticisme quant aux avantages du commerce international libéral, le retrait du Japon des principes du marché lorsque cela est politiquement opportun envoie précisément le mauvais signal sur la durabilité de l’ordre économique mondial.
Yoneyuki Sugita est titulaire d’un doctorat en histoire diplomatique des États-Unis et a précédemment occupé les postes de directeur exécutif des relations stratégiques à l’Université Temple du Japon, de conseiller principal en politique commerciale à l’ambassade du Royaume-Uni à Tokyo et de professeur à l’Université d’Osaka.
Views: 74