Cet été, nous tenterons de vous faire voyager hors de « l’information » dont nous allons commencer par vous dire le plus grand mal. Puisque Histoire et societe vous offre en matière apéritive un chapitre d’un petit fascicule de 122 pages (avec de larges marges) intitulé « la crise dans le récit » qui est une méditation à partir de Walter Benjamin. Il serait fructueux de le lire en même temps qu’un échange violent autour de l’image intitulé Politique de l’image, la politique de l’image : trois auteurs s’écharpent autour de « la complaisance esthétique » de l’image et du dévoiement de sa force politique ou au contraire du respect de sa dialectique, de son inachèvement, là encore il y a Walter Benjamin et sa dialectique de l’image. En fait, comme souvent, ce choix de lecture a été inspiré par un constat assez désespérant sur les complicités dont jouissent les impérialistes, y compris dans notre inertie, l’oubli. Une nouvelle chassant l’autre, la réduction du champ des préoccupations par une pseudo familiarité, le dérisoire des indignations. Le fait que l’on ne lit plus de livres, que ce refus de lire participe même de l’ultime référence de classe, se flatter de ne pas lire cela devient bizarrement l’ultime manière de ne plus se laisser avoir, comme de refuser les vaccins… de la bataille du livre d’Aragon aux Gilets jaunes pendant que les « cultivés » se racontent, se regardent et se plaignent de disparaitre… Alors qu’il faudrait se battre… Nous allons cet été exiger de quelques-un de nos lecteurs ce qu’internet « interdit », fragmente, à savoir l’écoute attentive dans laquelle on s’oublie pour accéder enfin à la pensée d’un autre ….à des lectures qui en appellent d’autres pour éclairer non pas la répétition mais la nouveauté de l’Histoire.
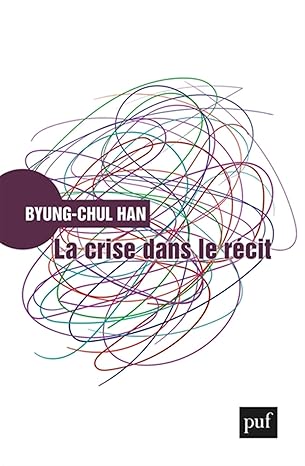
L’actualité va-t-elle enfin nous laisser le temps estival de lectures, de « mises à distance », qui nous aident à penser le temps ou plutôt les temps de ce basculement historique ? Le propre de la période ne serait-il pas justement d’empêcher cette mise à distance ? Alors que le mode « informationnel » dans lequel nous sommes pris, n’engendre qu’une excitation, une manière de feindre la disponibilité qui nous frappe d’inertie ? RAS, rien à signaler, il ne s’est rien passé, une révélation succède à une autre pour des sujets oublieux contraints à notre incapacité d’écoute et d’entendement. Il est paru des livres, dont nous allons tenter de rendre compte, qui nous interpellent sur cet enlisement .
Nous commencerons par vous offrir un chapitre d’un petit fascicule de 122 pages (avec de larges marges) intitulé « la crise dans le récit » (1). Il serait fructueux de le lire en même temps qu’un échange violent autour de l’image : trois auteurs qui s’écharpent autour de « la complaisance esthétique » de l’image et de sa force politique ou au contraire du respect de sa dialectique, de son inachèvement (2). Parce qu’il y a derrière la représentation et son impact politique toujours ce que Walter Benjamin définit comme l’aura, que l’on pourrait réduire au mot authenticité. C’est proche de « vérité » mais l’aura porte la puissance de l’animisme, quand l’intensité du regard, de l’attente, de l’ouverture a transféré dans les choses la puissance de l’être, du vivant, du collectif, de sa force. En quoi alors le besoin de raconter des histoires, de s’ouvrir sur l’inconnu de l’espèce, sa magie devient récit et en quoi le socialisme restitue-t-il la dynamique historique dont le capitalisme a privé le monde, en quoi le matérialisme dialectique et historique est-il plus que le « réalisme », le matérialisme ordinaire ? En quoi, en partant de la nécessité, de la terre, des luttes, de l’acquis matérialiste, retrouve-t-il l’équivalent de cet enchantement, de ce panthéisme merveilleux dont l’individualisme et les eaux glacées du calcul égoïste ont privé l’espèce humaine ? en quoi le nouveau rapport à la nature, aux sciences et aux techniques, le nouvel ordre international, la poussée des peuples peut-elle aller vers l' »aura » non comme un rêve ou un cauchemar mais dans un concret de luttes et d’actes ?
« l’idéalisme, dans sa pratique, n’est rien d’autre que la tromperie sans scrupule et sans réflexion d’un matérialisme… écœurant. » – Karl Marx
Reprenons le résumé de quatrième de couverture de l’opuscule de Byung-Chul Han, La crise dans le récit :
Parmi les besoins essentiels de l’homme, il y a celui de se raconter des histoires. Le récit permet de donner du sens à notre existence et crée du lien social. Or, la saturation actuelle de mots et d’informations a corrompu sa nature en le transformant en un objet mercantile, entraînant notre époque dans une véritable crise narrative. Si le récit s’adresse à la communauté, le storytelling que nous subissons aujourd’hui s’adresse aux consommateurs. L’auteur dénonce dans ce texte stimulant et incisif les maux de l’ère post-narrative, et nous invite à renouer avec le sens du récit.
Ce qui est proposé selon l’invite de Walter benjamin est un retour à l’aura, comme non seulement « vérité » mais guérison, création d’un collectif, en évoquant la communauté des poètes… celle d’Holderlin, Novalis mais aussi on pense à Aragon…
Cependant, nous n’en sommes pas là : la réalité est non seulement le fait que plus grand monde ne lit les poètes, mais cette invite celle de Byung-Chul Han reste celle d’un petit nombre et jouit du « secret » de son message. La situation demeure le fruit de l’échec du socialisme, autant que celui de l’élitisme capitaliste, l’ignorance et même le mépris, l’hostilité à ce qui nait y compris ce monde multipolaire, cette recherche des pays du Sud, les contradictions et la dynamique réelle. Tout se passe comme si l’on se résignait à pouvoir s’approprier intellectuellement cette jouissance, tel Ulysse qui attaché à son mat et ses marins les oreilles bouchées peut jouir du chant des sirènes, du mythe retrouvée puisque ceux qui font, eux en sont privés. L’intellectuel continue selon la dialectique de la raison à être le « sujet » occidental, l’entrepreneur dont le modèle est Ulysse affrontant et défiant l’univers mythique.

La Dialectique de la Raison (Dialektik der Aufklärung), est la référence incontournable de ces périodiques retour vers l’histoire, c’est un essai de philosophie de Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, publié en 1944 en exil à New York et en 1947 en Europe, mais qui était en gestation depuis 1920, face à la montée du nazisme. C’est l’ Œuvre la plus emblématique non seulement des deux auteurs mais de la Théorie critique de l’École de Francfort. L’interrogation de cette école porte sur le projet des Lumières (en allemand : Aufklärung), avec ce qui est aussi au cœur du matérialisme dialectique et historique à savoir donner à l’action et la connaissance de l’humanité la force libératrice de la science. Mais alors que le développement scientifique et technique de la modernité occidentale capitaliste crée les conditions de cette émancipation, le mouvement se transforme en son contraire et rejoint le mythe et la barbarie nazie avec ses oripeaux de pacotille. Cet obscurantisme dont la science prétendait émanciper l’humanité en marche vers sa libération, veut que le mouvement régresse jusqu’à la pire des aliénations cognitives, celle qui conduit le genre humain à sa fin.
Ce que nous avons posé en ouverture de notre livre « Quand la France s’éveillera à la Chine, la longue marche vers un monde multipolaire », c’est une démarche historique qui revendique le projet des Lumières. Ce n’est pas un hasard si dans son premier chapitre notre livre s’ouvre sur des textes peu connus de Marx évoquant le déplacement du centre de gravité vers le Pacifique, entre les USA et la Chine, et dans lequel la Chine selon Marx reviendra comme un boomerang vers l’Europe, vers le capitalisme britannique, celui de la guerre de l’opium en revendiquant sa dynamique hégélienne et la promesse de la Révolution française Égalité, liberté et fraternité. Nous sommes allés plus loin encore dans les chapitres suivant en inscrivant le matérialisme historique en lien avec la dialectique hégélienne dans le mythe de la marche du prolétaire. Le mythe et la raison ne sont pas des réalités opposées, ils ont la même origine, mais la raison en se déshumanisant à travers le capitalisme arrive à son contraire : l’irrationnel de la destruction. Il faut aussi partir de cette destruction des illusions théologiques de la révélation, de la théologie et retrouver ce qui faisait la force du mythe, la manière dont était arrachée par Prométhée la puissance du savoir pour devenir le bien des hommes. On ne doit pas renoncer à la raison. « Le mythe lui-même est déjà Raison mais la Raison se retourne en mythologie » dit la dialectique de la raison et l’on doit reprendre cette marche de l’émancipation humaine comme une lutte concrète et collective.
Le retour de la philosophie, de l’éthique, de l’esthétique reprend un questionnement qui va des années 1920 à 1944, et connaît aussi un prolongement dans les années soixante quand la poussée révolutionnaire va se perdre dans sa parodie soixante-huitarde et le Vietnam dans les pleurnicheries des boat people, de la Nouvelle philosophie, un dévoiement autant qu’une aspiration.
Notez que l’Histoire, la science théorico-pratique du matérialisme historique, revendique son origine dans le récit et nous verrons que Byung-Chul Han qui suit « la trace » de Walter Benjamin reprend la manière dont ce dernier place le père de l’histoire Hérodote au rang des grands maitres du récit. Ce qu’il faut donc souligner c’est que cette invite actuelle et à chaque crise de l’impérialisme à un retour à la démarche historique s’opère en majorité soit par la publication de textes anciens, soit la référence à eux. Il reste et le champ est immense à ouvrir le dialogue autour de « l’expérience » et c’est là l’autre mot clé. De quelle expérience s’agit-il ? En quoi « l’information » est-elle un obstacle à cette « expérience » ?
Faut-il attribuer cette mise en mouvement à l’inquiétude des couches moyennes urbaines et périurbaines devant le bouleversement annoncé de leur propre statut ? c’est un autre sujet, le fait est que quelques voix s »élèvent pour dénoncer la forfaiture qu’a été la désindustrialisation française… Mais nous y reviendrons. Contentons-nous de noter ce retour à une problématique qui est à la recherche de la rationalité, ne la voit plus dans l’immobilisme de la fin de l’histoire mais insiste aussi sur les apories du progrès, de la raison avec l’accusation de sa nature capitaliste certes mais sans aller jusqu’au socialisme… lui-même frappé de « barbarie »… il y a là aussi en filigrane une interrogation sur l’Europe, le continent des droits de l’homme qui se retourne en son contraire, nie les promesses qu’elle proclame.
L’interpellation retrouvée de l’école de Francfort dans un temps que chacun s’accorde pour dire être celui d’un basculement de civilisation, centre le débat : pourquoi le rapport à la nature scientifique et technique, la libération humaine paraît-elle nous conduire à la barbarie ?
« l’information » si l’on en croît Walter Benjamin est la forme de communication qui émerge du capitalisme, elle nie toute forme épique. Pourtant elle se nourrit des champs de bataille, le commerce sous une autre forme… le 20 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild accomplit un « coup de bourse » remarquable. Informé de la défaite napoléonienne bien avant les autorités, il se rend à la Bourse de Londres et met en vente tous ses titres. Tous pensent alors que Napoléon est sorti victorieux du combat et chacun, gagné par la panique, suit l’exemple de Rothschild. Les actions chutent à une vitesse folle. Rothschild attend la dernière minute puis les rachète et assoit ainsi la fortune familiale. Cette alliance entre la presse, la bourgeoisie accédant au capitalisme puis à l’impérialisme derrière les Britanniques, et laissant à l’écrivain les miettes du feuilleton, à fourni son matériau au Chef d’œuvre de Balzac, du Père Goriot à Splendeur et misère des courtisanes en passant par les Illusions perdues. Lukacs et André Wurmser ont dit cela. C’est ce à quoi également fait référence Benjamin quand il décrit la forme bourgeoise par excellence, celle du bourgeois possédant la presse pour suivre ses intérêts sur un mode planétaire initiée par l’épopée napoléonienne et son échec devant Moscou qui lui voit naitre Guerre et paix (3).
(1) Byung- Chul Han, La crise dans le récit. puf.traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, mars 2025
(2) Georges Didi-Huberman, Enzo Traverso et Guillaume Blanc – Marianne. Images de la politique, Politique des images, un débat. éditions EHSS . 2025
(3) Ce n’est pas seulement de cet affrontement franco-russe que nait l’œuvre de Tolstoï. Tourgueniev attribuera avec une violente émotion la naissance de l’épique russe à l’un des premiers textes de Tolstoï : Les Récits de Sébastopol (1855-1856), un recueil de trois nouvelles écrites par Léon Tolstoï pour raconter ses expériences lors du siège de Sébastopol (1854) pendant la guerre de Crimée. La guerre de Crimée oppose de 1853 à 1856 l’Empire russe à une coalition formée de l’Empire ottoman, de l’Empire français, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne. Le conflit se déroule essentiellement en Crimée autour de la base navale de Sébastopol. Il s’achève par la défaite de la Russie, entérinée par le traité de Paris de 1856. C’est la naissance d’un écrivain qui conserve la force du récit et qui 15 ans après écrira Guerre et paix. Il y a dans ces nouvelles, dans la descriptions de l’orient et de la Russie inextricablement mêlés dans cette péninsule la perception de choses qui encore aujourd’hui nous renseignent plus que tous les bulletins de guerre ou « explications » sur ce qui se joue entre la France et la Russie.
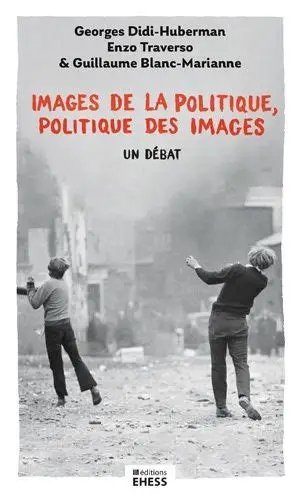
L’information, Trump, la crise du capitalisme sans issue socialiste…
Notre livre (3), envoyé à l’imprimerie fin décembre 2024, avant le retour au pouvoir de Trump dit à quel point rien de ses actions ne nous a surpris. Nous n’avons pas eu besoin d’actualiser notre analyse : la continuité, celle d’un système, en était le fond sous l’apparente brutalité mercantiliste. Trump était le syndic de faillite dudit système qui avait vu se succéder Obama, Biden. C’est pourquoi nous faisions cette proposition politique : la France avait le plus grand intérêt à s’émanciper de cette « coalition » atlantiste pour rejoindre le monde multipolaire, ce qui pouvait prendre la forme d’une adhésion aux BRICS. Mais il n’y avait là qu’une pièce d’un dispositif plus complexe, le fond étant la proposition chinoise : « Vous devez tous choisir ou la « communauté du destin planétaire » ou la servitude…
La proposition fondamentale émanait de la Chine dirigée par parti communiste. parce que ce qui se réalisait, « l’expérience » pas le modèle, l’expérience, le concret crédibilisait l’invite… Aujourd’hui, ce monde multipolaire est multiforme, il a déjà bouleversé toutes les institutions existantes et en a créé d’autres, il se présente comme une alternative qui accorde aux pays du Sud, aux nations émergentes et à celles qui sont dans leur orbite de développement, une juste place. Ce n’est pas a priori un système hostile à celui de l’occident hégémonique, mais la manière dont ce dernier se débat pousse vers une alternative politique…
Depuis janvier, et l’entrée en fonction de Trump, « les informations » sensationnelles se sont succédées, mais l’une a paru chasser l’autre en particulier aux Etats-Unis dont nos médias se font le plus souvent le simple écho en forçant le trait en caricature, la vague emportait et rien ne se créait. Nous sommes bien dans ce mode informationnel, cette nouvelle forme de communication et ses implications sur le politique. Byung-Chul Han explique dans le texte ci-dessous à propos d’internet et des autres formes de « communication » que ce qu’envisageait Walter Benjamin s’est réalisé pour une part mais qu’il ne pouvait pas prévoir internet et le numérique. L’incapacité à approfondir, à écouter, le désenchantement contre lequel nous avaient mis en garde l’École de Francfort et Walter Benjamin avait encore évolué non pas dans le sens de l’interdit mais de celui d’un bavardage généralisé. En lien avec le néolibéralisme s’établit un régime d’information qui n’emploie pas la répression, mais la séduction. Il prend une forme smart. Il n’opère pas par commandement ou interdiction. Il ne nous impose pas le silence. Cette domination smart nous invite au contraire en permanence à communiquer nos opinions, nos besoins, nos préférences, à raconter notre vie, à poster, à télécharger et à liker. Ici la liberté n’est pas réprimée, mais totalement exploitée.
Ce constat fait songer à celui de Michel Clouscard dans Le capitalisme de la séduction. Nous reviendrons ultérieurement sur tout le travail d’Aymeric Monville dans de nombreux livres des éditions DELGA autour de cet auteur et la critique opérée à partir de la « séduction » que le capital réservait à la petite bourgeoisie tandis que les prolétaires subissaient la répression ; le néolibéralisme ce n’était pas « la séduction » c’était Pinochet la torture, la manière d’imposer des plans d’ajustement structurel et chez nous les ouvriers massivement licenciés.
Même l’émancipation féminine est apparue à ceux qui étaient « exclus » comme la possibilité pour les femelles de choisir à leur gré le mâle dominant, tandis que les autres étaient voués à l’abstinence… Trump est bien la révélation ultime et la caricature de ce que dans une société inégalitaire, toujours plus inégalitaire le libertaire était devenu son contraire. La séduction devient le viol parce qu’elles sont censés aimer ça… il est viol de l’histoire au point d’ignorer ce qu’est le Liberia dont on convoque le président…
Le 17 juillet, le Wall Street Journal a rapporté qu’en 2003, Trump aurait inscrit un message « paillard » sur un album pour le cinquantième anniversaire d’Epstein. (« Un copain, c’est une chose merveilleuse. Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un autre merveilleux secret »). Trump a nié avoir écrit le message et s’est engagé à poursuivre le journal. La manière dont le « Président » a surréagi alors qu’il n’est accusé de rien personnellement simplement d’avoir des services qui ont bloqué les « révélations » est déjà incompréhensible rationnellement. Il y aurait là ce qui peut abattre le monstre fabriqué de toutes pièces, cette caricature de la puissance réduite à des attributs codés, le mâle blanc, l’occident, celui qui n’a aucune limite autre que ce que lui autorise sa suprématie sur les faibles, c’est l’affirmation de l’impérialisme comme un fascisme. La presse crie victoire sur le fait que le fantôme de Jeffrey Epstein a pu achever Trump. Pour la première fois, la base Maga n’achète pas ce que Trump vend. En d’autres termes, quelqu’un qui est décédé il y a six ans pose le problème existentiel de ce pouvoir ? Les fantômes ne cessent de hanter le présent comme celui de Staline mort en 1953 empêcherait toujours la crédibilité du socialisme…

Est-ce que pour la première fois, la base n’achèterait pas ce que Donald Trump leur vend ? Un fantôme des turpitudes de l’Etablissement décédé depuis six ans, réduit à un monde familier, celui de l’orgie fantasmée ? voilà qui conviendrait aux guerres de « l’information ». Faut-il craindre que pour se débarrasser de cet épisode, le maitre du monde soit contraint d’aller au delà de ce qu’une méga bombe puisse faire sur un site supposé nucléaire iranien ? telle se pose la succession d’évènements et leur interprétation. Trump répond en frappant à la caisse, il lance une poursuite judiciaire, qui réclame au moins 10 milliards de dollars de dommages et intérêts et un procès devant jury, il nomme la société mère du Journal, News Corp. ; son éditeur, Dow Jones ; deux reporters pour le journal ; le propriétaire de News Corp., Rupert Murdoch, et le directeur général, Robert Thomson, en tant que défendeurs, a rapporté NBC News. Il est évident que ce respectable organe de presse est caractéristique de ce qui se fait de pire en matière de tabloïd et de fausses informations, le nom de Rupert Murdoch est à lui seul un programme et ce qu’il est arrivé à diffuser de grotesques mensonges sur la Corée du nord en témoigne.
Revenons-en au petit fascicule de ce philosophe sud-Coréen, Byung-Chul Han et la manière dont il reprend et poursuit la réflexion de Walter Benjamin sur ce que représente l’information et qui va au-delà du mensonge.
Nous ne sommes plus dans le temps où il y a eu les diverses résurrections de l’esthétique dénonciation du capitalisme en tentant d’éviter l’engagement socialiste… Ni quand Hitler prend le pouvoir et jouit d’une force active, pugnace qui rêve de la suprématie européenne, mais dans une Europe qui s’enfonce dans l’insignifiance. Nous ne sommes plus dans les arrangements désillusionnés qui ont de fait accepté de constituer une Europe sans âme avec la garantie de la protection US, celle-ci lui est refusée, l’Impérialisme ne peut plus se payer le luxe du sentiment nostalgique. Que peut cette France, cette Europe sans héros et avec un peuple qui ne veut surtout pas se battre ni contre la Russie, ni contre ce qui l’oppresse ?
Qu’il y ait un système de propagande décrit entre autres par Chomsky, pour entretenir les fables, les imposer comme des vérités, mais quand la démystification va jusqu’à la colère et engendre des Trump, essence supposée du refus Maga, comment est-il encore possible de nous transformer en complices aliénés de notre refus d’une perspective révolutionnaire. Pas seulement la haine de l’Etablissement, la dénonciation vague du capitalisme, mais le refus d’une perspective ? On sent bien que la solution serait la Révolution mais elle n’est pas plus à l’ordre du jour en France, dans l’UE, qu’aux Etats-Unis ou un Japon et ce peuple divisé est prêt une fois de plus au fascisme. Quel est alors le statut de ceux qui une fois de plus s’accommodent en se lamentant tout en mesurant que rien ne peut rester en état.
Ce sont des chemins à explorer qui souvent construisent de fausses évidences sur le monde « informationnel » ou le pire est celui qui veut que quand on SAIT, quand se révèle la nocivité, la non légitimité de ce qui nous domine, cela ne change rien… RAS, rien à signaler, passez votre chemin… l’oubli et de fait la complicité est là… Aujourd’hui posons le jalon de chapitre que ce philosophe sud Coréen installé en Allemagne, un intellectuel secret, Byung-Chul Han, dans un petit opuscule intitulé « du récit à l’information »(1) nous confronte à ce rétrécissement de la perspective qui est peut-être le destin actuel auquel on peut aspirer pour accorder du répit à ceux qui ailleurs endiguent la bête immonde en son nom et celle de l’humanité.
3) Danielle Bleitrach, Marianne Dunlop, Jean Jullien, Franck Marsal, préface de Fabien Roussel, Quand la France s’éveillera à la Chine, la longue marche vers un monde multipolaire. Delga. avril 2025
Du récit à l’information (pp. 17 à 28)
Hyppolite de Villemessant, le fondateur du Figaro, résume l’essence de l’information en une formule: « pour mes lecteurs, l’incendie d’une charpente dans le Quartier latin est plus important qu’une révolution à Madrid 1 ». Pour Walter Benjamin, cette remarque fait comprendre d’un seul coup que « désormais, on écoute moins la nouvelle qui vient de loin que l’information qui fournit un point d’appui pour saisir ce qu’il y a de plus proche2 ». L’attention du lecteur de journaux ne dépasse pas ce qui est sa proximité immédiate. Elle se rétracte pour devenir une curiosité. Le lecteur de journaux modernes bondit d’une nouveauté à une autre au lieu de laisser son regard glisser vers le lointain et s’y attarder. Le regard long, lent, qui s’attarde lui échappe.
La nouvelle que contient toujours une histoire présente toujours une autre structure spatiale et temporelle que l’information. Elle vient « de loin ». Le lointain est son trait essentiel. Le démantèlement progressif du lointain est une caractéristique de la modernité. Le lointain disparaît au profit de l’absence de distance. L’information est un phénomène intrinsèque de l’absence de distance qui rend tout disponible. La Nouvelle en revanche se distingue par un lointain indisponible. Elle proclame un événement historique qui se dérobe à la disponibilité et à la prévisibilité. nous lui sommes livrés comme à un pouvoir fatidique.
L’information ne survit pas à l’instant de sa prise de connaissance: « l’information tire sa récompense de l’instant où elle est neuve. Elle ne veut que cet instant où elle est neuve. elle ne veut que de cet instant, elle doit se livrer à lui entièrement et s’expliquer à lui sans perdre le moindre temps 3. » Contrairement à l’information, la nouvelle que l’on annonce possède une ampleur temporelle qui la met en relation, au delà de l’instant avec ce qui arrive. Elle est porteuse d’Histoire. Elle a de manière intrinsèque une fréquence vibratoire narrative.
L’information est le média du reporter qui ratisse le monde pour trouver des nouveautés. Le narrateur est son personnage antinomique. Ce dernier n’informe pas, n’explique pas. L’art de la narration commande littéralement de faire de la rétention des informations: « La moitié de l’art de raconter consiste en effet à garder une histoire vierge d’explication lors de sa restitution 4. »L’information retenue, c’est-à-dire l’explication manquante augmente la tension narrative.
L’absence de distance détruit aussi bien la proximité que le lointain. L’absence de distance n’est pas identique à la proximité, car l’éloignement est inscrit en elle. Proximité et lointain se conditionnent et s’animent mutuellement. C’est précisément cette interaction de proximité et de distance qui produit l’aura: « la trace est l’apparition d’une proximité quelque lointain que puisse être ce qui l’évoque. L’aura est l’apparition d’un lointain, quelque proche puisse être ce qui l’évoque5. » L’aura est narrative car elle est enceinte du lointain. L’information, en revanche, désauratise et désenchante le monde en abolissant la distance. Elle pose le monde. Elle se rend par là même disponible . La « trace » qui désigne le lointain car elle est aussi riche en allusions et déclenche la tentation du récit.
La crise narrative de la modernité est due au fait que le monde est infondé d’informations. L’esprit du récit se noie sous leur flot. Benjamin constate : « Si l’art de raconter est devenu plus rare, la diffusion de l’information a contribué de façon décisive à cet état de choses6. » Les informations refoulent des données qui ne sont pas explicables, mais seulement racontables. Il n’est pas rare que les récits aient des marges faites de choses qui émerveillent et sont énigmatiques. Ils ne sont pas compatibles avec les informations, qui sont les contre-figures du secret. Explication et récit s’excluent mutuellement : » Chaque matin nous rapporte les nouvelles du globe. Et pourtant, nous sommes pauvres et nos histoires remarquables. Il en est ainsi parce qu’aucun événement ne nous parvient qui n’ait été truffé d’explications. En d’autres termes: plus rien de ce qui se produira ne servira le récit ; bientôt tout sera au profit de l’information7. »
Benjamin élève Hérodote au rang de maître ancien du récit. Pour illustrer son art narratif, il fait appel à l’histoire de Psammétique. Quand le roi égyptien Psammétique fut capturé après sa défaite face au roi perse Cambyse, celui-ci humilia le roi égyptien en le forçant à assister au triomphe des Perses. Il fit en sorte que Psammétique voie sa fille capturée et devenue servante défiler devant lui. Alors que tous les Égyptiens qui se trouvaient au bord du parcours s’en plaignaient, Psammétique resta immobile et muet, le regard rivé au sol. Quand il vit peu après son fils qu’on emmenait dans le cortège pour l’exécuter, il resta encore impassible. Mais quand il reconnut parmi les prisonniers son serviteur, un vieil homme sénile, il se frappa la tête avec les mains et montra sa profonde tristesse. Dans cette histoire racontée par Hérodote, Benjamin croit pouvoir discerner ce qui constitue le vrai récit. C’est l’idée que toutes les tentatives d’expliquer pourquoi le roi égyptien ne se lamente qu’à la vue de son serviteur détruisent la tension narrative. L’omission de l’explication est justement, à ses yeux essentielle au vrai récit. Le récit renonce à toute explication: « Hérodote n’explique rien. Sa relation est extrêmement sèche. C’est pourquoi cette histoire de l’Égypte ancienne est encore capable, après plusieurs milliers d’années, de provoquer l’étonnement et la réflexion. Elle ressemble aux semences restées enfermées pendant des milliers d’années dans des chambres hermétiques des pyramides et qui ont conservé leur puissance de germination jusqu’à ce jour 8. »
Le récit, selon Benjamin, « ne se dépense pas entièrement ». Il « conserve la force accumulée en lui et est capable de la laisser déployer longtemps après ». Les informations ont une tout autre temporalité. Leur faible écart avec l’actualité les épuise très rapidement. Elles n’agissent qu’un instant. Elles ne sont pas l’équivalent de graines dotées d’une force germinale immortelle mais des grains de poussière. Elles sont totalement dépourvues de force germinale. une fois qu’on en a pris connaissance, elles plongent dans l’insignifiance comme des messages que l’on vient d’écouter sur un répondeur téléphonique.
Le tout premier signe du déclin du récit est aux yeux de Benjamin l’émergence du roman au début des Temps modernes. Le récit se nourrit de l’expérience et la transmet à la génération suivante: « Le conteur tire ce qu’il raconte de l’expérience, de la sienne propre et de celle qui lui a été racontée. Et il en fait à nouveau une expérience pour ceux qui écoutent ses histoires 9. » Sa richesse d’expérience et de sagesse lui permet de conseiller le vivant. Le roman, en revanche, annonce la « profonde perplexité de celui qui vit 10. »Alors que le récit est créateur de communauté, la salle d’accouchement du roman est l’individu dans sa solitude et son isolement. Contrairement au roman, qui psychologise et se livre à des interprétations, le récit procède de manière descriptive: « l’extraordinaire, le merveilleux, est raconté avec la plus grande précision, en revanche, le cadre psychologique de l’événement n’est pas imposé au lecteur 11. » Ce n’est cependant pas le roman, mais l’apparition de l’information dans le capitalisme qui met un terme au récit : »Par ailleurs, nous pouvons observer comment, avec la domination progressive de la bourgeoisie – dont la presse est l’un des instruments les plus importants à l’âge du capitalisme avancé -, une forme de communication émerge, qui, aussi loin que puisse remonter son origine, n’a jamais été influencée de façon déterminée par la forme épique. Mais maintenant que son influence s’exerce, il apparait qu’elle n’est pas moins étrangère que le roman, mais qu’elle s’oppose à lui de façon bien plus menaçante […]. Cette nouvelle forme de communication, c’est l’information 12. »
Le récit a besoin d’un état de détente. Benjamin élève l’ennui au rang d’apogée de la détente intellectuelle. Il est l’oiseau de rêve qui couve l’œuf de l’expérience », une étoffe grise et chaude, garnie à l’intérieur d’une doublure de soie aux couleurs chatoyantes. » et dans lequel » nous nous roulons[…] quand nous rêvons 13. » Mais il se trouve que le bruit de l’information, « le bruissement des feuilles de la forêt » , chasse l’oiseau de rêve. Dans la forêt de feuillus, on » ne file et l’on ne tisse plus ». On ne produit et on ne consomme que des informations comme stimuli.
Narration et écoute se conditionnent mutuellement. La communauté du récit est une communauté de ceux qui écoutent. L’écoute implique une attention particulière. Celui qui écoute attentivement est oublieux de soi, plus ce qu’il écoute s’imprime profondément en lui 14. » Nous nous départissons de plus en plus du don de l’écoute. Nous nous produisons, nous nous écoutons au lieu de nous adonner, oublieux de nous mêmes, à l’écoute.
Sur internet, cette forêt de feuillus numérique, on ne trouve plus de nids de l’oiseau du rêve. Les chasseurs d’information l’ effarouchent. Dans l’hyperactivité actuelle, où l’essentiel est de ne pas laisser pointer l’ennui, nous n’atteignons jamais l’état d’une détente intellectuelle profonde. La société de l’information introduit une époque de haute tension intellectuelle, car l’attrait de la surprise est l’essence de l’information. Le tsunami de l’information fragmente l’attention. Il empêche l’attardement contemplatif qui constitue la narration et l’écoute attentive.
La numérisation met en marche un processus que Benjamin, compte tenu des conditions de son époque, ne pouvait pas prévoir. Il met l’information en relation avec la presse. C’est une nouvelle forme de communication, à côté du récit et du roman. Dans le sillage de la numérisation, l’information atteint un tout autre statut. La réalité prend elle-même la forme d’informations et de données. Elle est informatisée et « dataïsée ». Nous percevons la réalité en premier lieu en y cherchant des informations ou bien par les informations que nous recevons. L’information est une représentation, c’est-à-dire une nouvelle présentation. L’informatisation de la réalité fait que l’expérience immédiate de la présence s’étiole. La numérisation comme informatisation , réduit la réalité.
Un siècle après Benjamin, l’information se développe pour devenir une nouvelle forme d’être mieux, une nouvelle forme de domination. En lien avec le néolibéralisme s’établit un régime d’information qui n’emploie pas la répression, mais la séduction. Il prend une forme smart. Il n’opère pas par commandement ou interdiction ou interdiction. Il ne nous impose pas le silence. Cette domination smart nous invite au contraire en permanence à communiquer nos opinions, nos besoins, nos préférences, à raconter notre vie, à poster, à télécharger et à liker. Ici la liberté n’est pas réprimée, mais totalement exploitée. Elle se transforme en contrôle et pilotage. La domination smart est très efficace dans la mesure où elle n’a pas à apparaître de manière spécifique. Elle se dissimule dans l’apparence de la liberté et de la communication. Tandis que nous postons, téléchargeons et likons, nous nous soumettons au contexte de domination.
Nous sommes actuellement abasourdis par l’ivresse de l’information et de la communication. Or nous ne sommes plus maîtres de la communication. Nous nous exposons au contraire à l’échange accéléré d’informations, qui échappe à notre contrôle conscient. La communication est de plus en plus manipulée de l’extérieur. Elle parait obéir à un processus automatique, mécanique, piloté par des algorithmes, mais dont nous ne sommes pas conscients. Nous sommes livrés à la blackbox algorithmique. Les hommes s’atrophient pour devenir une série de données que l’on peut diriger et exploiter.
En régime d’information, les mots de Georg Büchner s’appliquent encore: « Nous sommes des marionnettes dont des forces inconnues tirent les fils; rien, rien que nous mêmes 15. » La violence n’est que plus subtile et plus invisible, si bien que nous n’en prenons pas conscience. Nous la confondons même avec la liberté. Le film d’animation de marionnettes Anomalia de Duke Johnson et Charlie Kaufman illustre la logique de la domination smart. Il parle d’un monde dans lequel tous les hommes se ressemblent et parlent de la même voix. Ce monde reproduit un enfer néolibéral de l’identique dans lequel paradoxalement, on invoque l’authenticité et la créativité. Le protagoniste, Michel Stone, est un coach de motivation qui a réussi. Il prend un jour conscience qu’il est une marionnette. Sa bouche se détache de son visage. Il la tient dans sa main. Et il est pétrifié par l’effroi, car la bouche tombée continue à bavarder seule.
1-Walter Benjamin, le Conteur, in idem, Expérience et pauvreté, suivi de le Conteur et la tâche du traducteur, trad. C.Cohen Skalli, Paris, Payot,2011 p.65.
2-ibid
3-ibd
4-ibid p.66.
5. Walter Benjamin. Paris, capitale du XIX e siècle/Le livre des passages/ traduction J. Lacoste, Pais, Cerf, 1989. p. ‘464. (note de danielle Bleitrach; la perte de l’aura pour Walter Benjamin c’est la perte de l’authenticité par les techniques de la reproduction moderne)
6.Walter Benjamin, Le conteur, op. cité, p66.
7.ibid
8- ibid, p.69. Benjamin ne restitue pas littéralement l’histoire de Psammétique. L’original diverge sensiblement de son résumé. il reprend manifestement la version de Michel de Montaigne qui la mentionne dans ses Essais.
9-Walter Benjamin, Le Conteur, op. cité.p.62
10-ibid. p.63
11-ibid p.66
12-ibid p.70
13- Walter Benjamin, Paris capitale du XIX e siècle op. cit p.131
14- Walter Benjaminn Le Conteur,op.cit, p.70
15-Georg Büchner, La mort de Danton, 1835. Nous traduisons(NdT)
Views: 19







LA MONTÉE DE L’EXTRÊME DROITE AU JAPON : ICI AUSSI ÉCLAIREUR ET REPOUSSOIR AU SERVICE DE L’IMPÉRIALISME US, par Danielle Bleitrach – Histoire et société
[…] Propositions de lectures et méditations estivales : aujourd’hui Byung-Chul Han, la crise dans le … […]