La conclusion est celle que la Chine a conseillé à l’Inde (et que déjà Marx soulignait comme la grande différence entre la Chine et ladite Inde): si vous voulez bénéficier comme nous des contradictions impérialistes, la seule solution est de vous débarrasser de votre soumission colonialiste (voir vidéo chinoise à la fin qui se moque de ce que Trump propose à sa classe ouvrière). De même que la seule solution pour la classe ouvrière et les exploités du nord est également de se débarrasser de leur identification à leur classe dominante prédatrice. (note et traduction de Danielle Bleitrach)
Jeudi 10 avril 2025
L’économie imaginaire

10 avril 2025 00:01
Au début de l’année 1971, le secrétaire au Trésor des États-Unis, John Connally Jr – ancien gouverneur du Texas, abattu alors qu’il accompagnait John F. Kennedy lors de sa dernière et fatale tournée – a suggéré à Richard Nixon une mesure retentissante pour faire face aux achats massifs d’or par les banques étrangères : découpler la valeur du dollar de son équivalent or. Son argument était élémentaire : « Les étrangers veulent nous baiser ; Notre boulot, c’est de les baiser en premier. Les échos de cette même agressivité résonnent aujourd’hui (comme une cruauté) dans l’authentique massacre tarifaire conçu par Peter Navarro et Howard Lutnick.
Le choc provoqué par Nixon en 1971 a permis à Washington de provoquer la crise pétrolière de 1973-1977 – qui a failli faire tomber l’économie mondiale – d’établir le dollar comme monnaie libre du marché mondial et d’entamer l’ère néolibérale. D’ailleurs, c’est Henry Kissinger qui a dissipé tous les doutes à ce sujet. Il éclaire cela dans son autobiographie, dans le chapitre intitulé « Qui a causé la crise pétrolière ? » Il répond lui-même dans la première phrase : « C’était nous. »
Neil Ferguson, l’historien britannique, a récemment mis en évidence un autre aspect de l’exotisme de l’unicité américaine. Aucun empire dans l’histoire, ni Rome ni Istanbul, ni l’Espagne ni la Hollande, pas même l’Angleterre, n’a réussi à préserver son hégémonie après avoir perdu le contrôle de son déficit budgétaire et s’être engagé dans la voie des balances rouges de sa balance commerciale. Le premier chiffre trahit la domination croissante d’une élite rentière ; la seconde, un effondrement général de la productivité et un abus de force et d’armes. Les États-Unis sont le seul cas qui réfute cet axiome. Pendant 54 ans, depuis 1971, son économie a connu une croissance sans pareille sous l’effet d’un déficit budgétaire croissant (aujourd’hui devenu inupportable) et d’une balance commerciale endémiquement déficitaire.
En retour, grâce à son étonnant système financier, elle disposait d’un privilège indiscutable : les ressources du monde entier – religieusement déposées à Wall Street – pour favoriser et monopoliser l’une des plus grandes révolutions technologiques de l’histoire : la numérisation du monde (et de toutes les parties qui le définissent : la production, la guerre, la communication, l’éducation et même la vie émotionnelle. Dans ce même domaine, le siècle a provoqué – et souffert – quatre crises majeures de dimension mondiale – la crise pétrolière, l’effondrement des valeurs numériques. com, celle des crédits immobiliers en 2008 et celle de la pandémie). Quiconque dit qu’il s’agit d’un système stable parle d’une économie imaginaire. Le mystère est de savoir comment il a réussi à conserver la confiance des investisseurs pendant toutes ces transes.
Au cœur du conflit tarifaire actuel se trouve un sujet dont peu de gens parlent : les profonds changements qui ont transformé le monde de la production et du travail. L’automatisation cybernétique a l’un de ses lointains antécédents dans le fordisme des années 1920. Combiné à la stratégie néolibérale actuelle, il a provoqué un transfert de richesse du travail vers le capital comme jamais auparavant. Le dilemme de Washington n’est pas un déficit manufacturier – comme le claironne sa rhétorique officielle – mais les symptômes croissants d’une dangereuse crise de suraccumulation. D’une part, un niveau de productivité et de technologisation qui échappe à toute limite ; de l’autre, une relative stagnation des salariés, qui échappent à la possibilité de consommer ce qui est produit.
On oublie toujours que dans le capitalisme, ce sont les contradictions de l’abondance (et non de la pénurie) qui causent les pires désastres. Le fordisme – et les années folles – ont été le préambule de la dépression de 1929 ; espérons que l’automatisme numérique – et la fureur productiviste de la Chine – ne conduira pas à une catastrophe similaire.
Pour contourner le bourbier, les États-Unis avaient besoin d’un Roosevelt, pas d’un gangster, comme Trump. C’est-à-dire la réduction de la journée de travail de 40 à 35 heures, une réforme fiscale qui taxe les bénéfices, la couverture maladie universelle et la gratuité de l’enseignement universitaire.
Mais l’histoire n’admet pas d’agendas préétablis. Le néofascisme est-il le stade suprême du néolibéralisme ? La vérité est que la politique tarifaire est un impôt qui punit principalement ceux qui vivent de leur salaire. Aussi les coupes annoncées dans le personnel gouvernemental. Si Wall Street montre aujourd’hui une tendance à la récession, il manque le troisième chapitre de cette situation. Une fois que Peter Navarro annoncera bientôt la réduction des impôts pour les sociétés, et que Trump s’amusera à recevoir des délégations de plus de 50 pays pour renégocier les tarifs douaniers pertinents, la Bourse de New York aura de nouveau le sourire.
Que peut faire la société mexicaine face à ce changement dans l’ordre commercial mondial ? Tout d’abord, se libérer (ou, du moins, remettre en question) les vestiges de leur propre mentalité postcoloniale.
https://www.facebook.com/reel/1399728901473402
vidéo dans laquelle les Chinois se moquent des promesses de Trump aux travailleurs des Etats-Unis…
Views: 5





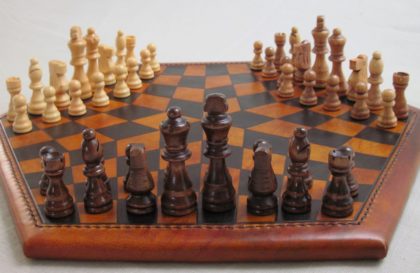

Xuan
« On oublie toujours que dans le capitalisme, ce sont les contradictions de l’abondance (et non de la pénurie) qui causent les pires désastres. » Je n’aurais pas parlé d’abondance mais de surproduction, parce que les « contradictions de l’abondance » signifient que la surproduction est relative et non absolue, de sorte que nous sommes toujours dans des sociétés de pénurie pour l’immense majorité.
Il est remarquable que les géants de la distribution ont supprimé le bio de leurs rayons
https://www.capital.fr/entreprises-marches/leclerc-auchan-carrefour-pourquoi-les-geants-de-la-distribution-lachent-le-bio-1511529
Ce qui veut dire que, y compris dans les pays « riches », la majorité des consommateurs ne peut plus s’offrir ce luxe.
Où l’on voit que la lutte de classe à l’échelle internationale et celle à l’échelle de notre quartier sont étroitement liées.
Tout va très vite maintenant, et les consciences peuvent aussi s’éveiller rapidement.
zorba
Les consommateurs sont aussi revenus des produits « bio », souvent de qualité médiocre et toujours très chers. C’est une réaction plutôt saine face au bourrage de cranes orchestré par la bourgeoisie écolo-européo-climatique. Peu vraisemblable à mon avis que cela traduise une conscience de classe locale ou continentale.