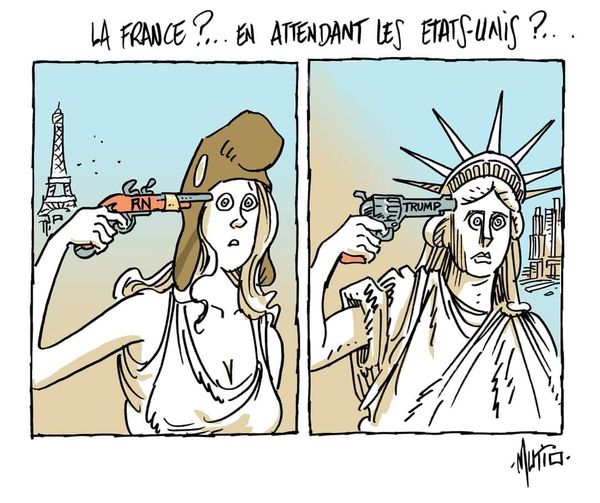Le jour où la France se réveillera à la Chine, ce titre d’un livre collectif se rédigeant plus ou moins dans le cadre de ce blog se veut à la fois une contribution à ce réveil en privilégiant le point de vue militant, à partir de l’évolution du PCF et de tous ceux qui ne se résignent pas au rapport des forces dans la France d’aujourd’hui même si celle-ci est plus que jamais intégrée à la chute de l’empire occidental. La France doit accepter de ne plus être LE protagoniste impérialiste, néo colonial, elle ne l’est déjà plus que dans une vassalisation qui la ruine. Contribuer à ce réveil ne peut se faire qu’à partir de ceux dont le sort est lié à la paix, au progrès social. Mais il a aussi une nécessité théorique, celle de retrouver une pensée action qui nous aide à sortir de la confusion, de l’aliénation. Voici donc un état de la réflexion sur l’accumulation et la jouissance du capital et ses contradictions dans la financiarisation comme une piste vers l’éco-marxisme, pas seulement en théorie mais dans ses mises en œuvre socialistes.
La classe capitaliste au stade de la financiarisation, l’exemple des USA…
Le marxisme et le conflit à la Faust du capital, entre accumulation et jouissance au stade de la financiarisation est aussi un éco-marxisme. Pour voir la pertinence de cette thèse, contribution au livre que nous sommes en train d’écrire, il faut analyser cette classe capitaliste à travers le « duo dynamique » installé aux Etats-Unis par Trump dont ils ont financé la campagne en espérant du « spoil système » un retour sur investissement, il y a Musk, le plus connu auquel a été associé un autre de la même espèce à savoir Ramaswamy dont le prodigieux enrichissement est lié à la coupe réglée du secteur de la santé. Le produit le plus prometteur de Ramaswamy était un médicament contre la maladie d’Alzheimer appelé intepirdine. Il a levé des centaines de millions pour commercialiser le médicament, et a fait la couverture de Forbes en 2015. Le problème, c’est que l’intepirdine n’a pas fonctionné et a été abandonné. … Ni l’un ni l’autre n’a gagné de l’argent à l’ancienne, en travaillant dans un secteur pendant toute une carrière, en apprenant, et en s’améliorant. Au lieu de cela, ils sont des créatures de la Silicon Valley et de Wall Street, le monde en pleine effervescence des start-ups, des tours de financement et des tournées de promotion. Tous deux sont des entrepreneurs célèbres qui s’appuient sur les modes du monde financier, sur l’argent facile et sur la bonne volonté du gouvernement. Il ne connaissent rien d’autre que l’art et la manière d’utiliser l’État pour leur accumulation et ils ont généré tout un monde capitaliste incapable d’autre type d’accumulation. Donald Trump lui-même aurait probablement fait faillite il y a 30 ans s’il n’avait pas été subventionné par les taux d’intérêt ultra-bas de la Fed. Et toute la créativité dont ils sont capables repose sur cette « carrière », sur ce mode d’accumulation et ce qu’il a engendré comme « civilisation » impérialiste. Il prétendent à la fois faire revenir le « rêve américain » au temps des pionniers et continuer plus que jamais à jouir de la financiarisation qui a besoin d’un certain type d’État de plus en plus militarisé, de plus en plus répressif et du dieu dollar.
Déjà en difficulté pour s’attaquer à la « bureaucratie » de l’État fédéral, qui regorge de leurs pairs, les deux complices Musk et Ramaswamy pour atteindre l’objectif de 2 000 milliards de dollars par an (le montant des déficits attendus dans les années à venir) vont devoir aller plus loin, s’attaquer à l’excès de « muscle » de l’Empire (le Pentagone, l’industrie de la puissance de feu, l’aide étrangère, etc.) et aux transferts extravagants vers la population nationale (Sécurité sociale, couverture médicale et bien d’autres « avantages »). C’est exactement la feuille de route de l’UE, de Barnier et celle que tout gouvernement toléré par Macron doit exécuter et c’est suicidaire…
Partir du livre 1 du Capital sur l’Accumulation du capital entre accumulation et jouissance…
Dans le livre I du capital sur Le développement de la production capitaliste la VII° section est consacrée à l’ Accumulation du capital et le Chapitre XXIV à : la Transformation de la plus-value en capital, j’en conseille une lecture attentive mais j’en reprends ce résumé du conflit à la Faust du capital : A l’origine de la production capitaliste et cette phase historique se renouvelle dans la vie privée de tout industriel parvenu, l’avarice et l’envie de s’enrichir l’emportent exclusivement. Mais le progrès de la production ne crée pas seulement un nouveau monde de jouissances : il ouvre, avec la spéculation et le crédit, mille sources d’enrichissement soudain. A un certain degré de développement, il impose même au malheureux capitaliste une prodigalité toute de convention, à la fois étalage de richesse et moyen de crédit. Le luxe devient une nécessité de métier et entre dans les frais de représentation du capital. Ce n’est pas tout : le capitaliste ne s’enrichit pas, comme le paysan et l’artisan indépendants, proportionnellement à son travail et à sa frugalité personnels, mais en raison du travail gratuit d’autrui qu’il absorbe, et du renoncement à toutes les jouissances de la vie imposé à ses ouvriers. Bien que sa prodigalité ne revête donc jamais les franches allures de celle du seigneur féodal, bien qu’elle ait peine à dissimuler l’avarice la plus sordide et l’esprit de calcul le plus mesquin, elle grandit néanmoins à mesure qu’il accumule, sans que son accumulation soit nécessairement restreinte par sa dépense, ni celle-ci par celle-là. Toutefois il s’élève dès lors en lui un conflit à la Faust entre le penchant à l’accumulation et le penchant à la jouissance.
Elon Musk dans la financiarisation décrite ci-dessous est l’illustration de ce conflit résolu par non par le moins d’État mais par l’État devenu seulement machine à accumulation qui porte alors à un niveau plus élevé le « conflit à la Faust », il faut comprendre ce stade de la financiarisation et incontestablement ceux qui sont le plus avancés dans cette compréhensions sont les dirigeants communistes qui ont pris la mesure de l’attaque contre l’industrie, contre « le muscle » de la nation.
Et cette conscience permet même de défendre une conception écologique et progressiste pour peu que l’on élargisse son champ d’analyse au-delà d’un retour à l’autarcie et au protectionnisme.
Ce qui alors permet de mieux envisager que Marx ne soit pas simplement un productiviste mais comme le perçoivent un certain nombre de marxistes un penseur de l’écologie. Voici un article qui présente comment le « conflit à la Faust » s’est aggravé et accroit dans sa soif d’accumulation le conflit homme nature. Cet article a le mérite de tracer une piste mais il exige d’aller plus loin. Il permet de voir une tendance qui a vu un nombre croissant d’écrits éco-marxistes récemment développé aux États-Unis, qui contredit fortement l’idée reçue d’un Marx seulement productiviste.
De l’accumulation comme contradiction au cœur des forces productives, c’est à dire la relation entre les hommes et la nature et à leur propre nature :
Les pionniers de cette nouvelle recherche sont John Bellamy Foster et Paul Burkett, suivis par Ian Angus, Fred Magdoff et d’autres ; ils ont contribué à transformer Monthly Review en une revue éco-marxiste. Leur principal argument est que Marx était pleinement conscient des conséquences destructrices de l’accumulation capitaliste sur l’environnement, un processus qu’il a décrit par le concept de « rupture métabolique » entre les sociétés humaines et la nature. On peut ne pas être d’accord avec certaines de leurs interprétations des écrits de Marx, mais leurs recherches ont été décisives pour une nouvelle compréhension de sa contribution à la critique écologique du capitalisme.
Demain, je tenterai de présenter d’autres pistes qui sont ouvertes par des chercheurs à partir du marxisme comme « anthropologie »… cela va dans le même sens celui qui impose une lecture non « occidentalisée »…
Comme souvent les trotskistes avec beaucoup de pertinence pointent une question théorique critique, dans cet article ils font état de recherches mais ce qui permettra d’avancer c’est de voir ce qui se réalise, que ce soit à Cuba, en Chine, dans cette écologie qui tente d’endiguer la destruction concrète du capital, trace des pistes… Alors que pour les trotskistes comme le notait Fidel l’approche demeure toujours « intellectuelle » traditionnelle axée sur la critique, il y a l’hypothèse de l’intellectuel de type nouveau celui qui est organique au socialisme et qui intervient dans le collectif, dans une planification, à partir de la classe ouvrière, du peuple. Et c’est ce qui fonde l’intérêt du parti, à la fois avec des principes, une théorie et l’expérimentation dans la lutte des classes et l’antiimpérialisme. (note de Danielle Bleitrach)
La nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital
Kohei Saïto, Éditions Syllepse, 2021, 350 p.
Les écologistes classiques rejettent souvent Marx comme étant « productiviste » et aveugle aux problèmes écologiques. Un nombre croissant d’écrits éco-marxistes a été récemment développé aux États-Unis, qui contredit fortement cette idée reçue. Les pionniers de cette nouvelle recherche sont John Bellamy Foster et Paul Burkett, suivis par Ian Angus, Fred Magdoff et d’autres ; ils ont contribué à transformer Monthly Review en une revue éco-marxiste. Leur principal argument est que Marx était pleinement conscient des conséquences destructrices de l’accumulation capitaliste sur l’environnement, un processus qu’il a décrit par le concept de « rupture métabolique » entre les sociétés humaines et la nature. On peut ne pas être d’accord avec certaines de leurs interprétations des écrits de Marx, mais leurs recherches ont été décisives pour une nouvelle compréhension de sa contribution à la critique écologique du capitalisme.
Kohei Saïto est un chercheur japonais qui appartient à cette importante école éco-marxiste. Traduit de l’allemand et issu d’une thèse soutenue à l’université Humboldt de Berlin, son livre est une contribution très précieuse à la réévaluation de l’héritage marxien, dans une perspective écosocialiste.
L’une des grandes qualités de son travail est que – contrairement à de nombreux autres chercheurs – il ne traite pas les écrits de Marx comme un ensemble systématique d’écrits, défini, du début à la fin, par un fort engagement écologique (selon certains), ou une forte tendance non écologique (selon d’autres). Comme l’affirme Saïto de manière très convaincante, il existe des éléments de continuité dans la réflexion de Marx sur la nature, mais aussi des réorientations et changements très significatifs. En outre, comme le suggère le sous-titre du livre, ses réflexions critiques sur la relation entre l’économie politique et l’environnement naturel sont « inachevées ».
Parmi les continuités, l’une des plus importantes est la question de la « séparation » capitaliste des humains de la terre, c’est-à-dire de la nature. Marx pensait que dans les sociétés précapitalistes, il existait une forme d’unité entre les producteurs et la terre, et il considérait que l’une des tâches essentielles du socialisme était de rétablir l’unité originelle entre les humains et la nature, détruite par le capitalisme, mais à un niveau plus élevé (négation de la négation). Cela explique l’intérêt de Marx pour les communautés précapitalistes, que ce soit dans ses discussions écologiques (par exemple Carl Fraas) ou dans ses recherches anthropologiques (Franz Maurer) : ces deux auteurs étaient perçus comme des « socialistes inconscients ». Et, bien sûr, dans son dernier document important, la lettre à Vera Zassoulitsch (1881), Marx affirme que grâce à la suppression du capitalisme, les sociétés modernes pourraient revenir à une forme supérieure d’un type « archaïque » de propriété et de production collectives. Je dirais que cela appartient au moment « anticapitaliste romantique » des réflexions de Marx… Quoi qu’il en soit, cet aperçu intéressant de Saïto est très pertinent aujourd’hui, alors que les communautés indigènes des Amériques, du Canada à la Patagonie, sont en première ligne de la résistance à la destruction capitaliste de l’environnement.
Cependant, la principale contribution de Saïto est de montrer le mouvement, l’évolution des réflexions de Marx sur la nature, dans un processus d’apprentissage, de repensée et de remodelage de ses pensées. Avant Le capital (1867), on peut trouver dans les écrits publiés de Marx une évaluation assez peu critique du « progrès » capitaliste – une attitude souvent décrite par le terme mythologique vague de « prométhéisme ». Cela est évident dans le Manifeste communiste, qui célèbre la « soumission des forces de la nature à l’homme » et le « défrichement de continents entiers pour la culture » ; mais cela s’applique aussi aux Cahiers de Londres (1851), aux Manuscrits économiques de 1861-1863 et à d’autres écrits de ces années-là. Curieusement, Saïto semble exclure les Grundrisse (1857-1858) de sa critique, une exception qui à mon avis n’est pas justifiée, quand on sait combien Marx admire, dans ce manuscrit, « la grande mission civilisatrice du capitalisme », par rapport à la nature et aux communautés précapitalistes, prisonnières de leur localisme et de leur « idolâtrie de la nature » !
Le changement intervient en 1865-1866, lorsque Marx découvre, en lisant les écrits du chimiste agricole Justus Von Liebig, le problème de l’épuisement des sols, et la rupture métabolique entre les sociétés humaines et l’environnement naturel. Cela conduira, dans le Livre 1 du Capital (1867) – mais aussi dans les deux autres Livres inachevés – à une évaluation beaucoup plus critique de la nature destructrice du « progrès » capitaliste, en particulier dans l’agriculture. Après 1868, en lisant un autre scientifique allemand, Carl Fraas, Marx découvrira aussi d’autres questions écologiques importantes, telles que la déforestation et le changement climatique local. Selon Saïto, si Marx avait pu achever les Livres 2 et 3 du Capital, il aurait davantage mis l’accent sur la crise écologique – ce qui signifie, au moins implicitement, que dans leur état actuel d’inachèvement, l’accent n’est pas suffisamment mis sur ces questions…
Cela m’amène à mon principal désaccord avec Saïto : dans plusieurs passages de l’ouvrage, il affirme que pour Marx « la non-durabilité environnementale du capitalisme est la contradiction du système » (p. 142, souligné par l’auteur) ; ou qu’à la fin de sa vie, il en est venu à considérer la rupture métabolique comme « le problème le plus grave du capitalisme » ; ou que le conflit avec les limites naturelles est, pour Marx, « la principale contradiction du mode de production capitaliste ».
Je me demande où Saïto a trouvé dans les écrits de Marx de telles affirmations. Elles sont introuvables dans ses livres publiés, dans les manuscrits ou les carnets. Et cela pour une bonne raison : l’insoutenabilité écologique du système capitaliste n’était pas une question décisive au 19e siècle, comme elle l’est devenue aujourd’hui, ou plus précisément depuis 1945, lorsque la planète est entrée dans une nouvelle ère géologique, l’Anthropocène. De plus, je crois que la rupture métabolique, ou le conflit avec les limites naturelles, n’est pas « un problème du capitalisme » ou une « contradiction du système » : c’est bien plus que cela ! C’est une contradiction entre le système et « les conditions naturelles éternelles » (Marx), et donc avec les conditions naturelles de la vie humaine sur la planète. En fait, comme l’affirme Paul Burkett (cité par Saïto), le capital peut continuer à s’accumuler dans n’importe quelles conditions naturelles, même dégradées, tant qu’il n’y a pas d’extinction complète de la vie humaine : la civilisation humaine peut disparaître avant que l’accumulation du capital ne devienne impossible…
Saïto conclut son livre par une évaluation lucide qui me semble être un résumé très pertinent de la question : Le capital reste un projet inachevé. Marx n’a pas répondu à toutes les questions ni prédit le monde d’aujourd’hui. Mais sa critique du capitalisme fournit une base théorique extrêmement utile pour la compréhension de la crise écologique actuelle. Par conséquent, j’ajouterais que l’écosocialisme peut s’appuyer sur les idées de Marx, mais qu’il doit développer pleinement une nouvelle confrontation éco-marxiste avec les défis de l’Anthropocène au 21e siècle.
?
Views: 0