22 septembre 2025
Le retour à Marx et au matérialisme historique même dialectique est manifeste. Visiblement on ne se contente plus de le citer à travers quelques vagues formules tronquées on le relit y compris aux USA. Et on peut conseiller ceux qui arrivent encore à dépasser trois lignes en matière de lecture de se replonger effectivement dans les luttes des classes en France, en se disant que la bouffonnerie sinistre que Marx voyait déjà dans Napoléon III a encore augmenté d’un cran. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsocieté)

À mesure que nous progressons vers une gouvernance par la coercition, nous devons être prêts à retirer notre consentement à être gouvernés par ce régime. Image par Koshu Kunii.
Poussé par les exigences contradictoires de sa situation, et étant en même temps, tel un jongleur, sous la nécessité de garder le regard du public sur lui-même… en suscitant des surprises constantes – c’est-à-dire sous la nécessité d’organiser chaque jour un coup d’État en miniature – [il] jette l’ensemble… l’économie jusqu’à la confusion, viole tout ce qui semblait inviolable, rend les uns tolérants à la révolution et en fait désirer d’autres, et produit l’anarchie au nom de l’ordre, tout en dépouillant tout l’appareil d’État de son auréole, en le profanant et en le rendant à la fois répugnant et ridicule – Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1851
Ainsi se termine la chronique perspicace de Marx sur les événements en France de 1848 à 1851 qui ont abouti à l’écrasement brutal du prolétariat français, ainsi qu’à l’ascension de Napoléon III, d’abord en tant que président (très temporairement) et finalement en tant qu’empereur. Au milieu de notre consternation et de notre souci de comprendre notre propre glissade actuelle vers ces temps sombres, nous pourrions nous tourner vers l’analyse de Marx pour obtenir des conseils bien nécessaires. Comme Marx lui-même a décrit son objectif (dans une préface de 1869 à une deuxième édition) pour la série d’articles qui est devenue le pamphlet, il n’était pas intéressé à glorifier Bonaparte ou à raconter une histoire du genre « grand homme de l’histoire », mais plutôt il voulait « démontrer comment la lutte des classes en France a créé les circonstances et les relations qui ont permis à une médiocrité grotesque de jouer un rôle héroïque ». Cela ressemble à quelqu’un / quelque chose que nous connaissons ?
Qu’en pensez-vous alors ? Marx, dans ce passage, essayait de comprendre comment la paysannerie française en est venue à jouer son rôle improbable, mais essentiel, dans l’ascension de Bonaparte. Il se lit comme une caractérisation étrangement prémonitoire du mouvement MAGA en tant que centre de soutien apparemment inébranlable pour le régime actuel, ainsi que leur dangereuse susceptibilité à sa démagogie incessante :
Dans la mesure où des millions de familles vivent dans des conditions d’existence qui séparent leur mode de vie, leurs intérêts et leur culture de ceux des autres classes, et les opposent hostilement à ces dernières, elles forment une classe. Dans la mesure où il n’y a qu’une interconnexion locale entre ces gens, et que l’identité de leurs intérêts ne forme aucune communauté, aucun lien national et aucune organisation politique entre eux, ils ne constituent pas une classe. Ils sont donc incapables de faire valoir leur intérêt de classe en leur propre nom, que ce soit par le biais d’un parlement ou d’une convention. Ils ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, ils doivent être représentés. Leur représentant doit en même temps apparaître comme leur maître, comme une autorité sur eux, un pouvoir gouvernemental illimité qui les protège des autres classes [pour lesquelles nous pourrions, bien sûr, lire des « autres » dangereux et indignes, dont nous parlerons dans un instant] et leur envoie la pluie et le soleil d’en haut. L’influence politique des Magalites trouve donc son expression finale dans le pouvoir exécutif qui subordonne la société à elle-même.
Et qu’en est-il des freins et contrepoids institutionnels putatifs sur le pouvoir exécutif ? Ici aussi, nous pouvons trouver des observations étonnamment pertinentes qui prévoient avec précision nos gros titres quotidiens :
En repoussant l’armée… et ainsi, livrant irrévocablement l’armée au président, le parti de l’ordre [c’est-à-dire la branche du Congrès avec ses pouvoirs de guerre] déclare que la bourgeoisie a perdu sa vocation de gouverner. Il n’existe plus de ministère parlementaire. Ayant maintenant perdu son emprise sur l’armée et la garde nationale, quels moyens de force lui restait-il [au Congrès] pour maintenir simultanément l’autorité usurpée du parlement sur le peuple et son autorité constitutionnelle contre le président ? Aucun. Il ne lui restait plus que l’appel à des principes impuissants [ou à des lettres d’inquiétude sévères], à des principes qu’il avait toujours lui-même interprétés simplement comme des règles générales, que l’on prescrit aux autres pour pouvoir se mouvoir d’autant plus librement que l’on peut se mouvoir soi-même.
Alors, qu’est-ce que tout cela (et tant d’autres choses qui pourraient être citées) apporte en termes d’idées pour faire face à la myriade de dilemmes auxquels nous sommes actuellement confrontés ? Si nous devons suivre le conseil de Marx, notre enquête ne devrait pas se concentrer sur les particularités et les idiosyncrasies de notre propre « médiocrité grotesque », mais plutôt sur les circonstances et les relations qui lui ont permis de « jouer un rôle de héros ». Pour cela, je pense qu’il est instructif de revenir sur un élément particulier des primaires et des campagnes présidentielles de 2016. Il est devenu clair pour de nombreux observateurs que la grande majorité de l’électorat, quelle que soit sa position sur l’échiquier politique, était avide de changement par rapport au statu quo qui prévalait alors. Pour le meilleur ou pour le pire, littéralement, les deux candidats qui ont finalement émergé comme les incarnations les plus probables d’un tel changement étaient Bernie Sanders et Donald Trump. Les plus improbables étaient les clones virtuels sur la scène républicaine, et Hillary Clinton du côté démocrate. Bien que Sanders ait été écarté par l’establishment du parti, je pense qu’il vaut toujours la peine de comparer son récit (à l’époque et aujourd’hui) avec celui de Trump (à l’époque et aujourd’hui également) afin de comprendre la constellation de facteurs (y compris, comme l’a observé Marx, des alliances improbables) qui ont produit le moment présent.
Je commence par ce avec quoi Marx a commencé dans son évaluation (à la fois dans cette brochure et dans presque toutes ses autres œuvres) : les conditions matérielles des gens sur le terrain. C’est aussi là que Sanders et Trump ont tous deux situé leurs campagnes, et tous deux ont reconnu que leurs partisans potentiels avaient des griefs tout à fait légitimes sur des éléments essentiels de leur vie. Au-delà de cet accord fondamental, cependant, les histoires divergent immédiatement et sauvagement. Pour Sanders (et, bien sûr, il s’agit d’un élément central de la campagne anti-oligarchie en cours), les problèmes très réels que les gens rencontrent découlent d’un système qui oppose le 1 % au reste. Et bien que ce diagnostic puisse trouver un écho chez des personnes ayant des positions idéologiques assez divergentes (comme Sanders continue de le démontrer dans les circonscriptions rouge et bleue), les remèdes sont, ou de manière plus réaliste, sont présentés comme presque impossibles : c’est-à-dire un changement fondamental et systémique. Et pour couronner le tout, Sanders a dû/doit faire face aux réactions instinctives (soit la peur existentielle, soit l’utopisme banalisé) à son socialisme démocratique autoproclamé, bien que guère radical. Pour en revenir brièvement au 18Brumaire, ce fardeau a aussi une longue histoire :
Quelle que soit la quantité de passion et de déclamation employée… la parole est restée… monosyllabique… Aussi monosyllabique sur l’estrade que dans la presse. Plat comme une énigme dont la réponse est connue d’avance. Qu’il s’agisse du droit de pétition ou de l’impôt sur le vin, de la liberté de la presse ou du libre-échange, des clubs ou de la charte municipale, de la protection de la liberté individuelle ou de la réglementation du budget de l’État, le mot d’ordre revient constamment, le thème reste toujours le même, le verdict est toujours prêt et se lit invariablement comme suit : « Le socialisme ! » Même le libéralisme bourgeois est déclaré socialiste, les Lumières bourgeoises socialistes, la réforme financière bourgeoise socialiste. C’était socialiste de construire un chemin de fer là où il y avait déjà un canal, et c’était socialiste de se défendre avec une canne quand on était attaqué avec une rapière.
Et donc, quelle était/est l’histoire de Trump ? Comme avec Sanders, il commence par la présomption et l’affirmation publique continuelle (qu’il le croie ou non) que les griefs sont authentiques. Les causes, cependant, ne proviennent pas d’un système truqué par les riches et les puissants, mais sont plutôt le résultat d’« autres » indignes qui entravent illégalement et illégitimement les perspectives de ceux jugés méritants par le régime au pouvoir. Et si ce régime est prêt à écarter les protections minimales accordées à ces « autres » identifiés, il est facile de comprendre pourquoi l’actionnabilité tangible et visible de cette approche est préférable à ses partisans, à la vague agitation et tordre la main des prescriptions de Sanders. Le revers de la mythologie du soi-disant « rêve américain » méritocratique (travaillez dur, respectez les règles, vous y arriverez) est que si vous échouez, c’est de votre faute. À la lumière de cela, il est doublement attrayant de se faire dire « non, ce n’est pas de ta faute ; c’est ‘le leur’ », puis de les voir humiliés, déshumanisés et disparaître d’une manière ou d’une autre.
Il est également possible, à la lumière de l’évaluation de Marx, d’utiliser ce récit trumpien pour nous aider à comprendre ce qui apparaît comme une coalition improbable (les circonstances et les relations) entre le grand capital (la finance et les grandes entreprises technologiques en particulier) et divers éléments de la classe ouvrière (par exemple, certains segments du mouvement syndical). Cela sert également à expliquer certains des changements démographiques apparemment contradictoires que nous avons vus se produire récemment parmi diverses populations de couleur et dans des cohortes liées à l’âge. En se référant à la citation de Marx/MAGA ci-dessus, beaucoup de gens sont susceptibles de revendications démagogiques de soulagement et de salut, et c’est particulièrement le cas en ces moments difficiles. Lorsque les gens vivent indéniablement dans des circonstances précaires, il devient beaucoup plus attrayant d’entendre qu’il existe un remède « facile » (éliminer « ces personnes ») que d’entendre qu’un changement systémique fondamental est nécessaire avant que les choses ne s’améliorent.
Alors, que faire ? Je reviens encore une fois, et enfin, au 18 Brumaire, et à sa citation la plus célèbre (modifiée pour les sensibilités actuelles) : « [Les gens] font leur propre histoire, mais ils ne la font pas à leur guise ; Ils ne le font pas dans des circonstances qu’ils ont choisies eux-mêmes, mais dans des circonstances déjà existantes, données et transmises du passé. Il reste maintenant un peu plus de 400 jours avant les élections de mi-mandat de 2026, si tant est qu’elles aient lieu. Et c’est un très grand si, étant donné que le régime essaie maintenant par tous les moyens possibles (guerre avec le Venezuela, guerre avec les villes, guerre contre « la gauche », etc., etc.) pour fomenter une « urgence » réelle ou fausse afin de déclarer la loi martiale et d’annuler, plutôt que de risquer de perdre, les élections.
Mais si nous les avons, au cours des 400 prochains jours, deux voies pour écrire l’histoire devraient être empruntées simultanément et avec l’urgence que notre situation difficile exige. La première est la voie électorale et fonctionne sous la présomption toujours valable (pour l’instant) que les élections auront lieu. Au cours de cette période, et alors que les effets des politiques actuelles (en particulier les tarifs douaniers et le gros billet de loi) se font sentir et produisent des effets matériels dans la vie quotidienne des gens, chaque candidat démocrate ou titulaire d’une fonction publique devrait se donner pour priorité absolue de suivre l’exemple de Sanders et de partager avec les électeurs de toutes les tendances politiques : 1) précisément d’où vient leur véritable douleur ; et 2) comment, spécifiquement, un Congrès contrôlé par les démocrates travaillerait de manière programmatique pour alléger ces fardeaux. Est-ce réaliste ? Quelle est l’alternative ?
L’autre voie qu’il convient d’emprunter est de contester, de toutes les manières possibles, la légitimité de l’administration actuelle. À mesure que nous progressons vers une gouvernance par la coercition (appliquée si l’on ose être en désaccord avec les orientations actuelles), nous devons être prêts à retirer notre consentement à être gouvernés par ce régime. Si nous avions réellement la « gauche organisée » fiévreusement conjurée et imaginée par le prolétariat, nous pourrions être en train de produire de manière créative des retenues de travail et de consommation, de développer des grèves générales de 5 à 10 minutes et d’obtenir de nos élus alliés qu’ils « mettent leur corps sur les engrenages, les roues et les leviers de l’odieuse machine et la fassent s’arrêter » ou au moins la ralentir jusqu’à ce que nous puissions prendre le contrôle. En l’absence de cette gauche cohérente (une de ces circonstances transmises du passé), nous devons profiter des organisations apparentées qui existent ou qui peuvent être créées rapidement pour mettre en œuvre une telle stratégie à tous les niveaux appropriés. Est-ce réaliste ? Quelle est l’alternative ?
Marv Waterstone est professeur émérite à l’École de géographie, de développement et d’environnement de l’Université de l’Arizona, et co-auteur plus récemment avec Noam Chomsky de Consequences of Capitalism : Manufacturing Discontent and Resistance (Haymarket Books).
Views: 264




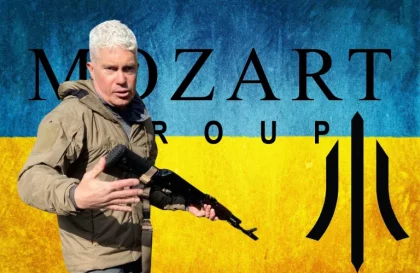

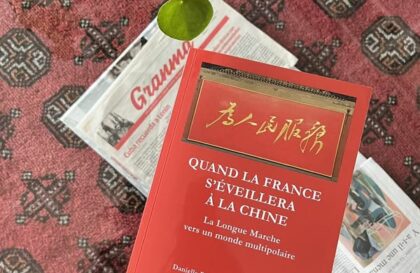
pam
lisant la citation « L’influence politique des Magalites trouve donc son expression finale dans le pouvoir exécutif qui subordonne la société à elle-même » et me demandant qui sont les magalites, je cherche la citation et ne la trouve pas, ni dans le 18 brumaire, ni dans les luttes de classe… J’ai raté quelque chose ?