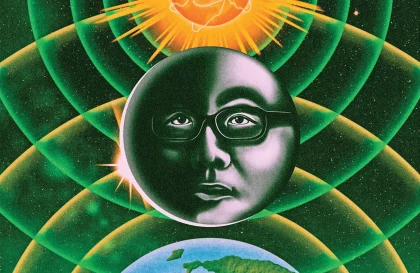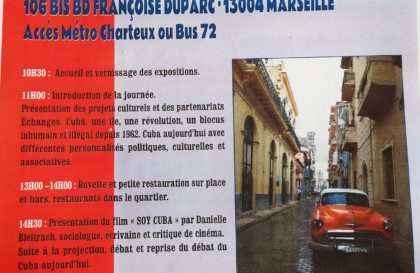L’hypothèse trois est déjà là : et le monde est déjà différent… En Europe, toujours divisée mais irrésistiblement entraînée dans un scénario allemand qui n’a rien de particulièrement rassurant, ceux qui veulent de fait une soumission totale aux Etats-Unis se heurteront à ce scénario dans lequel l’Allemagne a compris que les coups étaient principalement dirigés contre elle mais qui est fortement tentée par le choix hitlérien de surarmement et d’accentuer sa domination sur ce qui est déjà son domaine économique : les pays de l’ex-URSS. On reprend la politique de Merkel mais avec l’industrie de l’armement en pointe et quand on fabrique des armes c’est pour s’en servir. La France de Macron dans ses rêves mégalomanes invitée à ce partage impérialiste du temps où l’Europe se partageait encore les continents, comme si la deuxième guerre mondiale pouvait être rejouée. Parce que ce qui se joue n’est plus le monde multipolaire, la crise a révélé son existence et l’impossible retour en arrière, mais le sens même de ce monde : celui où des empires tentent de renaitre dans l’absence de droit international, des conflits locaux et celui d’un ordre international qui au contraire impose négociations et droit des États. L’impérialisme contre le socialisme. Il faut plus que jamais réclamer la paix en sachant que celle-ci n’a rien de « naturel » et que la guerre est là. (note de danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop)
https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html
Trump ne se contente pas de faire la révolution aux États-Unis, il orchestre une explosion mondiale. Cependant, la guerre commerciale totale annoncée par le président des États-Unis au monde entier poursuit le même objectif – elle doit transformer l’Amérique de l’intérieur, rénover ses infrastructures, revitaliser l’industrie, renforcer l’économie dans son ensemble et changer sa place dans le monde. Il veut vraiment « rendre à l’Amérique sa grandeur », même si cela implique de mettre la pagaille dans le monde entier. Y parviendra-t-il et quelles en seront les conséquences pour le pays et le monde ? Non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan géopolitique, car c’est du futur ordre mondial qu’il s’agit.
Que ce soit en cas de succès ou d’échec, le monde ne sera plus le même – non pas parce que Trump a augmenté les droits de douane, mais parce qu’avec cette mesure, il a mis fin à l’étape actuelle de l’ère de la mondialisation. Non, elle n’est pas morte, comme l’a déjà annoncé le Premier ministre britannique Starmer, mais elle se trouve à une bifurcation : le processus de mondialisation peut être freiné, simplement mis en pause, et même son accélération n’est pas exclue. Tout est désormais possible, car l’ancien ordre s’est effondré et le nouvel ordre prend forme dans des conditions de turbulence accrue.
Alors que les marchés mondiaux connaissent un effondrement comparable à celui du début de la pandémie ou de la crise mondiale de 2008, le pessimisme prévaut – même certains des milliardaires américains partisans de Trump suggèrent une pause sur la voie de ce qu’ils appellent une « guerre nucléaire économique avec le monde ». Mais Trump ne reculera pas – le sort en est jeté et le Rubicon franchi. Que nous réserve l’avenir ?
Si les choses se déroulent selon un scénario catastrophe pour Trump, lui et l’Amérique seront perdants. La guerre commerciale avec le monde entier deviendra une réalité, le chiffre d’affaires des États-Unis diminuera, la récession commencera, l’inflation augmentera fortement, l’économie déclinera – et la popularité de Trump avec elle. Tout entrera alors en crise, les États-Unis entreront en défense commerciale et en semi-autarcie – et le dollar commencera à perdre sa position de monnaie commerciale et de réserve. Trump perdra de manière écrasante les élections de mi-mandat de l’année prochaine, il perdra le Congrès. Et en 2028, un démocrate-mondialiste de gauche sera élu président et tentera de renverser la vapeur, de restaurer l’unité de l’Occident et de reprendre le processus de mondialisation à l’anglo-saxonne. Mais d’ici là, le monde aura encore changé : la guerre économique avec les États-Unis conduira à la consolidation de plusieurs centres de pouvoir régionaux (l’UE, l’ANASE, l’Asie du Sud dirigée par l’Inde), et la Chine deviendra non seulement le principal pays commercial et économique du monde, mais aussi le moteur d’une nouvelle version multipolaire de la mondialisation. Les États-Unis seront contraints de s’adapter au nouveau système émergent ou d’essayer de le briser par la force militaire (en provoquant une guerre qui ne sera plus commerciale avec la Chine).
Le scénario inverse conduirait à la victoire de Trump : la plupart des pays se plieraient aux demandes américaines de réduction des droits de douane. Les États-Unis bénéficieront d’une augmentation sans précédent des investissements dans leur économie, principalement dans le secteur manufacturier – des usines et des chantiers navals commenceront à être construits et relancés. Les exportations américaines augmenteront – les pays contraints d’équilibrer leur balance commerciale avec les États-Unis achèteront tout, de la nourriture aux armes. La Chine ne sera pas en mesure de réorienter ses flux d’exportation, ce qui entraînera une crise économique intérieure et l’obligera à réduire ses activités à l’étranger. L’Amérique deviendra plus forte, sa dépendance à l’égard des importations sera minimisée, l’influence du dollar sera encore renforcée et sa position en matière de politique étrangère sera rétablie au niveau de « quasi-hégémon ». Dans le même temps, Trump reconstruira la structure politique interne de l’État, en réussissant à assécher le « marais de Washington » et à purger l’élite mondialiste. En 2028, J.D. Vance deviendra président et son premier décret sera de graver l’image de Trump sur le Mont Rushmore.
Ces deux scénarios sont presque maximalistes, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont impossibles. Certes, ils ne sont pas exacts à 100 %, mais les tendances générales sont à peu près correctes. Lequel se réalisera ?
Aucun, car en réalité, un troisième scénario est bien plus probable.
Selon ce dernier scénario, il n’y aura pas de crise mondiale, ni d’effondrement de l’économie américaine. Le modèle actuel de mondialisation va en effet rendre l’âme – enfin, il vivait déjà sous respiration artificielle, et Trump n’a fait que débrancher la machine. Certes, il parviendra à obtenir des concessions de la plupart des pays pour conserver l’accès au marché américain, mais la guerre commerciale avec la Chine prendra également de l’ampleur. Même si Washington et Pékin se mettront très certainement d’accord pour réduire les droits de douane (par rapport au niveau actuel quasiment prohibitif), la tendance générale ne changera pas : le processus de divorce des deux économies s’accélérera, le chiffre d’affaires des échanges et les investissements diminueront. Le monde évolue vers la création de deux pôles de pouvoir – économique, commercial, financier et militaire. Les États-Unis et la Chine ne diviseront pas le monde en deux, car le processus de formation de la multipolarité (qui met l’accent sur les associations régionales et les civilisations-puissances) prendra de l’ampleur en parallèle, et les États-Unis eux-mêmes passeront de la prétention à la domination mondiale au statut de plus grande puissance du monde.
Il ne s’agit plus d’une prétention à la domination mondiale (qui est l’essence du modèle anglo-saxon de mondialisation), mais ce n’est pas non plus l’autarcie ( au sein de tout l’hémisphère occidental, il est vrai) de l’isolationnisme américain. Les Etats-Unis ne pourront pas retrouver leur statut de principale usine industrielle du monde, mais il ne pourra leur être utile qu’en cas de guerre généralisée et prolongée. Avec qui ? Avec la Chine (ou même avec la Chine et la Russie à la fois), mais le problème est qu’une telle guerre ne peut pas être prolongée, car elle risque de dégénérer rapidement en guerre nucléaire. Par conséquent, le divorce entre les États-Unis et la Chine sera pacifique. Bien que des provocations autour de Taïwan (du côté américain) soient toujours possibles, il est probable que Trump (ou plutôt son successeur) acceptera le transfert de l’île à Pékin selon un schéma de « Super Hong Kong » : un statut spécial pendant un demi-siècle, mais sans l’entrée de troupes chinoises.
Donc, stratégiquement, le succès relatif de la révolution de Trump serait bénéfique au monde entier, car malgré les coûts à court terme (voire à moins court terme) pour les marchés financiers, le commerce mondial et les économies de nombreux pays, il reflète une tendance réelle et très correcte : l’Amérique abandonne la mondialisation, s’isole et veut » vivre pour elle-même » (oui, y compris aux dépens des autres, mais aux dépens du dollar dans une mesure encore plus grande maintenant, sauf qu’il n’est pas dépensé pour elle-même, mais pour contrôler le monde).
Ce processus sera long, mais il est beaucoup plus correct que les tentatives d’un hégémon condamné à maintenir sa position par la force militaire. Et l’alternative à la révolution Trump est justement ce scénario sanglant.
Views: 2