Zone critique , offre des articles toujours passionnants sur la littérature contemporaine, celui-ci est plus « sociologique » puisqu’il s’agit d’un livre qui témoigne de l’incapacité des « élites » de la culture et de l’université à produire une critique radicale. La description ne concerne pas que les Etats-Unis, on s’y croirait. (Note de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
Posted by Juliette Josset on mercredi, juin 8, 2022
Catherine Liu : Autocritique de classe – ZONE CRITIQUE (zone-critique.com)

© Droits réservés
Ils sont journalistes, universitaires ou encore cadres en entreprise ; ils affichent de nobles idéaux mais ont délaissé les classes populaires. Dans son essai Le Monopole de la vertu (Virtue Hoarders. The Case against the Professional Managerial Class), paru en avril 2022 aux Éditions Allia, Catherine Liu, professeure au département des études cinématographiques et visuelles et directrice du centre des sciences humaines de l’université de Californie, épingle les membres de cette gauche progressiste qui marche main dans la main avec le capitalisme.
Son essai est donc une critique virulente à l’égard de la « Professional Managerial Class », terme forgé par les auteurs John et Barbara Ehrenreich, traduit en français par l’acronyme CPIS (Cadres et professions intellectuelles supérieures).
Histoire d’une trahison
De l’éclosion de la contre-culture hippie, de l’apparition des cultural studies et des théories poststructuralistes au sein du paysage universitaire à l’élection de Donald Trump, elle revient sur les mouvances et les évènements qui ont façonné le paysage politique américain et les guerres culturelles actuelles.
Dans la première moitié du XXème siècle, la classe managériale américaine soutenait le militantisme ouvrier et l’intervention de l’Etat dans les domaines de l’économie, du travail ou de l’éducation. Elle s’est aujourd’hui ralliée au capitalisme et aux grandes entreprises, tout en affichant une posture transgressive et des idéaux progressistes. Catherine Liu retrace la genèse et l’histoire de ce volte-face qui débute dans les années 1960. De l’éclosion de la contre-culture hippie, de l’apparition des cultural studies et des théories poststructuralistes au sein du paysage universitaire à l’élection de Donald Trump, elle revient sur les mouvances et les évènements qui ont façonné le paysage politique américain et les guerres culturelles actuelles.
La crise des subprimes qui a éclaté en 2007 fait figure de tournant. En effet, il s’agissait d’une occasion pour la classe managériale de prendre une posture résolument critique vis-à-vis du monde capitaliste. Or, selon l’auteure, le mouvement Occupy Wall Street, composé majoritairement de membres de la classe supérieure intellectuelle menacés de déclassement, a échoué, par hypocrisie et manque de revendications politiques concrètes, à prendre une réelle position de contestation vis-à-vis du capitalisme. Les CPIS s’en sont ainsi tenus à de vagues postures progressistes, sans réellement tenter d’inverser les rapports de force économiques qui traversent la société. Une des raisons de cet échec est la réticence de la classe managériale à aborder les problèmes sociaux en termes de classe : « Dans les cercles progressistes, parler de classe ou de conscience de classe avant toute autre forme de différence n’est pas seulement matière à polémique : c’est une hérésie »
Pourtant, la classe managériale s’envisage comme une force motrice de l’histoire, porteuse d’une révolution. En effet, héritière des idéaux hédonistes de la contre-culture des années 1960 et 1970, elle affiche son rejet de certaines normes, jugées conformistes, et se donne le beau rôle dans des luttes sociétales, qui, selon l’auteure, oblitèrent les inégalités économiques réelles : « Les membres de la classe managériale se voient comme des précurseurs vertueux, détachés des structures et des conditions historiques, transgressant les frontières pour inventer de nouveaux modes de pensée et d’existence ». En réalité, les valeurs affichées par les CPIS sont simplement des habitudes et des goûts érigés au rang de vertus.
Hypocrisies de classe
Catherine Liu évoque notamment longuement le cas des universités, qui sont devenues des terrains de luttes sociétales, alors que la recherche publique et l’autonomie des chercheurs s’affaiblissent progressivement.
Catherine Liu s’attache ainsi à montrer que derrière les principes moraux défendus par les CPIS se cachent en réalité des intérêts de classe : « …les CPIS surent se distinguer de ceux qui leur étaient économiquement inférieurs de façon moralement justifiable. » Les CPIS investissent en effet certains domaines, comme la parentalité, l’éducation, la culture ou encore la sexualité, pour mieux afficher leur supériorité vis-à-vis des classes populaires : « Lire des livres, élever des enfants, se nourrir, rester en bonne santé ou faire l’amour ont constitué autant d’occasions de démontrer qu’on faisait partie des individus les plus évolués de l’histoire humaine, tant sur le plan affectif que culturel. » Certains de ces domaines, notamment la puériculture et l’éducation, correspondent d’ailleurs à des sphères où l’influence de l’Etat s’est progressivement délitée au profit d’institutions privées et des catégories les plus favorisées de la société : « Nul besoin d’être socialiste pour constater que la puériculture, la santé et l’éducation constituent les domaines où les privilèges de classe sont reproduits de la manière la plus extrême et la plus spectaculaire ». Catherine Liu évoque notamment longuement le cas des universités, qui sont devenues des terrains de luttes sociétales, alors que la recherche publique et l’autonomie des chercheurs s’affaiblissent progressivement. La classe managériale fait par exemple front contre les violences sexuelles à l’université mais ne lutte jamais contre l’insécurité professionnelle et les inégalités économiques qui sont souvent à l’origine de ces violences : « En matière de sexe, il ne peut exister aucun plaisir ni aucune liberté tant que nous ne serons pas affranchis de l’angoisse économique que représente la survie au quotidien… ».
Catherine Liu replace ainsi les engagements et les valeurs des CPIS, qui prônent souvent une neutralité vertueuse, dans une perspective économique et pointe le conservatisme réel qui se cache derrière ces valeurs. A travers son portrait de la classe managériale, elle fait également un état des lieux d’une société américaine rongée par les inégalités, et en appelle à un changement de paradigme: « Dans un pays qui, plus qu’aucun autre, se croyait capable de niveler tous les préjudices sociaux, de créer une réelle égalité des chances pour un formidable éventail de personnes de tous les genres, de toutes les races, sexualités, identités de genre, etc., les institutions américaines récompensent de plus en plus l’intelligence et le dur labeur d’une poignée d’élus dans le mépris total des souffrances et de l’exclusion du plus grand nombre. »
De la nécessité d’une autocritique
L’attitude arrogante et hypocrite de la classe managériale est une des raisons expliquant la défaite d’Hillary Clinton face à Donald Trump en 2017. En effet, Hillary Clinton, progressiste et libérale, incarnait totalement les valeurs des CPIS : « La défaite de Clinton ne porta pas seulement un coup d’arrêt à la tendance centriste : ce rejet viscéral visait également l’hypocrisie des classes supérieures dans leur ensemble ». Alors que les colères des classes populaires ont permis la montée en puissance d’un populisme réactionnaire, il est indispensable, selon Catherine Liu, d’imaginer d’autres perspectives politiques : « Pour vaincre les politique réactionnaires qui se cachent sous le masque du populisme, il nous faut mener à gauche une lutte des classes contre les CPIS et refuser cette politique des identités qui leur permet d’exhiber leur vertu ».
Sa critique volontairement virulente de la classe managériale est donc motivée par un désir de refondation d’une société faisant face à une multitude de crises, politiques, environnementales et sociales : « J’écris cette critique afin d’identifier les politiques de monopole de la vertu qui, ancrées dans un contexte historique, manifestent ce refus de la part des CPIS d’adopter et de soutenir les changements sociopolitiques dont nous avons si urgemment besoin ». Catherine Liu assume ainsi pleinement la dimension pamphlétaire et la finalité idéologique de son essai. Néanmoins, elle reconnaît faire partie de façon ambivalente de la catégorie de population qu’elle vise. Son livre fait ainsi figure d’auto-critique salutaire, à laquelle elle invite tout membre de la classe managériale : « L’autocritique doit être le point de départ de tout engagement politique. » L’auteure épingle l’individualisme forcené des catégories supérieures de la population pour proposer à la place un sens de la communauté et un partage de valeurs : « Je suis déterminée à lutter pour redonner une dimension commune à toutes les choses que la classe managériale cherche à monopoliser : la vertu, le courage, la détermination, l’érudition, les connaissances spécialisées, le prestige et le plaisir, ainsi que le capital culturel et le capital réel ».
Ainsi, cet essai, quoique caricatural dans sa dénonciation d’une certaine catégorie de la population, n’en est pas moins intéressant dans sa peinture des fractures de classe qui traversent la société américaine – et sûrement l’ensemble des sociétés occidentales – et des hypocrisies qui les masquent.
Views: 1






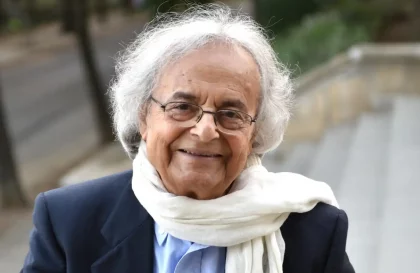
LEMOINE Michel
Les CPIS se sont éloignés des classes populaires. Mais le parti représentant ces classes populaires ne s’est-il pas obstinément comporté comme si le socialisme ne pouvait se faire que sans eux ou même contre eux.
Il est normal que les CPIS veuillent occuper le premier rang. Ne sont-elles pas la classe montante, celle qui maitrise les sciences et les techniques qui font la société moderne. La classe ouvrière a perdu ce rôle même si elle reste la classe productive.
Ces deux classes doivent se retrouver, converger dans la construction d’un socialisme du 21ème siècle. Ce sera l’objet des luttes de classe du 21ème siècle. Mais que de temps perdu !
etoilerouge
Il semble que les classes en question ont au contraire bien appris et profité des luttes ouvrières. Exemple en France la montée relative des syndicats cadres mais aussi les hausses de salaires réservée à ces classed,ou bien une retraite puisant ds les fonds des ouvriers employés techniciens pour payer monstrueusement 10/100 d’augmentation des le premier enfant alors que ouvriers employés techniciens c’est maintenu au 3eme. Le tout s’appuie sur le fait qu’en France les cadres st la classe qui fait le plus d’enfants 4 en moyenne alors que employés ouvriers tech st au mieux à deux. Comme hypocrites et faux culs plus qu’un cadre? Internationalement c’est la classe des cadres qui a trahi en URSS et ds les pays socialistes. Staline était justement attentif à ce que les cadres ne s’accaparent le pouvoir d’ou certaine répression. Marx démontre que les cadres ainsi que leurs opinions et valeurs st les plus aliénés et intégrés au système. Ds les siècles proches ds nombre de sociétés les nouveaux pouvoirs se debarassaient des cadres. Les classes de travailleurs doivent se battre sur des bases égalitaires. Aucune attitude de supériorité ni tentative de se faire les poches des travailleurs ne doit être toléré de ces catégories. Le savoir aujourd’hui peut se diffuser très vite ce st ces castes qui pour garder leurs privilèges empêchent hypocritement tte unité de lutte. Les cadres au service du GD nombre ou celui ci doit aussi les combattre y compris violemment.
Xuan
Je ne parlerai pas de convergence mais de changement de direction. Pas d’orientation, mais de direction, au sens de classe dirigeante dans la révolution.
Tant que les catégories intermédiaires conservent les rênes de la « gauche » il est impossible de renverser le capitalisme, parce que ces classes rêvent de devenir elles-mêmes des classes bourgeoises et d’exploiter le prolétariat.
Leur proximité avec la bourgeoisie flatte leur ego. S’ils ne possèdent pas le capital en mains propres, ils en râclent les miettes, et le moindre compliment issu des VIP les fait frémir d’espoir. Aussi ont-ils adopté le mépris de leurs maîtres pour la vile populace, tandis qu’ils se considèrent eux-mêmes comme le gratin cultivé de la société.
Une autocritique ne résoudra pas le problème, le mal est trop profond. Il s’agit d’une refonte des idées : rééduquer et réformer son esprit pour adopter le point de vue révolutionnaire du prolétariat.
Mao Zedong préconisait que les intellectuels aillent réformer leur esprit en allant travailler à la campagne avec les paysans, et adoptent l’esprit de « servir le peuple de tout son cœur ».
Xi Jinping a repris ce slogan. D’ailleurs lui-même l’avait mis en pratique.
Mais ce n’est pas une garantie décisive. Des intellectuels proches du parti communiste ont bien viré leur cuti. Et des établis des années 70 sont revenus dans les bras de la famille.
La garantie que les intellectuels se mettent au service du peuple, c’est que le parti communiste conserve une orientation révolutionnaire marxiste-léniniste. Que les éléments les plus conscients de la classe ouvrière le dirigent, c’est-à-dire qu’il s’appuie sur des cellules d’entreprise notamment.
Alors l’intelligentsia retrouvera sa place dans la lutte pour le progrès de l’humanité. Elle mettra sa culture et son savoir au service du peuple et de la révolution prolétarienne.
LEMOINE Michel
Voilà l’illustration de ce que je critique : on propose un strapontin à une classe qui façonne l’avenir. On voudrait la vassaliser alors qu’elle dirige déjà. Elle sert le capital c’est vrai
mais elle s’en sert d’abord.
Nous ne ferons pas le socialisme contre elle si nous contribuons à renforcer ses liens avec le capital. Il faut l’attaquer sur son idéologie mais en lui tendant la main.
Xuan
Ni la révolution ni le socialisme ne se feront contre les intellectuels, les cadres intermédiaires, les commerciaux, les paysans pauvres et moyens, ni même contre les artisans et les petits patrons. Mais ce ne sont pas ces classes qui peuvent et doivent diriger la révolution parce qu’elle ne sont pas révolutionnaires.
Elles ne dirigent rien. Mais c’est l’illusion de diriger la société qui émousse leur combativité et leur détermination.
D’autre part les blaireaux sur machines sont eux-mêmes beaucoup plus instruits que dans les années 70 où – sauf le chef du personnel – un bachelier dans une usine était un martien. Parce que ces machines sont devenues automatisées, puis interconnectées par des réseaux Ethernet, les employeurs ont voulu prendre la ceinture, les bretelles et le parachute, ils ont embauché des ouvriers bacheliers ou titulaires d’un BTS pour conduire des machines, mais aussi pouvoir les déplacer facilement d’un poste à un autre.
Pourquoi lorsqu’on propose à un ouvrier un travail plus complexe demande-t-il la rallonge d’abord ?
Et pourquoi le technicien se précipite tête baissée sans garantie d’être augmenté, reste jusqu’à point d’heure pour montrer qu’il est digne de tant d’honneur ?
Pourtant il y a peu de différences entre un ouvrier et un technicien.
Autrefois les électroniciens étaient appelés les « seigneurs ». Maintenant ils ont pratiquement disparu des usines parce qu’on ne répare plus les circuits imprimés. Idem pour les régleurs parce que les régulateurs de process sont auto adaptatifs et n’ont pratiquement plus besoin de réglage.
Et combien de grèves dans les banques ? Combien de grévistes à la BNP fin 2020 ?
Je ne cherche pas à décerner la médaille du bon gréviste, mais la grève traduit en actes la détermination des catégories sociales. Et c’est un pas très en deçà, mais un pas quand même vers des combats beaucoup plus conséquents.
Si elles veulent jouer un rôle révolutionnaire, les CISP doivent prendre exemple sur la classe ouvrière, adopter l’idéologie du prolétariat, le soutenir dans ses luttes, faire grève avec lui, bref se placer sous sa direction politique.
Et la dégradation des conditions de travail dans le secteur public a conduit des magistrats par exemple à se joindre de plus en plus souvent aux manifestations. C’est un pas positif dans ce sens.
L’histoire a montré par exemple en 1963 que le soutien des cadres à la grève des mineurs a favorisé la victoire. Mais ce sont les mineurs qui ont d’abord refusé la réquisition. Les cadres par eux-mêmes ne sont pas le fer de lance des luttes. Ce n’est pas une question de compétence ou de responsabilité, c’est une question d’idéologie.
Donc tendre la main bien sûr, mais pas pour se laisser mener par le bout du nez comme le PCF le fait avec Mélenchon en ce moment.
Parce que naturellement rien de ceci n’est possible si le parti du prolétariat lui-même est dirigé par des réformistes.
etoilerouge
Bien accord
LEMOINE Michel
Une anecdote pour conclure. En 2001 je travaillais dans une grande banque internationale. Après le 11 septembre, nous sommes réunis. Il y a là présents ou représentés les directions des principaux services (les CISP donc). Le présentant de la direction générale (ici la voix du capital) nous tient un discours délirant : nous sommes en guerre, ça va saigner, pas de pitié pour les canards boiteux etc. et le couperet tombe : les budgets sont réduits de 10% (il ne le dit pas mais tout le monde le comprend : il faut sauver les dividendes.)
10% en moins sur un budget annuel annoncés en septembre quand tout est engagé cela signifie l’abandon de tous les projets, l’arrêt de toute opération et le départ des sous-traitants. Ce sont donc les prolétaires qui trinquent.
Et ce sont les CISP, qui ont durement travaillé aux projets, ceux qui assurent par leur inventivité le développement de la banque qui doivent détruire leurs propres réalisations.
Cela permet de situer le rôle et le pouvoir des CISP dans l’économie capitaliste. Elle n’existe pas sans eux. Pourtant ils ne sont pas grand chose auprès du capital. Quant aux prolétaires, comme l’a dit Macron, ce sont des gens « qui ne sont rien » !
Peut-être que c’est cette situation inconfortable des CISP qui les amène à développer des idéologies de diversion par lesquelles ils miment la contestation faute de pouvoir contester effectivement.
etoilerouge
Soit les généraux défendent la révolution soit il faut les fusiller.