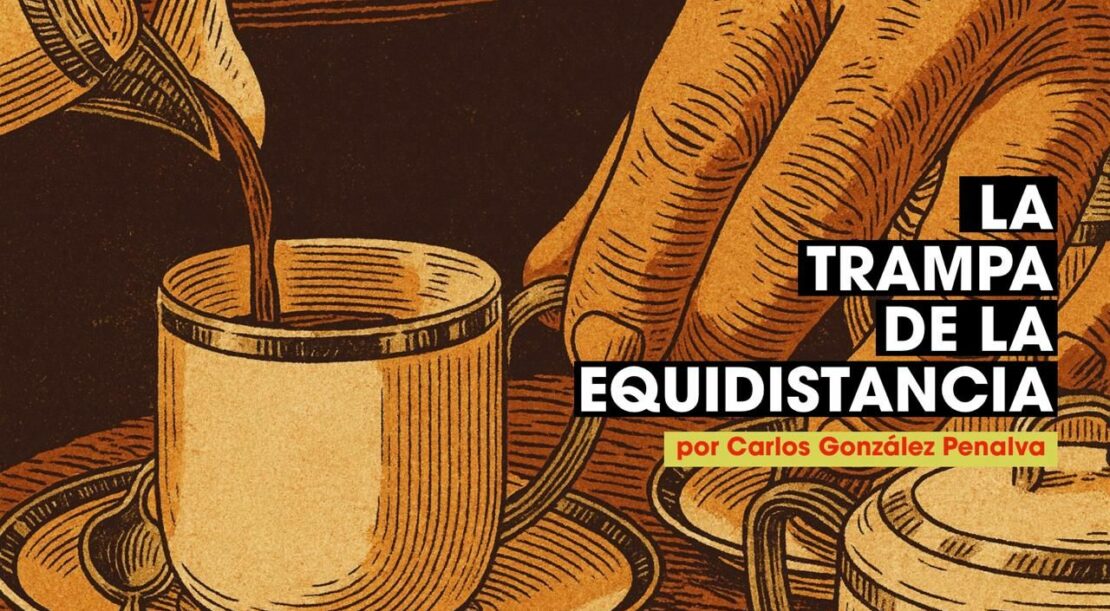Quand l’impérialisme n’a pas le pouvoir il tente de se présenter comme le pluralisme, quand il l’a comme aux Etats-Unis ou en France il obligent à la censure la plus totale y compris en exigeant des communistes qu’ils se « dénoncent » et que grace à ceux qui veulent bien jouer le jeu on en arrive à tolérer blocus, génocide, guerre sous prétexte de « démocratie » . Ici la jeunesse cubaine révolutionnaire démonte ce genre d’opération, « le pluralisme sous blocus » avec le scénario écrit par l’adversaire… «
Par : Carlos González PenalvaDans cet article : Cuba, Israël Rojas, Médias, Politique4 août 2025 |
La récente participation d’Israel Rojas, leader du duo Buena Fe, à l’émission La sobremesa de la plateforme numérique La Joven Cuba a suscité un débat intéressant en marge de l’intelligentsia révolutionnaire cubaine. Sa présence, polie mais ferme, honnête et sereine, a été célébrée par beaucoup comme un geste d’ouverture et de courage. Et c’est certainement le cas. Mais cette reconnaissance ne peut nous conduire à ignorer le terrain sur lequel se déroule l’échange. Parce qu’en politique – et surtout dans la bataille culturelle – le scénario compte autant que le mot, et qu’il n’y a pas de dialogue innocent lorsque le scénario est écrit par l’adversaire.
Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur WhatsApp Partager sur Telegram
La scène est présentée comme un dialogue entre différentes personnes, une conversation cubaine après le dîner dans une tonalité plurielle. Mais il s’agit d’une mise en scène parfaitement calculée : un espace conçu pour éroder de l’intérieur la légitimité symbolique du projet révolutionnaire, sous le masque du journalisme « critique » ou « indépendant ». La clé est précisément dans ce mot : indépendant. Indépendant de quoi ? Dont? Et avec quels moyens ?
Le problème n’est pas mineur. En période de guerre culturelle et de siège hybride, où l’adversaire bombarde non seulement avec des missiles économiques mais aussi avec des discours apparemment neutres, le choix de l’espace compte autant que le contenu du message. La Joven Cuba n’est pas n’importe quel forum : c’est une plateforme qui a reçu le soutien financier de l’ambassade de Norvège à La Havane, dont les lignes de coopération privilégient depuis plus d’une décennie la promotion d’un écosystème médiatique « alternatif » sur l’île. Mais alternative à quoi ? Pour les médias publics cubains, oui. Mais aussi, et plus sérieusement, une alternative au projet révolutionnaire lui-même, qu’il présente comme un anachronisme ou un autoritarisme déguisé en légitimité historique.
La stratégie n’est pas nouvelle. En 2011, sous le second mandat de Barack Obama, la politique de « changement de régime » à l’égard de Cuba a été ouvertement reformulée par le biais d’une ingénierie de consensus sophistiquée. Au lieu de miser sur la confrontation directe, la Maison-Blanche a promu une « société civile » cultivée artificiellement, avec le soutien logistique et financier de l’USAID, de la NED et de diverses ambassades européennes alliées. Dans ce contexte, les projets académiques, culturels et journalistiques se sont multipliés qui, sous la rhétorique des droits de l’homme, de la diversité des voix ou de la modernisation de l’État, ont en réalité promu une mutation idéologique : vider l’espace public de tout contenu révolutionnaire, et le remplacer par une fausse équidistance entre victime et bourreau, entre assiégé et agresseur.
Bien sûr, le problème n’est pas Israël Rojas. Sa présence dans l’espace a permis de faire apparaître, dans un environnement souvent réfractaire au débat honnête, la voix de Cuba qui résiste. Mais elle a aussi servi, involontairement, à la mise en scène d’un faux pluralisme : une conversation « entre égaux » qui assimile artificiellement le défenseur d’un projet révolutionnaire à ses adversaires stratégiques. Et cela, dans un pays assiégé économiquement, financièrement, politiquement et médiatiquement, n’est pas neutre : c’est un acte qui a des conséquences.
La guerre culturelle et la contre-révolution douce : le piège de l’équidistance
La politique étrangère des États-Unis à l’égard de Cuba a considérablement changé sous l’administration Obama, non pas dans ses objectifs, mais dans ses méthodes. Il ne s’agissait plus de renverser la Révolution par des marines ou par asphyxie directe, mais de promouvoir une « société civile » alternative qui, au nom de l’ouverture, introduirait les valeurs du libéralisme bourgeois – individualisme, méritocratie, pluralisme abstrait – dans le tissu idéologique cubain. C’est ce que Joseph Nye appellerait le soft power : ne pas imposer de l’extérieur, mais rendre la domination désirable de l’intérieur. Ce qu’Antonio Gramsci a analysé, à partir des coordonnées matérialistes, comme l’hégémonie culturelle.
À cette fin, tout un réseau de financement et de soutien institutionnel a été activé pour des projets médiatiques, académiques et artistiques qui, sans se déclarer ouvertement contre-révolutionnaires, remettaient en question la légitimité de l’État socialiste, remettaient en question le rôle du Parti communiste et proposaient une refondation démocratique dans une clé libérale. L’un des fruits les plus évidents de cette stratégie a été la prolifération de médias numériques tels que La Joven Cuba, dont le nom, soit dit en passant, constitue une appropriation symbolique de l’héritage d’Antonio Guiteras – un révolutionnaire profondément anti-impérialiste qui n’aurait jamais accepté de financement étranger pour sa cause.
Ici, une distinction essentielle est imposée : une chose est la critique de l’intérieur du processus révolutionnaire, comme forme dialectique de sa perfection, et une autre est la critique fonctionnelle du démantèlement du projet socialiste, financée et validée par ceux qui veulent sa fin. Cette critique n’en est pas une, c’est une contre-révolution douce, avec un visage amical et des manières académiques.
Israël Rojas, en tant qu’artiste engagé dans le destin collectif de son pays, a toujours défendu la Révolution à partir d’une position populaire, critique et créative. Sa présence dans La sobremesa n’enlève rien à cette trajectoire. Mais il est nécessaire de mettre en garde contre le cadre. En entrant dans ce décor, même avec les meilleures intentions, Israël devient – qu’il le veuille ou non – un élément de légitimation de l’appareil.
Le programme ne cherche pas simplement à parler. Il cherche à mettre en scène un dialogue d’« égal à égal » entre la Révolution et ceux qui, avec un sourire modéré, prônent son démantèlement. Ce qui est présenté comme pluralisme est, en réalité, une stratégie de normalisation de la contre-révolution sous le manteau de la diversité. Le problème n’est pas de débattre : il s’agit d’accepter comme interlocuteurs légitimes ceux qui reçoivent des fonds de l’étranger pour saper l’ordre constitutionnel cubain, surtout lorsque ces fonds proviennent d’ambassades comme la Norvège, qui finance depuis des années des projets audiovisuels, artistiques et journalistiques liés aux secteurs les plus actifs dans l’agenda de la restauration camouflés sous l’étiquette de « société civile ».
Gramsci a mis en garde contre l’utilisation du concept de « société civile » comme déguisement du pouvoir bourgeois, capable d’absorber les énergies intellectuelles et morales de l’adversaire afin de les neutraliser dans les limites du système. À Cuba, cette logique se reproduit à travers la création d’espaces hybrides, qui apparaissent pluriels, critiques et modernes, mais qui fonctionnent comme des dispositifs de légitimation d’une restauration capitaliste déguisée en citoyenneté critique. C’est le visage amical de la contre-révolution.
En ce sens, le lien entre ces opérations culturelles et des phénomènes tels que le 27N, le mouvement San Isidro ou la campagne d’influenceurs numériques qui, en pleine crise économique dérivée de l’intensification du blocus et de la pandémie, ont cherché à capitaliser sur le mécontentement populaire pour déclencher une rupture institutionnelle, ne peut être ignoré.
Il n’y a pas de symétrie face au siège
Le choix du nom La Joven Cuba n’est pas un geste innocent. Il cherche à établir une fausse continuité entre l’héritage héroïque d’Antonio Guiteras – tombé au combat contre l’impérialisme yankee et ses marionnettes locales – et un espace qui, au lieu de lutter contre le pouvoir mondial, est financé avec ses miettes. Comme l’a rappelé Carlos Fernández de Cossío, l’opposition à la Révolution est une contre-révolution, quel que soit son nom de famille. Et le fondateur de l’original La Joven Cuba n’avait pas besoin et n’aurait jamais accepté d’aide étrangère pour entreprendre son lutte.
Gramsci insistait sur le fait que la bataille pour l’hégémonie n’était pas seulement menée dans les parlements ou les usines, mais dans les écoles, les journaux, les universités, les théâtres. Aujourd’hui, on pourrait dire aussi sur les réseaux sociaux, les podcasts et les médias numériques. Et Cuba, en état de siège permanent, n’a pas le luxe d’accorder la neutralité à ces fronts. Pas quand la liberté de la presse, comme l’a averti Rafael Correa, continue d’être la volonté du propriétaire de la presse à imprimer. Et le propriétaire, dans ce cas, n’est pas cubain.
Ce qui est en jeu n’est pas un débat académique ou une conversation postmoderne entre sensibilités idéologiques. Ce qui est en jeu, c’est la capacité d’un pays bloqué, attaqué et criminalisé à défendre sa souveraineté politique, son modèle social et sa légitimité historique. Dans ce contexte, tout espace qui cherche à mettre sur le même plan la Révolution et ses adversaires financés n’est pas un espace de dialogue : c’est un piège sémiotique, une scène soigneusement mise en scène pour déplacer l’axe du sens commun au consensus libéral.
Participer à cette scène, ce n’est pas seulement parler : c’est contribuer à la production d’un nouveau scénario, où la Révolution apparaît comme l’une des nombreuses options possibles, dépourvue d’exceptionnalité morale et historique. Et c’est là que réside le danger.
Défendre la Révolution cubaine aujourd’hui implique non seulement de résister aux attaques économiques, mais aussi de lire clairement les signes du moment. Dans la guerre des cultures, les formes comptent : l’espace, le langage, le dialogue, le financement. Il ne s’agit pas de rejeter le débat, mais de ne pas céder le terrain. Il ne s’agit pas de censurer, mais de démasquer. Et il ne s’agit pas d’attaquer ceux qui participent par honnêteté, mais de dénoncer l’architecture qui permet à l’adversaire de se déguiser en modéré.
La défense du projet socialiste exige de l’intelligence, de la subtilité et du courage. Et il faut aussi ne pas oublier qu’en politique, comme en dramaturgie, la scène n’est jamais neutre. Parfois, même le monologue le mieux joué peut finir par légitimer la mauvaise pièce.
Parfois, participer n’est pas dialoguer, mais valider. Et valider l’adversaire sur son terrain, avec ses règles, c’est céder une bataille de plus dans cette guerre prolongée par la conscience des peuples.
Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur WhatsApp Partager sur Telegram
Views: 18