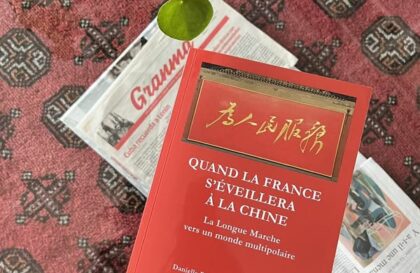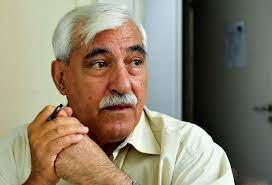Voir le monde à travers le regard de l’autre, dans une société de classe, et dans un monde dominé par l’impérialisme occidental (d’abord les empires coloniaux français et britannique, puis l’impérialisme US et ses vassaux), c’est donc voir le monde que l’on ne nous montre pas, puisque le regard de l’idéologie dominante, parfaitement construit (comme nous le montrons aujourd’hui dans un autre article) nous est imposé et présent. C’est voir le monde du point de vue des prolétaires et des pays-prolétaires que sont les pays du dit « Sud global ». D’où l’importance du regard et de la photo, mais comme nous l’exprime ci-dessous Danielle Bleitrach, il y a aussi le regard du critique qui nous livre la photo en occultant une partie de ce qu’elle montre et en introduisant quelque chose qui n’est pas sur l’image, mais qu’il surimpose d’autorité. C’est toute notre époque, radicalement différente de celle où Brel, avec sa poignante chanson « au suivant » dénonçait les bordels de campagne des armées occidentales. Mais cette époque se termine et, comme nous le dit Danielle, des peuples monte une autre voix. (note de Franck Marsal pour Histoire&Société)
Le texte de présentation ci dessous prétend opposer la mise en scène au regard du quotidien du jeune soldat russe. Une fraîcheur qui toujours selon le commentaire éviterait « la mise en scène » d’un fait historique qui marque malheureusement pour eux à jamais les esprits, mais aussi qui ignorerait ce que selon la propagande occidentale auraient accompli son armée… pas la moindre trace de violence sexuelle dans ce regard dit le commentaire… Et si là n’était pas la réalité celle d’un peuple qui n’aimait pas la guerre et qui n’a même pas voulu la rappeler aux criminels qui l’avaient faite et lui avaient imposé tant de morts et tant d’horreur. Un peuple qui encore aujourd’hui pense la guerre autrement. je viens de recevoir un livre de Constantin Simonov (l’auteur des vivants et les morts) : Staline et la guerre, des entretiens avec Joukov et d’autres généraux, maréchaux(1). Je l’ai à peine feuilleté, mais déjà je le considère, comme ces regards de jeunes russes dans Berlin, comme une pièce au dossier qui sera ré-ouvert à partir des peuples qui font l’histoire et la subissent. (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
1) Constantin Simonov . Staline et la guerre, entretiens avec Gueorgui Joukov, Ivan Koniv, Ivan Isskov, Alexandre Vassilivski traduit du russe par Simone Perez et François Eychart . Le temps des cerises. 2025
22 juillet 2025

Archives – 22 juillet 2020
Être à Berlin en avril et mai 1945, c’était assister à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et aux premiers jours d’une nouvelle époque de l’histoire du monde. La photographie la plus célèbre de l’époque montre le drapeau rouge avec une étoile, un marteau et une faucille levés au-dessus du Reichstag. L’événement s’est vraiment produit mais la photo était une séance photo. Un cliché extrêmement dramatique et pris à un moment historique mais, néanmoins, un événement mis en scène pour la caméra. Les photographies prises par Valery Faminsky dans les rues de la capitale allemande en avril et mai ne sont pas mises en scène. C’était un jeune Russe, engagé par l’armée pour documenter les soins médicaux pour les soldats blessés. Accrédité de cette façon, il a pu se déplacer librement dans la ville. C’est ce qu’il a fait et en faisant son travail, il a également profité de l’occasion pour prendre des photos de moments quotidiens dans les rues, non seulement de soldats soviétiques, mais aussi de citoyens allemands.

De retour en Russie fin mai avec son trésor de négatifs, Faminsky ne les a jamais fait connaître. Ils ont été découverts par ses petits-enfants qui les ont mis en vente sur Internet. Achetés il y a trois ans et maintenant publiés, leur authenticité et leur valeur remarquables sont évidentes, soixante-quinze ans après leur prise.
L’œil de Faminsky est attiré par ce qui devenait le quotidien à une époque extraordinaire: les soldats se détendent; soignent des camarades blessés; commémorant ceux qui sont morts. Il accorde une attention égale aux Berlinois qui sont sortis des caves et essayent de refaire leur vie: faire la queue pour la nourriture; recueillir l’eau dans des seaux; chacun portant quelque chose qui contient des objets précieux. Physiquement, ils sont vivants, les dommages psychologiques sont étouffés, les débris qui les entourent signifient l’effondrement d’une idéologie monstrueuse.
Le travail de Faminsky recèle la promesse insaisissable de ce que Paul Levinson appelle «la conception immaculée de la photographie»: une pure objectivité préservée dans le temps. Le Russe qui parcourait les rues de la capitale allemande nous montre des morceaux de réalité vécue qui existaient à l’époque, capturés par son apparatus non vivant.
Nous savons tous, bien sûr, que ce n’est pas aussi simple que cela. La transparence dans la photographie documentaire ne peut être tenue pour acquise; l’image du drapeau levant sur le Reichstag avait de la fumée, prise d’une autre image, ajoutée pour créer une atmosphère et, sur le bras d’un des soldats sur le toit, une montre-bracelet (vraisemblablement une pillée) a été éditée.
Compte tenu de sa provenance, il est extrêmement improbable que le travail de Faminsky ait jamais été trafiqué, mais l’absence de quelque chose d’important constitue-t-elle également une forme de médiation? Une photo de lui montre une femme seule en train de lire une lettre et, même si cela peut être perçu comme poignant, le fait que, fin avril et mai, des viols systématiques (100 000 pourraient être une estimation conservatrice) avaient lieu dans les ruines de Berlin est occulté. Son appareil photo ne voit aucune preuve de la violence sexuelle et Faminsky lui-même ignorait peut-être ce que faisait l’armée à laquelle il appartenait. Se référant aux images de Berlin après la capitulation, Ariella Aïsha Azoulay fait valoir dans Potential History, que « les photographies devraient toujours être étudiées en relation avec ce que l’obturateur cherchait à garder déconnecté de ce que nous sommes invités à voir ». Elle appelle à un décodage qui révèlera ce qui n’a pas été visualisé.
Dieter Keller, servant dans l’armée allemande, a été déployé dans la zone frontalière entre la Biélorussie et l’Ukraine en 1941-2. Bien qu’il lui soit interdit de le faire, il a pris des photos et a ramené les négatifs en contrebande en Allemagne. Désormais publiées pour la première fois sous le nom de Das Auge des Krieges («l’œil de la guerre»), les images troublantes de Keller contrastent fortement avec celles de Faminsky.
Les photographies soigneusement composées pourraient être des images fixes d’un film artistique sombre comme Ida de Pawlikowski et, comme ce film, elles évoquent des souvenirs troublants de périodes sombres. L’Holocauste en Biélorussie et en Ukraine a été perpétré lors de massacres en groupe, pas dans des camps de la mort, et les photos de Keller de fermes en flammes, d’enfants, de cadavres et de morceaux de corps dans la neige le rappellent, même s’ils ne documentent pas spécifiquement la Shoah.
Dans d’autres photos étudiées, de bâtiments, de paysages et du froid hivernal, le style esthétisé de Keller crée une beauté désolée et austère qui est, pour le moins, étrange à la lumière du contexte historique. Comme pour les réponses au Triumph of the Will de Leni Riefenstahl, des questions éthiques insistent pour être posées.
Les photographies de ces deux livres, du même éditeur, sont aussi précieuses qu’authentiques et soulèvent des questions contestées sur la photographie documentaire.
Valery Faminsky Berlin Mai 1945 et Dieter Keller’s Das Auge Des Krieges sont publiés par Buchkunst Berlin

Views: 35