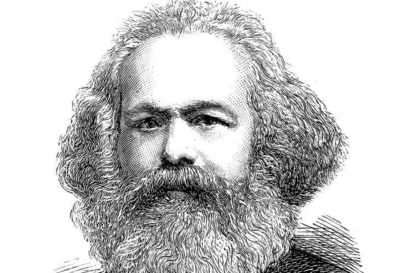Le professeur Wang Jisi de l’Université de Pékin (PKU) est l’un des observateurs les plus éminents de l’Amérique en Chine. Wang est le président fondateur de l’Institut d’études internationales et stratégiques de la PKU, ancien doyen de la School of International Studies de la PKU et président honoraire de l’Institut d’études internationales de la PKU. Né à Canton (aujourd’hui Guangzhou), en novembre 1948, il a passé la majeure partie de sa vie à Pékin. Il est diplômé de la prestigieuse école secondaire affiliée de l’Université de Pékin en 1968. Après avoir terminé ses études secondaires au plus fort de la Révolution culturelle, Wang a été envoyé à la campagne pour servir en tant qu’éducateur en Mongolie intérieure. Là, il a passé sept ans à travailler dans la bannière d’Ujimqin Est. En 1975, il est réaffecté au Henan, recruté comme ouvrier à la centrale hydroélectrique du barrage de Sanmenxia. En 1978, deux ans après la fin de la Révolution culturelle, Wang a été admis dans le programme de politique internationale de l’Université de Pékin, où il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise. Ce parcours fait songer à celui de Xi Jinping et de beaucoup de cadres actuels qui ont subi la révolution culturelle n’en ont pas tiré que du négatif au contraire et ont trempé dans l’acier des convictions mais le réalisme aussi. En particulier, il n’y a pas d’hostilité de principe aux Etats-Unis, peut-être la conscience que le temps de l’apprentissage est terminé et que la Chine doit à son tour conduire la barque et tenir le gouvernail. Mais il n’y a pas de sagesse à prétendre éliminer ce qui est destiné à coexister avec vous. Les Etats-Unis ne disparaitront pas. Il y reste le conseil de Deng Xiaoping, ne te fais pas remarquer mais nous sommes devenus trop gros, on ne peut pas nous ignorer… mais il ne faut pas exagérer nos performances, il est plus confortable de ne pas revendiquer trop tôt la charge de première puissance du monde. (note et traduction de l’anglais par Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Voici un extrait de ses analyses sur la situation américaine à l’égard de la Chine sous le mandat Trump :
Q : Trump a fait pression sur les alliés des États-Unis pour qu’ils augmentent leurs budgets de défense. Comment cette approche intransigeante pourrait-elle remodeler les relations de l’Amérique avec ces pays ?
R : Sous le second mandat de Trump, les relations transatlantiques sont sur le point de connaître plus de turbulences que sous Biden, en particulier sur des questions telles que le commerce international, les obligations de défense et la politique climatique. Dans le même temps, les pays européens eux-mêmes diffèrent dans leurs points de vue à l’égard de Washington, et bien que Trump puisse essayer de creuser un fossé entre eux, il serait prématuré de déclarer la fin de la cohésion occidentale. Les appels à augmenter les dépenses de défense en pourcentage du PIB reflètent à la fois une nouvelle demande de l’administration Trump envers les alliés de l’OTAN et une décision que certaines grandes puissances européennes prennent indépendamment par souci du futur paysage de sécurité de l’Europe. En Asie, malgré de subtils changements de politique intérieure au Japon et en Corée du Sud, le système d’alliance américain en Asie de l’Est reste fermement intact. Pendant ce temps, la politique étrangère de l’Inde est devenue de plus en plus indépendante, s’efforçant d’éviter de se faire des ennemis et montrant une réticence à prendre parti entre la Chine et les États-Unis.
Q : Dans quelle mesure la décision de Trump de retirer les États-Unis des principales institutions internationales affectera-t-elle le soft power du pays ? Comment ce changement pourrait-il influencer la puissance et la position internationale de l’Amérique ?
R : Au cours des dernières années, le soft power américain a connu un déclin constant, et cela semble être une tendance à long terme. Le soft power américain provient traditionnellement de deux sources : premièrement, l’attrait de son système politique, de ses valeurs et de son mode de vie ; Deuxièmement, la réputation et l’influence de son comportement dans les affaires internationales. Sur le plan intérieur, la démocratie américaine est confrontée à de sérieux défis, à tel point que peu de pays considèrent encore aujourd’hui le modèle politique américain comme un modèle pour le leur. Cela dit, cela ne signifie pas que les systèmes politiques contraires gagnent nécessairement en attrait. La gestion par les États-Unis du conflit au Moyen-Orient, en particulier leur favoritisme manifeste envers Israël, a été largement impopulaire. La récente proclamation de Trump de « prendre le contrôle de la bande de Gaza » n’a fait que susciter l’indignation mondiale.
Le retrait de l’administration Trump des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé et l’Accord de Paris, ainsi que les affirmations territoriales de Trump sur le Canada, le canal de Panama et le Groenland – au mépris flagrant du droit international et de la souveraineté nationale – sapent clairement le soft power des États-Unis. Pourtant, malgré le défi ouvert de l’Amérique aux règles et normes mondiales sous Trump, il y a encore eu une réaction mondiale coordonnée. La plupart des pays restent fragmentés dans leurs réponses, et il y a peu de perspectives d’une « alliance anti-américaine ».
Lorsque l’hégémonie américaine rejette la retenue morale et les contrôles intérieurs, elle est capable d’une audace choquante. Dans mon article de 2003 « La logique de l’hégémonie américaine », j’ai cité l’historien Arthur Schlesinger Jr., qui a vivement critiqué la tendance culturelle de l’Amérique à la violence – à tel point qu’il a appelé les Américains « le peuple le plus effrayant de cette planète », parce que ni les atrocités nationales ni les atrocités internationales n’avaient jamais éveillé la conscience morale des dirigeants américains. L’Amérique que je connais n’a jamais été particulièrement bienveillante dans sa conduite à l’étranger. Alors que les élites américaines sont parfois capables d’une profonde autocritique, elles sont très unies, nationalistes et souvent dominatrices dans les relations étrangères. Les États-Unis sous Trump semblent plus désireux d’instiller la peur par leur puissance dure que de gagner le respect par leur puissance douce.
Même si son soft power s’estompe, le hard power de l’Amérique continue de croître. En termes de production totale, de qualité économique et de capacité technologique, les États-Unis dépassent de loin l’Europe, le Japon, le Canada et l’Australie. Bien que la part de l’Occident dans le PIB mondial ait considérablement diminué au cours des deux dernières décennies, la part de l’Amérique est restée à peu près stable à environ 25 %, ce qui suggère que son poids économique au sein du monde occidental est en fait en augmentation.
Ce n’est que par rapport à la Chine que la puissance dure de l’Amérique apparaît relativement diminuée. Le fossé entre la Chine et les États-Unis d’un côté, et les autres grandes puissances de l’autre, se creuse. Bien que l’Inde fasse figure d’exception, elle est loin d’être en mesure d’égaler la Chine ou les États-Unis à court terme. Il est temps d’entreprendre une réévaluation complète et nuancée des relations sino-américaines. équilibre de puissance. En tant que deux plus grandes économies du monde, l’écart de PIB entre elles continue de fluctuer dans une certaine fourchette. À un niveau plus granulaire, comme dans les semi-conducteurs, l’IA et la robotique, l’équilibre technologique entre les deux pays présente un paysage très complexe. Ces comparaisons exigent une analyse approfondie et des données empiriques. À mon avis, la Chine et les États-Unis sont les deux nations les plus puissantes du monde, mais l’équilibre des pouvoirs entre elles n’a pas subi de changement transformateur. Il n’y a pas non plus d’indication claire que le potentiel de développement à long terme des États-Unis est plus faible que celui de la Chine. Il reste à voir l’impact complet de la refonte intérieure de Trump sur la force globale de l’Amérique.
Q : En tant que principal architecte de l’ordre international actuel et ancienne puissance hégémonique, les États-Unis sont de plus en plus imprudents dans leur conduite mondiale. Quel regard portez-vous sur son comportement international actuel ?
R : Dans la société internationale, les relations entre les États étaient autrefois régies par une sorte d’entente tacite – des normes partagées, des normes de conduite acceptées et des frontières implicites. La plupart des pays gèrent généralement les relations bilatérales selon des procédures établies. Mais ces dernières années, les États-Unis ont activement sapé le système westphalien, au mépris des principes fondamentaux de souveraineté. Tant que quelque chose sert leurs propres intérêts, les États-Unis ont agi de manière imprudente et sans retenue, sans se soucier des règles internationales ou des besoins et intérêts des autres nations. Lorsque le pays le plus puissant du monde abandonne ses principes et perd sa boussole morale, il devient profondément dangereux, capable d’infliger de grands dommages à l’échelle mondiale. L’Amérique d’aujourd’hui s’est de plus en plus éloignée de l’image que le monde en avait autrefois. Bien que de nombreux pays observent et tentent toujours de parvenir à des compromis avec les États-Unis dans la mesure du possible, le malaise et l’insatisfaction face à son comportement international sont clairement en hausse.
Le pivot diplomatique de Trump s’aligne sur une tendance mondiale plus large vers la droite. Dans le monde occidental, de plus en plus de factions populistes de droite peuvent devenir des forces dominantes dans les gouvernements ou exercer une influence politique plus forte. Un développement notable aujourd’hui est que de nombreuses forces politiques de droite dans le monde partagent des points communs idéologiques avec l’administration Trump et recherchent son soutien. En ce sens, l’influence internationale de l’Amérique sous Trump pourrait augmenter, et son impact perturbateur et destructeur sur l’ordre international pourrait devenir plus prononcé. Pour donner un sens au monde d’aujourd’hui, il est essentiel d’adopter non seulement une perspective de relations internationales, mais aussi de reconnaître les changements politiques mondiaux sous-jacents, en particulier les inégalités croissantes, la montée du populisme de droite, l’innovation technologique qui perturbe les structures économiques et sociales traditionnelles, et l’évolution des valeurs et des modes de vie des milléniaux et de la génération Z, etc.
IV. Sino-États-Unis Relations : une concurrence persistante, il reste encore de la place
Q : Sur quoi se concentrera-t-elle dans la stratégie chinoise du second mandat de Trump ? Si son administration pousse au découplage dans les domaines de la technologie, des chaînes d’approvisionnement clés et des échanges entre les peuples, nous dirigeons-nous vers deux « mondes parallèles » ? Et bien que Trump ne soit pas idéologique, comment son administration pourrait-elle encore cibler la Chine pour des raisons idéologiques ?
R : La concurrence stratégique de l’administration Trump avec la Chine sera davantage concentrée sur le commerce et la technologie, plutôt que sur les droits de l’homme, les systèmes politiques ou les questions traditionnelles de sécurité nationale. Sur le front économique, Trump a menacé pendant sa campagne de révoquer le statut de nation la plus favorisée de la Chine, d’imposer des droits de douane de 60 % sur les exportations chinoises vers les États-Unis, d’arrêter progressivement les importations de tous les biens essentiels en provenance de Chine et d’éliminer la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine dans tous les secteurs critiques. Certaines de ces déclarations sont probablement exagérées. S’ils étaient pleinement mis en œuvre, ils nuiraient aux intérêts économiques des États-Unis.
Trump cherche à obtenir des avantages dans le domaine du commerce – il est ouvert aux investissements chinois aux États-Unis dans certains secteurs et accueille favorablement davantage d’exportations vers la Chine. Cependant, la position personnelle de Trump à l’égard de la Chine ne s’aligne pas entièrement sur l’orientation stratégique plus large du gouvernement américain. L’ampleur des revers subira des revers au commerce bilatéral dépend des mesures spécifiques adoptées par son administration. Les frictions sont susceptibles de s’intensifier dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les véhicules électriques et les métaux rares, mais un découplage complet reste peu probable.
D’après mon expérience personnelle, même si Huawei n’a pas le droit de vendre ses produits aux États-Unis, je peux toujours utiliser un téléphone Huawei là-bas, à condition d’ajuster quelques applications. Dans les domaines liés au bien-être public, tels que la R&D, l’approbation réglementaire et la circulation transfrontalière des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, il reste encore beaucoup à faire. La Chine continuera également d’importer de grandes quantités de produits agricoles américains. Les entreprises des deux pays jouent toujours un rôle stabilisateur dans le commerce bilatéral, agissant comme des « soupapes de pression ».
J’ai parlé à de nombreux entrepreneurs dans les deux pays. Les entrepreneurs chinois, qu’ils travaillent dans des entreprises publiques ou privées, espèrent tous élargir leurs liens commerciaux avec les États-Unis et éviter le découplage. Ils croient sincèrement qu’il s’agit d’une situation gagnant-gagnant. La plupart des hommes d’affaires américains veulent également protéger leurs intérêts économiques en Chine et augmenteraient leurs investissements s’ils en avaient l’occasion. En raison de la pression exercée par les extrémistes et du « politiquement correct » qui règne à l’égard de la Chine, ils sont souvent incapables d’exprimer ouvertement leur soutien à la poursuite des relations sino-américaines. La coopération économique et commerciale, mais ils continuent à faire pression dans les bureaux fédéraux, étatiques et du Congrès dans les coulisses. Cette interdépendance mutuelle, y compris la circulation des personnes et les échanges sociétaux, ne peut être entièrement rompue. Bien sûr, les forces d’extrême droite aux États-Unis s’efforcent de mettre fin aux échanges scientifiques, technologiques et entre les peuples avec la Chine – et il y a même une nouvelle vague de maccarthysme. Cependant, il n’est plus possible pour les relations sino-américaines de revenir à l’isolement du début de la guerre froide.
La relation sino-américaine la rivalité entre les systèmes sociaux et les idéologies persistera au cours du second mandat de Trump. Bien que Trump lui-même ne mette pas l’accent sur l’idéologie, il ne peut pas modifier le consensus politique dominant de Washington sur la Chine. Dans les partis démocrate et républicain, il est largement admis que le système politique et l’idéologie de la Chine sont en opposition directe avec ceux des États-Unis. De nombreux conseillers et personnes nommées par Trump ont des mentalités de guerre froide et de sérieux préjugés contre la Chine. Lors de l’élection présidentielle de 2024, Trump a violemment critiqué le « socialisme démocratique » et la « gauche radicale » comme des menaces pour les États-Unis, accusant la candidate démocrate Kamala Harris de pencher vers le socialisme. Son populisme conservateur reflète de profonds changements dans le paysage idéologique américain. Au fur et à mesure que la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine s’intensifie, la militarisation de l’idéologie deviendra plus prononcée, façonnant la compétition entre les deux pays sur l’ordre national et international.
Par conséquent, le gouvernement américain est susceptible de continuer à exercer une pression idéologique sur la Chine – en faisant du battage publicitaire et en sanctionnant le prétendu « travail forcé » au Xinjiang, en s’engageant avec les forces séparatistes tibétaines et en soutenant les soi-disant militants « pro-démocratie » de Hong Kong. En ce qui concerne Taïwan, je m’attends à ce que l’administration Trump n’abandonne pas officiellement la politique d’une seule Chine ou ne soutienne pas « l’indépendance de Taïwan », mais qu’elle soutienne probablement le gouvernement du Parti démocrate progressiste (DPP) dans la mise à niveau de ses systèmes d’armement et l’augmentation des dépenses militaires. Pourtant, ces questions ne seront pas au cœur de la politique chinoise du second mandat de Trump. Trump n’approuve pas personnellement les stratégies de changement de régime et n’invoque pas fréquemment la rhétorique démocratique libérale comme le font de nombreux démocrates. Cependant, il n’empêchera pas le Congrès ou les agences exécutives de continuer à exercer des pressions idéologiques sur la Chine, et pourrait utiliser de manière opportuniste de telles tactiques pour obtenir des concessions dans d’autres domaines politiques.
Q : Le gouvernement américain affirme qu’il ne rejette pas la coopération avec la Chine, mais ces dernières années, la coopération réelle a semblé moins importante que prévu. Selon vous, qu’est-ce qui a causé cette situation ? Au cours du second mandat de Trump, la marge de manœuvre pour les relations sino-américaines La coopération s’étend ou se contracte ?
R : La réalité objective des relations sino-américaines est que les deux pays ont besoin de coopération pour parvenir au développement. Cependant, l’objectif de Trump de « rendre sa grandeur à l’Amérique » entre fondamentalement en conflit avec l’aspiration de la Chine à un rajeunissement national. Aux yeux du courant politique dominant américain, les États-Unis ne peuvent pas être « grands à nouveau » à moins d’affaiblir la puissance de la Chine. Sur les grandes questions de principe, il y a peu de place pour le compromis.
Cela dit, Trump lui-même est intéressé à conclure des « accords » avec la Chine et est prêt à engager le dialogue. Cela présente des opportunités tactiques pour la Chine. Il est à la fois nécessaire et souhaitable pour la Chine de s’engager avec l’équipe Trump pour comprendre sa pensée et ses intentions. Cela signifie que, même si l’espace de coopération dans les domaines de la haute technologie et du commerce continuera de se réduire, il reste une volonté et un potentiel de coopération dans d’autres domaines. Par exemple, les deux pays souhaitent renforcer la communication entre militaires et explorer des mécanismes de prévention et de gestion des crises. Cependant, les restrictions internes et les obstacles procéduraux dans les deux pays ont entravé un dialogue constructif. Si les deux gouvernements parviennent à conclure certains accords au cours des prochains mois – pour élargir les canaux de dialogue dans des domaines tels que le commerce, les affaires militaires, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la lutte contre les stupéfiants – il pourrait y avoir un moyen de stabiliser la relation bilatérale et de répondre à des préoccupations communes dans les années à venir. Contrairement à Biden, Trump est plus ouvert aux « transactions ». Cela pourrait augmenter le potentiel et l’espace de coopération entre la Chine et les États-Unis et aider à éviter une confrontation directe.
Q : Au cours de vos conversations avec des responsables et des universitaires américains, avez-vous observé des changements notables dans leurs attitudes et leurs positions envers la Chine ?
R : Il existe aujourd’hui un consensus stratégique fondamental au sein de la politique et des communautés universitaires américaines concernant le caractère de la Chine, la nature des relations sino-américaines. et l’ampleur du défi que la Chine pose aux États-Unis. Une vision bipartisane et largement partagée s’est enracinée : pour la prochaine décennie, et probablement au-delà, la Chine sera la plus grande menace pour la sécurité, le défi le plus sérieux et le concurrent le plus puissant auquel les États-Unis seront confrontés. La caractérisation actuelle des relations sino-américaines en tant que « concurrence stratégique » et l’objectif global de « surpasser » la Chine sont les résultats inévitables des stratégies internes et externes sous les deux mandats de Trump et de l’administration Biden. Presque personne à Washington ne décrit encore la Chine comme un ami ou un pays que les États-Unis pourraient gagner. La plus grande source de suspicion américaine réside dans la croyance que l’objectif stratégique de la Chine n’est pas seulement de réaliser un rajeunissement national, mais aussi de saper, et peut-être de renverser, l’ordre international dirigé par les États-Unis, et de déplacer ou de remplacer la domination mondiale des États-Unis.
À ce stade, débattre des intentions stratégiques de la Chine avec les responsables et les universitaires américains a peu d’effet. Il existe une croyance dominante et profondément ancrée que la puissance croissante de la Chine pose un défi aux États-Unis, et que cette montée alimentera inévitablement l’ambition de Pékin de se battre pour le leadership mondial. Nombreux sont ceux qui, à Washington, pensent que la seule raison pour laquelle la Chine n’a pas encore pris de mesures plus agressives est qu’elle n’a pas la capacité de le faire. Une fois cette capacité acquise, supposent-ils, la Chine agira. Les États-Unis accordent également peu de confiance aux dénégations officielles de la Chine concernant de telles intentions, en partie à cause de la rhétorique anti-américaine trouvée sur les médias sociaux chinois.
Au sein de la communauté politique américaine, les désaccords actuels tournent principalement autour des stratégies spécifiques pour traiter avec la Chine. Les États-Unis emploient une série de mesures pour réprimer la Chine, dans le but de l’empêcher d’acquérir de plus grandes capacités. Cependant, on craint également qu’une action trop rapide ou trop énergique ne déclenche une confrontation directe, ne cause des pertes inacceptables aux États-Unis et ne provoque de graves réactions internationales. Ainsi, le débat central à Washington se concentre maintenant sur la façon de calibrer une stratégie chinoise qui entrave l’ascension de la Chine sans franchir le seuil d’une guerre chaude.
Q : Le nombre d’« experts de la Chine » aux États-Unis est-il en baisse ? Dans les conditions actuelles, que peut-on faire pour promouvoir les échanges entre la Chine et les États-Unis afin de renforcer la compréhension mutuelle et d’éviter les erreurs de jugement ?
R : Je ne crois pas que le nombre d’experts de la Chine aux États-Unis diminue ; Au contraire, nous ne nous engageons tout simplement pas assez avec eux. Aux États-Unis, il y a beaucoup d’universitaires spécialisés dans la Chine, et il existe un fossé générationnel clair entre eux. Des experts de haut niveau comme David Lampton et Kenneth Lieberthal ont une connaissance plus large et une compréhension plus complète de la Chine. Pendant ce temps, les jeunes chercheurs tels qu’Evan Medeiros, Ryan Hass, Scott Kennedy, Jude Blanchette et Rush Doshi ont tendance à avoir de meilleures compétences en langue chinoise et des spécialisations profondes dans leurs recherches. Ils ont également une bonne compréhension des conditions nationales de la Chine, bien que leurs opinions politiques divergent souvent considérablement des nôtres. La question clé n’est pas de savoir s’il y a moins d’experts de la Chine aux États-Unis, mais comment nous pouvons renforcer le dialogue avec eux.
Depuis le premier mandat de Trump, et en particulier pendant la pandémie de COVID-19, les échanges entre les peuples de la Chine et des États-Unis ont considérablement diminué. Il ne suffit pas de se fier uniquement aux livres, aux sites Web et aux appels vidéo pour comprendre l’autre pays ; Seule l’interaction en face à face entre les individus peut vraiment améliorer la compréhension mutuelle. À mon avis, le moyen le plus efficace de renforcer la compréhension entre les deux parties n’est pas seulement de résoudre les problèmes de visa ou d’étendre les exemptions de visa, mais d’offrir un soutien pratique aux échanges entre les groupes de réflexion et les institutions universitaires. Il est essentiel d’éliminer des obstacles spécifiques, d’envoyer plus de chercheurs pour le travail sur le terrain dans l’autre pays et de créer un environnement plus ouvert et plus pratique pour les visites universitaires. De nombreux universitaires en Chine et aux États-Unis sont prudents à l’idée de visiter leur pays respectif, en partie à cause des difficultés de visa, mais plus souvent en raison de préoccupations concernant les barrières d’entrée potentielles, les risques pour la sécurité personnelle et les limites de communication ou d’expression. Ces préoccupations ne sont pas sans fondement ; Ils sont basés sur des expériences réelles.
Ce n’est que par le biais de discussions substantielles et perspicaces sur des sujets concrets, tels que le commerce, la technologie, les affaires militaires, la cybersécurité et l’intelligence artificielle, que la compréhension mutuelle entre la Chine et les États-Unis pourra être approfondie de manière significative. Les universitaires chinois doivent mener des recherches rigoureuses, publier des idées originales et établir des canaux de communication efficaces avec les décideurs politiques et les professionnels de l’industrie. Ce n’est qu’ainsi que la valeur des échanges pourra être reconnue par leurs homologues américains. Il ne suffit pas de discuter de questions trop larges ou abstraites. En plus d’aborder les questions politiques, les universitaires chinois devraient approfondir leur engagement face aux défis du monde réel dans les zones rurales, le secteur des affaires, la défense nationale et la recherche scientifique du pays. Les universitaires chinois spécialisés dans les études américaines devraient rechercher activement des opportunités de mener des travaux sur le terrain aux États-Unis et maintenir le dialogue avec les professionnels de la science et de la technologie, de l’industrie, de la finance et des affaires stratégiques dans les deux pays. Cela permettra d’accumuler les connaissances et l’élan nécessaires pour faire progresser les échanges entre les peuples et les discussions sur les politiques.
Views: 131