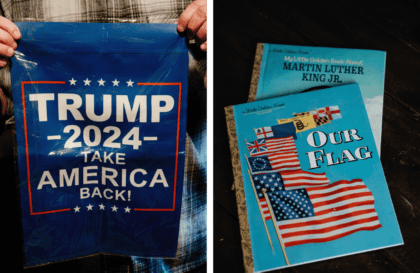Dans le jeu émergent de la géopolitique maritime de l’Arctique, de nombreux atouts se trouvent entre les mains des Russes et des Chinois. C’est une des grandes leçons de la période, pendant que les Etats-Unis avec Trump marchandent, que l’Europe et le Canada jouent les otages volontaires tentant de négocier le poids des chaînes et n’osent pas franchir le pas de leur possible libération, d’autres pays font et installent le monde nouveau dans les faits. Il faut analyser la manière dont partout y compris dans la conquête de l’espace le partenariat stratégique de la Russie et de la Chine mais aussi en Afrique, les deux pays avancent. Qu’on le veuille ou non face au réchauffement de l’Arctique, l’idée de ce que peut en faire Trump et sa bande de mafieux fait frémir alors que comme nous l’analysons dans notre livre il y a dans la Russie et actuellement dans la Chine une autre conception environnementale malgré ou à cause de l’accélération de leur propre développement et de ses conséquences, il y a la planification, et toute une réflexion sur l’économie des ressources. Ce devrait être la préoccupation collective, celle du destin commun de l’humanité. (note et traduction de Danielle Bleitrach histoireetsociete)
par Kent E. Calder 30 avril 2025

Nulle part sur terre le réchauffement climatique ne progresse plus rapidement qu’à l’intérieur du cercle polaire arctique. Au cours des deux dernières décennies, l’Arctique s’est réchauffé de cinq degrés Celsius. Et la tendance s’accélère, l’Arctique se réchauffant près de quatre fois plus rapidement que le reste de la planète.
Les climatologues s’attendent à ce que les températures médianes de l’Arctique augmentent de 2 degrés Celsius par an au cours de la prochaine décennie.
Bien que les températures changent normalement à la vitesse glaciaire, dans l’Arctique, ces transformations sont maintenant perceptibles à l’œil nu : l’année dernière a marqué une augmentation inquiétante des incendies de forêt et des inondations dans l’Arctique.
Et, alors que le changement climatique se poursuit sans relâche, les eaux de la mer Arctique, qui s’étendent des côtes sibériennes du nord de la Russie au Groenland en passant par l’Alaska, s’ouvrent à un rythme sans précédent. Pour la première fois dans l’histoire, la navigation commerciale régulière dans l’Arctique a atteint un tel niveau de régularité.
Les tentatives de faire le tour de l’Eurasie ne sont certainement pas nouvelles. Il y a près de trois siècles, en 1728, Vitus Bering contournait le détroit entre l’Alaska et la Sibérie qui porte son nom pour explorer les mers polaires.
Ce n’est que dans les années 1870 que la route de la mer du Nord traversant la côte russe de l’Arctique a été entièrement parcourue par les explorateurs. Et ce n’est qu’en 2013 qu’un navire commercial a fait tout le long voyage vers le nord de l’Europe à l’Asie, même avec l’escorte d’un brise-glace.
Pourtant, au cours de la dernière décennie, les mers arctiques sont devenues beaucoup plus navigables. En conséquence, la géopolitique arrive rapidement dans la région, une tendance que je décris dans mon récent livre, Eurasian Maritime Geopolitics.
Pour commencer, les enjeux économiques sont plus élevés que jamais. L’Arctique est un vaste entrepôt inexploité de matières premières essentielles à la 21St siècle. La région abrite environ un quart des réserves inexplorées de pétrole et de gaz naturel de la planète, ainsi que 150 gisements de terres rares, évalués à environ 1 billion de dollars. Le platine, le nickel et d’autres métaux rares stockés sous l’océan sont cruciaux pour les industries de haute technologie, et donc pour les pays et les entreprises qui cherchent à préserver leur statut de puissance industrielle.
La mer Arctique, d’environ 1,5 fois la taille des États-Unis, est relativement peu profonde, ce qui la rend propice à l’exploitation, si les conditions climatiques le permettent, avec 240 espèces de poissons en grandes quantités, s’ajoutant à toutes les ressources inanimées.
Les enjeux politico-militaires sont aussi élevés que les enjeux économiques, le système international étant de plus en plus polarisé et l’Arctique étant la principale pomme de discorde. L’océan Arctique est une zone d’une importance inhabituelle et une zone naturelle de conflit en raison de sa valeur géographique. C’est de l’autre côté du pôle Nord que les États-Unis et la Russie se trouvent à proximité la plus proche, faisant des mers arctiques une arène naturelle de rivalité à l’ère nucléaire.
La même réalité géopolitique a épisodiquement rendu le Groenland important : ce n’est pas un hasard si les États-Unis ont présenté une offre d’achat du Groenland en 1946 ; que les États-Unis ont maintenu une base majeure du Strategic Air Command dans le nord du Groenland depuis 1951 ; ou que le président Donald Trump a également été obsédé par le Groenland.
Les conflits internationaux actuels amplifient les dimensions économiques et militaires de la concurrence dans l’Arctique.
La Russie, en particulier, a de forts intérêts à ce que le statu quo soit révisé dans les voies maritimes de l’Arctique qui émergent rapidement. Cinquante-trois pour cent du littoral arctique se trouve en Russie (contre moins de 4 % pour l’Alaska américain). La Voie maritime du Nord, le long des côtes septentrionales de l’Arctique russe, devient navigable à mesure que le continent se réchauffe plus rapidement que du côté canado-américain.
L’ouverture de l’océan Arctique au commerce et au transport naval donne à la Russie un accès sans entrave à la haute mer qu’elle a recherchée pendant des siècles – de Pierre le Grand à Vladimir Poutine – mais qu’elle n’a jamais obtenue de manière décisive ailleurs dans le monde.
L’Arctique est également devenu une zone de fort intérêt géoéconomique et géopolitique pour la Chine ces dernières années. Les ressources énergétiques de l’Arctique sont naturellement attrayantes pour le plus grand consommateur d’énergie de la planète. La Chine est particulièrement motivée pour gagner la course à l’exploration de l’Arctique parce qu’elle importe massivement du golfe Persique via les voies maritimes vulnérables de l’Indo-Pacifique qui sont dominées par les États-Unis.
Une fois accessible à la Chine, l’Arctique résoudrait le problème de l’étranglement américain des points d’étranglement tels que le détroit de Malacca. Cela augmenterait également l’avance de Pékin dans les minéraux critiques, ce qui compliquerait davantage les efforts de Washington pour rivaliser efficacement. Et les liens sympathiques de Pékin avec la Russie, une force puissante dans l’Arctique, sont un atout géopolitique supplémentaire.
Les enjeux économiques et politico-militaires mondiaux qui alimentent la concurrence géopolitique actuelle dans l’Arctique ont commencé au ralenti. En août 2007, la Russie a planté un drapeau en titane au pôle Nord. Moscou revendique maintenant tranquillement plus de 50 % du sol de l’océan Arctique.
Il y a deux décennies, avec Vladimir Poutine au pouvoir, la Russie a commencé à rénover les bases militaires de la guerre froide dans le Nord et à construire davantage de brise-glaces. Aujourd’hui, il compte plus de 40 bases, soit environ un tiers de plus que le total combiné de toutes les grandes puissances de l’OTAN dans le proche Arctique, y compris la Finlande, le Canada et les États-Unis.

Sur le plan économique, la Russie a également été la première à exploiter les ressources énergétiques le long des côtes de l’Arctique – avec l’aide de la Chine.
Les propositions initiales de Moscou, il y a deux décennies, devaient impliquer des multinationales occidentales telles qu’Exxon, Shell et British Petroleum, avec leur technologie supérieure pour le forage dans les climats arctiques. Cependant, les entreprises occidentales se sont rapidement retirées, à la fois pour des raisons économiques et à la suite des sanctions associées à l’invasion russe de la Crimée en 2014.
En 2013, la Russie a commencé la construction de l’énorme projet Yamal LNG de 27 milliards de dollars sur les côtes arctiques, avec la société chinoise CNPC comme actionnaire à 20 %. Le premier train Yamal LNG a été achevé en 2017.
En 2018, la Russie a également commencé la construction du projet Arctic II de la péninsule de Gydan, toujours avec la participation de l’Asie de l’Est. En échange de la fourniture de capitaux et d’équipements, la Chine reçoit aujourd’hui du pétrole russe de ces projets spécifiques – et le fait illégalement par le biais de la route maritime du Nord.
Au début du XXIe siècle, la logique économique – les ressources massives de la Russie, associées à l’essor économique de l’Asie – a propulsé le développement progressif des voies maritimes de l’Arctique pendant quinze ans. Pourtant, ce sont des moments critiques – des périodes courtes et abruptes de transformation structurelle comme la guerre – qui ont catalysé l’ère de la géopolitique maritime sérieuse de l’Arctique qui prévaut actuellement.
Les sanctions occidentales à la suite de l’occupation de la Crimée par la Russie ont été un événement catalyseur, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a été bien plus importante. Cela a entraîné plusieurs changements géoéconomiques et géopolitiques radicaux qui ont animé l’intense géopolitique maritime de l’Arctique qui émerge maintenant.
Le changement climatique, comme indiqué ci-dessus, est un facteur de fond silencieux qui augmente les enjeux des conflits géopolitiques : lorsque les mers sont ouvertes, les opportunités économiques et politico-militaires deviennent plus réalistes.
Cependant, les réponses décisives des principaux acteurs à la nouvelle agression russe ont donné un nouveau souffle explosif aux rivalités géopolitiques latentes. Plus important encore, la Finlande (avril 2023) puis la Suède (mars 2024) sont devenues membres de l’OTAN. À la suite de leurs actions, sept des huit pays bordant directement l’Arctique étaient membres de l’OTAN, seule la Russie – avec le plus long littoral arctique et les enjeux économiques les plus forts – en étant exclue.
Il n’est pas surprenant que la Russie ait réagi au nouvel environnement géopolitique entourant le conflit ukrainien par ses propres contre-mesures. Comme Poutine l’a lui-même souligné, le développement de l’Arctique est une « priorité indiscutable » pour la Russie, en raison de son importance stratégique et de son potentiel économique.
Pour consolider sa position dans une région vitale, Moscou a à la fois intensifié ses propres actions provocatrices dans l’Arctique, comme dans les mers Baltiques, et s’est simultanément associée à la Chine pour faire pression sur l’OTAN et sur les États-Unis au niveau bilatéral.
En 2023, des navires des marines russe et chinoise ont patrouillé conjointement près de l’Alaska ; en juillet 2024, des bombardiers russes et chinois ont lancé une sonde collaborative dans l’ADIZ américaine au-dessus de la mer de Béring, à moins de 200 miles de la côte de l’Alaska ; et en octobre 2024, les garde-côtes russes et chinois ont effectué leur première patrouille conjointe dans les mers arctiques.
Les États-Unis ont naturellement réagi à la politique de la corde raide de la Russie et de la Chine dans l’Arctique. En 2013, à la suite du premier transit dans la Voie maritime arctique du brise-glace chinois Xue Long (Dragon de glace) et de l’inauguration du projet russe Yamal LNG, l’administration Obama a élaboré une stratégie américaine pour l’Arctique.
En 2014, Washington a fait du contrôle de l’approvisionnement en technologie avancée de forage pétrolier en eau froide des États-Unis un élément majeur des sanctions contre la Crimée. En 2024, le ministère de la Défense de l’administration Biden a publié une mise à jour de la stratégie de 2013, mentionnant la Russie et la Chine comme principaux challengers, dans le but de freiner la capacité de développement à long terme de la Russie dans l’Arctique.
Les États-Unis n’ont cessé de faire preuve de plus en plus d’audace dans leur réponse à l’Arctique, en mettant de plus en plus l’accent sur la région.
Malgré des gestes diplomatiques clairvoyants et une préoccupation louable concernant les dangers environnementaux, les États-Unis ont néanmoins été lents à relever les principaux défis géoéconomiques qui s’aggravent actuellement le long des voies maritimes de l’Arctique.
Plus important encore, les États-Unis n’ont pas réussi à développer leur capacité nationale de brise-glace, ni n’ont commencé à développer des capacités navales connexes qui leur permettraient de contester activement et de contenir le renforcement rapide de la Russie et de la Chine le long des voies maritimes de l’Arctique.
Et jusqu’à récemment, il a fait remarquablement peu pour soutenir ses amis de l’Arctique en ce qui concerne le soutien aux investissements dans les infrastructures. Les États-Unis, par exemple, n’ont pas de ports en eau profonde de l’Arctique pour accueillir des porte-conteneurs lourds. Le Canada n’en a qu’un, situé à 500 milles au sud du cercle polaire arctique.
Même si la Russie dispose aujourd’hui de plus de 40 brise-glaces, dont plusieurs à propulsion nucléaire, et d’un programme de construction actif, les États-Unis n’ont actuellement qu’un seul brise-glace lourd ou moyen actif dans l’Arctique. La capacité des brise-glaces américains, telle qu’elle est, est entièrement concentrée dans les Grands Lacs.
L’accord ICE de juillet 2024 avec le Canada et la Finlande, conclu lors du sommet de l’OTAN à Washington en 2024, commence à aborder la crise des brise-glaces de manière multilatérale. Pourtant, la carence massive de la capacité des États-Unis en matière de brise-glaces, enracinée dans les faiblesses frappantes de sa propre industrie nationale de construction navale, persiste.
Dans le jeu émergent de la géopolitique maritime de l’Arctique, trop d(atouts sont encore entre les mains des Russes et des Chinois.
Kent Calder est directeur du Reischauer Center for East Asian Studies à l’Université Johns Hopkins SAIS, ancien conseiller spécial de l’ambassadeur des États-Unis au Japon et auteur récent de Eurasian Maritime Geopolitics (Brookings, 2025).
Views: 2