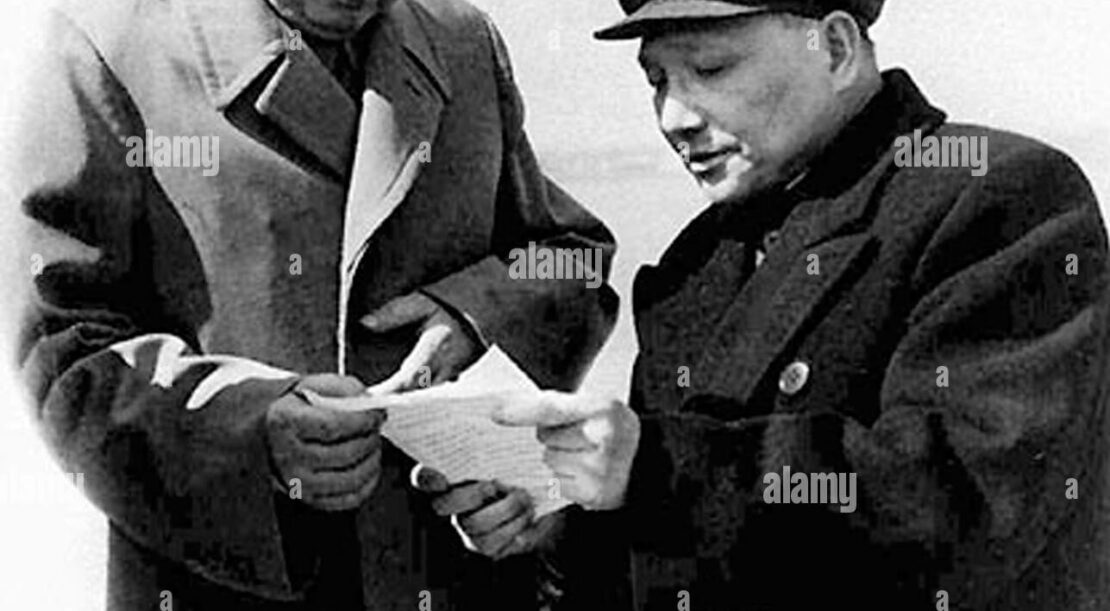La Seconde Guerre mondiale a commencé en Asie pendant la guerre des années 1930 entre la Chine et le Japon. Mais la Chine n’a pas été invitée à la conférence de Yalta de 1945 des Trois Grands (États-Unis, URSS et Empire britannique) qui devait mettre fin à la guerre et négocier l’ordre mondial d’après-guerre. La Chine était l’allié oublié. Nous reprenons ici le dernier envoi de cet universitaire australien jeff Rich qui nous présente des travaux d’autres universitaires anglosaxons qui procèdent comme nous le faisons dans histoireetsociete, et dans notre livre qui vient de sortir, en tentant de mettre à jour une autre histoire, non seulement celle de la Chine mais également de toute la part de « notre » histoire, nous les êtres humains qui nous a été volée parce qu’on a prétendu et l’occident prétend encore ne voir que ce qui légitime sa domination. Celle d’un système d’exploitation et de pillage dont les « valeurs », liées à la lutte des classes en leur sein, au génie contestataire de leurs savants et artistes, ont été salies et rendues hypocrites en tant que drapeau impérialiste… La démocratie a besoin d’être défendue et débarrassée de ceux qui encore aujourd’hui en arrivent à retourner au fascisme et nous avons des alliés y compris chez les chercheurs et intellectuels qui n’acceptent plus le narratif « officiel ». (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

Bienvenue à la quatrième semaine de mon Tour de l’Histoire du Monde de la Chine. Le livre d’histoire recommandé cette semaine est Rana Mitter, Forgotten Ally : China’s World War II 1937-1945 (2013).
Les prises de guerre
Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, trop d’Occidentaux oublient les sacrifices de la Chine dans cette guerre. Ils ignorent comment l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Chine est une tragédie dans laquelle la souveraineté nationale moderne a été gagnée, malgré la guerre, la guerre civile, l’intervention étrangère impériale et 14 à 20 millions de morts. Ils imaginent que les États-Unis ont mené le monde sur la voie de l’ordre mondial d’après-guerre. Ils ignorent comment les dirigeants américains de l’après-guerre déplorent la « perte de la Chine » qu’ils avaient exploitée, commandée et trompée depuis 1842.
Et ils oublient ce que l’allié des États-Unis ressentait à l’égard des grandes puissances qui se sont rencontrées à Yalta en 1945. Tchang Kaï-chek, le principal des trois dirigeants de la Chine divisée en temps de guerre, ne se faisait aucune illusion sur la faiblesse de la Chine ou sur les valeurs qui ont motivé la façon dont les États-Unis, l’URSS et l’Empire britannique ont construit l’ordre mondial d’après-guerre. « La Chine est le plus faible des quatre Alliés », a-t-il écrit lors d’une tournée diplomatique aux États-Unis.
« C’est comme si une personne faible avait rencontré un kidnappeur, un hooligan et un tyran. »
Tchang Kaï-chek
Tchang a anticipé la rhétorique de l’ancien secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, dans une phrase plus brutale. Ses alliés traitaient leurs amis ou alliés de la même manière lorsqu’ils étaient hors de la pièce. Ils « vous considèrent comme de la viande sur la planche à découper ».
Paradoxalement, cependant, la faiblesse de la Chine l’a emporté sur le kidnappeur (Churchill, Empire britannique), le hooligan (Staline, URSS) et l’intimidateur (Roosevelt, États-Unis). Elle est devenu le premier signataire de la charte des Nations Unies. Mitter écrit :
En août 1945, la Chine se trouvait à la fois dans la position mondiale la plus forte qu’elle ait jamais occupée et plus faible qu’elle ne l’avait été depuis près d’un siècle. Lorsque la guerre a commencé, elle était encore soumise à l’extraterritorialité et à l’impérialisme. Maintenant, non seulement le système tant détesté d’immunité juridique pour les étrangers avait pris fin, mais la Chine était sur le point de laisser sa marque dans le monde de l’après-guerre. Pour la première fois depuis 1842, lorsque l’empire Qing avait signé le traité de Nankin, le pays était à nouveau pleinement souverain. De plus, la Chine était désormais l’une des « quatre grandes », l’une des puissances qui joueraient un rôle permanent et central dans la formation de la nouvelle Organisation des Nations Unies, et la seule non européenne.
(Mitter, Forgotten Ally, p. 362)
Le récit de Mitter de ce paradoxe de la force et de la faiblesse a inspiré le récit de Klaus Mühlhahn sur la création de la Chine moderne et des idées plurielles de la nation, au milieu du désordre de 1900 à 1940. J’ai esquissé le chemin vers la guerre et la nation dans ma plongée en profondeur cette semaine : Bouleverser l’Empire et Reconstruire la République. En bref, elle avait lutté avec et contre les empires pour remporter le prix de la souveraineté nationale moderne. Mais le peuple chinois a payé un prix terrible.
Avant Yalta, Tchang Kaï-chek avec Roosevelt et Churchill à la conférence du Caire en 1943
Le prix de la guerre
« La guerre avec le Japon », écrit Mitter, « avait vidé la Chine de sa substance. » Elle a frôlé la désintégration, maintenue violemment par des armées. Le pays était divisé politiquement entre nationalistes, communistes et collaborateurs des idées panasiatiques du Japon. Sa géographie stratégique avait changé avec un nouvel accent sur l’extrême sud-ouest. Elle a subi des bombardements catastrophiques de ses villes, des massacres et des crimes de guerre, la famine, des viols, des morts au combat et un nombre total de morts estimé entre 14 et 20 millions de Chinois. Jusqu’à 100 millions de personnes, soit un cinquième de la population chinoise, ont été déplacées ou forcées de fuir en tant que réfugiés. Sa relation avec son ami infidèle, les États-Unis, avait été empoisonnée par la personne de Vinegar Bob Stilwell, qui canalisait toutes les pires caractéristiques de l’Amérique : les préjugés raciaux, le mépris de la civilisation et l’arrogance militaire. Les divisions en Chine avaient fait ressortir le pire avec Tchang Kaï-chek, qui avait transformé le rêve de Sun Yat-sen d’une république généreuse en cendres d’un régime nationaliste répressif. Mitter écrit :
La nation avait de grandes visions, mais la réalité était la faim de masse, la corruption officielle et un État de sécurité brutal qui tentait en vain de réprimer les aspirations d’un peuple qui avait été exhorté à développer un sens de l’identité nationale et exigeait maintenant un État qui corresponde à son nouveau sens de lui-même. Il y avait un sentiment de changement généralisé dans le pays à l’étranger.
(Mitter, L’Allié oublié, p. 363)
Mitter ne raconte pas seulement la haute diplomatie et les batailles de la Seconde Guerre mondiale en Chine. Il transmet l’expérience tragique et cicatrisante de cette guerre. Dans la deuxième partie : Catastrophe, il décrit les événements les plus désastreux de la guerre, tels que le bombardement de Shanghai, la crise des réfugiés suite à l’invasion japonaise, le massacre de Nankin et la destruction des barrages pour inonder le fleuve Jaune.
À la fin de 1937, Tchang Kaï-chek défendit Shanghai. Il a parié sur l’intervention des puissances occidentales, mais les « puissances occidentales, bien qu’elles se tordaient les mains sur le sort de la Chine (et les marchés qu’elles souhaitaient exploiter), n’ont presque rien fait pour aider à ce stade » (Mitter, p. 107). Les nationalistes perdirent terriblement, perdant 187 000 soldats en trois mois. Les poètes britanniques, W.H. Auden et Christopher Isherwood, ont été choqués par la dévastation de Shanghai et la lâcheté mercenaire des empires occidentaux, quelques mois avant Munich 1938. Zhou Fohai, qui collaborera plus tard avec le Japon, en a tiré une amère leçon. Il a écrit : « Notre destin a été scellé. Où seront nos lieux de sépulture ? ».
Après la capture rapide par les Japonais de villes à travers la Chine, y compris dans le nord de Beiping et Tianjin, une crise majeure de réfugiés a émergé. Des millions de personnes ont fui, y compris dans le centre de la Chine le long du fleuve Yangtze vers les refuges de Chongqing et de Wuhan. Mitter partage des témoignages personnels des réfugiés, y compris le souvenir ultérieur d’un réfugié selon lequel la fuite de tant de personnes vers la base nationaliste de Chiang Kai-shek à Chongqing a été comme un Dunkerque chinois. Mitter compare également cette fuite des loyalistes de Tchang Kaï-chek à la Longue Marche, la retraite légendaire des forces communistes fuyant les forces nationalistes de Tchang ; et montre ainsi que dans la mémoire de la guerre, tous les héros ne sont jamais égaux.
Mitter souligne également comment le chemin de la Chine vers la guerre a créé une société amère et violente qui était impitoyable envers les choix difficiles que les gens faisaient pour survivre à la guerre, ce qui signifiait parfois collaborer avec les occupants. Comme nous l’avons vu dans l’analyse approfondie de cette semaine, les décennies précédant la Seconde Guerre mondiale ont vu la Chine tourner le dos à une culture politique pluraliste et devenir polarisée, conflictuelle et militarisée. « La culture de la guerre constante », a écrit Mitter, « a conduit à une violence profonde et omniprésente qui imprégnait la société chinoise. » Les civils se sont joints aux soldats pour tuer et traquer leurs opposants, les étrangers et les collaborateurs, connus sous le nom de hanjian, pour signifier qu’ils avaient perdu le droit d’être chinois. Il cite un récit d’escouades itinérantes jouant des actes de violence en représailles.
« Un jour, ils ont amené huit collaborateurs, et chacun d’eux portait un haut chapeau en papier, sur lequel étaient clairement écrits le nom de chacun, ses détails personnels et son comportement perfide. Ils ont été placés dans un véhicule et emmenés dans les rues, et l’escouade a utilisé un très gros tambour, le battant au fur et à mesure… Les rues étaient pleines de gens qui regardaient ces collaborateurs, et tous d’une seule voix les ont insultés et maudits ».
(Du Zhongyuan citant Mitter, Forgotten Ally, p. 121)
Les sociétés qui sont honteuses de la défaite, déplacées par le chaos et ravagées par la guerre perdent rapidement leur civilité. Je crains que ce ne soit déjà le sort de l’Ukraine, comme je l’ai évoqué dans mon entretien avec Marta Havryshko.
Mitter discute également des atrocités et des viols de masse épouvantables du massacre de Nankin, au cours duquel le Japon a cherché à faire comprendre à la Chine les conséquences de sa résistance au Japon. Mitter présente une explication subtile des atrocités qui n’étaient pas les seules atrocités de la guerre, mais un massacre prémédité. Il était poussé d’en bas par la colère chthonienne.
L’armée japonaise était profondément en colère. Elle avait supposé qu’elle conquerrait rapidement la Chine et que le manque de résistance rencontré lors des incursions précédentes entre 1931 et 1937 se répéterait. La force de l’opposition et le temps qu’il a fallu pour sécuriser Shanghai avaient enragé des troupes déjà attisées par la propagande sur la justesse de leur cause, et qui avaient elles-mêmes été brutalisées par leur entraînement militaire au Japon.
(Mitter, Forgotten Ally, p. 142)
Combien de fois devons-nous apprendre qu’une fois les chiens de guerre lâchés, personne ne peut contrôler les événements ?
Mais le Japon n’a pas été le seul auteur de crimes de guerre dans cette guerre. En juin 1938, sur ordre de Tchang Kaï-chek, les forces nationalistes détruisirent les barrages contrôlant le fleuve Jaune. Leur intention était de ralentir l’avancée des forces japonaises. L’effet a été d’inonder les terres de leurs propres citoyens.
Le magazine Time a rapporté que :
« Un mur d’eau de cinq pieds s’est déployé sur une zone de 500 miles carrés, semant la mort. Les inondations du fleuve Jaune ne sont pas tant dues à des noyades rapides qu’à des maladies et à la famine progressives. La boue de la rivière se dépose jusqu’aux chevilles sur les champs, détruisant les germes, étouffant les récoltes. La semaine dernière, environ 500 000 paysans ont été chassés de 2 000 communautés pour attendre les secours de la mort sur le sol sec qu’ils pouvaient trouver ».
Mais bien que les nationalistes aient amorcé les explosifs, ils n’avaient pas préparé d’intervention d’urgence. On estime que 500 000 à 900 000 personnes sont mortes et que près de 5 millions sont devenues des réfugiés. Cet acte n’a pas eu beaucoup d’effet militaire, mais comme l’écrit Mitter :
Dans la lutte qui faisait rage au sein de l’âme du Parti nationaliste, la tendance insensible et calculatrice avait gagné, pour le moment. La rupture des digues a marqué un tournant car les nationalistes ont commis un acte dont ils ont finalement dû expier les terribles conséquences.
(Mitter, L’Allié oublié, p. 164)
Les personnalités de la guerre
L’histoire de Mitter nous fait passer par tous les événements majeurs de la guerre, depuis ces premiers désastres, lorsque la Chine se battait seule, en passant par l’adhésion de la Chine à une guerre mondiale et à une alliance empoisonnée après Pearl Harbour, lorsque la Grande-Bretagne et les États-Unis ont pris la décision tardive de se battre avec la Chine.
Il personnalise l’histoire à travers les trois dirigeants de la Chine divisée en temps de guerre : Tchang Kai-shek, Mao Zedong et Wang Jingwei. Chiang et Wang avaient été des rivaux à la direction du Guomindang à droite et à gauche du parti, respectivement. Wang Jingwei ferait le choix fatidique de diriger le gouvernement collaborationniste avec le Japon. C’est une grande vertu du livre de Mitter qu’aucun de ces trois dirigeants ne soit présenté comme une caricature. Vous pouvez comprendre leurs choix. Dans le cas de Wang Jingwei :
Le groupe de Wang considérait la négociation d’une paix juste comme la seule solution réaliste à la crise de la guerre. Ils étaient nourris d’un véritable enthousiasme idéologique qui les rendait plus enthousiastes à un avenir panasianiste qu’à une alliance avec la Grande-Bretagne ou l’Amérique, puissances dont le comportement impérialiste en Chine ne les rendait guère préférables aux Japonais.
(Mitter, L’Allié oublié, p. 207)
Mitter explique avec perspicacité l’interaction complexe des grands États – le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS – forçant la main des personnalités qui dirigeaient la Chine divisée pendant la guerre. Il souligne la dévastation, les conséquences et la contingence de la guerre, et comment chacun de ces dirigeants représentait un avenir alternatif pour la Chine, qui, avec un autre coup de dés, aurait pu modeler l’ordre mondial d’après-guerre. Il défige l’histoire et la mémoire publique de la Seconde Guerre mondiale en Occident et en Chine.
« Pourtant, l’une des conclusions les plus importantes que nous puissions tirer de l’histoire de la Chine en temps de guerre pourrait encore être malvenue en Chine. Et c’est la nature contingente de la voie de la Chine vers la modernité. Les trois hommes qui ont cherché à gouverner la Chine pendant la guerre – Tchang Kaï-chek, Mao Zedong et Wang Jingwei – incarnaient incarné une voie différente vers le même objectif : un État chinois moderne et nationaliste ».
(Mitter, Forgotten Ally, p. 377)
Rana Mitter aborde le thème de la façon dont la mémoire publique en République populaire de Chine a honoré l’une de ces voies plus que les autres dans son ouvrage sur le nationalisme et les « circuits de la mémoire », China’s Good War : How World War II Is Shaping a New Nationalism (2020). Les circuits de mémoire décrivent comment les institutions transmettent géographiquement et chronologiquement la mémoire collective de la guerre. Alors que le rôle de la Chine dans le monde a changé, que les marées de la mondialisation changent, la Chine a rebranché les circuits de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de l’ordre mondial de l’après-guerre. Mitter note :
Pékin soutient maintenant que la Chine a été l’un des créateurs de l’ordre qui a émergé en 1945, et que la menace pour cet ordre vient des États-Unis, et non de la Chine. La Chine est en train de créer un circuit de mémoire pour renforcer sa position et son autorité aux niveaux national et international, ainsi que pour rivaliser avec le circuit de mémoire établi de longue date qui nourrit le récit des États-Unis libérant l’Asie-Pacifique. Au fur et à mesure que la Chine devient plus puissante, le monde devra accorder plus d’attention aux histoires qu’elle veut raconter. Que nous en soyons conscients ou non, nous vivons tous dans le long après-guerre de la Chine.
(Mitter, La bonne guerre de la Chine, pp. 260 et 261)
Si vous n’aimez pas les histoires de guerre, alors China’s Good War offre une autre façon de recâbler les circuits de la mémoire dans votre perception de la place de la Chine dans le monde. Mais je recommande la lecture de l’histoire compatissante, sage, équilibrée et perspicace de Rana Mitter sur l’allié que l’Occident a oublié et sur la Seconde Guerre mondiale en Chine. Comme il l’écrit dans sa dernière phrase :
« Et en reconnaissant leurs souffrances, leur résistance et les terribles choix qu’ils ont été forcés de faire, nous, en Occident, faisons également plus honneur à nos propres mémoires collectives et à notre compréhension de la Seconde Guerre mondiale ».
(Mitter, Forgotten Ally, p. 379)
🙏❤️🌏
Jeff
© 2025 Jeff Rich
PO Box 2098, Forest Hill 3131, Victoria, Australie.
Views: 40