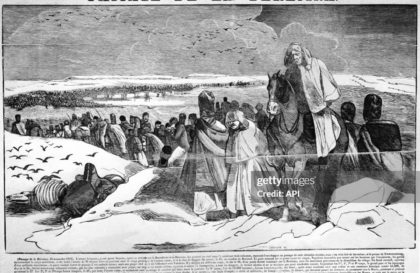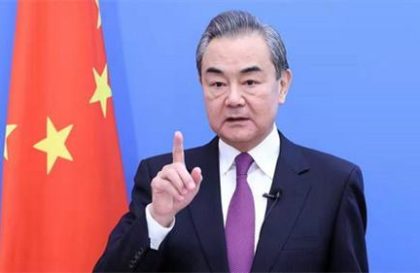Voilà une importante contribution à la question de savoir si la Russie est une puissance impérialiste et si la guerre qu’elle mène est impérialiste ou si elle subit le choc de l’impérialisme en crise hégémonique en tant qu’alliée de fait de la Chine socialiste, ce qui est notre position. (note de danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop pour histoireetsociete)
https://svpressa.ru/blogs/article/460809
Depuis de nombreuses années, les hautes instances russes appellent à la souveraineté de la Russie. On affirme même parfois que nous l’avons déjà atteinte. Hélas, on fait passer nos désirs pour la réalité.
On crée l’illusion que la souveraineté nationale peut être conciliée avec le système socio-économique qui existe en Fédération de Russie depuis sa naissance. Et si l’on parle souvent de souveraineté, il existe un tabou tacite sur la définition du système socio-économique qui s’est développé en Russie. Ce système s’appelle le « capitalisme ». Et aujourd’hui, presque tous les États de la planète suivent la voie du capitalisme.
Le seul à avoir brisé ce tabou est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lors de son discours au Forum international de Valdaï en 2021. Voici un extrait de son discours : « Les problèmes socio-économiques de l’humanité se sont aggravés à un point tel que, dans le passé, ils ont provoqué des bouleversements à l’échelle mondiale (guerres, révolutions)… Tout le monde dit que le modèle capitaliste actuel, qui est aujourd’hui le fondement de l’ordre social dans la grande majorité des pays, a fait son temps. Dans ce cadre, il n’y a pas d’issue à l’enchevêtrement des contradictions… La répartition inégale des biens matériels conduit à une inégalité croissante… ».
Le président a ici abordé un aspect important du capitalisme : la répartition inégale (on pourrait dire injuste) des richesses et des biens matériels entre les personnes. Il faut supposer qu’il faisait référence à la répartition inégale tant au sein des États qu’entre les pays. Les inégalités socio-économiques ne sont qu’une des manifestations de l’« enchevêtrement de contradictions » du capitalisme évoqué par Poutine.
Une autre manifestation de ce phénomène est le fait que presque tous les pays, par la voix de leurs dirigeants, proclament leur indépendance ou leur lutte pour l’indépendance. C’est-à-dire leur souveraineté nationale. La souveraineté est proche de la notion d’indépendance. Elle est parfois définie comme la priorité des intérêts nationaux dans la politique étrangère et intérieure d’un pays.
Le président américain Donald Trump a proclamé et continue de proclamer la souveraineté nationale de son pays. Il est vrai qu’il n’utilise pas souvent le mot « souveraineté ». Ainsi, dès son premier mandat, en septembre 2017, lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Trump a déclaré : « La souveraineté, la sécurité et la prospérité sont les trois piliers sur lesquels repose le monde ». Il a également appelé tous les pays à défendre leur souveraineté.
Le célèbre slogan MAGA (« Make America Great Again », « Rendre sa grandeur à l’Amérique »), comme l’a expliqué à plusieurs reprises Trump, est la priorité des intérêts nationaux des États-Unis. Ses prédécesseurs à la Maison Blanche ont oublié cette priorité, et c’est pourquoi il se battra pour la rétablir.
Certains politiciens américains se permettent d’évaluer plus sévèrement l’état de la souveraineté nationale des États-Unis. Ils constatent son affaiblissement, voire son absence. À titre d’exemple, je citerai le projet de loi qui a été soumis à la Chambre basse du Congrès américain en 2022 par le député Mike D. Rogers.
Ce document s’intitule « Loi sur le rétablissement de la souveraineté américaine » (The American Sovereignty Restoration Act). Selon l’auteur du projet de loi, l’adhésion des États-Unis à l’Organisation des Nations unies (ONU) prive l’Amérique de sa souveraineté. L’idée principale du document est que les États-Unis doivent immédiatement quitter l’ONU.
En coulisses, Trump et ses partisans discutent également plus ouvertement de la question de la souveraineté nationale des États-Unis et parviennent à la conclusion qu’elle a été largement perdue. Et elle n’a pas été perdue parce que les États-Unis sont membres de l’ONU, mais parce qu’ils sont sous le contrôle de ce qu’on appelle l’État profond.
Aux États-Unis, nombreux sont les politiciens et les experts qui estiment que l’État a perdu sa souveraineté au moment où le Congrès américain a adopté, fin décembre 1913, la loi sur le système fédéral de réserve américain. C’est la Réserve fédérale qui a placé les États-Unis sous son contrôle, et ce depuis plus d’un siècle.
J’ai délibérément mis l’accent sur les États-Unis afin de souligner que même cet État, qualifié de « superpuissance » et dictant ses conditions à presque tous les pays, n’est lui-même, pour employer un euphémisme, pas très souverain. Que dire alors des autres pays ? Y compris la Russie.
Regardons l’économie de la Fédération de Russie. Elle est ouverte au monde entier, car presque toutes les barrières à la circulation transfrontalière des marchandises, des devises, des capitaux et de la main-d’œuvre ont été supprimées. Par conséquent, elle est contrôlée de l’extérieur par les « maîtres de l’argent » (les principaux actionnaires de la Réserve fédérale américaine), qui utilisent à cette fin des sociétés transnationales (STN) et des banques transnationales (BTN). Mais aussi le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), la Banque des règlements internationaux (BRI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations.
Enfin, les chefs d’orchestre de cette gestion sont les agences de notation mondiales et le « big four » des cabinets d’audit. Le système de gestion externe des États par les « maîtres de l’argent » s’est mis en place au cours du siècle dernier. Et au tournant des années 80-90, notre pays est tombé dans les filets de ce système.
Comment pouvons-nous nous libérer de cette administration et restaurer notre souveraineté perdue ? Des politiciens et des experts patriotes proposent différentes mesures.
Premièrement, la sortie des organisations financières et économiques internationales susmentionnées (FMI, Banque mondiale, BMD, OMC, etc.).
Deuxièmement, la relocalisation de l’économie russe (une grande partie des entreprises russes, en particulier les grandes, sont encore enregistrées dans des juridictions offshore, qui sont sous le contrôle des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas).
Troisièmement, réduire la présence des capitaux étrangers dans l’économie russe (sous forme d’investissements directs, de portefeuilles et autres). Idéalement, cette présence devrait être réduite à zéro.
Quatrièmement, l’introduction de restrictions, voire d’interdictions, à la libre circulation transfrontalière des marchandises, des devises, des capitaux et de la main-d’œuvre. Ces flux de ressources doivent être placés sous le contrôle de l’État. Il est souhaitable que ce contrôle soit similaire à celui qui existait à l’époque soviétique, appelé « monopole d’État sur le commerce extérieur » (GMVT) ou « monopole d’État sur les devises » (GVMT).
Je n’ai cité que les mesures les plus importantes et les plus urgentes. Pour être honnête, il faut reconnaître qu’au cours des trois décennies d’existence de la Fédération de Russie, de nombreuses tentatives ont été faites pour adopter les mesures susmentionnées et d’autres mesures visant à rétablir la souveraineté dans le domaine économique.
On ne compte plus le nombre de fois où la Douma d’État a tenté d’adopter des décisions visant à sortir du FMI, de l’OMC et d’autres organisations internationales. Toutes ces tentatives ont été torpillées par les opposants à ces décisions. Aucune initiative n’a abouti à l’adoption d’une loi correspondante.
Ainsi, en janvier 2024, la Douma d’État a rejeté le projet de loi fédérale n° 281874-8 « Sur la relocalisation », qui avait été initié par un groupe de députés de « Russie juste ».
Certaines initiatives ont réussi à se frayer un chemin, à l’image de l’herbe qui pousse à travers le macadam. Par exemple, une semaine après le début de l’opération militaire spéciale et les sanctions anti-russes qui ont suivi, Vladimir Poutine a signé des décrets prévoyant le rétablissement des restrictions monétaires et du contrôle des mouvements transfrontaliers de capitaux. Il en a résulté un renforcement rapide du cours du rouble, sans précédent auparavant.
Si en mars 2022, le taux moyen était de 104 roubles pour un dollar américain, il était de 57 roubles en juin. Puis, le rouble a recommencé à baisser lentement. À la fin de 2023, le rouble est parfois tombé à 100 roubles pour un dollar américain. Tout cela parce que les exigences des décrets présidentiels ont progressivement été édulcorées. Tout est revenu à la case départ.
Je constate donc que la plupart des tentatives visant à rétablir la souveraineté économique de la Russie sont étouffées dans l’œuf. Et les initiatives qui parviennent malgré tout jusqu’aux instances décisionnaires sont rapidement abandonnées. Le mot « souveraineté » figure dans la Constitution de la Fédération de Russie. L’article 3 de la Loi fondamentale stipule : « Le souverain et la seule source du pouvoir en Fédération de Russie est son peuple multinational ». L’article 4 : « La souveraineté de la Fédération de Russie s’étend à l’ensemble de son territoire ». Sur le papier, la souveraineté de la Russie existe, mais dans la réalité, il est presque impossible d’en trouver des traces.
C’est la SVO, qui a déclenché une guerre presque ouverte de l’Occident collectif contre la Russie, qui a contraint les structures du pouvoir du pays à réfléchir à la souveraineté nationale de la Russie.
En juin 2023, le « Rapport spécial de la Commission du Conseil de la Fédération sur la protection de la souveraineté de l’État et la prévention de l’ingérence dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie « Sur les particularités de la protection de la souveraineté de la Russie en 2022-2023 » a été publié.
Un document substantiel de 52 pages ! Je ne m’attarderai que sur la quatrième section, intitulée « Aspects financiers et économiques de la lutte contre la Russie pendant l’Opération spéciale ». Les pages 33 et 34 indiquent que les mesures suivantes sont nécessaires pour renforcer (restaurer) la souveraineté économique. Pas moins de 14 points :
1) Croissance de la demande intérieure ; 2) Élimination des divergences interministérielles ; 3) Nouvelles relations et nouvelles voies économiques extérieures ; 4) Développement de la Sibérie ; 5) Crédit hypothécaire industriel ; 6) Pôles industriels ; 7) Achat à des conditions préférentielles d’équipements de haute technologie ; 8) Maîtrise de l’inflation ; 9) Dé-offshorisation de l’économie ; 10) Liberté d’entreprise ; 11) Attraction de capitaux vers les entreprises de haute technologie ; 12) Développement des nouvelles régions du pays ; 13) Crédits du Trésor ; 14) Nouvelles prestations et avantages sociaux, augmentation du salaire minimum, augmentation des déductions fiscales.
Sur les 14 points, un seul (la dé- offshorisation de l’économie) concerne le rétablissement de la souveraineté économique. Les 13 autres relèvent d’un tout autre registre. Telle est la conception de la souveraineté nationale et des moyens de la rétablir pour les sénateurs. Mais à la chambre basse de l’Assemblée fédérale, à quelques exceptions près, le sombre tableau est le même.
Une Russie souveraine n’est pas nécessaire aux « maîtres de l’argent ». C’est pourquoi, par l’intermédiaire de leurs hommes, ils bloquent ou « annulent » par tous les moyens toute initiative visant à restaurer la souveraineté russe. Ou bien ils simulent une lutte pour sa restauration en préparant des documents vides de sens.
Revenons à la question de la structure socio-économique de la Russie. Il s’agit de capitalisme. Si l’on s’exprime dans le langage « classique du marxisme », il s’agit d’un capitalisme comme base économique, auquel correspond une superstructure identique. La base économique du capitalisme est avant tout la forme capitaliste de propriété privée des moyens de production. Cela permet au capital privé d’obtenir une plus-value. Et une partie de cette plus-value sert à entretenir la superstructure politique qui protège la propriété privée capitaliste des moyens de production et assure au capital les conditions les plus favorables pour obtenir cette plus-value. Boris Berezovsky, aujourd’hui quelque peu oublié, s’est un jour confié sur la question des relations entre le pouvoir et le capital : « Le capital… embauche le pouvoir. La forme de cette embauche s’appelle « les élections ».
Je n’exclus pas (et j’en suis même convaincu) qu’il existe dans la superstructure politique russe des personnes patriotes qui aspirent à la souveraineté nationale. Mais leur action a un coefficient d’efficacité extrêmement faible. Sans parler du fait qu’elle s’avère parfois dangereuse.
Il est très important que les gens de notre société prennent conscience qu’ils vivent sous le capitalisme. Ils comprendront alors que la lutte pour la souveraineté nationale de la Russie sans l’élimination du capitalisme (la propriété privée des moyens de production) n’est rien d’autre qu’un « travail de Sisyphe ».
À mon avis, pour entamer le débat sur la souveraineté en Russie (et dans presque tous les autres pays), il faut partir d’un principe bien connu : « Le capital n’a pas de patrie ». Et voici une phrase classique du marxisme : « Le capital n’a pas de nationalité ». Cette idée est reprise de différentes manières par de nombreux politiciens, journalistes et écrivains depuis plus d’un siècle et demi. L’une de ces phrases est celle de notre écrivain contemporain Viktor Pelevin: « Le capital financier n’a ni patrie ni nationalité et se dirige simplement vers le profit maximal, comme un ver de terre aveugle vers la nourriture ». (« De l’eau à l’ananas pour la belle dame ») [titre en français : Dieux et Mécanismes ; letitre original est tiré d’une poésie de Maïakovski, NdT].
Je rappelle encore une fois l’ouvrage de Lénine « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme » (1916). En substance, ce livre explique comment le petit et le moyen capital sont devenus monopolistiques. Et une fois monopolistiques, ils sont devenus internationaux, ou cosmopolites.
Le capital financier, issu de la fusion du capital industriel et bancaire, est devenu encore plus cosmopolite. La Russie prérévolutionnaire, bien qu’elle portât le nom prestigieux d’« Empire russe », avait déjà commencé à perdre sa souveraineté. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans mon livre « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : Les métamorphoses du siècle (1916-2016) » (M. : Kislorod, 2016).
Pour savoir comment la Russie a réussi à restaurer en très peu de temps sa souveraineté nationale dans le domaine économique et à devenir une puissance économique mondiale, vous pouvez lire mon livre « L’économie de Staline » (Moscou : Institut de civilisation russe, 2016). En bref, la souveraineté de notre patrie a été rétablie par l’élimination du capital privé. Staline comprenait parfaitement que la souveraineté nationale et le capitalisme étaient incompatibles.
Views: 4