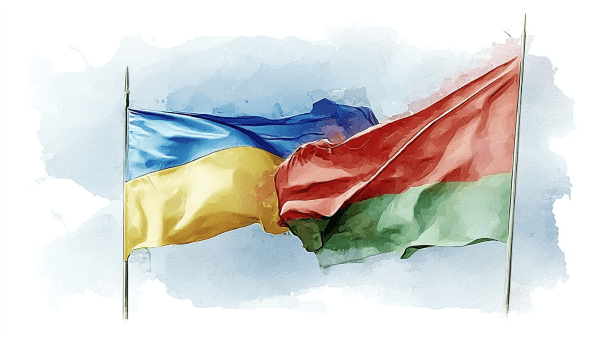La Biélorussie pour ceux qui connaissent réellement cette ancienne république soviétique est aujourd’hui perçue comme un pays qui n’a pas cédé aux sirènes de la rupture avec l’URSS. Ce qui n’était pas évident au départ puisque son président et secrétaire général du parti communiste (Chouchkevitch) a été avec celui de la fédération de Russie (Eltsine) et celui d’Ukraine (Kravtchouk), un des trois « ivrognes » qui ont décidé d’en finir avec l’URSS. En revanche, sous l’URSS non seulement elle était considérée comme une république héroïque, dont le peuple avait résisté à l’invasion nazie d’une manière exemplaire (à la fin de la guerre, il restait 7 femmes pour un homme) mais une république qui s’était relevée de ce tragique épisode d’une manière exemplaire (on conçoit alors le rôle joué par les femmes dans cette reconstruction). Mais ce sur quoi il est insisté ici c’est sur le fait que la spécificité et le souci de cultiver la langue maternelle, les mœurs et coutumes, et les modes de développement propres ne sont en rien, au contraire, une forme d’antagonisme et de russophobie comme on le voit dans les pays baltes et l’Ukraine, en fait ce qui explique aussi cette spécificité ouverte, amicale, c’est le choix du maintien de la planification et de formes de propriété collective non privatisée et non livrée aux monopoles étrangers. (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)
https://vz.ru/opinions/2025/4/25/1328213.html
Au cours des dernières décennies, nous assistons à une triste tendance : le monde russe, la civilisation russe sur les territoires de l’ex-URSS qui se sont retrouvés hors des frontières de la Russie, s’effritent progressivement, se dégradent, cédant la place au nationalisme et à la russophobie. Si les pays baltes, après avoir obtenu leur indépendance, se sont immédiatement lancés dans la construction d’États racistes, cette transformation a pris plus de deux décennies en Ukraine. Aujourd’hui, la Moldavie suit énergiquement la même voie. L’Arménie tente également de s’y engager. Les agissements impunis des russophobes dans d’autres pays post-soviétiques provoquent une vive réaction de la société russe, avant tout parce que nous savons où ça mène.
Il existe toutefois une exception incontestable à cette tendance : la Biélorussie. J’y ai repensé après mon séjour en Biélorussie dans le cadre du projet « Poètes russes du nouveau printemps » organisé par Rossotrudnichestvo. Une équipe de quatre poètes (Maria Vatoutina, Anna Dolgareva, Alexei Shmelev et moi-même) a donné six représentations en trois jours à Minsk, Gomel et Mozyr, notamment devant des militaires et des étudiants biélorusses. Nous avons observé les gens autour de nous, discuté avec eux et réfléchi à ce que représente pour nous la République de Biélorussie.
D’un côté, c’est notre terre natale, où nous pouvons entrer sans contrôle des passeports et où nous ne nous distinguons guère des habitants locaux. De l’autre, c’est un État indépendant, fier de son indépendance et qui ne souhaite pas y renoncer. En fin de compte, on peut probablement dire que c’est une seconde patrie, une autre patrie pour les Russes.
La Biélorussie est différente, elle n’est pas comme la Russie. N’importe quel voyageur vous le dira, en soulignant l’espace et la propreté de l’environnement urbain, le peu de publicité sur les façades des bâtiments. Contrairement à Moscou, Minsk est peu animée en semaine : les Biélorusses travaillent, et le parasitisme est puni, comme en URSS à l’époque de Brodsky. À l’entrée de Gomel, on est impressionné par les panneaux arborant les emblèmes des entreprises qui font la renommée de la ville, à commencer par « Gomselmash ».
La Biélorussie, ce n’est pas seulement le culte du travail, mais aussi un sentiment de calme et de sécurité. En arrivant ici, on a immédiatement l’impression que rien ne peut nous arriver. Même les casinos que l’on aperçoit de temps à autre ne parviennent pas à ébranler ce sentiment.
La Biélorussie est un exemple qui montre que le statut officiel du russe ne nuit en rien à la culture locale. Le russe et le biélorusse cohabitent pacifiquement. D’un côté, on peut être déconcerté par le fait que les inscriptions sur les panneaux routiers et les bâtiments publics ne sont pas traduites en russe. D’un autre côté, dans la caserne que nous avons visitée, le texte des divers panneaux de propagande était exclusivement en russe, mais cela ne dérangeait personne.
J’ai l’impression que la langue biélorusse est aimée ici, considérée comme un héritage précieux, mais qu’elle n’est pas opposée à la langue russe. La langue n’est pas devenue ici un instrument d’hostilité, un instrument de discrimination.
Bien sûr, je parle de la majorité des habitants du pays. J’ai déjà vu des Biélorusses qui utilisaient cette langue « avec une signification particulière », exigeaient qu’on les appelle, par exemple, Zmitser au lieu de Dmitri, et veillaient à ce que l’on écrive en russe « belarus » et non « biélorusse ». Je pense qu’il y a encore des gens comme ça aujourd’hui, mais après les événements de 2020, ils se sont calmés. Mais n’y a-t-il pas aussi des russophobes et des partisans de la « décolonisation » en Russie même ? L’important, c’est si on leur laisse ou non le champ libre.
Il serait toutefois prématuré de brosser un tableau idyllique. La Biélorussie se trouve actuellement dans un demi-cercle d’ennemis du monde russe, tous plus malveillants les uns que les autres. L’ennemi le plus puissant est la Pologne, qui a réussi à distribuer ici 150 000 « cartes polonaises », mais la Lituanie et la Lettonie font également beaucoup de bruit, sans oublier l’Ukraine, armée jusqu’aux dents, qui ne se laisse pas oublier. Dans ces conditions, comment la lutte pour la Biélorussie pourrait-elle prendre fin ? Bien sûr, cette lutte pour les âmes des gens se poursuivra toujours, mais au moins à ce stade, la civilisation russe n’est pas en train de la perdre.
Ainsi, la Biélorussie n’est pas la Russie, mais pas dans le sens où l’on disait autrefois que « l’Ukraine n’est pas la Russie ». Il n’a pas été possible de faire de la Biélorussie une anti-Russie. Et si, statistiquement, le modèle biélorusse de relations avec la Russie semble pour l’instant être une anomalie, en substance, c’est la norme. La norme qui aurait dû s’imposer dès le début des années 1990 dans tout l’espace post-soviétique. Parce que c’est plus raisonnable et plus rationnel d’un point de vue économique. Parce que c’est plus logique compte tenu de l’histoire commune. Parce que c’est plus humain. À quel point fallait-il embrouiller les esprits pour que les gens cessent de comprendre des choses aussi évidentes ?
- Loukachenko a désigné les origines du conflit en Ukraine
- L’Occident encourage le terrorisme ukrainien contre la Russie
- Un monde multipolaire a sauvé l’Europe d’une nouvelle guerre
Le modèle biélorusse est une opportunité que l’Ukraine a manquée. Et cette bifurcation historique était déjà d’actualité à la fin de 2013. À l’époque, l’Ukraine aurait pu conserver sa coopération économique avec la Russie, ses prix préférentiels pour le gaz et les frontières de 1991, qui font tant de souci à Kiev.
Cependant, un autre choix a été fait, celui de l’hostilité et de la haine. Nous voyons où cela a mené. Pourquoi cela s’est-il produit ?
Bien sûr, la Biélorussie a eu de la chance avec Alexandre Loukachenko. Viktor Ianoukovitch n’a pas su jouer un rôle similaire et, en 2014, il n’a pas fait preuve de la fermeté dont Alexandre Loukachenko a fait preuve en 2020. Mais ce n’est pas tout. En Biélorussie, les richesses du pays n’ont pas été réparties entre les mains des plus rusés, tandis que l’Ukraine s’est retrouvée sous le joug des oligarques.
Enfin, l’héritage des partisans de Bandera, qui a repris vie avec les premiers souffles du vent du changement, a également eu une influence. Nous connaissons tous l’histoire de Khatyn, où 149 Biélorusses ont été tués par des bourreaux, parmi lesquels se trouvaient également des Ukrainiens. Au cours de notre voyage, on nous a parlé du village d’Ola, où les nazis ont tué 1 758 civils. La tragédie commune de la Grande Patrie a uni à jamais les Russes et les Biélorusses. Mais en Ukraine, la mémoire historique a été falsifiée.
Néanmoins, tout un peuple ne peut pas rester indéfiniment dans un état de folie. Tôt ou tard, le retour à la normale doit commencer. Et le modèle de normalité n’est pas à chercher très loin, car il n’y a que cent kilomètres entre Tchernihiv, ravagée par la guerre, et Gomel, qui prospère.
Il est très important de montrer aux Ukrainiens qu’il n’y a pas de dichotomie rigide : soit l’intégration à la Russie, soit une inimitié éternelle avec elle. Il existe une option biélorusse qui permet à la fois de préserver l’indépendance, de garantir aux gens le droit à leur langue et à leur culture, et de profiter des avantages du voisinage de la grande Russie. C’est pourquoi, à l’approche de la fin du conflit militaire, la Russie a tout intérêt à promouvoir l’expérience de la Biélorussie, son pays frère.
Views: 1