Pékin domine l’escalade dans la lutte tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Le bluff des Etats-Unis se heurte au fait que la Chine ne bluffe jamais et elle refuse même de jouer au même jeu que son adversaire et ce dès le début. La démonstration de ce consultant du FMI et de divers gouvernement est imparable et explique ce que dit calmement la Chine : le jeu tarifaire est imbécile, nous ne souhaitons pas y jouer mais nous ne le craignons pas parce que les Etats-Unis ne sont plus qu’un tigre de papier. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
Adam S. Posen
9 avril 2025

ADAM S. POSEN est président du Peterson Institute for International Economics.
« Lorsqu’un pays (les États-Unis) perd plusieurs milliards de dollars sur le commerce avec pratiquement tous les pays avec lesquels il fait des affaires », a tweeté le président américain Donald Trump en 2018, « les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner ». Cette semaine, lorsque l’administration Trump a imposé des droits de douane de plus de 100 % sur les importations américaines en provenance de Chine, déclenchant une nouvelle guerre commerciale encore plus dangereuse, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a offert une justification similaire : « Je pense que c’était une grosse erreur, cette escalade chinoise, parce qu’ils jouent avec une paire de deux. Qu’est-ce que nous perdons si les Chinois augmentent les droits de douane ? Nous exportons vers eux un cinquième de ce qu’ils exportent vers nous, c’est donc une main perdante pour eux ».
En bref, l’administration Trump croit qu’elle a ce que les théoriciens des jeux appellent une domination de l’escalade sur la Chine et toute autre économie avec laquelle elle a un déficit commercial bilatéral. La domination de l’escalade, selon les termes d’un rapport de la RAND Corporation, signifie qu’« un combattant a la capacité d’intensifier un conflit d’une manière qui sera désavantageuse ou coûteuse pour l’adversaire alors que l’adversaire ne peut pas faire la même chose en retour ». Si la logique de l’administration est correcte, alors la Chine, le Canada et tout autre pays qui riposte contre les tarifs américains jouent effectivement une main perdante.
Mais cette logique est fausse : c’est la Chine qui domine l’escalade dans cette guerre commerciale. Les États-Unis obtiennent de la Chine des biens vitaux qui ne peuvent pas être remplacés de sitôt ou fabriqués chez eux à un coût inférieur à celui prohibitif. Réduire une telle dépendance vis-à-vis de la Chine peut être une raison d’agir, mais mener la guerre actuelle avant de le faire est une recette pour une défaite presque certaine, à un coût énorme. Ou, pour le dire dans les termes de Bessent : Washington, et non Pékin, mise all-in sur une main perdante.
MONTREZ VOTRE MAIN
Les affirmations de l’administration sont erronées sur deux points. D’une part, les deux parties sont touchées par une guerre commerciale, parce qu’elles perdent l’accès à ce que leur économie veut et a besoin et pour lesquelles leurs employés et leurs entreprises sont prêts à payer. Comme le lancement d’une guerre réelle, une guerre commerciale est un acte de destruction qui met en danger les propres forces de l’attaquant et son front intérieur : si le camp défenseur ne croyait pas qu’il pouvait riposter d’une manière qui nuirait à l’attaquant, il se rendrait.
L’analogie de Bessent avec le poker est trompeuse parce que le poker est un jeu à somme nulle : je ne gagne que si vous perdez ; tu ne gagnes que si je perds. Le commerce, en revanche, est à somme positive : dans la plupart des situations, mieux vous faites, mieux je fais, et vice versa. Au poker, vous ne récupérez rien pour ce que vous avez mis dans le pot à moins que vous ne gagniez. Dans le commerce, vous le récupérez immédiatement, sous la forme des biens et services que vous achetez.
L’administration Trump estime que plus vous importez, moins vous avez d’enjeux – que parce que les États-Unis ont un déficit commercial avec la Chine, important plus de biens et de services chinois que la Chine n’importe de biens et de services américains, ils sont moins vulnérables. C’est factuellement faux, ce n’est pas une question d’opinion. Le blocage du commerce réduit le revenu réel et le pouvoir d’achat d’un pays. Les pays exportent afin de gagner de l’argent pour acheter des choses qu’ils n’ont pas ou qui sont trop chères à fabriquer chez eux.
De plus, même si l’on se concentre uniquement sur la balance commerciale bilatérale, comme le fait l’administration Trump, cela augure mal des États-Unis dans une guerre commerciale avec la Chine. En 2024, les exportations américaines de biens et de services vers la Chine se sont chiffrées à 199,2 milliards de dollars, et les importations en provenance de la Chine à 462,5 milliards de dollars, ce qui a entraîné un déficit commercial de 263,3 milliards de dollars. Dans la mesure où la balance commerciale bilatérale prédit quel camp « gagnera » dans une guerre commerciale, l’avantage réside dans l’économie excédentaire et non dans l’économie déficitaire. La Chine, le pays excédentaire, abandonne les ventes, qui ne sont que de l’argent ; les États-Unis, pays déficitaire, abandonnent des biens et des services qu’ils ne produisent pas de manière compétitive ou pas du tout chez eux. L’argent est fongible : si vous perdez des revenus, vous pouvez réduire vos dépenses, trouver des ventes ailleurs, répartir le fardeau dans tout le pays ou puiser dans votre épargne (par exemple, en faisant des mesures de relance budgétaire). La Chine, comme la plupart des pays ayant des excédents commerciaux globaux, épargne plus qu’elle n’investit, ce qui signifie qu’elle a, dans un sens, trop d’épargne. L’ajustement serait relativement facile. Il n’y aurait pas de pénurie critique et elle pourrait remplacer une grande partie de ce qu’elle vend normalement aux États-Unis par des ventes intérieures ou à d’autres.
Les pays qui ont des déficits commerciaux globaux, comme les États-Unis, dépensent plus qu’ils n’épargnent. Dans les guerres commerciales, ils abandonnent ou réduisent l’offre de choses dont ils ont besoin (puisque les tarifs les font coûter plus cher), et ceux-ci ne sont pas aussi fongibles ou facilement substituables que l’argent. Par conséquent, l’impact se fait sentir dans des industries, des lieux ou des ménages spécifiques qui font face à des pénuries, parfois d’articles nécessaires, dont certains sont irremplaçables à court terme. Les pays déficitaires importent également des capitaux, ce qui rend les États-Unis plus vulnérables aux changements de sentiment quant à la fiabilité de leur gouvernement et à son attractivité en tant que lieu d’affaires. Lorsque l’administration Trump prendra des décisions capricieuses d’imposer une énorme augmentation d’impôts et une grande incertitude sur les chaînes d’approvisionnement des fabricants, il en résultera une réduction des investissements aux États-Unis, ce qui augmentera les taux d’intérêt sur sa dette.
DES DÉFICITS ET DE LA DOMINATION
En bref, l’économie américaine souffrira énormément d’une guerre commerciale à grande échelle avec la Chine, suite aux niveaux actuels des droits de douane imposés par Trump, à plus de 100 %, s’ils sont laissés en place. En fait, l’économie américaine souffrira plus que l’économie chinoise, et la souffrance ne fera qu’augmenter si les États-Unis intensifient leur pression. L’administration Trump pense peut-être qu’elle agit durement, mais en fait, elle met l’économie américaine à la merci de l’escalade chinoise.
Les États-Unis seront confrontés à des pénuries d’intrants critiques, allant des ingrédients de base de la plupart des produits pharmaceutiques aux semi-conducteurs bon marché utilisés dans les voitures et les appareils ménagers, en passant par les minéraux critiques pour les processus industriels, y compris la production d’armes. Le choc de l’offre résultant d’une réduction drastique ou d’une réduction à zéro des importations en provenance de Chine, comme Trump prétend vouloir le faire, signifierait la stagflation, le cauchemar macroéconomique observé dans les années 1970 et pendant la pandémie de COVID, lorsque l’économie se contracte et que l’inflation augmente simultanément. Dans une telle situation, qui est peut-être plus proche que beaucoup ne le pensent, la Réserve fédérale et les responsables de la politique budgétaire n’ont que des options terribles et peu de chances d’éviter le chômage, sauf en augmentant davantage l’inflation.
Lorsqu’il s’agit d’une vraie guerre, si vous avez des raisons d’avoir peur d’être envahi, il serait suicidaire de provoquer votre adversaire avant de vous être armé. C’est essentiellement ce que risque l’attaque économique de Trump : étant donné que l’économie américaine est entièrement dépendante des sources chinoises pour les biens vitaux (actions pharmaceutiques, puces électroniques bon marché, minéraux critiques), il est extrêmement imprudent de ne pas s’assurer d’autres fournisseurs ou une production nationale adéquate avant de couper le commerce. En faisant l’inverse, l’administration invite exactement le genre de dommages qu’elle dit vouloir prévenir.
Tout cela pourrait n’être qu’une tactique de négociation, en dépit des déclarations et des actions répétées de Trump et de Bessent. Mais même dans ces conditions, la stratégie fera plus de mal que de bien. Comme je l’ai mis en garde dans Foreign Affairs en octobre dernier, le problème fondamental de l’approche économique de Trump est qu’elle devrait mettre à exécution suffisamment de menaces autodestructrices pour être crédible, ce qui signifie que les marchés et les ménages s’attendraient à une incertitude permanente. Les Américains et les étrangers investiraient moins, et non plus, dans l’économie américaine, et ils ne feraient plus confiance au gouvernement américain pour respecter un accord, ce qui rendrait difficile la conclusion d’un règlement négocié ou d’un accord de désescalade. En conséquence, la capacité de production des États-Unis diminuerait au lieu de s’améliorer, ce qui ne ferait qu’accroître l’influence de la Chine et d’autres pays sur les États-Unis.
L’administration Trump s’embarque dans l’équivalent économique de la guerre du Vietnam – une guerre de choix qui aboutira bientôt à un bourbier, sapant la confiance à la fois dans la fiabilité et la compétence des États-Unis dans le pays et à l’étranger – et nous savons tous comment cela s’est passé.
***
ADAM S. POSEN est président du Peterson Institute for International Economics. Il a été consultant auprès du Fonds monétaire international et des gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon. De 1994 à 1997, il a été économiste à la Federal Reserve Bank de New York et, de 2009 à 2012, il a été membre votant externe du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre. Il est coéditeur, avec Jean Pisani-Ferry, de The Green Frontier : Assessing the Economic Implications of Climate Action.
Views: 1




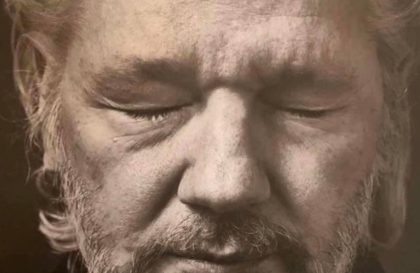

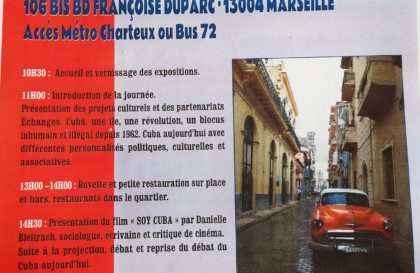
Nasser
Une sagesse dit : Pourquoi chercher des ennuis quand on est en paix ! Pourquoi chercher une improbable chose dans un trou quand elle est à portée de mains, sûre et à bon marché !
C’est parce les riches capitalistes sont certains de perdre tout ce qu’ils ont, qu’il n’y aura pas de guerre contre la puissante Chine.
Qu’on nous explique cette logique et cette « sagesse » américaine contraire à la raison: Les USA ne veulent pas que la Chine (par extension d’autres pays) produisent des biens et des services pour le bien et la prospérité de l’humanité?
Les guerres commerciales sont faciles à perdre – Monde25
[…] source : Foreign Affairs via Histoire et Société […]