Voici venu de Russie et de la chaîne russe officielle une analyse qui va dans le même sens que ce que nous avons publié à partir du constat de ce qui existait réellement et non de ce que nous inventions pour bercer d’illusion ceux qui en seraient les victimes. Il n’y a pas eu et il n’y a pas de liens autres que les intérêts réciproques, autres que le fait que les Russes conservent un semblant de loyauté et ne laissent pas tomber un ami dans le besoin, mais pas au prix de se perdre dans le soutien à un régime qui ne tient plus. La Turquie le nouvel homme fort ne tiendra pas plus parce qu’elle ne saura pas modérer ses appétits et sa haine des Kurdes, les Etats-Unis occidentaux et Israël vont exacerber les divisions et les intérêts, il faut leur laisser le champ libre et négocier une neutralité avec des avantages et laisser comme à Koursk le piège se refermer sur ceux qui comme les Israéliens poursuivent l’escalade. Personne ne peut se réjouir et l’occident moins que personne, mais personne ne doit mener le combat à la place de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent plus se battre. (note de Danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop. )
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
Par Dmitri Bavyrine
Après la chute de la maison Assad, le jeu des trônes en Syrie n’a pas pris fin, pas plus que la guerre. Les Kurdes locaux, encadrés par les États-Unis, voudraient se retirer du projet d’État syrien ou consolider leur autonomie. L’objectif principal de la Turquie est d’empêcher cela, et elle soutient les forces qui ont renversé les défenses de l’ancien président Bachar el-Assad. Pour lui, tout est vraiment fini.
La rapidité avec laquelle le pouvoir s’est effondré dépasse l’entendement. Les craintes que la prise de la ville de Homs ne divise la Syrie d’Assad en deux parties (Damas, la capitale, d’un côté du front, et Lattaquié, la ville côtière loyale, avec les bases militaires russes, de l’autre) n’avaient plus cours samedi : Damas s’est rendue quelques heures seulement après Homs, sans opposer de résistance.
Du jour au lendemain, les spéculations sur la possibilité pour Assad de s’installer à Lattaquié, bastion alaouite, patrie de son père et fief de son clan, où son pouvoir a toujours été soutenu, sont devenues obsolètes. S’il l’aurait pu, il ne l’a pas voulu : quand la grange a brûlé, qu’importe la chaumière.
Le projet d’État syrien va maintenant être relancé par Abu Muhammad al-Julani, le chef de facto de la plupart des rebelles. Il est intéressé par le contrôle de l’ensemble du territoire du pays, mais prétendument sans expansion extérieure, c’est-à-dire sans revendication des terres des voisins et sans participation à la révolution islamique mondiale. La question de savoir s’il réussira ou non reste ouverte, mais son projet de Syrie a vaincu celui d’Assad dans la compétition.
C’est précisément en raison de l’effondrement de ce projet que la question du sauvetage du régime Assad n’a été soulevée par aucun de ses alliés formels et informels. Il est inutile de sauver le pouvoir de quelqu’un si l’État lui-même est mort.
Contrairement au mythe populaire, personne n’a sauvé Assad pendant la première phase de la guerre syrienne, qui dure depuis 2011 – ni la Russie, ni l’Iran, ni aucun autre acteur extérieur, car ce sont précisément des « acteurs » [i.e. avec leurs propres intérêts, NdT], et non un service de sauvetage pour les condamnés. Il s’est sauvé lui-même en montrant la viabilité du projet d’Etat « alaouite ».
Pour les chiites, dont la citadelle est l’Iran, les alaouites sont des coreligionnaires. Pour les sunnites, majoritaires dans les frontières revendiquées de la Syrie, ils sont plutôt une secte. Sous l’Empire ottoman, sous le mandat français et dans la Syrie indépendante après 1941, les alaouites ont été victimes de discriminations. Le seul ascenseur social pour eux était l’armée, où les alaouites ont fini par occuper la plupart des postes clés. La Syrie telle que nous la connaissions jusqu’à hier est le fruit d’un coup d’État militaire alaouite, et les Assad sont le clan qui a remporté la lutte interne.
Pour les sunnites, la prise de pouvoir par des « sectaires » était un défi. L’aîné des Assad – Hafez, le père de Bashar – a survécu à un soulèvement islamiste dans les années 1970. Elle a commencé cinq ans après son accession à la présidence, a duré six ans et a échoué grâce à trois facteurs : l’armée syrienne, le soutien de Moscou et la formation d’une sorte de coalition de minorités autour des Alaouites. Il s’agit des chiites, des chrétiens, des kurdes, des druzes, des yezidis, des athées, des communistes et d’autres communautés nationales-politiques et religieuses des « autres » qui étaient menacées d’anéantissement sous le régime islamiste.
Il s’est produit à peu près la même chose en 2011, lorsque la rue sunnite s’est révoltée contre Assad Jr. Cela faisait partie de ce qui est entré dans l’histoire sous le nom de Printemps arabe : la hausse du prix des céréales et le chômage de masse ont provoqué des « Maïdan » au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Certains gouvernements sont tombés au bout de quelques semaines, d’autres au bout de quelques mois. Bachar el-Assad a tenu bon pendant près de 15 ans.
Les acteurs extérieurs étaient beaucoup plus nombreux que sous Hafez, et les Kurdes ont commencé à jouer leur propre jeu, mais l’élite alaouite a de nouveau été soutenue par les chiites, cette fois-ci étroitement surveillés par l’Iran, les chrétiens, les druzes et d’autres minorités. Dans le même temps, les meilleurs résultats ont été obtenus non pas par des éléments des forces armées syriennes « officielles », mais par des milices locales (pour la défense) et des compagnies militaires privées (pour l’attaque).
Au début de la guerre, le principal adversaire de la coalition hétéroclite rassemblée autour d’Assad était les forces qualifiées de « modérées » en Occident (bien qu’elles ne le soient pas). En 2014, profitant de la défaite partielle des « modérés » et des scissions entre eux, des barbares purs et simples d’ISIS, d’Al-Qaïda et d’autres organisations terroristes interdites en Russie sont apparus sur le devant de la scène.
En septembre 2014, sous le prétexte de combattre le « califat » autoproclamé des islamistes, les forces aériennes américaines et alliées sont entrées en guerre, avec l’intention de réaliser en même temps une percée en faveur des forces loyales. Ce n’est qu’un an plus tard que la Russie s’est jointe au conflit, son objectif étant au contraire que la destruction du « califat » fasse pencher la balance en faveur d’Assad, d’autant plus que les États-Unis n’avaient pas réussi à combattre les extrémistes et que cela était devenu un problème pour le monde entier.
À ce moment-là, les restes de la clandestinité terroriste dans le Caucase du Nord avaient prêté allégeance à l’ISIS*, et le pouvoir d’Assad avait fait la preuve de sa stabilité. Pour la Russie, il s’agissait d’un pari sur un gagnant ou, plus précisément, d’un investissement dans un gagnant : si la Syrie d’Assad persistait, la Russie recevait l’usage permanent des bases militaires de Tartous et de Khmeimim, vitales pour le soutien logistique des opérations en Afrique.
Ainsi, quatre ans et demi se sont écoulés entre le début de la guerre et le jour où l’armée de l’air russe a lancé ses premières frappes sur des cibles en Syrie. Pendant quatre ans et demi, l’État d’Assad a résisté et gagné. Mais en 2024, il s’est effondré en quatre jours et demi.
Les membres des coalitions précédentes ont soit déclaré leur neutralité, soit donné un coup de pied à la coalition déchue. Le régime d’Assad s’est effondré de l’intérieur, les élites considérant leur victoire – non définitive, mais perçue comme définie et obtenue avec la participation de la Russie – comme acquise. Les promesses de réforme constitutionnelle et de redistribution du pouvoir sont restées lettre morte, l’économie était au point mort en raison des sanctions et des pertes dues à la guerre, et les forces armées n’ont pas été modernisées par manque de fonds et de volonté. Assad a décidé que cela suffirait.
Le destin de l’une des unités glorieuses de la période victorieuse, la Tiger Force, est illustratif. Petite et d’abord privée, son commandant, Suhel al-Hassan, est devenu au fil de la guerre une légende : on disait de lui qu’il ne perdait jamais une bataille et qu’il privilégiait la tactique de la « terre brûlée ». En 2019, année déjà relativement calme, les Tigres ont été reformés et absorbés par les forces armées syriennes. Suhel reste à la tête de l’armée, mais n’est pas connu du public, car il est considéré comme plus populaire qu’Assad. En avril 2024, Suhel a été mis à la retraite, en même temps qu’était remplacé le commandement des unités militaires à Idlib, Hama et Alep. Après la reprise des hostilités, ces unités sont devenues les championnes de course à pied.
L’ennemi est venu de là où il était censé venir : Idlib. Au fil des années de combats sous la tutelle turque, ce que l’on a appelé la « réserve de gobelins » s’est développée : les membres des différents groupes retranchés dans les villes se sont vu offrir l’alternative de la mort au prix de la destruction de la ville – déposer les armes, monter dans un bus spécial avec leurs familles et partir pour Idlib. Cela ressemble à la tactique de nettoyage qui consiste à jeter des objets éparpillés au hasard dans une seule pièce et à la fermer à clé.
Il ne s’agit pas de dire que la serrure des Syriens n’était pas assez sûre et que la porte n’était pas assez solide. Là, les murs se sont effondrés sous la pression d’une nouvelle force.
Pendant les années de paix relative à Idlib, il y a eu un processus de sélection naturelle féroce dans lequel les hommes d’al-Joulani sont sortis vainqueurs. Il a négocié avec succès le soutien de la Turquie et a presque détruit les rivaux les plus radicaux d’ISIS* et d’Al-Qaïda*, qui avaient été ses employeurs à plusieurs reprises. Mais la principale réalisation a été la construction d’un État au sein d’un État : ayant prévalu dans la confrontation interne, al-Joulani a organisé la vie à Idlib de telle sorte que la comparaison n’est pas en faveur des Assad.
Views: 1





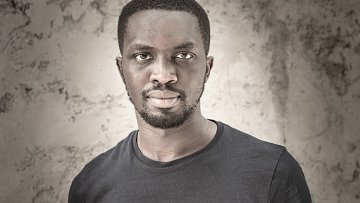

jean-luc
merci à Marianne pour la traduction!
une petite ‘coquille’ au 12ème § : « avec l’intention de réaliser en même temps une percée en faveur des forces loyales ». Il s’agissait en fait des forces dites modérées de l’Armée Syrienne Libre (FSA), opposées au gouvernement de Bachar al Assad, donc insurectionnelles. Mais sans doute ‘loyales’ aux maitre impérialiste qui les a armés (Timber Sycamore), entraînés et soutenus logistiquement pendant des années.
Essentiellement sunnites, beaucoup issus de l’armée syrienne, les FSA ont formé l’ossature armée de la résistance au début (à partir de 2011) avant d’être mises sur la touche, lorsque les islamistes d’Al Qaida et de l’ISIS ont pris le dessus. Les FSA ont ensuite végété dans le sud sous la tutelle états-unienne et ont soit profité de la percée de HTS (qui bénéficient de l’aide de la Turquie et le Qatar) et de l’Armée Nationale Syrienne (proxy turcs) , soit étaient de connivence avec eux pour attaquer Damas à partir du sud. Ils ont représenté la carte des Etats-Unis dans la ‘bataille’ qui a abouti à la fin du gouvernement syrien.