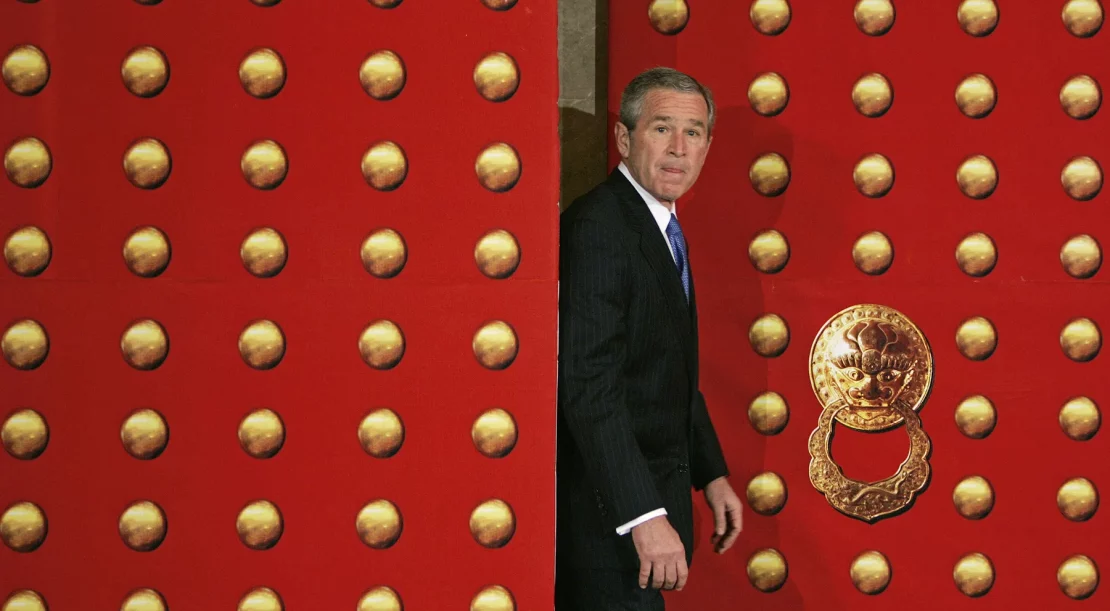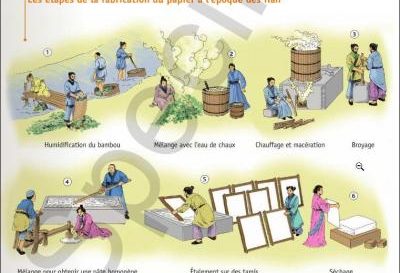Si l’on en reste au théâtre politicien renforcé par le jeu électoral effectivement on peut se demander comment un individu aussi médiocre que Georges Bush junior a pu accomplir autant de dégâts durables. En fait les forces qui étaient derrière lui et sa dynastie texane mais aussi étroitement liée à la CIA et aux puissants courants évangélistes étaient les représentants « protestants » des conseils d’administration du capitalisme, en proie à une cécité totale sur à la fois l’excellence supposée du modèle « américain », occidental en général, et aux illusions sur l’enthousiasme que mettraient d’autres nations à l’adopter. Cette cécité décrite ici à travers la crise de 2008, autant que l’écroulement des tours newyorkaises, reflétait les intérêts d’une caste étroite déjà en rupture avec son propre peuple, a fortiori celle des peuples dominés. La « débâcle » actuelle de cette caste et l’endoctrinement des peuples occidentaux sur leur propre excellence a engendré si l’on en croit l’analyse ci-dessous un sentiment de frustration dont Trump est l’expression : nous sommes trop bons, trop généreux continuent-ils à proclamer, au lieu de s’interroger sur l’épuisement et l’impuissance de leur hégémon, de tirer les leçons de la crise financière de 2008, des échecs répétés militaires et de tenter de comprendre les valeurs et aspirations d’un monde échappant à leur stéréotype. Ils ont incapables de passer des conseils d’administration à l’intérêt de l’Etat chinois qui a reçu « mandat » et sait que son pouvoir dépend de ce mandat. Non seulement la Chine n’a pas « trompé » les Etats-Unis mais au vu de la fragilité de leur modèle en a déduit les limites de la copie et a incité d’autres pays en développement à faire comme la Chine, s’économiser les problèmes qu’un tel modèle générait. (note et traduction de Danielle Bleitrach histoire et société)

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont commencé à dévier de leur trajectoire il y a 15 ans, mais Washington a trébuché gravement dans sa réponse.
BY PAUL BLUSTEIN2 OCTOBRE 2019
Lorsqu’il est devenu secrétaire au Trésor en juillet 2006, Henry Paulson s’était rendu en Chine environ 70 fois en tant que haut responsable de Goldman Sachs. Doté d’une stature imposante – il a été joueur de ligne offensive dans l’équipe de football du Dartmouth College -, M. Paulson est devenu une présence familière dans les sanctuaires du pouvoir chinois en représentant Goldman dans le cadre de transactions telles que la vente d’actions d’entreprises d’État. Bien qu’il ne parle pas le chinois, il a acquis un sens aigu du fonctionnement du système chinois, ayant rencontré les principaux dirigeants à de nombreuses reprises dans leur enceinte à Pékin.
Lorsqu’il a été convoqué à la Maison Blanche pour se voir proposer le poste du Trésor, M. Paulson a donc demandé au président George W. Bush de l’autoriser à prendre en charge la politique économique de l’administration à l’égard de la Chine. Il lui a semblé logique de tirer le meilleur parti des compétences et des relations qu’il avait développées avec les dirigeants chinois, et M. Bush a accepté d’emblée de confier à son nouveau chef du Trésor le pouvoir de superviser une stratégie coordonnée entre les différentes agences américaines chargées des questions économiques sino-américaines. À l’époque, il s’agissait d’un défi de taille. Une myriade de problèmes affectaient les relations commerciales, financières et d’investissement entre les deux pays.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Paul Blustein, ancien journaliste au Washington Post, est chercheur principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale. Cet essai est adapté de son nouveau livre, Schism : China, America, and the Fracturing of the Global Trading System.
Rétrospectivement, cependant, la mission de Paulson était encore plus importante que quiconque ne le pensait à l’époque. C’est sous la direction de l’administration Bush que les relations économiques entre les deux puissances ont commencé à se détériorer. Les problèmes auxquels Paulson, parmi d’autres membres de l’administration, ont été confrontés et les réponses qu’ils ont élaborées – ou n’ont pas élaborées – sont au cœur de la guerre commerciale qui fait rage aujourd’hui entre Washington et Pékin.
Une demi-décennie avant que Paulson ne devienne secrétaire au Trésor, la Chine avait rejoint l’Organisation mondiale du commerce (OMC), une intégration historique dans l’économie mondiale de la nation la plus peuplée du monde. Pour entrer dans l’organisme commercial basé à Genève, la Chine avait accepté, après de longues négociations, d’ouvrir ses marchés d’une manière qui dépasserait les exigences imposées aux autres pays, et Pékin a également accepté que ses partenaires commerciaux puissent utiliser plusieurs mécanismes inhabituels qui pourraient restreindre l’afflux de produits chinois sur leurs marchés. L’hypothèse des partenaires commerciaux de la Chine était que la libéralisation économique mettrait progressivement Pékin sur la voie d’une véritable libre entreprise – si elle n’était pas totalement débridée, du moins sous une forme similaire à celle de la Corée du Sud, par exemple. Dans un livre de 2002 qu’il a co-écrit, le directeur général désigné de l’OMC de l’époque, Supachai Panitchpakdi, s’est enthousiasmé : « L’accord a signalé la volonté de la Chine de respecter les règles du commerce international et de mettre son appareil gouvernemental souvent opaque et encombrant en harmonie avec un ordre mondial qui exige clarté et équité. »
Mais cet optimisme était enraciné dans une incapacité à anticiper l’évolution des politiques économiques de la Chine. À partir de 2003 environ, et pendant un certain nombre d’années par la suite, la Chine a maintenu le taux de change de sa monnaie à des niveaux artificiellement bas, conférant des avantages concurrentiels importants aux exportateurs chinois. Cela a exacerbé un phénomène connu sous le nom de « choc chinois », qui fait référence à la décimation des entreprises manufacturières dans un certain nombre de communautés de cols bleus américains qui ont été touchées de manière disproportionnée par les importations chinoises.
Toujours en 2003, Pékin a mis en place des institutions lui donnant un contrôle plus strict et plus efficace sur la gestion des entreprises d’État géantes, l’allocation des subventions, l’application des réglementations et l’approbation des investissements. Ce fut le début d’une nouvelle orientation politique, diversement surnommée « capitalisme d’État », « techno-nationalisme » et « Chine Inc ». Bien que le secteur privé soit dynamique et florissant, l’intervention du gouvernement et du Parti communiste deviendra beaucoup plus envahissante qu’auparavant. Les entreprises étrangères qui avaient autrefois été accueillies à bras ouverts seraient de plus en plus victimes d’un éventail ahurissant d’obstacles et de politiques industrielles visant à promouvoir et à protéger les concurrents chinois favorisés par l’État-parti.
SI L’ON REGARDE LA FAÇON DONT L’ADMINISTRATION BUSH A GÉRÉ CES PROBLÈMES, IL EST RAISONNABLE DE SE DEMANDER POURQUOI UNE APPROCHE PLUS ÉNERGIQUE N’A PAS ÉTÉ ADOPTÉE.
Le choc chinois, bien qu’il n’ait été reconnu par les économistes comme un événement marquant que des années plus tard, a stimulé le sentiment politique, en particulier parmi les Américains de la classe ouvrière, que les partenaires commerciaux de leur pays l’avaient pris en otage – un point de vue que Donald Trump a exploité dans sa campagne présidentielle en affirmant que la Chine avait commis un « viol » de l’économie américaine. Et les mauvais traitements présumés infligés par Pékin aux entreprises américaines – qui se sont beaucoup intensifiés sous Xi Jinping, le dirigeant suprême de la Chine depuis 2012 – ont été la principale base de l’imposition par l’administration Trump de droits de douane sur les produits chinois en 2018.
Si l’on considère la façon dont l’administration Bush a géré ces problèmes, il est raisonnable de se demander pourquoi une approche plus énergique n’a pas été adoptée ; la réponse des États-Unis peut être qualifiée à juste titre de lente. Plusieurs raisons émergent d’un examen granulaire du processus. L’un des plus importants est l’optimisme persistant de Washington quant à la capacité de la Chine à se débarrasser des vestiges du maoïsme et à ouvrir ses marchés. Les craintes d’une rupture économique entre les États-Unis et la Chine et ce que cela signifierait pour les États-Unis et leurs alliés ont également joué un rôle.
Mais le plus crucial de tous a peut-être été l’éclatement de la crise financière mondiale, qui a mis en évidence des défauts flagrants dans le modèle américain et a contrecarré les efforts visant à modifier les politiques de la Chine. C’est une cruelle ironie de l’histoire que Paulson, la cheville ouvrière des efforts de l’administration Bush pour changer la politique chinoise, se soit trouvé au cœur de l’effondrement financier qui les a fatalement minés.

Le président chinois Hu Jintao (au centre) et son épouse, Liu Yongqing, posent sur le parquet de la Bourse de New York avant de sonner la cloche d’ouverture le 29 avril 2002. Ils sont accompagnés du président du NYSE Richard Grasso (de gauche à droite), du PDG d’American International Group, Maurice Greenberg, et du PDG de Goldman Sachs, Henry Paulson. HENNY RAY ABRAMS/AFP/GETTY IMAGES
Peu de gens auraient pu imaginer une telle tournure des événements lorsque Hu Jintao est devenu président de la Chine le 15 novembre 2002, moins d’un an après l’adhésion du pays à l’OMC. Les initiés de Pékin ont eu du mal à caractériser Hu Jintao, âgé de 59 ans, comme autre chose qu’une énigme fade et prudente de loyauté stricte envers le Parti communiste. Le trait le plus saillant de Hu était sa discrétion disciplinée, surtout en public. L’un des commentaires les plus révélateurs sur le nouveau président est venu de sa grand-tante de 88 ans, Liu Bingxia, qui l’a aidé à l’élever après la mort de sa mère quand il était jeune. À propos de son petit-neveu, Liu a déclaré : « Il n’a jamais interrompu une seule fois ses aînés lorsqu’ils parlaient. »
Compte tenu de l’approche prudente et consensuelle de Hu Jintao, les chances semblaient favoriser la continuité de la politique, y compris sur les questions économiques, pour lesquelles Hu Jiabao a délégué une responsabilité substantielle au Premier ministre Wen Jiabao. Et à des égards importants, le duo de dirigeants Hu-Wen a continué à suivre la voie de l’ouverture des marchés qui avait été tracée par leurs prédécesseurs, Jiang Zemin et Zhu Rongji, lors de l’entrée de la Chine dans l’OMC. Sous Hu Jintao et Wen, Pékin a mis en œuvre des réductions tarifaires et éliminé les quotas d’importation, ainsi que de nombreuses autres mesures et réformes promises lors des négociations d’adhésion à l’OMC.
Mais dans les premiers mois de 2003, très peu de temps après leur arrivée au pouvoir, Hu et Wen ont jeté les bases d’une intervention économique beaucoup plus importante de Pékin que ce que les États-Unis et d’autres membres de l’OMC avaient prévu lorsqu’ils ont fait entrer la Chine dans l’organisation commerciale. L’importance d’un grand nombre de ces mesures ne serait reconnue qu’a posteriori ; les institutions créées sous la direction de Hu et Wen n’ont guère attiré l’attention à l’étranger à l’époque.
MAIS DANS LES PREMIERS MOIS DE 2003, TRÈS PEU DE TEMPS APRÈS LEUR ARRIVÉE AU POUVOIR, HU ET WEN ONT JETÉ LES BASES D’UNE INTERVENTION ÉCONOMIQUE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE DE PÉKIN QUE CE QUE LES ÉTATS-UNIS ET D’AUTRES MEMBRES DE L’OMC AVAIENT PRÉVU.
L’une de ces institutions était la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État (SASAC), qui a pris le contrôle centralisé des actions du gouvernement national dans 196 des plus grandes entreprises publiques. Ces entreprises étaient des mastodontes – PetroChina, China Mobile, Dongfeng Motors et Sinopec, par exemple – qui se livraient une concurrence féroce sur les marchés privés et émettaient une grande partie de leurs actions à des investisseurs mondiaux. Mais avec le pouvoir de nommer (et de révoquer) des dirigeants dans bon nombre de ces entreprises et le mandat de « maintenir et d’améliorer le … compétitivité de l’économie d’État », la SASAC est un instrument de gestion économique tout à fait nouveau, même dans un monde où de telles entreprises d’État existent dans de nombreux pays. Comme l’a écrit Mark Wu, professeur à la faculté de droit de Harvard :
« Imaginez qu’une agence gouvernementale américaine contrôle General Electric, General Motors, Ford, Boeing, U.S. Steel, DuPont, AT&T, Verizon, Honeywell et United Technologies. De plus, imaginez que cette agence ne soit pas simplement un actionnaire passif, mais qu’elle se comporte également comme le ferait un fonds de capital-investissement avec ses sociétés de portefeuille. Elle pourrait embaucher et licencier des dirigeants, déployer et transférer des ressources entre les sociétés de portefeuille et générer des synergies entre ses participations. … À bien des égards, la SASAC fonctionne comme le font d’autres actionnaires majoritaires. Il est heureux d’accorder à la direction une autonomie opérationnelle tant qu’elle respecte la mesure convenue. La différence, c’est que la mesure n’est pas le profit pur, mais plutôt l’intérêt de l’État chinois, au sens large.
Une autre entité qui a vu le jour en 2003 est devenue connue sous le nom de « superministère » en raison de son pouvoir de coordination sur les autres. Elle a été surnommée la Commission nationale du développement et de la réforme, et l’une des principales responsabilités attribuées à sa bureaucratie de 30 000 personnes était la conception du plan quinquennal de la Chine. L’influence des planificateurs chinois avait diminué pendant la période de libéralisation économique des années 1980 et 1990, mais avec la nouvelle commission, la Chine a renforcé les responsabilités des planificateurs, conférant à leurs objectifs une force beaucoup plus grande que de simples directives. Les prix des principaux produits de base et intrants – en particulier l’électricité, le pétrole, l’essence, le gaz naturel et l’eau – seraient fixés par la commission, qui allouerait également des fonds d’investissement de l’État et détiendrait un pouvoir d’approbation sur de nombreux grands projets, tels que les infrastructures et les usines.
Ces institutions ont donné à Pékin un éventail de nouveaux leviers pour manipuler et influencer les actions des entreprises, tant publiques que privées, dans l’ensemble de l’économie chinoise. Et derrière eux – ou plus précisément, au-dessus d’eux – se dressait l’autorité ultime dans la façon dont ces leviers seraient manipulés, à savoir le Parti communiste.
Le symbole le plus frappant de ce système était les téléphones rouges qui trônaient sur les bureaux de plusieurs centaines de personnes parmi les plus puissantes du gouvernement du pays, ainsi que des PDG des plus grandes entreprises d’État. Les téléphones, qui ne se connectaient qu’à d’autres téléphones similaires, étaient appelés « machines rouges » parce que quiconque les appelait était susceptible d’occuper un rang élevé dans l’appareil du parti. « Quand la ‘machine rouge’ sonne », a déclaré un cadre supérieur d’une banque d’État à l’auteur Richard McGregor, « vous feriez mieux de vous assurer d’y répondre. »
Les téléphones rouges sont emblématiques de la portée du parti, qui s’étend non seulement à tous les niveaux, branches et agences des gouvernements nationaux, provinciaux et locaux, mais aussi à l’industrie, à la finance, aux médias et au milieu universitaire. Presque toutes les personnes occupant un poste ministériel ou vice-ministériel dans une agence gouvernementale seront membres du parti ; Il en va de même pour les cadres supérieurs des entreprises publiques et des banques, ainsi que pour d’autres institutions telles que les grandes universités, les instituts de recherche et les organes de presse.
ENVIRON TROIS ANS APRÈS SON ACCESSION À LA DIRECTION, LE RÉGIME HU-WEN A PRIS DES MESURES IMPORTANTES POUR DÉPLOYER LES POUVOIRS DE L’ÉTAT-PARTI AFIN D’INFLUENCER LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES, INDUSTRIELS ET DES ENTREPRISES.
Tout ce commandement et ce contrôle ont pu être utilisés par les dirigeants chinois pour des raisons purement politiques, pour consolider leur pouvoir et étouffer la dissidence. Si cela avait été le cas, les implications pour le système commercial auraient pu être mineures. Mais environ trois ans après son accession à la tête du pays, le régime Hu-Wen a pris des mesures majeures pour déployer les pouvoirs de l’État-parti afin d’influencer les résultats économiques, industriels et des entreprises, un net renversement de cap par rapport aux réformes du marché de l’ère Jiang-Zhu.
En février 2006, le Conseil des affaires d’État a publié un document historique intitulé « Plan national à moyen et long terme pour le développement de la science et de la technologie (2006-2020) ». Une expression dans son dense bureaucratisme coincé dans les écrevisses des dirigeants d’entreprises étrangères et des responsables du commerce : « zizhu chuangxin », ou « innovation indigène ». Ce terme impliquait qu’au lieu d’importer des marchandises de l’étranger ou d’inciter les entreprises étrangères à investir et à produire librement en Chine, le gouvernement s’orientait vers une stratégie visant à stimuler les entreprises chinoises, très probablement au détriment des entreprises étrangères.
Le plan énumère un certain nombre de secteurs « prioritaires » « qui sont à la fois essentiels au développement économique et social et à la sécurité nationale et qui ont un besoin urgent de soutien [scientifique et technologique] ». Il s’agit notamment des trains à grande vitesse, des automobiles à haut rendement énergétique, des « ordinateurs performants et fiables », des écrans plats, des équipements médicaux de pointe et des énergies renouvelables. Seize « mégaprojets » ont également été définis : puces et logiciels haut de gamme, fabrication de circuits intégrés à très grande échelle, télécommunications sans fil à large bande de la prochaine génération, machines à commande numérique de pointe, avions de grande taille, réacteurs nucléaires, produits pharmaceutiques et organismes génétiquement modifiés. Les entreprises d’État ont été invitées à obtenir le savoir-faire de partenaires étrangers par le biais de la « co-innovation et de la réinnovation fondées sur l’assimilation de technologies importées ».
Aussi inoffensifs que puissent paraître des mots tels que « assimilation » et « co-innovation », ils ont frappé de nombreux étrangers comme étant de mauvais augure. Le piratage de la propriété intellectuelle à l’ancienne (copie de DVD, imitations de produits de luxe, etc.) était en baisse, mais il y avait une préoccupation potentiellement plus épineuse : la pression exercée sur certaines entreprises étrangères pour qu’elles transmettent le savoir-faire exclusif auquel elles étaient soumises si elles voulaient exploiter le marché chinois. Bien que d’autres pays, notamment le Japon, aient utilisé des stratégies similaires à leur avantage au cours des décennies précédentes, les demandes officielles de transfert de technologie de la part d’investisseurs étrangers contrevenaient aux principes de l’OMC et, lors de son adhésion à l’organisation, Pékin s’était engagé à mettre fin à cette pratique, qu’elle avait autrefois imposée explicitement.
Quelles ont été les implications pratiques de ces développements pour les entreprises étrangères actives sur le marché chinois ? Les résultats dans un secteur sont révélateurs. L’industrie éolienne illustre comment les réglementations gouvernementales, les subventions et d’autres formes de soutien ont permis aux entreprises chinoises d’extraire l’expertise technologique des investisseurs étrangers, puis, après avoir conquis la majeure partie du marché intérieur, de se transformer en puissances d’exportation.
LA CHINE SE DONNAIT UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LES MARCHÉS MONDIAUX QUI ALLAIT AU-DELÀ DES TURBULENCES NORMALES DU CAPITALISME MONDIAL.
Gamesa, une entreprise espagnole qui était le troisième fabricant mondial d’éoliennes, a commencé à expédier un grand nombre d’éoliennes en Chine au tournant du siècle et est devenue le leader, avec une part de 35 % du marché chinois en 2005. Mais cette année-là, le gouvernement chinois a décrété que les parcs éoliens ne pouvaient acheter que des turbines contenant plus de 70 % de pièces fabriquées en Chine ; « Les parcs éoliens qui ne répondent pas à l’exigence de taux de localisation des équipements ne seront pas autorisés à être construits », indique la directive. Gamesa a réagi en envoyant des ingénieurs à Tianjin, où ils ont aidé à construire une usine d’assemblage et ont formé des fournisseurs chinois à la fabrication de composants, tels que des pièces forgées en acier et des commandes électroniques. D’autres fabricants multinationaux de turbines ont pris des mesures similaires et, en l’espace de cinq ans, les entreprises chinoises, soutenues par des prêts à faible taux d’intérêt des banques d’État et des terrains bon marché des autorités municipales, contrôlaient 85 % du marché ; La part de Gamesa était tombée à 3 %. Les plus grands fabricants chinois de turbines détenaient près de la moitié du marché mondial en 2010 et se préparaient à en conquérir davantage.
L’imposition d’exigences en matière de contenu local sur les éoliennes vendues en Chine a clairement violé les règles de l’OMC. Malgré cela, Gamesa ne faisait pas d’histoires – le marché chinois était devenu si important que même la part réduite de l’entreprise était amplement rentable. « Si vous envisagez d’aller dans un pays, vous devez vraiment vous engager dans un pays », a déclaré Jorge Calvet, PDG de Gamesa à l’époque, au New York Times en 2010. Comme l’a rapporté le journal, « le gouvernement chinois a parié à juste titre que Gamesa, ainsi que G.E. et d’autres multinationales, n’oseraient pas risquer de perdre une partie de l’activité florissante des parcs éoliens de la Chine en se plaignant auprès des responsables du commerce de leur pays d’origine ».
Il serait tout à fait injuste d’attribuer à de tels programmes de politique industrielle le mérite d’avoir alimenté toute la croissance spectaculaire dont la Chine a bénéficié au cours des années qui ont suivi son entrée dans l’OMC. L’un des principaux facteurs à l’origine du mastodonte des exportations du pays, en plus des faibles coûts de main-d’œuvre, a été la construction d’infrastructures, telles que les ports côtiers et les autoroutes, qui ont permis la livraison de marchandises aux États-Unis en aussi peu que 18 jours, contre 28 à 45, par exemple, au Sri Lanka. De plus, la réduction des droits de douane imposés par la Chine a rendu les intrants (machines, matières premières, etc.) moins chers pour les fabricants chinois, améliorant ainsi leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Selon une étude publiée par la Federal Reserve Bank of New York en 2017, les industries chinoises qui ont connu la plus forte croissance des exportations sont celles qui ont connu une forte réduction de leurs droits de douane sur les intrants.
Mais le travail acharné, les investissements, les bonnes infrastructures, la maigreur et la mesquinerie ne racontent pas toute l’histoire. La Chine se donnait une longueur d’avance sur les marchés mondiaux qui allait au-delà des turbulences normales du capitalisme mondial.

Une femme est assise au volant d’une voiture neuve dans un parking de Pékin, le 20 juin 2003, lors d’un boom de la possession de voitures privées en Chine. NATALIE BEHRING-CHISHOLM/GETTY IMAGES
Parmi les entreprises américaines qui s’attendaient à récolter une aubaine lorsque la Chine entrerait dans l’OMC, il y avait les fabricants de pièces automobiles, et pendant un certain temps après 2001, les bénéfices se sont matérialisés à peu près comme prévu. Chaque mois, des centaines de milliers de Chinois achetaient leurs premières voitures, dont beaucoup étaient remplies de composants fabriqués aux États-Unis, car l’industrie automobile en pleine croissance du pays dépendait fortement des moteurs, des transmissions, des systèmes de contrôle des sièges, etc. importés. De plus, la Chine réduisait fortement les droits de douane sur les pièces automobiles, conformément à ses engagements d’adhésion.
Mais en 2005, les rôles étaient en train de changer. Cette année-là, pour la première fois, la Chine a exporté plus de pièces automobiles qu’elle n’en a acheté à l’étranger, les expéditions vers le marché américain ayant bondi de 39 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars. L’afflux de pièces chinoises a exacerbé les malheurs d’une industrie américaine déjà en difficulté, comme en témoigne le dépôt de bilan en octobre 2005 de Delphi Corp., le plus grand fabricant américain de pièces automobiles. Les fabricants de meubles américains ont été encore plus durement touchés, car ils étaient sous le choc d’une vague d’importations, principalement en provenance de Chine. Entre 2001 et 2005, au moins 230 usines de meubles ont été fermées aux États-Unis, entraînant la perte de 55 000 emplois, alors que la part de la Chine sur le marché américain des meubles en bois – qui n’était que de 3 % en 1994 – atteignait 42 % en 2002 et 60 % en 2005.
Le choc chinois bat son plein. Bien que le faible coût de la main-d’œuvre chinoise soit en partie l’explication, l’hypercompétitivité des exportateurs chinois peut être attribuée à un autre facteur clé : le taux de change de la monnaie chinoise, le renminbi.
La plupart des grands pays du monde ont laissé leur monnaie flotter en valeur sur les marchés internationaux, en fonction de l’offre et de la demande, au cours des dernières décennies du XXe siècle. Ce n’est pas le cas de la Chine, qui a utilisé un système différent qui s’appuyait sur des contrôles stricts des entrées et des sorties de capitaux et maintenait le renminbi à 8,28 pour un dollar américain, même pendant les années qui ont suivi l’adhésion à l’OMC, lorsque les exportations de la Chine ont grimpé en flèche et dépassé largement les importations. L’excédent de la balance courante du pays – la mesure la plus large de l’excédent des exportations sur les importations – s’élevait à plus de 7 % du PIB en 2005, soit un pourcentage de son économie plus élevé que celui que le Japon ou l’Allemagne n’avaient jamais atteint. Au lieu de permettre à sa monnaie de s’apprécier, ce qui se produirait normalement dans un pays avec un énorme excédent, la Chine l’a freinée en intervenant massivement sur les marchés des changes.
Les entreprises américaines, les syndicats et de nombreux économistes ont soulevé un tollé, considérant le renminbi à taux fixe comme une manipulation classique des forces du marché au profit des travailleurs chinois au détriment des travailleurs américains, bien que les consommateurs américains aient bénéficié de produits chinois moins chers. Des membres indignés du Congrès américain ont présenté divers projets de loi visant à remédier à cette injustice. Le projet de loi le plus populaire – il a recueilli 67 soutiens au Sénat à un moment donné – a été présenté par les sénateurs Chuck Schumer, un démocrate, et Lindsey Graham, un républicain, qui aurait imposé des droits de douane de 27,5 % sur les produits chinois, sur la base des estimations de certains analystes de la sous-évaluation du renminbi.
LES RESPONSABLES DE L’ADMINISTRATION BUSH CONSIDÉRAIENT QUE LEURS OPTIONS ÉTAIENT EXTRÊMEMENT LIMITÉES.
Aussi bruyante qu’ait pu être une telle grandiloquence, les responsables de l’administration Bush considéraient que leurs options étaient extrêmement limitées. Imposer unilatéralement des droits de douane sur les produits chinois constituerait une violation flagrante des règles de l’OMC et conduirait sûrement à une guerre économique entre Washington et Pékin – un scénario cauchemardesque selon presque toutes les estimations raisonnables. L’interdépendance a uni les économies américaine et chinoise dans une étreinte communément surnommée « Chimerica », en dépit – ou plutôt, à cause de – leurs grandes différences. En expédiant des tonnes de marchandises aux consommateurs américains, la Chine accumulait des centaines de milliards de dollars par an, qu’elle injectait dans des titres américains de toutes sortes, y compris des bons du Trésor américain et des obligations émises par des entreprises parrainées par le gouvernement telles que Fannie Mae et Freddie Mac. Pour leur part, les États-Unis, avec leur faible taux d’épargne, se sont appuyés sur cet afflux de capitaux chinois – et de capitaux d’autres pays – pour aider à maintenir les taux d’intérêt bas. Pékin a obtenu des emplois dans le secteur manufacturier pour sortir sa main-d’œuvre massive de la pauvreté, tandis que les Américains ont obtenu des appareils électroniques, des vêtements et d’autres produits importés bon marché, ainsi que des prêts hypothécaires à des taux avantageux. Un conflit commercial qui perturberait les vastes chaînes d’approvisionnement concernées mettrait en danger l’accord Chimerica – et probablement aussi l’économie mondiale, ont estimé les responsables américains. Ils se sont donc tournés vers la diplomatie – le plus silencieux serait le mieux, selon eux, car la Chine voudrait éviter même l’apparence de céder à la pression américaine.
Un exemple est venu lorsque Paulson, quelques mois après son entrée en fonction, a fait son premier voyage en Chine en tant que secrétaire au Trésor. Signe de l’estime dans laquelle il jouissait, il a réussi à s’entretenir brièvement en tête-à-tête avec le président Hu Hu Jintao – juste tous les deux, plus un interprète, une courtoisie extraordinaire étant donné que Paulson n’était pas un chef d’État.
« D’une manière qui ne pouvait être faite que dans le cadre d’une réunion vraiment « privée », j’ai dit quelque chose que je n’ai jamais divulgué aux membres du Congrès ou même à mes collègues membres du Cabinet », écrit Paulson dans son livre Dealing with China (ajoutant qu’il a rapporté l’échange à Bush). « Je lui ai donné un numéro avec lequel travailler. ‘ Monsieur le Président, ai-je dit, si votre monnaie s’appréciait de 3 % par rapport au dollar avant la fin de l’année… En décembre, le résultat serait bon pour la Chine et cela m’aiderait à convaincre le Congrès que [la diplomatie] fonctionne. La réponse de Hu Jintao – « Je comprends » – a suffi à convaincre Paulson que Pékin permettrait au renminbi de s’apprécier plus rapidement qu’auparavant, et à son retour, il a appelé Schumer et Graham, qui ont mis leur projet de loi de côté, du moins pour le moment.
Le renminbi a bien grimpé, mais seulement de 1,3 % au dernier trimestre de 2006 et de 2,2 % au printemps 2007. Le mécontentement est demeuré vif dans les cercles de l’industrie américaine et au Capitole à l’égard du renminbi, qui est encore largement sous-évalué. Frustrés, les responsables de Bush ont mis davantage l’accent sur une nouvelle stratégie, faisant pression sur le Fonds monétaire international pour qu’il change ses règles et utilise son autorité en tant que voix de la communauté internationale pour châtier les pays dont les taux de change sont « fondamentalement désalignés » – la Chine étant la cible évidente. Le résultat, comme nous le verrons, fut une débâcle.

Le président américain George W. Bush salue lors d’une photo de groupe avec les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique à Shanghai, le 21 octobre 2001. Le sommet s’est concentré sur les moyens de stimuler le commerce pour soutenir l’économie mondiale en chute libre à la suite des attentats du 11 septembre. STEPHEN JAFFE/AFP/GETTY IMAGES
Demandez à presque tous ceux qui ont travaillé sur les questions commerciales avec la Chine dans l’administration Bush au cours des premières années qui ont suivi l’adhésion de la Chine à l’OMC et ils admettront que leurs hypothèses optimistes se sont avérées terriblement erronées. Comme l’administration Clinton avant elle, l’administration Bush était majoritairement d’avis que Pékin progressait graduellement mais délibérément vers la libéralisation économique, grâce à l’impulsion de l’adhésion à l’OMC. Bien que mécontents de la politique de change de la Chine, les responsables américains étaient enclins à hausser les épaules plutôt que de tirer la sonnette d’alarme sur des développements tels que la formation de la SASAC ou l’approbation du plan de développement scientifique et technologique de 2006.
« L’opinion générale était que nous allions avoir des obstacles sur la route avec la Chine, et ils viennent d’avaler un énorme éléphant [c’est-à-dire les engagements d’adhésion à l’OMC], donc nous devrions être un peu patients avec eux », m’a dit un haut responsable politique de l’administration Bush. « Leurs politiques s’aligneront sur les nôtres, pas sur des mois, mais cela va se produire. Il y avait une grande confiance là-dedans. Et si vous êtes confiant quant au point final, cela vous permet d’être plus patient en cas de faux pas en cours de route.
Cette indulgence à l’égard de la Chine n’a jamais été plus lourde de conséquences qu’en ce qui concerne les actionneurs de piédestal, des mécanismes qui ajustent la hauteur des sièges des scooters motorisés utilisés par les handicapés physiques.
En août 2002, un fabricant d’actionneurs sur piédestal du New Jersey qui avait perdu une quantité substantielle d’affaires à cause des importations chinoises a décidé de riposter en utilisant la loi. Il s’agissait de la première tentative d’utiliser un type spécial de tarif de sauvegarde qui ne s’appliquait qu’à la Chine. Les mesures de protection ordinaires s’appliquent aux importations en provenance de tous les pays et peuvent être imposées pour fournir une protection temporaire à une industrie menacée par une augmentation des importations, à condition qu’il puisse être démontré que les importations « causent ou menacent de causer un préjudice grave » aux entreprises nationales. Mais au cours de ses négociations d’adhésion à l’OMC, Pékin avait accepté à contrecœur que ses partenaires commerciaux puissent recourir à une sauvegarde « spécifique aux produits chinois », sur la base d’un niveau de preuve relativement laxiste. Les fabricants américains pourraient obtenir des droits de douane temporaires ou d’autres mesures de protection prélevés sur les produits chinois concurrents uniquement si la Commission du commerce international des États-Unis concluait que ces produits importés causaient une « perturbation du marché » affectant négativement l’industrie américaine.
Dans l’affaire des actionneurs sur piédestal, le 18 octobre 2002, la commission du commerce a voté à 3 contre 2 en faveur de l’imposition de mesures de protection contre les importations chinoises. L’« allègement » recommandé consistait en des quotas limitant le nombre d’actionneurs sur piédestal chinois importés pendant trois ans.
BUSH A ENVOYÉ LE MESSAGE QUE LA SAUVEGARDE SPÉCIFIQUE AUX PRODUITS CHINOIS NE SERAIT PAS D’UNE GRANDE UTILITÉ, DU MOINS TANT QU’IL ÉTAIT AU POUVOIR.
Mais trois mois plus tard, la Maison-Blanche annonçait que Bush exerçait son droit de rejeter la recommandation de la commission. Cela a créé un précédent qui s’est produit dans des cas similaires : le 25 avril 2003, le président a refusé d’imposer les mesures de sauvegarde que la commission avait recommandées dans une affaire impliquant des cintres en fil de fer chinois importés ; il a récidivé en 2004, dans une affaire impliquant des « raccords d’aqueduc en fonte ductile » importés de Chine, qui sont utilisés pour assembler des tuyaux et des vannes ; et de nouveau en 2005 dans une affaire de tuyaux en acier. En refusant systématiquement les mesures favorisées par la commission – même lorsque les commissaires votaient à l’unanimité, comme ils l’ont fait dans les cas des cintres et des raccords d’aqueduc – Bush a envoyé le message que la sauvegarde spécifique aux produits chinois ne serait pas d’une grande utilité, du moins tant qu’il était en fonction. Les entreprises américaines ont cessé de déposer de telles plaintes pour le reste de la présidence de Bush, pensant qu’elles ne feraient que perdre du temps et de l’argent.
Expliquant ses décisions dans ces cas, la Maison-Blanche a publié des déclarations notant qu’en vertu de la loi régissant la sauvegarde spécifique aux produits chinois, le président est censé tenir compte de l’impact global sur l’économie américaine, et pas seulement de l’industrie en concurrence avec les importations chinoises. La restriction des importations chinoises entraînerait une hausse des prix pour les utilisateurs de ces articles, ont souligné les déclarations de la Maison Blanche ; Dans le cas des actionneurs de piédestal, par exemple, « un quota aurait un impact négatif sur les nombreux acheteurs handicapés et âgés de scooters de mobilité et de fauteuils roulants électriques, les principaux consommateurs finaux d’actionneurs de piédestal », a déclaré un communiqué présidentiel. De plus, même si le gouvernement bloquait les importations en provenance de Chine, des produits similaires arriveraient bientôt sur le marché américain en provenance d’ailleurs, ce qui rendrait les mesures de protection inefficaces.
Certaines des raisons les plus profondes du rejet de l’utilisation de la sauvegarde de la Chine ont été omises dans ces déclarations publiques. Les conseillers de Bush, menés par le représentant américain au Commerce Robert Zoellick, craignaient que si une industrie bénéficiait d’une protection dans le cadre de la sauvegarde, pratiquement tous les fabricants américains en concurrence avec les importations chinoises réclameraient un traitement similaire. Cela mettrait en péril l’ensemble des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et les multinationales américaines, qui engrangaient de gros profits sur le marché chinois, exerçaient un lobbying intense pour éviter toute perturbation majeure. Le lobbying des responsables chinois, qui se sont vigoureusement opposés à l’utilisation par les États-Unis de la mesure de sauvegarde discriminatoire de la Chine, a également fait pencher la balance. La Maison-Blanche n’avait pas d’autre choix que d’écouter, compte tenu des considérations de politique étrangère telles que l’obtention du soutien de la Chine pour ses campagnes antiterroristes.
BUSH A RÉSISTÉ AUX SUPPLICATIONS DE SÉVIR CONTRE LA CHINE – ET IL A ÉTÉ CONSIDÉRABLEMENT CRITIQUÉ EN CONSÉQUENCE.
Ce n’est pas que l’équipe Bush ait adhéré à la pureté idéologique dans son adhésion au libre-échange. En mars 2002, le président a cédé à la pression des États de la Rust Belt en imposant des droits de douane allant de 8 à 30 % sur l’acier importé, y compris l’acier chinois, en utilisant les règles générales de sauvegarde. Et suivant un modèle établi sous l’administration Clinton, le département du Commerce de Bush a imposé des droits antidumping (pour des ventes présumées à des prix injustement bas) sur les importations en provenance de Chine beaucoup plus souvent, et de manière beaucoup plus punitive, que les importations en provenance de tout autre partenaire commercial.
Mais Bush a résisté aux supplications de sévir contre la Chine – et il a été considérablement critiqué en conséquence. Même lors de sa campagne de réélection en 2004, alors qu’il se faisait pilonner par le candidat démocrate John Kerry pour sa mollesse à l’égard de Pékin, le président s’est ouvertement opposé aux demandes de sanctions des syndicats contre le traitement des travailleurs par la Chine. En restant fidèle à ses convictions, Bush mérite d’être félicité pour son courage politique. Avec le recul, cependant, l’utilisation de la sauvegarde chinoise – ou simplement la menace discrète de Pékin de son application à grande échelle – aurait pu être efficace pour induire un changement dans la politique de change de la Chine. Cela, à son tour, aurait pu atténuer l’impact du choc chinois.
Une telle approche aurait-elle fonctionné ? C’est une question à laquelle il est impossible de répondre ; Quoi qu’il en soit, la Maison-Blanche n’a pas essayé.

Le secrétaire américain au Trésor, Henry Paulson, serre la main du ministre chinois des Finances, Jin Renqing, avant leur rencontre à Pékin, le 21 septembre 2006. ELIZABETH DALZIEL/GETTY IMAGES
Au cours du second mandat de Bush, alors que les aspects troublants de la politique économique de la Chine devenaient plus évidents, les hauts responsables américains ont commencé à parler plus franchement et à agir de manière plus agressive. « La Chine a été plus ouverte que de nombreux pays en développement, mais il y a de plus en plus de signes de mercantilisme, avec des politiques qui cherchent à orienter les marchés plutôt qu’à les ouvrir », a averti Zoellick, qui avait été nommé secrétaire d’État adjoint, dans un discours largement acclamé le 21 septembre 2005, qui a exhorté Pékin à devenir une « partie prenante responsable dans le système international ».
En réponse à l’intensification des critiques au Congrès, le nouveau représentant américain au commerce, Rob Portman, a promis d’entreprendre un « examen complet » de la politique commerciale de l’administration vis-à-vis de la Chine. Cet examen a donné lieu à un rapport de février 2006 citant, entre autres, « les obstacles persistants de la Chine à certaines exportations américaines ; l’absence de protection des droits de propriété intellectuelle ; l’incapacité à protéger les droits du travail et à faire respecter les lois et les normes du travail ; [et] des subventions et des préférences gouvernementales étendues et non déclarées pour les propres industries [de la Chine] ». La principale proposition, mise en œuvre peu de temps après, était une expansion significative de la capacité de Washington à enquêter sur les pratiques commerciales chinoises et à réprimer les infractions.
Et puis, quelques mois après ce rapport, Paulson est arrivé à Washington avec la bénédiction du président pour essayer une nouvelle approche de l’engagement économique entre les États-Unis et la Chine.
L’idée de Paulson, qui a été baptisée « Dialogue économique stratégique », a germé au cours de l’été 2006 lors de séances de brainstorming avec Deborah Lehr, qui avait servi dans l’administration Clinton en tant que négociatrice commerciale de haut niveau pour la Chine et était mariée au chef de cabinet de Goldman. Les décideurs politiques de haut niveau se réunissaient deux fois par an pour faire des concessions sur toutes sortes de questions économiques, non seulement sur des sujets brûlants liés au commerce, à la monnaie et à l’investissement, mais aussi sur l’ouverture des marchés financiers, l’énergie, l’environnement et la sécurité des aliments et des produits. Autres relations sino-américaines Des forums de négociation existaient déjà, notamment celui lancé en 1983 appelé la Commission mixte sur le commerce et le commerce, mais en choisissant les principales priorités économiques et en mettant le maximum d’accent sur celles-ci lors du Dialogue économique stratégique, les États-Unis pourraient communiquer plus clairement à la Chine ce qu’ils voulaient et ce qu’ils étaient prêts à donner en retour, a soutenu Paulson. Le chef du Trésor souhaitait inclure un grand nombre de ministres chinois et de responsables influents impliqués dans les questions économiques, tout en réservant du temps pour un bref entretien avec les chefs d’État respectifs, Hu Jintao et Bush. Ce serait le moyen le plus efficace d’exploiter la « prise de décision descendante mais consensuelle » de la Chine, selon Paulson.
PAULSON EST ARRIVÉ À WASHINGTON AVEC LA BÉNÉDICTION DU PRÉSIDENT POUR ESSAYER UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE.
Le résultat peut être décrit comme incrémental au mieux. La première séance s’est tenue les 14 et 15 décembre 2006 dans le Grand Palais du Peuple, les deux délégations se faisant face sur de longues tables et des écrans vidéo placés à intervalles réguliers pour visionner des diapositives PowerPoint. Paulson occupait une position de « super cabinet », à la tête d’une équipe de 28 personnes qui comprenait six de ses collègues membres du cabinet et des chefs d’agence, notamment le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke. Du côté chinois, le vice-Premier ministre Wu Yi a été l’homologue de Paulson, avec 14 responsables ministériels présents ainsi que des assistants de haut rang. Malgré l’espoir d’une discussion animée sur les points de l’ordre du jour qui comprenaient la stratégie de développement économique de la Chine et des questions énergétiques et environnementales spécifiques, même Paulson a dû admettre dans son livre que « les orateurs se sont trop souvent appuyés sur des éléments de base ou des points de discussion ». Quatre autres rassemblements ont eu lieu pendant le reste de la présidence de Bush – un à Washington, un à Annapolis, dans le Maryland, et deux autres à Pékin.
Quelques résultats concrets ont été obtenus, notamment un accord sur le transport aérien qui a plus que doublé le nombre de liaisons sans escale entre les États-Unis et la Chine, un engagement de la Chine en matière d’échange de droits d’émission et un accord sur la promotion du tourisme. Mais les responsables commerciaux américains qui y ont participé ont généralement trouvé que les pourparlers n’étaient pas propices à des percées sur les questions qui leur importaient. « C’était intéressant – il y avait des présentations toutes faites, mais absolument rien n’en est ressorti », m’a dit Warren Maruyama, conseiller général au Bureau du représentant américain au commerce à l’époque.
Quoi qu’il en soit, les Dialogues économiques stratégiques ont été dépassés par d’autres développements sur les marchés financiers américains.
Les discussions étaient censées se dérouler dans les deux sens, la Chine ayant le droit réciproque d’exprimer ses préoccupations concernant les politiques américaines, et les responsables chinois avaient beaucoup de choses à dire après l’effondrement de Bear Stearns en mars 2008. Au milieu de la débilitation constante d’autres entreprises de Wall Street, M. Paulson a été assailli de questions de la part des Chinois sur la santé des banques américaines, l’adéquation de la réponse de Washington et la sécurité des titres américains détenus par la Chine. Lors du dialogue d’Annapolis en juin 2008, Wang Qishan, qui connaissait Paulson depuis 15 ans et avait succédé à Wu à la tête de la délégation chinoise, a pris le secrétaire au Trésor à part. Il voulait que je sache que la crise financière aux États-Unis avait affecté la façon dont lui et d’autres hauts responsables du Parti nous voyaient », se souvient M. Paulson, qui cite M. Wang comme ayant dit : « Vous étiez mon professeur, mais aujourd’hui, vous n’êtes plus le seul : « Vous avez été mon professeur, mais je suis maintenant dans le domaine de mon professeur, et regardez votre système, Hank. Nous ne sommes plus sûrs de devoir apprendre de vous ».
LES DIALOGUES ÉCONOMIQUES STRATÉGIQUES ONT ÉTÉ DÉPASSÉS PAR D’AUTRES DÉVELOPPEMENTS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS AMÉRICAINS..
Pendant ce temps, au FMI, la bataille sur la politique monétaire de la Chine atteignait son paroxysme en coulisses. Les services du FMI mettaient la dernière main à un rapport qui aurait vivement réprimandé la Chine aux yeux de la communauté internationale en qualifiant le renminbi de « fondamentalement désaligné » et en demandant à la direction générale du Fonds d’entamer des consultations spéciales avec Pékin. Paulson et d’autres fonctionnaires du Trésor ont exercé de fortes pressions, malgré les objections véhémentes de la Chine, pour que le rapport soit publié et présenté au conseil d’administration du Fonds monétaire. Une épreuve de force s’annonçait lorsqu’une réunion du conseil d’administration a été programmée pour le 22 septembre 2008, date dont personne ne savait à l’époque qu’elle interviendrait exactement une semaine après l’épisode financier le plus catastrophique que l’on ait connu depuis des générations.
La réunion du conseil d’administration n’a jamais eu lieu. Le rapport des services du FMI est resté enfoui dans les dossiers du Fonds jusqu’à ce que j’en reçoive une copie et que j’en fasse la lumière des années plus tard. En fait, le Trésor américain n’a plus voulu inciter le FMI à dénoncer la politique monétaire de la Chine. Le 15 septembre, Lehman Brothers a fait faillite ; le lendemain, l’assureur géant AIG a dû obtenir un prêt d’urgence de 85 milliards de dollars de la Fed pour éviter le sort de Lehman. Les fluctuations financières d’une ampleur stupéfiante qui ont suivi pendant des mois ont à nouveau déplacé l’équilibre des forces des États-Unis vers la Chine – cette fois-ci de manière sismique, par plusieurs ordres de grandeur plus importants que tout ce qui s’était produit plus tôt dans la crise.
Un autre livre de M. Paulson, On the Brink, donne des indications utiles sur les raisons de ce changement radical. Dans les chapitres qu’il consacre aux événements qui ont immédiatement suivi la faillite de Lehman, l’ancien secrétaire au Trésor évoque de nombreux appels téléphoniques à Pékin au cours desquels lui-même et d’autres fonctionnaires du Trésor imploraient essentiellement les dirigeants chinois de les aider à maintenir à flot le reste du système financier américain. Le samedi suivant l’effondrement de Lehman, par exemple, Paulson a appelé Wang dans l’espoir qu’une entreprise publique chinoise investisse dans le géant de la banque d’investissement Morgan Stanley, qui avait désespérément besoin d’une injection de liquidités.
DANS LA MESURE OÙ L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE AVAIT ÉTÉ ADMIRÉE COMME UN MODÈLE QUE LA CHINE DEVAIT S’EFFORCER D’IMITER, LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE A FAIT VOLER EN ÉCLATS CES PERCEPTIONS.
C’est là, ironiquement, que le dialogue économique stratégique a peut-être eu l’impact le plus important. Reconnaissant à Pékin le mérite d’avoir « joué un rôle important pour aider l’Occident à survivre et à sortir du pire de la crise », M. Paulson conclut : « Les relations que j’avais établies en Chine, chez Goldman et grâce aux efforts minutieux du SED, ont porté leurs fruits : « Les relations que j’avais nouées en Chine, chez Goldman et grâce aux efforts laborieux du SED, ont porté leurs fruits.
Les profondeurs dans lesquelles les États-Unis ont plongé – et la crise en Europe qui a suivi – ont complètement discrédité le capitalisme de style occidental aux yeux de nombreux Chinois. Dans la mesure où l’économie américaine avait été admirée comme un modèle que la Chine devrait s’efforcer d’imiter, la crise financière mondiale a fait voler en éclats ces perceptions.
Non seulement l’économie chinoise a elle résisté à la crise, mais elle a également connu une croissance si vigoureuse qu’elle est devenue la source la plus puissante de soutien à la reprise mondiale. Lorsque la demande étrangère s’est ratatinée au cours de l’hiver 2008-2009, provoquant une chute des commandes à l’exportation et laissant des millions de travailleurs chinois inactifs, Pékin a réagi avec un plan de relance d’urgence qui comprenait des dépenses de près de 600 milliards de dollars, soit 12,5 % du PIB, sur des priorités telles que les transports, l’électrification, les soins de santé, l’éducation et le logement à faible revenu. La Banque populaire de Chine, quant à elle, a réduit les taux d’intérêt et a également utilisé un outil politique à la disposition de peu de banques centrales ailleurs : elle a doublé l’objectif de prêt bancaire, auquel les grandes banques ont été obligées d’obéir par une folie de crédit pour les entreprises publiques et privées chinoises. La conséquence a été que la production a augmenté à un rythme de 9,1 % en 2009, soit presque le même taux de croissance que l’année précédente et dépassant de loin les économies du reste du monde.
En Chine, les réformateurs qui étaient en faveur de progrès supplémentaires vers la libéralisation des marchés et le recul du contrôle du parti-État ont été mis sur la défensive. Les étatistes s’enhardissaient. De plus en plus confiant dans les vertus de son propre modèle, Pékin s’écarte de l’approche économique de ses partenaires commerciaux ; ce faisant, elle a sapé le soutien au système de l’OMC fondé sur des règles à l’étranger. Et maintenant, les fondements de ce système ont été fracturés par le comportement capricieux et le mépris des règles internationales de l’actuel président des États-Unis. Mais les origines de la destruction actuelle se trouvent dans les événements d’une présidence américaine précédente.
Views: 2