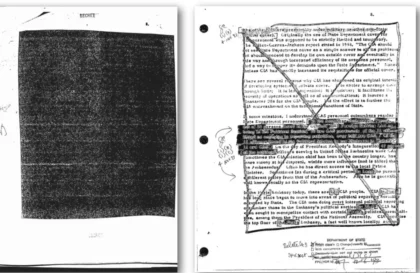Cet article met l’accent sur quelque chose d’important, la difficulté d’une perception globale (holiste) du capitalisme et il propose à la suite des travaux de FREDERIC JAMESON de voir les productions culturelles comme reflétant cette impossibilité cognitive, mais il a tendance à attribuer à la nature mélodramatique de la fiction l’impossibilité politique à faire autre chose qu’à jouer la lutte des classes, à les parodier comme à guignol et le cinéma sud-coréen refléterait à la fois l’extrême où nous mène le capitalisme, le nécessaire internationalisme et la parodie exutoire plus que l’action révolutionnaire, il y a du vrai. Pourtant cette absence de synthèse et ce masque sur les causalités, ce moralisme, qui tend surtout à masquer la nature de classe des processus à l’œuvre est bien « culturelle » et elle lie l’élite, les scientifiques, les créateurs et le grand public dans la même désorientation ce qui donne un brouhaha généralisé et une parcellisation déformée, un effet loupe dans laquelle l’action est conçue comme impossible. On ne sort pas de l’idéologie par l’idéologie, et de la représentation par la représentation, mais celle-ci exprime un profond malaise dans la civilisation. Je crois qu’un des succès tout relatif de ce blog réside dans le fait que ses contributeurs marxistes et communistes refusent résolument cet air du temps, entre positivisme, modernisme et acceptation, en privilégiant le sens dans ses formes globales, une carte, mais aussi une histoire avec ses lignes fortes de progrès, ce qui débouche sur le « faire », ce qui me paraît être la reconstruction capable de recréer un lien entre créateurs, scientifiques et protagonistes de l’histoire. (note et traduction de Danielle Bleitrach dans histoire et société)
08/12/2021
Cet article a été initialement publié à l’Institut d’études culturelles et de changement social
Je n’ai pas l’intention ici de dire grand-chose sur le prétendu anticapitalisme du nouveau méga-succès coréen The Squid Game. Pas parce que je pense que ce n’est pas important. Des personnes beaucoup plus pertinentes, comme Pablo Iglesias lui-même, ont déjà écrit sur les vertus supposées édifiantes de ce qui est déjà la série Netflix la plus regardée de tous les temps. Au vu du succès de ce qui semble sans doute être une dystopie critique avec le système capitaliste, presque tous les porte-parole et critiques culturels de la gauche se sont précipités pour souligner et célébrer le contenu social de la série, qui d’autre part semble suffisamment évident pour qu’aucun intellectuel n’ait eu à l’expliquer.
Cette insistance de la gauche ne peut pas non plus être écartée face à la tendance à pointer du côté supposé paradoxal de la série. Après tout, c’est le produit d’une multinationale comme Netflix et, si vous faites des poupées funky à partir de The Squid Game, ce ne sera pas si anticapitaliste. Ces arguments, parfois aussi articulés (mais aussi puissants) sont rudimentaires, mais pas anodins. En fin de compte, ce qui était jusqu’à il y a quelques semaines la série non anglophone la plus regardée sur Netflix, La casa de papel, est un bon exemple de la façon dont l’éthique révolutionnaire peut être réduite à sa simple iconographie, lorsque la fantaisie à laquelle la série invite ne va pas au-delà de l’air cool avec une combinaison rouge et un pistolet dans les mains, même si c’est au rythme de Bella Ciao et entre les appels à Robin des Bois. Des débats qui ne sont pas nouveaux, voir le statut iconique du masque bien connu de Guy Fawkes qui cache le visage de V dans le roman graphique V pour Vendetta. Je ne pense pas non plus que cette libido iconographique ne soit pas importante, je serais même prêt à accepter qu’une partie de cette iconographie performative soit une condition nécessaire de toute révolution. En aucun cas, bien sûr, cela ne peut être une condition suffisante.
Quoi qu’il en soit, il y a encore un débat sur la question de savoir si, comme Matt Colquhoun l’a récemment défendu dans son blog, The Squid Game « ce n’est pas le capitalisme qui avance par l’appropriation du sentiment anticapitaliste mais le sentiment anticapitaliste qui avance par l’appropriation du capitalisme ». J’ai tendance à être d’accord avec Matt ici, mais je ne voulais pas me concentrer sur le message supposé de la série. Au lieu de cela, j’ai voulu réfléchir à quelque chose qui, je pense, est plus subtil, mais encore plus important : les questions qu’il soulève sur la représentation du Capital et le problème de sa forme mélodramatique dans la fiction contemporaine.
La théorie des cartes cognitives de Fredric Jameson
Tout d’abord, il faut faire un petit détour, pour remonter aux années soixante-dix. À cette époque, il n’y avait toujours aucun moyen de prédire le monstre de Frankenstein que deviendrait un courant artistique naissant qui a fini par être appelé, dans un terme emprunté à l’architecture, le postmodernisme. Plus d’une décennie avant son travail monumental sur le postmodernisme, le théoricien américain Fredric Jameson, en bon marxiste, était clair : les mutations dans le langage artistique et culturel répondaient aux mutations du système de production capitaliste. Dans une célèbre conférence donnée au milieu de la décennie, Jameson a établi un parallèle entre les différentes étapes du capitalisme et les moments d’évolution de la culture contemporaine, sans postuler une causalité directe mais une corrélation claire. Le capitalisme national de la seconde moitié du XIXe siècle correspondait au réalisme de Flaubert ou Galdós, et à la période monopoliste et impérialiste de la première moitié du XXe siècle correspondait le modernisme d’Eliott, Mann ou Joyce. Pour faire progresser le capitalisme d’après-guerre, multinational et délocalisé, Jameson a étudié le langage postmoderniste d’Andy Warhol ou de Thomas Pynchon.
Dans cette conférence, le philosophe a utilisé ce parallélisme pour dessiner son concept de cartes cognitives, compte tenu du fait que le capitalisme est entré dans ce qu’il comprenait comme une phase particulièrement complexe qui nous poserait un problème dans notre capacité à le décrire clairement. L’idée de cartes cognitives est fondamentalement très simple, et est basée sur la possibilité d’une médiation entre deux pôles. D’une part, les injustices et les spoliations matérielles du capitalisme continuent d’être ressenties dans la vie quotidienne comme toujours, elles sont parfois plus palpables et évidentes que jamais au niveau individuel. D’autre part, cependant, le système de production capitaliste a atteint un niveau de complexité, de dépersonnalisation et d’internationalisation si prononcé qu’il semble impossible de trouver non seulement directement des responsables, mais quelque chose de similaire à la possibilité de changement.
Le capitalisme avancé, un terme que Jameson reprend de l’économiste Ernst Mandel, semble impossible à comprendre mieux que comme une présence insondable et inquiétante, au point qu’au fur et à mesure que son influence s’étend dans tout l’espace vital de la planète, sa présence devient plus insaisissable et ineffable, s’identifiant à la réalité elle-même: ce qui est toujours mais il est impossible de dire précisément ce que c’est. En guise de médiation pour cette figure, Jameson a ensuite proposé le concept de « carte cognitive », terme qu’il reprend du livre de Kevin Lynch The Image of the City. Dans ce livre, Lynch a étudié la façon dont les citadins modernes se présentent l’arrangement urbain de leur propre environnement, parfois avec des résultats déformés de manière suggestive. Pour Jameson, la cartographie cognitive est donc l’exercice de chaque individu pour représenter le système global dans lequel il vit et sa position particulière dans celui-ci, une tâche qui est devenue de plus en plus compliquée chaque jour. C’est la tâche épistémologique de l’auto-perception de la société capitaliste contemporaine, qui se produit généralement à travers nos produits culturels, nos fictions et nos stratégies esthétiques.
Pour Jameson, la carte cognitive : « … c’est essentiellement un concept allégorique qui présuppose l’évidence, c’est-à-dire que ces nouvelles et énormes réalités globales sont inaccessibles à tout sujet ou conscience individuelle […] ce qui revient à dire que ces réalités fondamentales sont en quelque sorte finalement irreprésentables ou, pour reprendre le terme d’Althusser, sont quelque chose comme une cause absente, qui ne peut pas émerger en présence de la perception. Alors que cette cause absente peut trouver des figures à travers lesquelles s’exprimer de manière déformée et symbolique » [1].
La tâche de la cartographie cognitive est donc d’élucider notre chemin entre ces formes déformées et symboliques. Ce qui est une carte cognitive appropriée pour une stratégie émancipatrice est quelque chose que Jameson ne dit jamais tout à fait clairement et quand il semble approcher un critère, c’est quelque peu décevant. Mais Jameson a beaucoup à dire sur les formes inadéquates et pernicieuses de la cartographie cognitive, celles qui falsifient ou blanchissent la réalité du système capitaliste contemporain. Certaines de ces cartographies imparfaites accusent également les fictions les plus explicitement anticapitalistes. À mon avis, quelque chose comme ça se passe avec The Squid Game.
Jameson était très clair sur le fait que l’un des problèmes fondamentaux de la cartographie cognitive était le mélodrame. C’est-à-dire : l’approche de l’histoire comme une lutte antagoniste entre le bien et le mal, entre les valeurs morales absolues. Nous vivons dans un monde post-Eichmann, pensait Jameson, où l’on ne peut pas dire que le mal le plus absolu du monde ne vient pas d’un conclave satanique ou d’un cerveau central machiavélique, mais où les plus grandes injustices et humiliations sont l’œuvre au mieux de bureaucrates gris qui agissent comme de simples rouages dans un système aveugle qui se déplace déjà de manière imparable et automatique. Jameson pensait que cela avait rendu le mélodrame « de plus en plus intenable. Si le mal n’existe plus, les méchants deviennent également impossibles […] Cela explique pourquoi les méchants de la culture de masse ont été réduits à deux survivants solitaires de la catégorie du mal : ces deux représentations du vraiment antisocial sont, d’une part, des tueurs en série et, d’autre part, des terroristes. » [2]
La question du mélodrame est, à mon avis, exactement le problème fondamental de The Squid Game, mais pas exactement comme Jameson le formule. Bien que l’on puisse dire que la série a un message anticapitaliste sans équivoque, elle contient un problème fondamental dans la représentation du capitalisme lui-même. En tant que fiction, la série semble avoir besoin d’établir des méchants reconnaissables, une idée de mal mélodramatique et aiguisé, quelque chose qui interfère avec la réalité éminemment ineffable et dépersonnalisée du capitalisme contemporain, où il n’y a jamais de responsable direct clair ou de comité organisateur de l’injustice. Mais la série, contrairement à ce que dit Jameson, ne finit pas par recourir à des tueurs en série et des terroristes, mais à deux autres personnages particuliers.
D’une part, nous avons le méchant à l’intérieur du jeu: Cho Sang-woo, ami d’enfance de notre protagoniste, Seong Gi-hun, et qui, bien qu’ayant initialement triomphé dans la vie grâce à son éducation, s’est retrouvé dans une situation d’endettement similaire à son partenaire pas si primé. Au fur et à mesure que la série progresse, Cho Sang-woo fait preuve d’une attitude égoïste et intéressée, manipulant ses coéquipiers chaque fois qu’il le peut pour faire avancer le jeu et trahissant de nombreux autres joueurs, d’une manière particulièrement sanglante envers le naïf Abdul Ali. En revanche, Seong Gi-hun est présenté avec le caractère compatissant et solidaire, une attitude qui le pénalise parfois mais est finalement récompensée quand il finit par gagner la partie.
Sa compassion et son humanité atteignent son moment de foi définitif au plus fort de la série, lorsque devant un Sang-woo vaincu, il propose que les deux votent pour mettre fin au jeu et ainsi les deux sauvent leur vie, bien que la série ait clairement indiqué que Sang-woo ne mérite pas d’être sauvé (Gi-hun présente ici l’une des qualités les plus importantes de la divinité: la Grâce). Mais il est clair que Sang-woo ne peut pas être sauvé, et c’est lui-même qui se suicide. Si l’on doutait que ce soit le point culminant fondamental de la série, le déluge final opportun l’indique, qui reste dans la fiction audiovisuelle un déclencheur émotionnel extraordinairement efficace malgré sa condition de cliché répétitif, ou peut-être précisément à cause de cela. De cette façon, The Squid Game clôt son intrigue mélodramatique avec un autre cliché qui, cette fois en donnant la raison à Jameson, est devenu endémique dans la culture populaire en tant que résolution symbolique du mélodrame. Tant qu’il ne finit pas en prison ou dans un établissement psychiatrique, le méchant se suicide opportunément. Quoi qu’il en soit pour que le protagoniste ne voie pas son zénith moral entaché d’une mort sous sa responsabilité.
La deuxième figure avec laquelle la série dépeint le mal est peut-être plus intéressante, mais beaucoup plus problématique. Il s’agit des méchants externes, ceux qui gèrent le jeu lui-même. Au début, représentée par l’image iconique des sbires en costumes bleus et masques noirs, il est très suggestif de voir cette figuration du pouvoir dans le système capitaliste comme une entreprise éminemment aveugle, violente et dépersonnalisée, qui suit apparemment les ordres d’un méchant supérieur qui n’apparaît pourtant jamais. Les sbires dépersonnalisés semblent terriblement proches de la nature acéphale et brutale de la violence du capital, apparemment organisée de la manière la plus efficace et la plus rationnelle à l’intérieur, mais sans aucun sens ou intelligence externe qui l’englobe et lui donne sa raison d’être. Le fait qu’ils soient, en fin de compte, des hommes de main asservis qui ne peuvent connaître l’identité de chacun et qui sont, à leur manière, soumis à la violence de leurs supérieurs, est un rappel précis de la façon dont les vecteurs de répression et de perpétuation de l’ordre établi en sont à leur tour victimes.
Mais la série touche clairement un terrain marécageux au point qui a généré le plus de critiques et de frictions: quand il s’agit de représenter ses méchants, les soi-disant VIP, et quand elle révèle dans son dernier épisode que le joueur 001 était l’un des cerveaux derrière le jeu. Je ne parlerai pas beaucoup de ce dernier, car je pense qu’il contient des erreurs plus techniques, comme quelques trous de script. Mais je pense que le premier point mérite notre intérêt, car il illustre très bien le problème auquel nous sommes confrontés ici. Les personnages qui sont connus dans la série sous le nom de VIP semblent en fait être une conclusion logique aux commentaires sociaux du jeu, et résonnent de manière effrayante avec des histoires vraies comme les clients, tous milliardaires et figures du pouvoir mondial, affluant vers le réseau de prostitution infantile de Jeffrey Epstein. Je ne peux pas nier que je suis attiré par le comportement inquiétant et terrible des masques dorés des VIP, alors que de somptueux et cruels dieux païens regardant les affaires des mortels entre dédain et réjouissance des mortels insignifiants se déchiraient.
Mais il y a un problème clair à dépeindre la classe dirigeante du capitalisme comme explicitement cruelle et hédoniste, lubrique, comme si la raison de l’injustice (quelque chose qui semble également déduire le twist final susmentionné) était le simple amusement des riches. La série réussit à montrer que la dimension ludique et libidinale des injustices quotidiennes, où l’exploitation du travail et la consommation aliénante sont généralement déguisées en jeu, est une stratégie idéologique étendue. Faire allusion à l’idée que l’injustice et l’inégalité ont une relation directe avec l’hédonisme voyeuriste des riches peut nous rapprocher de l’absurdité et du non-sens de tout cela, mais cela favorise une mauvaise réponse au dilemme: que la raison de la souffrance de ceux d’en bas est le caprice des très méchants au sommet. De plus, dans ses efforts pour prouver à quel point ces VIP sont pervers, la série finit par présenter son seul personnage LGBTI comme un violeur, dans une itération saignante du trope mesquin et répétitif selon lequel la liberté sexuelle équivaut à la déviance sexuelle.
Cette figure de la salle des hyper-riches et des réseaux de pouvoir qui font fonctionner le jeu tombe aussi, en réalité, sur ce que Jameson n’a pas mis longtemps à qualifier de « carte cognitive des pauvres » [3] (ce que Jameson entendait ici par « pauvre » a fait l’objet, en réalité, de débats féroces). C’est le conspirationnisme, que l’on peut comprendre parce que c’est la figure la plus utilisée de la cartographie cognitive dans un monde dont l’énorme complexité et la vaste extension de la misère et de l’injustice nécessitent un plan directeur, un conclave secret qui tire les ficelles dans l’obscurité.
Dans les deux cas, la série semble rediriger son commentaire approprié sur le capitalisme, en tant que jeu violent, atroce et absurde, vers des touches mélodramatiques: l’iniquité du traître Sang-woo et la convoitise des VIP grotesques, des stéréotypes voluptueux du pouvoir comme hédonistes et conspirateurs. Je ne crois pas, comme Jameson le croit, que le mélodrame soit en crise profonde et, par extension, qu’il en soit de même pour la culture de masse. Je pense que le mélodrame est encore une limite insurmontable pour la fiction, bien qu’il y ait aussi des contre-exemples intéressants. Le fait que l’intrigue moraliste et le mélodrame en général continuent d’apparaître comme une cage narrative incontournable pour la culture de masse n’est pas un problème pour la culture de masse, mais pour ceux d’entre nous qui veulent générer une idée plus adéquate du monde dans lequel nous vivons, où il n’y a pas de conspiration qui gère les événements et le méchant ne résoudra pas l’enchevêtrement en prenant nos vies.
Il semble que nous soyons incapables de représenter adéquatement le système mondial dans lequel nous vivons sans recourir aux tropes moralistes du bien et du mal, au conspirationnisme ou au mal radical du terrorisme ou de la sociopathie. Selon les mots d’Alberto Toscano et jeff Kinkle, deux des principaux auteurs qui ont développé la théorie des cartes cognitives aujourd’hui : « c’est comme si l’incapacité d’aborder les aspects de la domination abstraite et de la violence systémique du capitalisme (son « mal » structurel) conduisait à projeter des scènes de violence réelle et de plans sinistres (une sorte de mal ‘diabolique’) sur son noyau » [4]. Il est effrayant de voir comment cette phrase semble décrire parfaitement The Squid Game. Ce qui est en crise dans nos capacités à représenter adéquatement le monde dans lequel nous vivons et qui est vraiment inquiétant, c’est que, si notre fiction semble inadéquate pour aborder ce problème, cela est sûrement pire pour nous, et non pour la fiction.
La Corée comme dystopie
Un effet particulièrement intéressant de The Squid Game a été d’attirer l’attention de la planète sur les extrêmes inhumains du néolibéralisme en Corée, où la dette familiale dépasse le PIB et la semaine de travail est de 52 heures, bien que les politiciens populaires proposent de ne pas la ramener aux 68 heures d’il y a seulement trois ans, mais pour l’étendre encore plus. Il y a quelques jours à peine, les travailleurs coréens ont lancé une grève massive au cours de laquelle, soit dit en passant, ils ont utilisé l’iconographie de la série pour attirer l’attention sur leurs revendications. Curieusement, il s’est avéré que la dystopie coréenne n’était pas celle du Nord, qui aujourd’hui ne va pas au-delà d’une parodie atroce des régimes totalitaires du XXe siècle, mais celle du Sud, qui apparaît comme grotesque mais possible extrême et surtout comparable pour ceux d’entre nous qui vivent sous le joug des sociétés néolibérales.
Ce n’est pas un hasard si tout le monde a pensé presque immédiatement à Parasite (Bong Joon-ho, 2019), une fable tordue sur les inégalités en Corée qui a obtenu un succès mondial très similaire à celui de The Squid Game, bien que différente dans les formes, en remportant l’Oscar du meilleur film en 2020 et en remplissant les gros titres de la presse pendant des mois. Bien que cette tendance semble très bonne, la réalité est que Bong Joon-ho avait déjà signé deux dystopies nettement critiques du néolibéralisme, Snowpiercer (2013) et Okja (2017), deux des meilleurs films de science-fiction de la dernière décennie. Aujourd’hui, il semble que nous soyons confrontés à toute une vague de nouvelles dystopies coréennes, dont nous ne pouvons que penser qu’elles seront aiguisées après le succès de la série Netflix. Fait intéressant, c’est cette même plateforme qui a distribué les deux exemples récents les plus remarquables, les films Hunting Time (Yoon Sung-hyun, 2020) et Space Sweepers (Jo Sung-hee, 2021) et, soit dit en passant, a produit une série sur Snowpiercer.
Ce qui est intéressant à propos de Hunting Time, c’est que son avenir dystopique, où l’inflation, la corruption et la pauvreté balayent une Corée traversée par la turbulence sociale et la désolation urbaine, est qu’il ne semble pas très différent de notre monde actuel. Peut-être que la chose la plus intéressante à propos du film est précisément ce semblant désenchanté et inhabité de la ville, qui apparaît ici plus comme le vieux rêve abandonné de l’urbanisme capitaliste, nu dans son squelette industriel, que la ville néon hallucinatoire du cyberpunk. Bien que son cadre soit certainement réussi, le récit retombe sur le mélodrame, dans une intrigue très pratique où les petits criminels font face à un tueur à gages impitoyable et implacable dont la figuration du pouvoir reflète des idées non négligeables, mais cela ne peut pas être dit nouveau depuis la première de Terminator (James Cameron, 1984), même avant.
Le ton comique et léger de Space Sweepers ne doit pas nous faire dédaigner cet autre film, qui contient des aperçus extraordinaires de quelque chose d’aussi évident mais nécessaire à souligner que la possibilité d’une solidarité internationaliste dans un monde d’éclectisme culturel et de mondialisation apparemment chaotique. Les protagonistes, dont la tâche est littéralement de collecter des déchets spatiaux, affrontent dans une aventure épique un gourou maléfique des technologies qui est une parodie machiavélique de Steve Jobs et Elon Musk, si caustique qu’elle semble irréelle mais est une broche très satisfaisante face à la Silicon Valley.
Sans avoir besoin d’approfondir les défauts ou les vertus de ces films, il convient de noter que les dystopies néolibérales coréennes sont un genre en pleine effervescence, dont il est fort probable que nous ayons à peine vu le début. Je n’ai pas assez de connaissances sur la réalité du pays pour établir un diagnostic précis de cette tendance, mais je pense qu’il n’est pas très difficile d’observer que le scénario sud-coréen de précarité, de flexibilité du travail et d’inégalité sociale est devenu un emblème sinistre et dangereux du monde à venir, une exagération grossière des difficultés ouvrières et économiques de nos propres sociétés qui semblent n’avoir fait qu’augmenter ces dernières années.
Il est vraiment curieux d’observer comment, dans l’imaginaire futuriste occidental, l’Extrême-Orient a presque toujours représenté un emblème de notre futur proche, ce qui est évident à partir de la modélisation de la ville cyberpunk à travers l’iconographie des mégapoles asiatiques. Il semble que quelque chose comme cela se reproduise avec la montée des dystopies coréennes. Au contraire, la simple popularité mondiale de ce genre, comme l’a démontré The Squid Game,est en soi une bonne nouvelle, et en tant que telle, nous devrions la prendre.
Une autre question sera d’évaluer, comme Jameson l’a proposé avec son analyse, dans quelle mesure ces dystopies peuvent comprendre de manière adéquate la complexité du système capitaliste mondial, comment elles peuvent agir comme des cartes cognitives. Cela ne semble pas être un bon signe que ces fictions tombent dans des schémas mélodramatiques, tels que le conflit de joueurs ou les figurations conspiratrices de The Squid Game, le thriller de braquage dans Hunting Time, ou le space opera épique Space Sweepers. L’idée que la Corée néolibérale puisse servir de pont entre les intempéries ressenties par des milliards d’individus dans le monde et le visage global de ce système lui-même est certainement suggestive. Nous manquerions toujours d’espace pour en parler, mais surtout il semble qu’en ce moment nous manquions de temps, assez pour comprendre où ce genre se dirige. Il semble encore trop tôt pour déterminer si The Squid Game sera le catalyseur définitif d’un âge d’or de la dystopie néolibérale dans la science-fiction, sud-coréenne et internationale, ou de la sublimation de tout ce que cela aurait pu signifier dans les fictions qu’ils supposent être l’itération fatiguée d’une iconographie aux ambitions de viralité.
En réalité, la question est plus sinistre : la fiction en tant que telle doit-elle tomber dans des schémas mélodramatiques ou des clés narratives communes simplement pour fonctionner comme une fiction ? Si pour offrir le conflit nécessaire et la réconciliation finale de tout récit, en particulier dans sa version de la culture de masse, il doit toujours y avoir du bon et du mauvais, un monstre au bout du couloir, un conclave maudit gérant la misère dans des pièces enfumées. La complexité du système mondial néolibéral ne peut que rendre imparfaite ou enfantine toute figuration qui nie le caractère dialectique de l’histoire et la profonde absurdité impersonnelle de la misère en réduisant tout à un théâtre de bons contre méchants, d’équipes par couleurs se battant dans un jeu dans la cour d’école.
[1] Fredric Jameson, « Cognitive mapping », dans Marxism and the Interpretation of Culture,sous la direction de Cary Nelson et Lawrence Grossberg (Urbana et Chicago : Illinois University Press), p. 350.
[2] Fredric Jameson, « Realism and Utopia in The Wire », Criticism 52, no 3-4 (2010) : 367-368.
[3] Fredric Jameson, « Cartographie cognitive », p. 356.
[4] Alberto Toscano et Jeff Kinkle, Cartografías del absoluta (Madrid: Materia Oscura, 2019), 146.
Views: 1