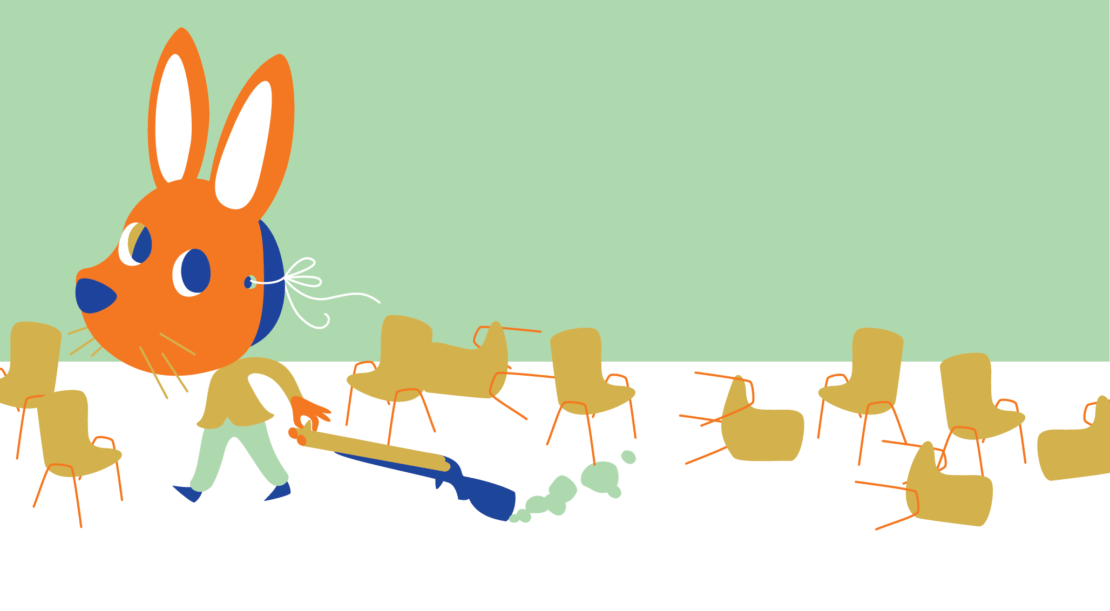Cet article, merci à Nicolas Maury et Adrien Thomas qui nous l’ont signalé est très intéressant et pose la question de la participation d’un parti qui a plus ou moins conservé le projet du socialisme à une coalition qui accepte la logique étatique et supra-étatique ici de l’UE. La débâcle de die Linke mérite mieux que l’affrontement présidentiel dans lequel s’enfonce la France, nous avons peu de temps, c’était en général à ces moments-là que Lénine s’enfermait dans la réflexion théorique pour en gagner DU TEMPS… Le problème est relativement évident et l’auteur analyse le cas de Berlin qui vient justement de laisser sa majorité de gauche aux « verts » : le passage d’une gestion corrompue à une gestion capitaliste «normale» et les politiques néolibérales auxquelles le PDS a participé ont été payés par la population singulièrement les plus pauvres. Die linke ou le pds aurait dû soutenir les mouvements de protestations des syndicats et des étudiants. Dans le fond, ce qui se joue aujourd’hui est déjà cette question non résolue même si elle est difficile à poser dans une campagne où la gauche est déjà marginalisée. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
—30 septembre 2019
Par sa participation aux gouvernements, Die Linke risque de perdre sa crédibilité comme alternative de gauche aux partis établis et, surtout, de ne plus jouer aucun rôle comme moteur de la mobilisation populaire.
Cet été, cinquante ans après le premier pas de l’homme sur la Lune, une première majorité rouge-rouge-verte a vu le jour dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest, plus particulièrement dans la ville-État de Brème, dans le nord du pays. Le plus petit Land de l’Allemagne sera gouverné par une coalition SPD (socialistes)-Verts-Die Linke. Lors du vote dans la section de Brême de Die Linke, 78,5 % ont voté pour. Sur les 84 sièges, le SPD en a 23, les Verts en ont 17 et Die Linke en a 11, soit plus que la majorité de 43 sièges. Outre le ministère de l’Économie, le parti aura un deuxième ministère au sein du sénat (gouvernement du Land) nouvellement formé. Les Verts ont obtenu trois postes sénatoriaux, le SPD en a quatre1.
Dietmar Bartsch, chef de la fraction Die Linke au parlement fédéral, le Bundestag, manifestement inspiré par l’astronaute américain Neil Armstrong, n’a pas hésité à y aller d’un « C’est un petit pas pour les habitants de Brême, et c’est un grand pas pour la structure du pouvoir en Allemagne2.» Il considère la coalition à Brême comme un modèle à suivre au sein du gouvernement fédéral où il est convaincu que le SPD, les Verts et Die Linke peuvent aussi gouverner ensemble: « Les majorités au-delà de l’Union démocrate-chrétienne sont possibles. »
Die Linke devant le dilemme
Le fait que Die Linke soit désormais un parti représenté au Parlement a sans aucun doute changé le climat politique en Allemagne. Cela a ouvert un espace où peut exister une gauche marxiste à côté de la social-démocratie et des Verts. Et cela a rendu l’air plus respirable dans un pays où, en 1956, le Parti communiste avait été interdit. Un pays où, en 1972, le gouvernement social-démocrate avait introduit le décret Berufsverbot qui permettait d’interdire aux communistes et autres « ennemis de la Constitution », comme ceux qui avaient voyagé en RDA, de travailler dans les services publics, en particulier dans l’enseignement. Des entreprises privées, des Églises, des journaux et certains syndicats avaient appliqué le décret. Die Linke a permis de briser cette atmosphère de plomb, y compris dans les syndicats, et a remis à l’ordre du jour la question sociale, l’antifascisme, l’antiracisme et la lutte pour la paix. Il y a désormais une marge de manœuvre pour les syndicats et les thèses de gauche.
Jusqu’à présent, Die Linke n’avait participé à aucun gouvernement sauf dans les États de l’ex-RDA (Allemagne de l’Est). La direction du parti a fait de grands efforts pour convaincre les sceptiques au sein du parti que l’accord de coalition de Brême « porte clairement une signature de gauche ». Elle se réfère pour cela au fait que sont prévus l’arrêt de l’exploitation du charbon d’ici 2023, l’accroissement des efforts dans la construction de logements sociaux et l’examen d’un plafonnement des loyers.
Les marges de manœuvre pour un gouvernement de gauche, surtout dans les gouvernements régionaux, sont particulièrement étroites en Allemagne.
Reste à savoir si le parti sera réellement en mesure d’amorcer un « changement de politique ». La marge de manœuvre financière est en effet très limitée. Pour l’ancien chef de la fraction Die Linke au Sénat de Brême, Peter Erlanson, « l’accord de coalition est encore pire que ce que je craignais. Nulle part dans l’accord, il n’est dit comment on va payer le programme. Le document contient une partie de ce que nous avons exigé en vain au cours des douze dernières années. Mais tout ce qui n’est pas chiffré ne vaut rien et Hermann Kuhn, des Verts, a déjà admis que les discussions sur le budget seront une sorte de deuxième négociation de coalition. Cela déterminera ce qui est vraiment prioritaire et ce qui passera sous la tondeuse à gazon3. »
Le Land de Brême est composé des villes de Brême et de Bremerhaven qui sont parmi les plus pauvres du pays et qui sont très endettées. Presque un tiers des enfants et des jeunes de Brême vivent dans des ménages qui dépendent de Hartz IV4. Depuis 2010, Brême a dû réduire ses dépenses de 125 millions d’euros par an pour combler un déficit d’un milliard d’euros (sur un budget de 5,5 milliards). Cette politique a entraîné des économies draconiennes, surtout dans les services publics et dans les investissements. L’infrastructure, notamment dans les hôpitaux, en a fort souffert.
Selon l’aile gauche de Die Linke à Brême, les négociations auraient dû commencer par définir ce qui est absolument indispensable : une évaluation contraignante des besoins en personnel dans les hôpitaux et les crèches, une formation rémunérée pour tous les éducateurs et éducatrices, la rénovation des écoles, l’engagement de centaines d’enseignants, la construction de 5 000 logements publics pour que les loyers puissent baisser, l’abolition des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des allocations, l’interdiction des expulsions forcées, la fermeture des centrales au charbon de Brême avec des emplois de remplacement pour les travailleurs et un programme d’investissements publics dans les énergies renouvelables. Puis, il aurait fallu discuter de la réalisation de ces projets et de leur financement.
Erlanson met le doigt sur le nœud du problème: le « frein à l’endettement », qui est inscrit dans la Constitution et imposé par l’Union européenne5. « L’État n’est plus autorisé à contracter des emprunts pour des investissements. C’est un problème pour les garderies, les écoles et les cliniques. Notre programme électoral affirme que le frein à l’endettement doit être supprimé, mais selon l’accord de coalition, nous acceptons de le respecter, comme le souhaitent le SPD et les Verts. En outre, il faudrait demander aux riches de payer, mais on n’a pas le courage de faire cela non plus. »
Erlanson n’est pas impressionné par la menace brandie par les partisans de la participation qui disent qu’en cas de refus de Die Linke, l’alternative est une coalition jamaïcaine (CDU, Verts et les libéraux du FDP). « Où est le problème? », se demande Erlanson. « Je ne pense pas que cela serait pire. La CDU sera confrontée aux mêmes problèmes. Elle devra construire des jardins d’enfants et des écoles et ne pourra pas le faire à cause du frein à l’endettement. Les cliniques municipales sont gérées selon les principes du capitalisme économique. C’était le cas avec le SPD et avec les Verts et ce sera le cas aussi pour la CDU. Rien ne changera. Moi, je veux du changement. Si nous, Die Linke au gouvernement, ne pouvons pas réaliser nos points essentiels, alors je ne sais pas pourquoi nous devrions être des porteurs d’eau pour un SPD usé. Cela me fait mal de voir que mon parti veut se joindre à une coalition qui soutient une politique néolibérale. »
La où il n’y a pas de mouvements extra-parlementaires puissants, la politique gouvernementale de Die Linke n’apporte pas un changement visible.
Par sa participation aux gouvernements dans les circonstances actuelles, Die Linke risque de perdre sa crédibilité comme alternative de gauche. Et surtout de ne plus jouer aucun rôle comme moteur de la mobilisation populaire. Les marges de manœuvre pour un gouvernement de gauche, surtout dans les gouvernements régionaux, sont particulièrement étroites aujourd’hui en Allemagne car les ressources financières d’un Land sont réglées à 97 % par des lois fédérales. Si, en plus, on accepte le « frein à l’endettement » et « l’interdiction d’emprunter », on se soumet totalement aux exigences de la politique d’austérité.
Une expérience pénible : Berlin 2003-2011
À Brême, l’histoire de la participation au gouvernement qui a eu lieu à Berlin entre 2003 et 2011 risque de se répéter. Le PDS de Berlin (aujourd’hui Die Linke) avait rejoint le gouvernement régional de Berlin à un moment où régnaient le népotisme, la corruption et les scandales bancaires. Les partisans de la participation avaient soutenu qu’une « administration délabrée ne se réorganise pas depuis les bancs de l’opposition. On ne construit pas plus de logements sociaux depuis les bancs de l’opposition et les places de garderie ne se développent pas depuis les bancs de l’opposition. Tout cela ne peut se faire que par la participation et par des réformes de grande envergure. »
La coalition SPD-PDS avait alors certes freiné la corruption et le népotisme. Mais le passage d’une gestion corrompue à une gestion capitaliste « normale » et les politiques néolibérales auxquelles le PDS a participé ont été payés par la population. Dans son programme électoral berlinois pour les élections législatives de 2016, Die Linke revient sur cette période: « La coalition rouge-rouge a rééquilibré le budget de l’État de 2002 à 2011. Cette politique de restructuration a été dure et a parfois été au-delà de ce qui était justifiable. Pour les locataires, les employés de la fonction publique, les enseignants et les pauvres, aucun progrès n’a été enregistré, leur situation a empiré6. »
En effet, la coalition rouge-rouge à Berlin a privatisé une partie du principal hôpital de Berlin, a mené une politique budgétaire stricte au détriment, par exemple, des allocations aux aveugles (en 2003) ou du billet social pour les transports publics urbains (en 2004), a vendu 65 700 maisons de la société publique de logement au prix avantageux de 405 millions d’euros à un consortium auquel appartenait Goldman Sachs, a supprimé les allocations aux propriétaires qui louaient leur maison à un loyer social, a voté la privatisation partielle du système de transport public, s’est opposée aux efforts pour revenir à une gestion publique de l’approvisionnement en eau, a réduit jusqu’à 12 % les salaires dans les services publics. Le Land de Berlin, qui disposait encore de 138 000 emplois à plein temps en 2001, en avait 33 000 de moins en 2011.
Avant d’être au gouvernement, le PDS avait fait campagne contre de telles mesures, mais une fois au pouvoir, il a été sourd aux protestations et s’est opposé par tous les moyens aux mouvements extra-parlementaires des syndicats et des étudiants. Le 6 décembre 2003, dans le luxueux hôtel Maritim du centre de Berlin, il a même dû être protégé par la police anti-émeute qui a fait évacuer la rue avec brutalité. D’après Cornelia Hildebrandt, à l’époque membre de la direction régionale du parti, « les syndicats ont manifesté contre les réductions prévues des salaires et du personnel dans le secteur public. Au lieu de faire du chantage envers les syndicats en se retirant de la convention collective régionale, le PDS aurait dû défendre la poursuite des grèves et des manifestations7. »
Résultat? Les Berlinois consacrent aujourd’hui en moyenne 46 % de leur revenu à leur loyer, le prix de l’eau a augmenté de 33 %, le billet social dans le transport public est à un prix bien plus élevé, les frais d’école ont augmenté, le gouvernement a économisé 500 millions par an sur le dos des salariés du secteur public où la charge de travail a augmenté, et on a assisté à la transformation de milliers de logements en objets de spéculation. Aujourd’hui encore, les salaires publics à Berlin sont inférieurs à ceux des autres États fédéraux. Pas surprenant qu’en 2011, le PDS, devenu Die Linke entre-temps, se soit effondré aux élections pour le sénat de Berlin. En dix ans, le parti est passé de 22,3 % à 11,5 % des voix et d’environ 12 000 membres à Berlin en 2001 à 8 000 en 2011. Aucun membre n’a pu être gagné dans des mouvements tels que la grève des étudiants de 2003 ou les mouvements dans la fonction publique parce que le parti se trouvait du côté du gouvernement contre lequel étaient dirigés ces mouvements et était devenu un appendice et un spectateur passif de la fraction parlementaire. Les présidents régionaux, au lieu d’exprimer publiquement les préoccupations du parti à l’égard du Sénat, se sont chargés de limiter, de discipliner et d’intégrer le parti dans le corset des politiques établies par son partenaire de la coalition. L’exécutif du parti a limité les droits démocratiques de la base du parti et a promu le concept d’un parti de fonctionnaires au lieu d’un parti de membres.
Le pouvoir global de la finance, des grandes entreprises et des structures politiques est la cause principale de l’échec de la participation gouvernementale.
En se soumettant à la logique néolibérale de l’assainissement budgétaire, non seulement le parti n’a pas créé de marge de manœuvre financière, mais il a en plus affaibli les infrastructures sociales et les services publics. Enfin, il n’a pas armé ses propres membres et partisans contre les arguments néolibéraux mais au contraire les a diffusés lui-même, réduisant ainsi sa propre force de frappe politique faute d’avoir fait pression sur le gouvernement au côté des mouvements sociaux et des syndicats. Participer au gouvernement, dans ces circonstances, c’est s’enfermer dans une prison politique car un gouvernement régional ne contrôle ni l’économie, ni les lois fédérales, donc le cadre financier, ni la justice, ni les organes répressifs de l’appareil d’État, qui ne sont pas organisés démocratiquement.
Une normalisation dramatique
En revanche, la participation actuelle de Die Linke à des gouvernements se fait dans un contexte où l’État a des excédents budgétaires et où l’emploi atteint des niveaux records. Les gouvernements n’ont donc pas à économiser sur tout comme à Berlin de 2003 à 2011. Un nouveau gouvernement rouge-rouge-vert est en place à Berlin depuis 2017 et il a pu voter des dépenses supplémentaires et des améliorations qui, toutes, sont urgentes.
Ce nouveau gouvernement de Berlin a, semble-t-il, l’intention de ne pas répéter les erreurs dévastatrices de la première participation gouvernementale. Dans un contexte de recettes fiscales croissantes et poussé par de nombreux mouvements et grèves, il a rendu gratuits les places dans les crèches, tout comme l’abonnement scolaire pour les écoliers dont les parents sont chômeurs ou bénéficiaires d’allocations de logement. Les tarifs des transports publics ont été gelés, l’abonnement scolaire est devenu gratuit pour tous, le prix du billet social pour le bus et le train a été réduit et on a instauré des repas gratuits dans les écoles primaires. Les enseignants du primaire ont été mis sur un pied d’égalité avec les autres enseignants et leurs salaires ont augmenté. On a créé 1 200 places d’hébergement de nuit pour les sans-abri. Il y a eu aussi des mesures symboliques positives, comme l’installation de la journée des femmes comme jour férié.
En ce qui concerne le thème du logement, les sociétés de logements publiques en construisent de nouveaux et ont commencé à racheter 7 000 logements privés, tandis que les loyers de plus d’un million et demi de logements privés et publics sont gelés pendant cinq ans et que les loyers qui dépassent un « loyer maximum » devront être réduits. À ce sujet, le gouvernement actuel est poussé par un grand mouvement de masse qui s’est emparé du thème du logement et demande l’expropriation des sociétés privées propriétaires de plus de 3 000 logements. Notamment Deutsche Wohnen qui en possède 111 000 à Berlin et qui a réalisé 1,9 milliard d’euros de bénéfices rien qu’en 2018. La campagne pour l’expropriation considère que l’indemnisation ne doit pas obligatoirement se faire à la valeur du marché et pourrait être bien inférieure. Die Linke a cette fois-ci officiellement accordé son soutien à l’initiative. Ce conflit sera un test pour la crédibilité de Die Linke. Si le SPD et les Verts ne sont pas prêts à mettre en œuvre cette politique, Die Linke doit être prêt à laisser la coalition éclater.
Un parti qui, au gouvernement, justifie l’austérité rend plus difficile la lutte pour la redistribution des richesses et la taxation des riches.
Ceci étant, ce gouvernement ne peut pas résoudre les problèmes centraux, comme le fait que les logements abordables restent extrêmement rares. Même s’il a promis de construire environ 6 000 appartements municipaux chaque année, il existe aujourd’hui une pénurie de 100 000 logements à loyers abordables. Par ailleurs, trouver une place à la crèche reste une entreprise presque impossible. De leur côté, les pompiers ont attiré de façon spectaculaire l’attention sur les dangers du manque d’investissements, du manque de personnel et donc du surmenage de celui-ci. Et si, dans les hôpitaux et les écoles, le taux d’investissement a été augmenté, il reste bien en deçà de la demande. La coalition rouge-rouge-verte reste dans l’austérité budgétaire et accepte qu’on ne demande presque rien aux riches et aux puissants. Elle est de ce fait obligée, pour pouvoir investir, de recourir à des formes plus ou moins larvées de privatisation: ainsi, les investissements dans les écoles sont mis en œuvre avec une construction juridique du type partenariat public-privé qui facilitera les privatisations futures.
Le président de Die Linke du district de Neukölln (Berlin) constate que « de nombreuses initiatives tirent sur la nappe, mais la nappe est tout simplement trop courte ». Différents acteurs et projets s’affrontent et sont montés les uns contre les autres, forçant ainsi les couches de travailleurs et les mouvements à se disputer les quelques miettes mises à disposition.
Pour ne pas avoir à gérer l’austérité, un gouvernement de gauche devrait adopter une approche complètement différente à l’égard des mouvements, même si cela va à l’encontre du frein à l’endettement et s’il n’y a plus d’argent pour des dépenses de prestige ou des cadeaux aux riches. Il consulterait les pompiers, les travailleurs des crèches, leurs syndicats; il élaborerait un plan pour les investissements nécessaires; il lutterait pour sa mise en œuvre, pour donner à tous les enfants une place à la crèche, pour payer un salaire décent aux travailleurs des services publics, en particulier de l’enseignement et des hôpitaux; il lutterait contre le sous-financement des services publics qui entraîne le mauvais fonctionnement des trains et des bus; il pratiquerait une réelle rupture avec la politique d’austérité qui plonge des milliers de pensionnés dans la précarité. Dans un pays où des milliers de personnes sont milliardaires, il y a assez d’argent pour tout cela.
En Thuringe, dans le Brandebourg ou à Brême, où il n’y a pas de mouvements extra-parlementaires aussi puissants qu’à Berlin, la politique gouvernementale de Die Linke n’apporte pas un changement visible. En Thuringe, les syndicats disent qu’il est devenu plus difficile d’obtenir des revendications syndicales qu’auparavant, 7 000 emplois dans le secteur public vont être supprimés alors que 290 000 euros ont été dépensés dans une campagne pour convaincre la population que l’austérité est une bonne idée et qu’un budget en équilibre est nécessaire. Le Land de Thuringe est devenu le deuxième Land en termes d’expulsions. Dans le Land de Brandebourg, le gouvernement a fusionné des universités malgré les manifestations et supprimé des emplois dans le secteur public, notamment des postes d’enseignants. Dans ce Land, Die Linke a approuvé l’extension des pouvoirs policiers comme la surveillance complète des téléphones mobiles. Un parti qui, au sein du gouvernement, soutient les atteintes à l’environnement, renforce la surveillance des citoyens et organise la restructuration néolibérale des universités rend la résistance plus difficile. Un parti qui, au gouvernement, justifie les coupes sombres dans le budget rend plus difficile la lutte pour la redistribution des richesses et la taxation des riches. Un parti qui, au gouvernement, fait travailler ses fonctionnaires au-delà de l’âge de la pension légale n’est pas crédible dans la lutte pour la pension à 65 ans.
Lorsqu’il participe à un gouvernement, Die Linke est obligé aussi d’assumer la responsabilité de toutes les actions de celui-ci, y compris celles qui sont totalement contraires à une politique de gauche. Ainsi, les gouvernements régionaux à participation de Die Linke ont voté au Bundesrat, le parlement des régions, une loi qui permet la privatisation des autoroutes et sont allés ainsi à l’encontre de la ligne officielle du parti.
Les non-arguments pour monter en coalition
Les arguments des partisans d’une participation de Die Linke à un gouvernement sont multiples8.
Il y a tout d’abord des arguments « électoraux »: « Les gens veulent que nous allions dans les gouvernements. Si nous excluons cela d’avance, nous perdons au moins cinq à dix pour cent d’électeurs. Pour un changement de politique, il faut d’autres majorités. Évidemment, les gens ne veulent pas que nous y allions sans conditions. Ils veulent des améliorations. Si ces améliorations ne sont pas à l’ordre du jour, nous n’y allons pas. » Mais, comme nous l’avons vu, c’est après sa première participation au gouvernement à Berlin que Die Linke s’est effondré aux élections et est passé de 22,3 % à 11,5 %. Lors de élections régionales du 1 septembre 2019 au Brandebourg et en Saxe, le parti s’est effondré: en Saxe 8,5 %, dans le Brandebourg 7,9 %. Il n’exprime plus la révolte des couches populaires, il n’est plus vu comme un parti radical mais comme un pilier de l’État et est considéré de plus en plus comme un parti comme les autres.
La peur de rompre avec la politique d’austérité européenne est à la base des échecs de Mitterrand, de Die Linke, de Syriza…
Il y a les arguments « antifascistes »: « Le progrès de l’extrême droite nous met devant de nouveaux défis. La question qui se pose n’est pas celle du dépassement du capitalisme ou de l’introduction du socialisme démocratique, mais la défense de la démocratie et d’un changement de politique vers plus de justice et de solidarité. Et cette orientation demande des alliances larges. L’État est un État de classe, mais la théorie marxiste de l’État s’est développée. L’État est un champ de bataille et un lieu de confrontation de classes. Cela reste du capitalisme, mais un capitalisme avec une assurance maladie est différent d’un capitalisme sans. » Ces arguments antifascistes ne résistent pas non plus à l’épreuve de la pratique. Les gouvernements avec participation de Die Linke n’arrêtent pas l’extrême droite. L’AfD a doublé son score en septembre 2019 lors des élections pour le Land de Brandebourg de 12 à 24,5 %. En Thuringe, il obtiendrait selon également un bon quart des sièges en octobre 2019. Depuis un peu plus de cinq ans, l’extrême droite est présente avec une force considérable dans tous les parlements des Länder et au Bundestag. Dans l’ancienne RDA, le PDS, puis Die Linke, ont longtemps été considérés par beaucoup comme les représentants des Allemands de l’Est défavorisés, les sujets passifs d’un « État d’injustice ». Die Linke apparaissait alors comme le seul représentant valable, surtout aux yeux des personnes âgées, des plus modestes, des plus fragilisés, qui étaient passés d’un emploi assuré à des périodes de chômage ou de précarité. Mais, depuis ses participations aux gouvernements, ce parti est de plus en plus associé à la structure dominante. Alors, les électeurs se tournent vers l’AfD, qui est vu comme plus anti-establishment et qui, aux élections de 2017, a pris 400 000 voix à Die Linke.
Enfin, il y a des arguments plus « sociologiques ». « Le monde a changé, les réponses du XXe siècle ne sont plus vraiment valables aujourd’hui, les gens ont des attentes différentes, c’est pourquoi la démocratie a besoin du compromis. Si on n’est pas prêt à cela, inutile d’aller dans les parlements. Nous sommes devenus un parti conservateur, un parti avec de vieilles réponses. Nous réagissons face aux nouveaux problèmes de façon défensive et pas avec la volonté de profiter des nouvelles possibilités de développement d’un socialisme démocratique. Il faut maintenant transformer nos idées en réalités. Un tournant n’est possible qu’avec une majorité parlementaire. Entre SPD, Verts et Die Linke, il y a des points communs sur des thèmes comme les réfugiés, la démocratie et la société civile, et ces coopérations devront aller en augmentant. »
Les partisans de la participation ont tous affirmé qu’ils allaient pouvoir « pousser à gauche les rapports de force ». Or, que s’est-il passé dans pratiquement toutes les expériences, y compris les plus récentes? Depuis le milieu des années 30, 19 partis situés à gauche de la social-démocratie ont participé à 31 gouvernements dans 11 pays européens. L’économiste Paul Glier a analysé ces expériences9. Il arrive à la conclusion suivante: « Ces partis n’ont pas répondu aux attentes de leurs électeurs car ils n’ont pas atteint les objectifs qu’ils avaient annoncés. Les électeurs attendent une politique qui soit dans l’intérêt des travailleurs et qui conduise à des améliorations visibles de leurs conditions de travail et de vie. Ou bien à des réformes démocratiques ou à l’arrêt d’aventures militaires. Parfois, certains de ces partis ont pu obtenir des mesures progressistes ou en faveur des travailleurs, surtout en début de législature. Il s’agit souvent de l’abolition de mesures antisociales des gouvernements précédents ou de mesures sociales immédiates qu’ils avaient réussi à faire entrer dans l’accord de coalition. Mais ces acquis ont été temporaires. Des tendances et des influences opposées les ont annulés et ont conduit à un développement ou même un renforcement d’une politique contraire aux intérêts des travailleurs. »
On pourrait rétorquer qu’il y a sans doute une exception: au Portugal, les communistes dans les gouvernements anticoloniaux et antifascistes de 1974/75, ont pu imprimer des acquis dans la Constitution. Mais cela n’a duré que pendant la période où ces gouvernements ont été portés par un mouvement révolutionnaire extra-parlementaire. C’est pourquoi l’auteur classe aussi cette expérience parmi les échecs vu son «résultat final».
Des facteurs bien plus importants et bien plus déterminants que «la volonté» des partis, ou «l’attitude de gauche» des politiciens dans les gouvernements limitent leur marge de manœuvre: le pouvoir de l’argent; le pouvoir de l’appareil administratif de l’État étroitement lié, au sommet du moins, aux «élites» de «l’économie»; l’ordre juridique, qui exprime largement la «volonté des conditions économiques» (Karl Marx) et sécurise l’ordre politique existant; les limites financières de l’action gouvernementale fixées par les lois financières; la limitation habituelle de l’action gouvernementale dans les gouvernements de coalition qui sont la plupart du temps des compromis entre les programmes des partis. Si la gauche s’appuie sur l’État pour transformer la société, elle dépend des hauts fonctionnaires et des experts bureaucratiques. Or cette «bourgeoisie d’État» désapprouve les réformes sociales et déguise son opposition politique derrière une supposée neutralité technique. L’inertie de l’administration suffit souvent à faire échouer des tentatives politiques10.
Pour Glier, le pouvoir social global de la finance, des grandes entreprises et des structures politiques en place est la cause principale de l’échec de la participation gouvernementale. Les circonstances peuvent être une crise financière, la pression de l’Union européenne et de ses critères budgétaires. Souvent les mesures progressistes prises en début de législature sont remises en cause au cours de la législature elle-même et ces gouvernements retournent à une politique néolibérale. Ce qui a subsisté est alors aboli par le gouvernement suivant, souvent à participation sociale-démocrate11.
Déception et anesthésie du mouvement social
Au parlement, les partis de la gauche radicale sont reconnus comme des représentants des travailleurs parce que, alors qu’ils sont dans l’opposition, ils portent les revendications des mouvements sociaux et démocratiques. Ils augmentent ainsi la pression sur les gouvernements et obtiennent certains succès même en étant dans l’opposition. Lorsqu’ils entrent au gouvernement, leurs électeurs attendent d’eux qu’ils se battent avec la même détermination et attendent des résultats tangibles. Si ces résultats ne sont pas au rendez-vous ou si la politique menée n’est pas meilleure qu’avant, la déception qui s’ensuit amène indignation et même dégoût. D’après Glier, «la critique des électeurs se tourne contre ce gouvernement, mais plus fort encore contre la gauche radicale au sein du gouvernement, rendue responsable de l’ensemble de la politique de ce gouvernement et pas seulement de celle menée par les ministres de gauche12.»
Glier conclut que les partis de gauche dans les gouvernements capitalistes échoueront tant que la domination du capital ne sera pas au moins neutralisée par des contre-forces sociales extra-parlementaires. «Dans la société dominée par le capital et dans le cadre des structures politiques existantes avec leur fonction d’intégration, il n’y a pas de primauté de la politique sur l’économie. Ceux qui pensent regagner la primauté de la politique sur l’économie en allant au gouvernement sont rappelés à l’ordre par toutes les expériences antérieures13.»
La question de la participation de la gauche radicale au gouvernement n’est pas seulement une question tactique sur la faisabilité de certaines réformes.
Ce qui reste au bout du compte des participations des partis de la gauche radicale, c’est leur échec en matière de programme et de politique. Et les conséquences se font sentir à long terme car ces partis perdent alors la confiance de leurs électeurs et leur crédibilité et ils sont punis plus fort que les partis traditionnels. On leur reproche «d’être comme les autres, de trahir aussi leurs promesses». Pour la période postérieure à 1946, Glier démontre, chiffres à l’appui, qu’après leur participation au gouvernement, ces partis perdent en moyenne 26 % de leurs voix par rapport aux élections précédentes. En Italie, en France et en Suède, les pertes se sont élevées à plus de 50 %. En termes absolus, cela signifie des millions de personnes. «Plus la participation au gouvernement se répète, plus la perte de crédibilité et de confiance est durable14», conclut Glier.
Beaucoup de ceux qui s’étaient engagés dans les mouvements sociaux se sentent trahis et tombent dans la passivité. Les passages de la gauche dans les gouvernements ont été, pour beaucoup de travailleurs et de militants, la démonstration qu’il fallait s’incliner devant les lois du marché capitaliste, en passer par la course à la compétitivité, par la recherche de la rentabilité et du profit.
Transformer la société avec la social-démocratie?
Dans les appels du pied que font certains partis radicaux de gauche aux sociaux-démocrates et aux Verts, il y a une sous-estimation du véritable caractère et de la stratégie de la social-démocratie. Il est quelques fois arrivé que les sociaux-démocrates forment des coalitions avec la gauche radicale dans le but explicite de la compromettre: ils l’ont impliquée en tant que principal parti d’opposition dans les coupes sociales massives afin de lui faire perdre son influence (parfois majoritaire) dans le camp progressiste. Oskar Lafontaine, qui était alors encore dirigeant du SPD, disait en 2003, à propos du gouvernement rouge-rouge à Berlin: «Un sénat (gouvernement de Berlin) qui exige des sacrifices de la population ne doit pas avoir un CDU déçu et un PDS social-populiste comme adversaires. Ceux qui veulent réaliser des économies budgétaires seraient bien avisés d’embarquer le PDS à bord15.»
Dans les faits, la participation de la gauche radicale à un gouvernement dans lequel dominent les partis sociaux-démocrates affaiblit les forces anticapitalistes. Lorsque la gauche radicale est au pouvoir, les mouvements sociaux deviennent moins dynamiques. Sa participation encourage la résignation populaire et l’attentisme des mouvements sociaux, elle renforce les illusions dans la politique par procuration: plus besoin de se mobiliser ni d’organiser la résistance extra-parlementaire puisque notre parti au gouvernement réalisera nos revendications.
Au début du 20e siècle, Rosa Luxemburg soulignait déjà qu’une prise de pouvoir par la gauche radicale d’alors dans des conditions de rapports de force sociaux défavorables suivrait inévitablement la logique résumée par la phrase suivante: «Le gibier n’a pas été tué, mais le fusil ne vaut plus grand-chose.»
Le cliché d’un gouvernement de gauche entraînant rapidement et réellement un «tournant politique» vers la justice sociale et la démocratie n’est vraiment pas correct si les conditions ne sont pas réunies, s’il n’y a pas le rapport de forces pour imposer une véritable rupture. Les partis de gauche, en tant qu’opposition parlementaire en conjonction avec des manifestations extra-parlementaires, obtiendront toujours plus pour le peuple que ce qu’ils peuvent obtenir en tant que junior partners dans un gouvernement. À Berlin, au cours de ses cinq années dans l’opposition, Die Linke a obtenu des avancées plus importantes et a gagné davantage de soutien par son engagement aux côtés de mouvements sociaux que ce qu’il a pu obtenir dans la coalition. Par exemple, il a obtenu le retour au secteur public des sociétés de distribution de l’eau, suite à l’organisation d’un référendum. Quand un parti n’est pas encore assez fort pour imposer un vrai changement dans un gouvernement, il est plus efficace dans l’opposition, au Parlement et dans la rue, que pieds et poings liés, paralysé dans un gouvernement qui n’aurait qu’une étiquette de gauche. Cela n’exclut évidemment pas un soutien à certaines lois, au cas par cas, quand elles vont dans le bon sens.
Soutenir qu’on peut faire progresser la cause des travailleurs sans rompre avec la politique d’austérité européenne est un leurre. La peur de rompre avec cette politique est à la base des échecs de Mitterrand, de Die Linke, de Syriza… La participation au gouvernement est envisageable seulement si l’on ose remettre tout cela en question, si tous les partenaires se rendent compte que la confrontation avec l’élite européenne sera très dure et s’ils sont prêts cependant à se lancer dans la bataille. Et pour vaincre cette résistance des pouvoirs établis, un gouvernement vraiment de gauche devra également organiser le soutien des travailleurs, il devra être capable de les mobiliser et de les mettre en mouvement.
Une nouvelle culture politique

Un changement politique réel ne sera également possible qu’en remplaçant la culture de la «politique par procuration», le discours du «nous allons arranger ça pour vous», par une culture politique visant à ce que le peuple prenne son sort en mains, s’organise, s’informe et se mobilise. Certains membres de partis de la gauche radicale se plaignent de l’émergence d’une couche de fonctionnaires, de mandataires et d’employés vivant du parti, couche qui veut construire des ponts vers les autres partis et qui est prête à se soumettre progressivement à la raison d’État et à accepter le principe de l’austérité. L’adaptation de cette couche, son intégration dans le monde politique classique se fait secrètement, surtout à travers la participation au gouvernement, et elle est de plus en plus forte. Il y a encore de bons discours de la part des dirigeants du parti mais tout cela n’a aucune conséquence. Lors des congrès du parti, l’approbation de textes n’est pas l’approbation de la politique concrète du parti, seulement des discours et des promesses.
La question de la participation de la gauche radicale au gouvernement n’est pas seulement une question tactique sur la faisabilité de certaines réformes. Elle est aussi liée à la question stratégique d’une alternative au système capitaliste: il ne s’agit pas de se limiter à administrer ce qui existe, il s’agit de changer les choses sur le plan structurel. Et ce n’est qu’en construisant une force organisée des exploités et des opprimés que l’on pourra développer le contre-pouvoir nécessaire pour imposer cette alternative.
La gauche radicale est la mieux placée pour organiser le combat contre la logique capitaliste. Cependant, elle n’a pas les mêmes instruments de pouvoir qu’eux, elle n’a pas de liens avec les lobbies patronaux, pas de médias de masse, pas d’ancrage dans l’administration et dans les appareils de l’État. Sa seule «ressource de pouvoir» c’est la mobilisation: les luttes sociales, le travail éducatif, la culture de la solidarité, l’organisation. Une politique vraiment de gauche, c’est une pratique qui prouve avec succès que cela vaut la peine de se battre, qui entraîne d’autres couches de la population, les politise et prépare ainsi le rapport de forces nécessaire pour imposer des changements plus profonds.
- Kristian Stemmler. “Mondlandung in Bremen” Junge Welt, 24 juillet 2019.
- Déclaration de Bartsch aux journaux du Funke Media Group.
- Lotta Drügemöller, «Linken-Politiker über R2G in Bremen», Taz, 4 juillet 2019. Voir http://taz.de/Linken-Politiker-ueber-R2G-in-Bremen/!5605169/.
- Suite à une réforme du système des allocations de chômage (la loi Hartz IV) sous le gouvernement SPD-Verts de Gerhard Schroeder, «les indemnités des chômeurs sans emploi depuis plus d’un an [sont transformées] en une allocation forfaitaire unique. Le faible montant de cette enveloppe — 409 euros par mois en 2017 pour une personne seule — est censé motiver l’allocataire à trouver au plus vite un emploi, aussi mal rémunéré et peu conforme à ses attentes ou à ses compétences soit-il. Son attribution est conditionnée à un régime de contrôle parmi les plus coercitifs d’Europe. (Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Réformes_Hartz.)
- Il s’agit de la fameuse limitation de la dette de l’État en dessous des 60 % du PIB stipulée dans le traité de Maastricht. Ce frein impose des budgets publics sans déficits structurels dans les Länder.
- Die Linke, «Unser Plan für ein soziales und ökologisches Berlin». Voir www.die-linke-berlin.de/fileadmin/download/2016/wahlprogramm.pdf.
- Lucia Schnell und Irmgard Wurdack, «Linke in Berlin: Eine linke Koalition für eine gerechtere Stadt? Besser opponieren als mitregieren: Rot-Rot in Berlin 2001–2011». Marx21. Voir www.marx21.de/linke-berlin-rot-rot-gruen-koalition-kritik/.
- Voir à ce sujet Luise Neuhaus-Wartenberg, Mathias Klätte& Dominic Heilig, «Inhalte und Strategie nach vorn stellen — Reformalternativen sichtbar machen». Voir http://forum-ds.de/wp-content/uploads/2016/10/Inhalte-und-Strategie-nach-vorne-stelle.pdf.
- Paul Glier, Was bringt es, wenn Linke mitregieren? Erfahrungen aus acht Jahrzehnten. Gedanken zur Neuorientierung, Verlag am Park, 2018.
- Voir à ce sujet: Serge Halimi, Quand la gauche essayait: Les leçons du pouvoir (1924, 1936, 1944, 1981), Agone, 2018.
- Voir Glier, op. cit., p. 109-111.
- Idem, p. 112-113.
- Ibidem.
- Ibidem.
- Oskar Lafontaine, «Alle für eine», Der Tagesspiegel, 20 juin 2001.
Views: 0