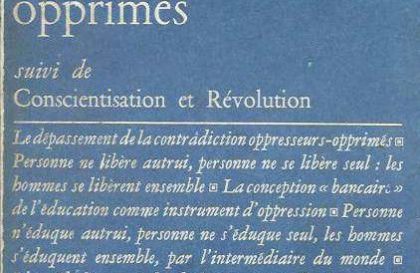Miguel Ángel Asturias, né à Guatemala le 19 octobre 1899 et mort à Madrid le 9 juin 1974, est un poète, écrivain et diplomate guatémaltèque. Il est lauréat du prix Nobel de littérature en 1967. En 1946, c’est son roman avec Monsieur le Président (El señor Presidente), le portrait satirique d’un dictateur sud-américain, à la manière de ce qu’avait fait l’écrivain espagnol Ramón del Valle-Inclán avec Tirano Banderas et comme le feront après lui Gabriel García Márquez dans L’Automne du patriarche, Augusto Roa Bastos dans Moi, le Suprême et Alejo Carpentier dans le Recours de la méthode. En 1949 paraît son chef-d’œuvre Hommes de maïs (Hombres de maíz), œuvre typique du réalisme magique et dénonciation de l’exploitation colonialiste. Ce dernier sujet est approfondi dans sa vaste trilogie romanesque ayant pour toile de fond l’exploitation par une compagnie américaine des travailleurs amérindiens dans les plantations de banane. Il ne renoncera jamais à mettre sa notoriété au service de l’émancipation anti-coloniale mais aussi anti-impérialiste. L’auteur de ce texte qui nous l’a confié après une traduction de l’espagnol et du portugais imagine que Miguel Angel Asturias interpelle Bolsanaro et l’abominable situation dans laquelle celui-ci, ses sicaires et les imbéciles qui le suivent ne laisse plus aucun espoir. Ce ton tragique est celui d’un continent qui a le malheur d’être l’arrière-cour des Etats-Unis, le lieu de toutes les expérimentations du capitalisme à son stade sénile et le réalisme magique traduit l’absurdité de l’oppression dans un décor dans lequel misère et richesse se confondent dans un baroque tragique. (note de Danielle Bleitrach)
Monsieur le Président
Ou
Message de Miguel Ángel Asturias au Brésil de Bolsonaro
...Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre!
Ainsi commence Monsieur le Président, une œuvre fondamentale de la littérature latino-américaine source à la fois du réalisme magique et des grands romans politiques sur les dictatures, qui ont causé tant de souffrance et de destruction sur tout le continent, comme « Moi, le Suprême » du Paraguayen Augusto Roa Bastos et L’automne du Patriarche du Colombien Gabriel Garcia Márquez.
Le livre, qui a eu une longue gestation, a été écrit entre le milieu des années 20 et le début des années 30 par Miguel Ángel Asturias à Paris, où il s’est exilé pendant plus de dix ans pour fuir la dictature d’Estrada Cabrera dans son pays d’origine, le Guatemala. La dictature d’Estada Cabrera, qui a duré de 1898 à 1920, a été suivie par la dictature de Jorge Ubico, et le livre n’a pu été publié qu’en 1946 au Mexique, année où le premier livre d’un autre écrivain fondateur a également été publié au Brésil : Sagarana de João Guimarães Rosa. Les chemins de ces deux écrivains se croiseront en 1965, lorsque le Congrès des écrivains d’Amérique Latine se tiendra à Gênes et que la première Société des écrivains d’Amérique Latine sera créée, avec Miguel Ángel Asturias et João Guimarães Rosa à sa tête. Lors d’une pause pendant ce congrès à Gênes, Guimarães Rosa a donné une célèbre interview au critique de littérature allemande Günter Lorenz, dans laquelle il a fait un commentaire intéressant sur Asturias en répondant à une question :
Guimarães Rosa : Je crois que vous m’avez mal compris. Apparemment, vous faites référence à ce qui s’est passé à Berlin. À ce propos, je voulais dire que je suis du côté de Asturias et non de (Jorge Luis) Borges. Bien que je n’approuve pas tout ce que Asturias a dit dans le feu du débat, je n’approuve rien de ce que Borges a dit. Les paroles de Borges ont révélé une absence totale de conscience de la responsabilité, et je suis toujours du côté de ceux qui prennent des responsabilités et non de ceux qui les nient.
Cette citation est très courte, elle ne contient pas beaucoup d’informations sur le contexte, mais elle me semble tout de même suffisante pour indiquer que Guimarães Rosa a reconnu Asturias comme un écrivain avec lequel il partageait la même position : tous deux ont assumé la responsabilité de l’écrivain devant son temps.
Dans Monsieur le Président, Miguel Ángel Asturias a affronté comme cela n’avait été jamais fait auparavant la société, la politique et la littérature latino-américaines de son temps. Pour le spécialiste de la littérature latino-américaine Gerald Martin, auteur de l’influent ouvrage intitulé Journeys through the Labyrinth : Latin American Fiction in the Twentieth Century, il s’agit d’un roman unique dans la littérature latino-américaine, le premier à « combiner son appel à la révolution linguistique et littéraire avec un appel à la révolution sociale et politique et le premier à se démasquer de l’autoritarisme et du patriarcat au niveau de la conscience, en d’autres termes, de l’intériorisation du totalitarisme ».
En relisant Monsieur le Président aujourd’hui, alors que le Brésil succombe à l’incompétence généralisée, à la corruption rampante et à l’ignorance délibérée d’une partie importante de la population, je reconnais beaucoup de points communs entre mon pays et le monde décrit par Asturias dans son roman, celui d’une société souffrant sous une dictature militaire mesquine et violente. Et face aux menaces de coup d’État de Monsieur le Président Bolsonaro et à l’instauration définitive d’une dictature, le roman de Miguel Ángel Asturias est un message, un avertissement sur ce que le Brésil peut encore devenir. Parce que tout peut toujours être pire : le puits n’a pas de fond, pas de limites à la stupidité.
Un personnage du roman, le Général Canelas, tombe en disgrâce sous le Président et doit fuir la dictature militaire qu’il a contribué à imposer. Et lors de sa fuite à l’intérieur du pays, face à la misère que le gouvernement dictatorial a créée et qui lui était jusqu’à récemment invisible, cachée par les privilèges dont il bénéficiait, il se dit :
Quelle était la réalité ? Ne jamais avoir pensé avec sa propre tête, toujours avoir pensé avec le képi. Être militaire pour garder le commandement d’une caste de voleurs, d’exploiteurs et de traîtres égoïstes (…).
Celui qui a des oreilles, entend. Celui qui a des yeux, voit.
Dans un autre épisode du roman, une employée d’un commandant de police reçoit la demande d’une humble femme qui veut seulement savoir où son mari a été enterré, après avoir été tué dans les prisons de la dictature. L’employée promet d’aider la femme à obtenir cette information et parle au commandant de la police, qui lui répond de cette façon :
Il ne faut pas donner d’espoir. (…) On reste à ces postes parce qu’on fait ce qu’on vous dit et la règle de conduite du président est de ne pas donner d’espoir et de les piétiner et les battre tous parce que c’est comme ça.
Face aux milliers de décès causés par la pandémie COVID 19 au Brésil, face à la destruction de la forêt Amazonienne et du Pantanal, comment ne pas voir dans ces mots la description exacte du leadership du Ministre de la Santé, le Général Eduardo Pazuello, du Ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, et de tant d’autres personnes occupant des postes importants dans le gouvernement du président Bolsonaro ?
Celui qui a des oreilles, entend. Celui qui a des yeux, voit.
Et face à l’inertie d’une grande partie des parlementaires, incapables d’adopter une attitude face à tant de débâcle, de morts et de destructions, sans aucune honte de leur propre opportunisme, ces mots écrits par Asturias et prononcés par un personnage du roman, semblent sortir de la bouche de millions de Brésiliens :
Il n’y a aucun espoir de liberté, mes amis ; nous sommes condamnés à l’endurer jusqu’à ce que Dieu le veuille. Les citoyens qui aspiraient au bien du pays sont loin (…) Les arbres ne portent plus de fruits comme auparavant. Le maïs ne nourrit plus. Le sommeil ne repose plus. L’eau ne rafraîchit plus. L’air devient irrespirable. Aux fléaux succèdent les pestes, aux pestes les fléaux, et bientôt un tremblement de terre viendra mettre fin à tout cela. (…) Où tourner les yeux en quête de liberté ?
Miguel Ángel Asturias, prix Nobel de littérature de 1967, de son petit pays qui a tant souffert, envoie aujourd’hui son message au Brésil. Nous devons lire Monsieur le Président, résister et chercher la force dans les mots enchanteurs du roman. Je reviens à son commencement :
Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre! Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, Luzbel de piedralumbre! Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre…, alumbre…,alumbra…, alumbre de alumbre…,alumbra, alumbre…!
Franklin Frederick
Views: 0