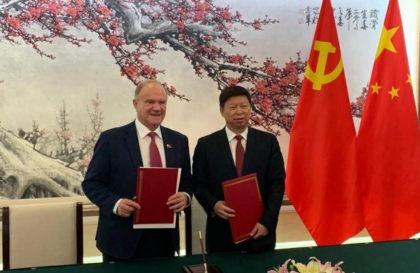Fanon était un individu d’envergure, de grande qualité par la finesse de ses jugements comme par son courage de dire la vérité. Psychiatre, il ne pouvait donc être qu’un bon psychiatre. Peaux noires, masques blancs et ses autres écrits concernant les maladies mentales qui frappaient les colonisés d’Algérie qu’il soignait, en constituent le très beau témoignage. Mais au-delà il a été un révolutionnaire authentique. Son livre, Les Damnés de la Terre, explicite sa vision de la révolution nécessaire pour sortir l’humanité de la barbarie capitaliste. Et c’est à ce titre qu’il a conquis le respect de tous les Africains et Asiatiques. Helmy Shaarawi, dans un beau texte publié en arabe, Fanon en Afrique, a dressé un tableau parfait de l’écho de sa pensée dans les mouvements de libération du continent.
1. Fanon, les Antilles et l’esclavage
Fanon est né Antillais. L’histoire de son peuple, de l’esclavage, de sa relation à la métropole française, a donc été par la force des choses le point de départ de sa réflexion critique.
Je n’ai pas connu le Fanon jeune de l’époque, mais mon histoire politique personnelle m’a fait connaître de l’intérieur la politique de « l’assimilation » mise en œuvre par la France aux Antilles, en Guyane et à la Réunion aux lendemains de la seconde guerre mondiale.
L’histoire des rapports de la France avec ses colonies esclavagistes est différente de celle des rapports de la Grande Bretagne avec les Amériques esclavagistes, puis des Etats-Unis avec leur colonie esclavagiste interne.
La première et seule révolution sociale que le continent américain ait connu jusqu’aux temps récents est celle des esclaves de Saint Domingue ( Haiti) ayant conquis par eux-mêmes leur liberté. La prétendue « révolution américaine » du XVIII ième siècle, comme celles des colonies espagnoles un peu plus tard, n’ont été que des révoltes des classes dominantes locales, se débarrassant du tribut payé à la mère patrie pour continuer la même exploitation des esclaves et des peuples conquis que celle mise en place par les métropoles du capitalisme mercantiliste. Elles n’ont jamais été des révolutions au sens plein du terme (je renvoie ici à mes développements sur le sujet dans Le Virus Libéral).
La révolution de Saint Domingue coïncidait avec celle du peuple français. L’aile radicale de la révolution française sympathisait donc naturellement avec celle des esclaves ayant conquis leur liberté par eux-mêmes , devenus de ce fait d’authentiques citoyens. Mais bien entendu les colons de la place ne l’entendaient pas ainsi. Le recul de la révolution française s’est traduit dans les Antilles par le rétablissement de l’esclavage, à nouveau aboli par la Seconde République en 1848, sans que pour autant soit aboli leur statut colonial jusqu’en 1945, date à partir de laquelle s’ouvre un chapitre nouveau de leur histoire.
Que voulait-on ? Quels devraient être les objectifs stratégiques de la lutte anticolonialiste ? L’indépendance – fut elle encore en apparence éloignée – ou l’assimilation, ou la construction d’une « Union française véritable », c’est à dire d’un Etat multinational, plus ou moins fédéré ou confédéré ? Aujourd’hui on peut croire que la seule option progressiste ne pouvait être que celle de l’indépendance. Mais à l’époque les choses se présentaient d’une manière plus complexe, surtout dans les années 1946-1950.
Les partis communistes des Antilles et de la Réunion se sont battus sur le terrain de l’assimilation et ont fini par l’emporter effectivement. Le résultat s’impose aujourd’hui : l’assimilation a créé une dépendance économique et sociale telle qu’il est difficile de concevoir que le mouvement puisse être inversé et que les Antilles et la Réunion puissent un jour – pour le meilleur ou pour le pire – devenir indépendants. Paradoxe apparent : si aujourd’hui les Antilles et la Réunion sont devenues indissociables de la France, elles le doivent aux efforts des communistes, de France et des colonies concernées, couronnés de succès. La droite, qui s’était toujours opposée à l’assimilation des droits, défenseur hier de l’esclavage et plus tard du statut colonial, n’auraient donc pas évité que le mouvement conduise, ici comme dans les Antilles anglaises et à Maurice, à la revendication indépendantiste.
Bien entendu, en dépit des transformations profondes produites par la départementalisation à partir de 1945, les effets du passé esclavagiste et colonial ne pouvaient être gommés ni de la mémoire des peuples concernés ni de leur conception vivante de leur identité dans ses rapports avec la France. Peaux noires, masques blancs nous propose, sur ce terrain une analyse d’une lucidité parfaite. Le traitement des problèmes abordés dans cet ouvrage permet d’en saisir la singularité – au-delà des dénominateurs communs banals- par opposition aux défis auxquels sont confrontés les Noirs des Etats-Unis, ceux des Antilles britanniques, du Brésil, les Noirs d’Afrique en général et ceux d’Afrique du Sud en particulier. Je rapporterai ces différences à la distinction que je propose entre colonialisme externe et colonialisme interne.
2. Colonialisme externe et colonialisme interne
Le contraste centres/périphéries est donc inhérent à l’expansion mondiale du capitalisme réellement existant à toutes les étapes de son déploiement depuis ses origines. L’impérialisme propre au capitalisme a bien entendu revêtu des formes diverses successives en rapport étroit avec les caractéristiques spécifiques des phases successives de l’accumulation capitaliste : le mercantilisme (de 1500 à 1800), le capitalisme industriel classique (1800 à 1945), l’après deuxième guerre (1945-1990) et la « mondialisation » en cours de construction.
Dans ce cadre d’analyse le colonialisme est une forme particulière d’expansion de certaines formations centrales (qualifiées de ce fait de puissances impérialistes ) fondée sur la soumission de pays conquis (les colonies ) au pouvoir politique des métropoles. La colonisation est alors « extérieure » au sens que les métropoles d’une part, les colonies de l’autre constituent des entités distinctes, même si les secondes sont intégrées dans un espace politique dominé par les premières. L’impérialisme en question est capitaliste et ne doit pas être confondu avec d’autres formes – antérieures – de l’éventuelle domination exercée par un pouvoir sur différents peuples. L’amalgame qui traite de l’impérialisme du capitalisme moderne dans des termes analogues à ceux par lesquels on analyse l’impérialisme romain n’a pas beaucoup de sens. Les Etats multinationaux (les Empires austro hongrois, ottoman, russe et l’ URSS) constituent également des phénomènes historiques distincts (en URSS par exemple les transferts financiers allaient du centre russe aux périphéries asiatiques, l’inverse de ce qu’il en est dans les systèmes coloniaux).
La colonisation capitaliste est d’abord celle des Amériques, conquises par les Espagnols, les Portugais, les Anglais et les Français. Dans leurs colonies d’Amérique les classes dirigeantes des métropoles conquérantes mettent en place des systèmes économiques et sociaux particuliers, conçus pour servir l’accumulation dans les centres dominants de l’époque. L’asymétrie Europe atlantique/Amérique coloniale n’est ni spontanée, ni naturelle , mais parfaitement construite. La soumission des sociétés indiennes conquises entre dans cette construction systémique.
La greffe de la traite négrière sur ce système est également destinée à en conforter l’efficacité en tant que système périphérique, soumis aux exigences de l’accumulation dans les centres de l’époque. L’Afrique noire, dont proviennent les esclaves, est de ce fait périphérie de la périphérie américaine .La colonisation se déploie rapidement au delà des Amériques, entre autre par la conquête de l’Inde anglaise et des Indes néerlandaises au XVIIIe siècle puis, à partir de la fin du XIXe siècle, de l’Afrique et de l’Asie du Sud Est. Les pays qui n’ont pas été franchement conquis – la Chine, l’Iran, l’Empire ottoman – ont été soumis à des traités inégaux qui donnent tout son sens à leur qualification de semi-colonies .
La colonisation est « extérieure », vue des métropoles, les nations les plus industrialisées et de surcroît les plus avancées dans la modernisation sociale, l’essor de leurs mouvements ouvriers et socialistes et les conquètes démocratiques. Mais ces avancées n’ont jamais bénéficié aux peuples de leurs colonies. L’esclavage à l’étape antérieure de ce déploiement, le travail forcé et d’autres formes de surexploitation des classes populaires, la brutalité administrative et les massacres coloniaux ponctuent cette histoire du capitalisme réellement existant. On doit parler à cet endroit du véritable « livre noir » du capitalisme, dans lequel le nombre des victimes se compte par dizaines de millions. Ces pratiques ont bien entendu exercé des influences dévastatrices dans les métropoles elles mêmes ; elles ont fourni le socle de la dérive raciste des cultures des élites dirigeantes et même des classes populaires, moyen de légitimation du contraste démocratie dans la métropole /autocratie sauvage dans les colonies. L’exploitation des colonies bénéficie au capital des centres dans leur ensemble, et les métropoles en tirent un profit supplémentaire déterminant leur position dans la hiérarchie mondiale ( la Grande Bretagne tire son hégémonie de l’importance de son Empire dont l’Allemagne, tard venue, ambitionne de s’emparer).
Les phénomènes de colonialisme interne sont produits par des combinaisons particulières de la colonisation de peuplement d’une part et de la logique de l’expansion impérialiste d’autre part. L’accumulation primitive dans les centres prend la forme d’une expropriation systématique des couches pauvres de la paysannerie, et crée de ce fait un excédant de population que l’industrialisation locale n’a pas toujours été capable d’absorber intégralement, créant de ce fait des courants d’émigration puissants. Plus tard la révolution démographique associée à la modernisation sociale s’exprime par la baisse de la mortalité précédant celle de la natalité , renforçant par là même l’émigration. L’Angleterre fournit l’exemple précoce de cette évolution, avec la généralisation des « enclosure » à partir du XVIIe siècle.
La formation de la Nouvelle Angleterre est le produit de cette conjoncture qui rend compte de la nature des mouvements politiques/idéologiques qui accompagnent cette immigration. Les « pauvres » – victimes du développement capitaliste dans la métropole – réagissent par l’adhésion à des sectes obscurantistes anti-Lumières qui organisent leur départ et leur installation en Nouvelle Angleterre. Cette origine imprégnera fortement l’idéologie américaine pour lui donner un caractère réactionnaire marqué. Mais l’essentiel, pour les classes dirigeantes de l’Angleterre capitaliste/impérialiste de l’époque n’est pas cette émigration mais la constitution de colonies ordinaires construites pour servir les objectifs de l’accumulation dans la métropole :les colonies esclavagistes de l’Amérique du Nord anglaise.
La juxtaposition de ces deux ensembles d’entités est alors appelée à donner à la formation sociale des Etats Unis son caractère spécifique, fondé sur un modèle de colonialisme interne. Car la Nouvelle Angleterre va bénéficier du peu d’intérêt de la métropole à son endroit. Elle s’érige donc en centre autonome, s’impose comme intermédiaire dans l’exploitation des colonies esclavagistes (en s’emparant d’abord du commerce maritime qui permet leur contrôle), et amorce une industrialisation précoce. Les Etats Unis associent donc dans leur formation un nouveau centre capitaliste/impérialiste (la Nouvelle Angleterre) et sa propre colonie interne (le Sud esclavagiste). Les effets de cette conjonction dans la formation de la culture politique des Etats Unis ont été décisifs. Je renvoie ici à mes développements sur cette question proposés dans Le Virus libéral.
Le colonialisme interne n’a pas été le produit exclusif de l’histoire des Etats Unis. On retrouve des caractères en partie comparables en Amérique latine et en Afrique du Sud. La péninsule ibérique ne se situait pas à l’avant garde du développement du capitalisme. Mais nonens volens cette conquête s’est inscrite dans la formation mercantiliste du capitalisme naissant . La soumission brutale des Indiens, puis le relais pris par l’importation d’esclaves africains, ont trouvé leur place dans ce cadre nouveau. A cela près que le système ne fonctionnait pas au profit de centres nouveaux , ni en Espagne et au Portugal encore moins dans les colonies d’Amérique. La fonction coloniale de l’Amérique latine devait donc être récupérée par les centres véritables en formation, l’ Angleterre en premier lieu, relayée plus tard au XIXe siècle par les Etats Unis (qui ont proclamé leur vocation à devenir seuls maîtres du continent à partir de la doctrine Monroe – 1823), les Espagnols et les Portugais remplissant des fonctions d’intermédiaires semblables à celles que les bourgeoisies compradores allaient occuper en Asie et dans l’Empire ottoman.
La colonisation interne en Amérique latine a tout de même entraîné des conséquences politiques et sociales du type de celui généré par la colonisation en général : le racisme à l’égard des Noirs (au Brésil notamment), le mépris à l’égard des Indiens. Cette colonisation interne n’a été remise en question qu’au Mexique dont la Révolution (1910-1920) se situe pour cette raison parmi les « grandes révolutions des temps modernes ». Elle est peut être en voie d’être remise en question dans les pays andins, avec la renaissance des revendications « indigénistes » contemporaines, mais bien entendu dans une conjoncture locale et globale nouvelle.
En Afrique du Sud la première colonisation de peuplement – celle des Boers- s’inscrivait plutôt dans la perspective de constitution d’un Etat « blanc pur » impliquant l’expulsion (ou l’extermination) des Africains plus que leur soumission. La conquête britannique par contre s’est donnée d’emblée l’objectif de soumettre les Africains aux exigences de l’expansion impérialiste de la métropole (l’exploitation des mines en premier lieu). Ni les colons anciens (les Boers), ni les nouveaux (Britanniques) n’étaient autorisés à s’ériger en centre autonome. L’Etat boer de l’apartheid après la seconde guerre mondiale a tenté de le faire, asseyant son pouvoir sur sa colonie interne (noire pour l’essentiel). Mais il n’est pas parvenu à ses fins du fait d’un rapport numérique défavorable (une forte majorité de Noirs) et de la résistance grandissante des peuples soumis, finalement victorieuse. Les pouvoirs en place après la fin de l’apartheid ont hérité de cette question de la colonisation interne, sans lui avoir apporté sa solution radicale jusqu’à présent. Mais cela constitue un nouveau chapitre de l’histoire.
Le cas de l’Afrique du Sud est particulièrement intéressant du point de vue des effets du colonialisme sur la culture politique. Ce n’est pas seulement que le colonialisme interne y soit ici visible même aux aveugles, ni même qu’il ait produit la culture politique de l’apartheid. C’est aussi que les Communistes de ce pays avaient su en tirer une analyse lucide de ce qu’est le capitalisme réellement existant. Le Parti Communiste de l’Afrique du Sud a été, dans les années 1920, le promoteur de la théorie du colonialisme interne (une théorie adoptée dans les années 1930 par un leader noir du PC des Etats Unis – Hayword – , mais non suivi par ses camarades « blancs ») . Il en avait tiré les conséquences : que les revenus élevés de la minorité « blanche » et incroyablement bas pour la majorité « noire » constituait l’endroit et l’envers de la même question.
Allant même plus loin ce PC avait osé faire l’analogie avec le contraste qui opposait – dans l’Empire britannique – les salaires anglais et les revenus du travail en Inde. Pour lui, comme pour la IIIe Internationale de l’époque, ces deux aspects de la même question – celle du capitalisme réel – étaient indissociables. La théorie communiste sud africaine du colonialisme interne conduisait à la conclusion qu’à l’échelle du système capitaliste mondial le colonialisme, d’apparence externe pour les puissances impérialistes majeures, est évidemment interne. Le PC d’Afrique du Sud et la IIIe Internationale de l’époque avaient intériorisé cette conclusion dans la culture politique de la gauche (communiste). Et en cela rompu radicalement avec celle de la gauche socialiste de la IIe Internationale social-colonialiste, dont la culture politique niait cette association inhérente à la réalité mondiale.
L’Afrique du Sud est un microcosme du système capitaliste mondial, ai-je écrit. Elle réunit sur son territoire les trois composantes de ce système : une minorité bénéficiant de la rente de situation des centres impérialistes, deux composantes majoritaires, à peu près également partagées entre un « tiers monde » industrialisé (les pays émergents d’aujourd’hui) et un « quart monde » exclu (dans les ex Bantoustans), analogue aux régions non industrialisées de l’Afrique contemporaine. Qui plus est les proportions entre les chiffres des populations de ces trois composantes et celles qui décrivent les hiérarchies de leurs revenus par tête, sont à peu près celles qui caractérisent le système mondial actuel. Ce fait a sans doute contribué à donner aux Communistes Sud africains de l’époque la lucidité qui fut la leur. Cette culture politique est aujourd’hui perdue. Non seulement en Afrique du Sud, avec le ralliement (tardif) du PC aux thèses banalisées du « racisme » (qui donne le statut de cause à ce qui n’est qu’un effet).. Mais encore à l’échelle mondiale, avec le ralliement social démocrate de la majorité des communistes.
La colonisation de la Palestine par Israel illustre sous nos yeux de contemporains, la permanence de l’accumulation par dépossession.
Le système mondial contemporain évolue-t-il en direction d’une généralisation nouvelle de formes de colonialisme interne ? L’approfondissement de la crise sociale dans ses périphéries qui abritent la moitié paysanne de l’humanité produite par l’offensive généralisée du capital (la stratégie « d’enclosure à l’échelle mondiale ») engendre une pression migratoire gigantesque qui viendrait compenser la stagnation démographique relative des centres de la Triade. L’hypothèse d’un colonialisme interne généralisé qui caractériserait la phase à venir du capitalisme mondial demeure discutable, du fait des résistances politiques et idéologiques réelles à adopter en Europe un modèle de ce genre, qui implique l’institutionalisation du « racisme ». Par contre le modèle « communautariste » inspiré par la pratique des Etats Unis paraît ici constituer le danger tout à fait réel d’une « américanisation de l’Europe ».
3. Fanon et le défi du capitalisme réellement existant L’accumulation par dépossession est permanente dans l’histoire du capitalisme réellement existant
Fanon avait parfaitement compris que l’expansion capitaliste était fondée sur la dépossession des peuples d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraibes, c’est-à-dire de la majorité écrasante des peuples de la planète. Que les victimes majeures de cette expansion – les « damnés de la terre »- étaient donc ces peuples, appelés par la force des choses à la révolte permanente et légitime contre l’ordre mondial impérialiste.
Le capitalisme historique (c’est à dire le capitalisme réellement existant, par opposition à la vision idéologique de « l’économie de marché ») est par nature impérialiste. Fondé sur la conquête du monde par les centres impérialistes (Europe, Etats Unis, Japon) il abolit par sa nature même la possibilité pour les sociétés des périphéries de son système mondial (Asie, Afrique, Amérique latine) de « rattraper » et de devenir, à l’image des centres, des sociétés capitalistes opulentes. La voie capitaliste constitue pour ces peuples une impasse. L’alternative est donc socialisme ou barbarie. La vision (hélas dominante) d’une accumulation préalable nécessaire et incontournable qui exigerait le passage par une « phase capitaliste » avant de s’engager sur la voie socialiste, est sans fondement dès lors qu’on prend la mesure des défis objectifs que représente le capitalisme historique.
La vulgate idéologique de l’économie conventionnelle et de la « pensée » culturelle et sociale qui l’accompagne prétend que l’accumulation est financée par l’épargne –vertueuse – des « riches », comme des nations. L’histoire ne conforte pas cette invention des puritains anglo-américains. Elle est, au contraire, celle d’une accumulation largement financée par la dépossession des uns (la majorité) au profit des autres (une minorité). Marx a analysé avec rigueur ces processus qu’il a qualifié d’accumulation primitive, dont la dépossession des paysans anglais (les « enclosures »), celle des paysans irlandais (au profit de landlords anglais conquérants), celle de la colonisation américaine constituent les témoignages éloquents. En réalité cette accumulation primitive ne se situe pas exclusivement aux origines lointaines et dépassées du capitalisme. Celle-ci se poursuit encore aujourd’hui.
La population de la Planète est multipliée par trois entre 1500 (de 450 à 550 millions d’êtres humains) et 1900 (1600 millions), puis par 3,75 au cours du XXe siècle (aujourd’hui plus de 6.000 millions). Mais la proportion des Européens (d’Europe et des territoires conquis en Amérique, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle Zélande) passe de 18 % (ou moins) en 1500 à 37 % en 1900, pour redescendre graduellement au XXe siècle. Les quatre premiers siècles (1500-1900) correspondent à la conquête du monde par les Européens, le XXe siècle – qui se poursuit au XXIe siècle – à « l’éveil du Sud », la Renaissance des peuples conquis.
La conquête du monde par les Européens constitue une gigantesque dépossession des Indiens d’Amérique, qui perdent leurs terres et leurs ressources naturelles au profit des colons. Les Indiens ont été exterminés en presque totalité (le génocide des Indiens d’Amérique du Nord) ou réduits par les effets de cette dépossession et de leur surexploitation par les conquérants espagnols et portugais au dixième de ce qu’ils étaient. La traite négrière qui prend la relève exerce sur une bonne partie de l’Afrique une ponction qui retarde d’un demi millénaire le progrès du continent.
Des phénomènes analogues sont visibles en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, en Algérie et plus encore en Australie et en Nouvelle Zélande. Ce procès d’accumulation par dépossession caractèrise l’Etat d’Israël – une colonisation en cours. Non moins visibles sont les conséquences de l’exploitation coloniale des paysanneries soumises de l’Inde anglaise, des Indes néerlandaises, Philippines, de l’Afrique : les famines (celle célèbre du Bengale, celles de l’Afrique contemporaine) en constituent la manifestation. La méthode avait été inaugurée par les Anglais en Irlande dont la population, jadis égale à celle de l’Angleterre n’en représente plus encore aujourd’hui que le dixième, ponctionnée par la famine organisée dont Marx a fait le procès. La dépossession n’a pas frappé seulement les populations paysannes – la grande majorité des peuples d’autrefois. Elle a détruit les capacités de production industrielle (artisanats et manufactures) de régions naguère et longtemps plus prospères que l’Europe elle même : la Chine et l’Inde entre autre (les développements de Bagchi, dans son dernier ouvrage Perilous passage, sont sur ce sujet indiscutables).
Il importe ici de bien comprendre que ces destructions n’ont pas été produites par les « lois du marché », l’industrie européenne – prétendue plus « efficace » – ayant pris la place de productions non compétitives. Ce discours idéologique passe sous silence les violences politiques et militaires mises en œuvre pour obtenir ce résultat. Ce ne sont pas les « canons » de l’industrie anglaise, mais ceux des canonnières tout court, qui ont eu raison de la supériorité – et non infériorité – des industries chinoises et indiennes. L’industrialisation, interdite par les administrations coloniales, a fait le reste et « développé le sous développement » de l’Asie et de l’Afrique aux XIXe et XXe siècles. Les atrocités coloniales, l’extrême surexploitation des travailleurs ont été les moyens et les produits naturels de l’accumulation par dépossesion.
De 1500 à 1800, la production matérielle des centres européens progresse à un taux qui dépasse de peu sans doute celui de leur démographie (mais celle-ci est forte en termes relatifs pour l’époque ). Ces rythmes s’accélèrent au XIXe siècle, avec l’approfondissement – et non l’atténuation – de l’exploitation des peuples d’outre mer, raison pour laquelle je parle d’accumulation permanente par dépossession et non d’accumulation « primitive » (« première », « antérieure »).
Cela n’exclut pas qu’aux XIXe et XXe siècles la contribution de l’accumulation financée par le progrès technologique – les révolutions industrielles successives – prend désormais une importance qu’elle n’avait jamais eu au cours des trois siècles mercantilistes qui précèdent. Finalement donc, de 1500 à 1900, la production apparente des centres nouveaux du système mondial capitaliste/impérialiste (l’Europe occidentale et centrale, les Etats Unis et – tard venu – le Japon) est multiplié par 7 à 7,5, faisant contraste avec celle des périphéries qui n’est guère que doublée. L’écart se creuse comme jamais il n’avait été possible dans toute l’histoire antérieure de l’humanité. Au cours du XXe siècle il s’approfondit encore, portant le revenu par tête apparent en 2000 à un niveau de 15 à 20 fois supérieur à celui des périphéries dans leur ensemble.
L’accumulation par dépossession des siècles du mercantilisme a largement financé le déploiement du luxe des trains de vie des classes dirigeantes de l’époque (« l’Ancien Régime »), sans avoir bénéficié aux classes populaires, dont les niveaux de vie se dégradent souvent – elles sont elles mêmes victimes de l’accumulation par dépossession de fractions importantes des paysanneries. Mais elle a surtout financé un extraordinaire renforcement des pouvoirs de l’Etat modernisé, de son administration et de sa puissance militaire. Les guerres de la Révolution et de l’Empire, qui font la jonction entre l’époque mercantiliste précédente et celle de l’industrialisation ultérieure, en témoignent. Cette accumulation est donc à l’origine des deux transformations majeures qui feront le XIXe siècle : la première révolution industrielle, la conquête coloniale facile.
Les classes populaires ne bénéficient pas de la prospérité coloniale des premiers temps, jusque tard dans le XIXe siècle, comme en témoigne le tableau désolant de la misère ouvrière en Angleterre, décrite par Engels. Mais ils ont l’échappatoire de l’émigration en masse, qui s’accélère au XIXe et XXe siècles. Au point que la population d’origine européenne soit devenue supérieure à celle des régions d’origine de leur émigration. Imagine-t-on aujourd’hui deux ou trois milliards d’Asiatiques et d’Africains disposant de tels avantages ?
Le XIXe siècle a représenté l’apogée de ce système de la mondialisation capitaliste/impérialiste. Au point que, désormais, expansion du capitalisme et « occidentalisation » au sens brutal du terme rendent impossible la distinction entre la dimension économique de la conquête et sa dimension culturelle, l’eurocentrisme.
4. Le capitalisme : une parenthèse dans l’histoire
Le parcours du capitalisme réellement existant est composé d’une période longue de maturation, s’étendant sur plusieurs siècles, conduisant à un moment d’apogée court (le XIXe siècle), suivi d’un long déclin probable, amorcé au XXe siècle, qui pourrait devenir une longue transition au socialisme mondialisé.
Le capitalisme n’est pas le produit d’une apparition brutale, presque magique, qui aurait choisi le triangle Londres/Amsterdam/Paris pour se constituer dans le temps court de la Réforme-Renaissance du XVIe siècle. Trois siècles plus tôt il avait trouvé une première formulation dans les villes italiennes. Des formules premières brillantes mais limitées dans l’espace, étouffées par le monde européen « féodal » ambiant, et de ce fait ayant essuyé des défaites successives conduisant à l’avortement de ces premières expériences. On peut même discuter d’antécédents divers à celles-ci, dans les villes marchandes des « routes de la Soie », de la Chine et de l’Inde au Moyen Orient islamique arabe et persan. Plus tard 1492, avec la conquête des Amériques par les Espagnols et les Portugais, amorce la création du système mercantiliste/esclavagiste/capitaliste. Mais les monarchies de Madrid et de Lisbonne, pour des raisons diverses qui ne sont pas le sujet de notre propos ici, ne sauront pas donner sa forme définitive au mercantilisme, que les Anglais, les Hollandais et les Français vont inventer à leur place. Cette troisième vague de transformations sociales, économiques, politiques et culturelles, qui va produire la transition au capitalisme dans la forme historique que nous lui connaissons (« l’Ancien Régime ») est impensable sans les deux vagues qui l’ont précédé. Pourquoi n’en serait-il pas de même du socialisme : un processus de long apprentissage pluriséculaire d’invention d’un stade plus avancé de la civilisation humaine ?
Le moment de l’apogée du système est bref : à peine un siècle sépare les révolutions industrielle et française de celle de 1917. C’est le siècle à la fois de l’accomplissement de ces deux révolutions qui s’emparent de l’Europe et de son enfant nord américain, de la remise en question de celles-ci (de la Commune de Paris – 1871 – à la révolution de 1917), et de l’achèvement de la conquête du monde, qui semble accepter son sort.
Ce capitalisme historique peut-il poursuivre son déploiement en permettant aux périphéries de son système de « rattraper leur retard » pour devenir des sociétés capitalistes pleinement « développées » à l’image de ce que sont celles de ses centres dominants ? Si cela était possible, si les lois du système le permettaient, alors le « rattrapage » par et dans le capitalisme s’imposerait comme une force objective incontournable, un préalable nécessaire au socialisme ultérieur. Mais voilà, cette vision, si banale et dominante puisse-t-elle être, est simplement fausse. Le capitalisme historique est – et continuera à être – polarisant par nature, rendant le « rattrapage » impossible.
Le capitalisme mondialisé réellement existant est polarisant par nature
Dans sa traduction en termes de stratégie politique et sociale, ce principe général signifie que la longue transition constitue un passage obligé, incontournable, par la construction d’une société nationale populaire, associée à celle d’une économie nationale autocentrée. Cette construction est contradictoire dans tous ses aspects : elle associe des critères, institutions, modes d’opération de nature capitaliste à des aspirations et des réformes sociales en conflit avec la logique du capitalisme mondial, elle associe une certaine ouverture extérieure (contrôlée autant que possible) et la protection des exigences des transformations sociales progressistes, en conflit avec les intérêts capitalistes dominants. Les classes dirigeantes, par leur nature historique, inscrivent leurs visions et aspirations dans la perspective du capitalisme mondial réellement existant et, bon gré mal gré, soumettent leurs stratégies aux contraintes de l’expansion mondiale du capitalisme. C’est pourquoi elles ne peuvent pas réellement envisager la déconnexion. Celle-ci, par contre, s’impose aux classes populaires dès lors qu’elles tentent d’utiliser le pouvoir politique pour transformer leurs conditions et se libérer des conséquences inhumaines qui leur sont faites par l’expansion mondiale polarisante du capitalisme.
L’option d’un développement autocentré est incontournable
Le développement autocentré a constitué historiquement le caractère spécifique du procès d’accumulation du capital dans les centres capitalistes et a déterminé les modalités du développement économique qui en sont résultées, à savoir qu’il est commandé principalement par la dynamique des rapports sociaux internes, renforcée par des relations extérieures mises à son service. Dans les périphéries par contre le procès de l’accumulation du capital est principalement dérivé de l’évolution des centres, greffé sur celle-ci, en quelque sorte « dépendant ».
La dynamique du modèle du développement autocentré est fondée sur une articulation majeure, celle qui met en relation d’interdépendance étroite la croissance de la production de biens de production et celle de la production de biens de consommation de masse. Les économies autocentrées ne sont pas fermées sur elles mêmes ; au contraire elles sont agressivement ouvertes dans ce sens qu’elles façonnent, par leur potentiel d’intervention politique et économique sur la scène internationale, le système mondial dans sa globalité. A cette articulation correspond un rapport social dont les termes majeurs sont constitués par les deux blocs fondamentaux du système : la bourgeoisie nationale et le monde du travail. La dynamique du capitalisme périphérique – l’antinomie du capitalisme central autocentré par définition – est fondée par contre sur une autre articulation principale qui met en relation la capacité d’exportation d’une part et la consommation – importée ou produite localement par substitution d’importation – d’une minorité d’autre part. Ce modèle définit la nature compradore – par opposition à nationale – des bourgeoisies de la périphérie.
5. Le XXe siècle : la première vague des révolutions socialistes et l’éveil du « Sud »
Le moment de l’apogée du système est donc bref : à peine un siècle. Le XXe siècle est celui de la première vague de grandes révolutions conduites au nom du socialisme (Russie, Chine, Vietnam, Cuba) et de la radicalisation des luttes de libération de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine (les périphéries du système impérialiste/capitaliste), dont les ambitions s’exprime à travers le « projet de Bandoung » (1955-1981).
Cette concomitance n’est pas le fruit du hasard. Le déploiement mondialisé du capitalisme/impérialisme a constitué pour les peuples des périphéries concernées la plus grande tragédie de l’histoire humaine, illustrant ainsi le caractère destructif de l’accumulation du capital. La loi de la paupérisation formulée par Marx s’exprime à l’échelle du système avec encore plus de violence que ne l’avait imaginé le père de la pensée socialiste !
Cette page de l’histoire est tournée. Les peuples des périphéries n’acceptent plus le sort que le capitalisme leur réserve. Ce changement d’attitude fondamental est irréversible. Ce qui signifie que le capitalisme est entré dans sa phase de déclin. Ce qui n’exclut pas la persistance d’illusions diverses : celles de réformes capables de donner au capitalisme un visage humain (ce qu’il n’a jamais eu pour la majorité des peuples), celles d’un « rattrapage » possible dans le système, dont se nourrissent les classes dirigeantes des pays « émergents », grisées par les succès du moment, celles de replis passéistes (para religieux ou para ethniques) dans lesquelles sombrent beaucoup de peuples « exclus » dans le moment actuel. Ces illusions paraissent tenaces du fait que nous sommes dans le creux de la vague, des questions sur lesquelles je reviendrai. La vague des révolutions du XX siècle s’est épuisée, celle de la nouvelle radicalité du XXI siècle ne s’est pas encore affirmée. Et dans le clair obscur des transitions se dessinent des monstres, comme l’écrivait Gramsci. L’éveil des peuples des périphéries se manifeste dés le XX siècle non seulement par leur rattrapage démographique mais encore par leur volonté proclamée de reconstruire leur Etat et leur société, désarticulés par l’impérialisme des quatre siècles qui précèdent.
Bandoung et la première mondialisation des luttes (1955-1980)
Les gouvernements et les peuples de l’Asie et de l’Afrique proclamaient à Bandoung en 1955 leur volonté de reconstruire le système mondial sur la base de la reconnaissance des droits des nations jusque là dominées. Ce « droit au développement » constituait le fondement de la mondialisation de l’époque, mise en œuvre dans un cadre multipolaire négocié, imposé à l’impérialisme contraint, lui, à s’ajuster à ces exigences nouvelles.
Les progrès de l’industrialisation amorcés durant l’ère de Bandoung ne procèdent pas de la logique du déploiement impérialiste mais ont été imposés par les victoires des peuples du Sud. Sans doute ces progrès ont-ils nourri l’illusion d’un « rattrapage » qui paraissait en cours de réalisation, alors qu’en fait l’impérialisme, contraint lui de s’ajuster aux exigences du développement des périphéries, se recomposait autour de nouvelles formes de domination. Le vieux contraste pays impérialistes/pays dominés qui était synonyme de contraste pays industrialisés/pays non industrialisés cédait peu à peu la place à un contraste nouveau fondé sur la centralisation d’avantages associés aux « cinq monopoles nouveaux des centres impérialistes » (le contrôle des technologies nouvelles, des ressources naturelles, du système financier global, des communications et des armements de destruction massive).
L’ère de Bandoung est celle de la Renaissance de l’Afrique. Le panafricanisme doit être situé dans cette perspective. A l’origine produit par les diasporas américaines, le panafricanisme a réalisé l’un de ses objectifs (l’indépendance des pays du continent) sinon l’autre (leur unité). Ce n’est pas un hasard si les Etats africains s’engagent dans des projets de rénovation qui leur imposent de s’inspirer des valeurs du socialisme, puisque la libération des peuples des périphéries s’inscrit nécessairement dans une perspective anti capitaliste. Il n’y a pas lieu de dénigrer ces tentatives nombreuses sur le continent, comme on le fait aujourd’hui : le régime odieux de Mobutu a permis en trente ans la formation d’un capital d’éducation au Congo 40 fois supérieur à celui que les Belges n’avaient pas réalisé en 80 ans. Qu’on le veuille ou non, les Etats africains sont à l’origine de la formation de véritables nations. Et les options « trans ethniques » de leurs classes dirigeantes ont favorisé cette cristallisation. Les dérives ethnicistes sont ultérieures, produites par l’épuisement des modèles de Bandoung, entraînant la perte de légitimité des pouvoirs et le recours de fractions de ceux ci à l’ethnicité pour la rétablir à leur profit. Je renvoie ici à mon ouvrage L’ Ethnie à l’assaut des Nations (Harmattan, 1994).
Le long déclin du capitalisme, sera-t-il synonyme d’une longue transition positive au socialisme ? Il faudrait pour qu’il en soit ainsi que le XXIe siècle prolonge le XXe siècle et en radicalise les objectifs de la transformation sociale. Ce qui est tout à fait possible mais dont les conditions doivent être précisées. A défaut, le long déclin du capitalisme se traduirait par la dégradation continue de la civilisation humaine.
Le déclin n’est pas non plus un processus continu, linéaire. Il n’exclut pas des moments de « reprise », de contre offensive du capital, analogues à leur manière à la contre offensive des classes dirigeantes de l’Ancien Régime à la veille de la Révolution française. Le moment actuel est de cette nature. Le XXe siècle constitue un premier chapitre du long apprentissage par les peuples du dépassement du capitalisme et de l’invention de formes socialistes nouvelles de vie, pour reprendre l’expression forte de Domenico Losurdo ( Fuir l’histoire, Delga 2007). Avec lui je n’analyse pas son développement dans les termes de « l’échec » (du socialisme, de l’indépendance nationale) comme la propagande réactionnaire qui a le vent en poupe aujourd’hui tente de le faire.
Au contraire ce sont les succès et non les échecs de cette première vague d’expériences socialistes et nationales populaires qui sont à l’origine des problèmes du monde contemporain. J’avais analysé les projets de cette première vague dans les termes des trois familles d’avancées sociales et politiques qu’ont représenté le Welfare State de l’Occident impérialiste (le compromis historique capital-travail de l’époque), les socialismes réellement existant soviétique et maoïste, les systèmes nationaux populaires de l’ère de Bandoung. Je les avais analysés dans les termes de leur complémentarité et de leur conflictualité au plan mondial (une perspective différente de celle de la « guerre froide » et de la bipolarité proposée aujourd’hui par les défenseurs du « capitalisme – fin – de l’histoire », qui plaçait l’accent sur le caractère multipolaire de la mondialisation du XXe siècle). L’analyse des contradictions sociales propres à chacun de ces systèmes, des tâtonnements caractéristiques de ces premières avancées, explique leur essoufflement et finalement leur défaite et non leur échec ( Samir Amin, Au delà du capitalisme sénile, PUF 2002, pp 11-19).
C’est donc cet essoufflement qui a créée les conditions favorables à la contre offensive du capital en cours : une nouvelle « transition périlleuse » des libérations du XXe siècle à celles du XXIe siècle. Il faut donc aborder maintenant la question de la nature de ce moment « creux » qui sépare les deux siècles et identifier les défis nouveaux qu’il représente pour les peuples.
L’action politique de Fanon est située toute entière dans ce moment de l’histoire, celui de l’ère de Bandoung (1955-1980) et de la première vague de luttes de libération victorieuses. Les choix qu’il a fait –se ranger aux côtés du Front de Libération Nationale de l’Algérie et des mouvements de libération du continent africain- était le seul digne d’un révolutionnaire authentique.
6. Pour un renouveau socialiste au XXI ième siècle Les avancées socialistes du XX ème siècle : soviétisme et maoisme
Le marxisme de la IIe Internationale, ouvriériste et eurocentriste, partageait avec l’idéologie dominante de l’époque une vision linéaire de l’histoire selon laquelle toutes les sociétés doivent passer d’abord par une étape de développement capitaliste (dont la colonisation – de ce fait « historiquement positive » – jetait les germes) avant de pouvoir aspirer au socialisme. L’idée que le « développement » des uns (les centres dominants) et le « sous développement » des autres (les périphéries dominées) étaient indissociables comme les deux faces d’une même pièce, produits immanents l’un et l’autre de l’expansion mondiale du capitalisme lui était parfaitement étrangère.
Dans un premier temps Lénine prend quelques distances avec la théorie dominante de la II ème Internationale, et conduit avec succès la révolution dans le « maillon faible » (la Russie), mais toujours avec la conviction que celle-ci sera suivie par une vague de révolutions socialistes en Europe. Espoir déçu ; Lénine amorce alors une vision qui donne plus d’importance à la transformation des rébellions de l’Orient en révolutions. Mais il appartenait au PCC et à Mao de systématiser cette perspective nouvelle.
La révolution russe avait été conduite par un Parti bien implanté dans la classe ouvrière et dans l’intelligentsia radicale. Son alliance avec la paysannerie (que le Parti Socialiste Révolutionnaire représentait), – en uniformes de soldats – s’est imposée naturellement. La réforme agraire radicale qui en a résulté donnait enfin satisfaction au vieux rêve des paysans russes : devenir propriétaires. Mais ce compromis historique portait en lui même les germes de ses limites : le « marché » devait produire par lui même, comme toujours, une différenciation grandissante au sein de la paysannerie (le phénomène bien connu de la « koulakisation »).
La révolution chinoise s’est déployée dès l’origine (ou du moins à partir des années 1930) sur d’autres bases garantissant une alliance solide avec la paysannerie pauvre et moyenne. Par ailleurs la dimension nationale – la guerre de résistance à l’agression japonaise – a également permis au front dirigé par les Communistes de recruter largement dans les classes bourgeoises déçues par les faiblesses et les trahisons du Kuo Min Tang.
La révolution chinoise, de ce fait, a produit une situation nouvelle différente de celle de la Russie post révolutionnaire. La révolution paysanne radicale a supprimé l’idée même de propriété privée du sol agraire, et lui a substitué la garantie pour tous les paysans d’un accès égal à celui ci. Jusqu’à ce jour cet avantage décisif, qui n’est partagé par aucun autre pays en dehors du Vietnam, constitue l’obstacle majeur à une expansion dévastatrice du capitalisme agraire. Les débats en cours en Chine portent en grande partie sur cette question. J’y renvoie le lecteur (Cf. S. Amin, Pour un Monde multipolaire, chapitre Chine, Paris 2005 ; S. Amin, Théorie et pratique du projet chinois de socialisme de marché, Alternatives Sud, vol VIII, N° 1, 2001). Mais par ailleurs le ralliement de nombreux bourgeois nationalistes au Parti Communiste devait par la force des choses exercer une influence idéologique propice à soutenir les dérives de ceux que Mao a qualifié de partisans de la voie capitaliste (« capitalist-roaders »).
Le régime post révolutionnaire en Chine n’a pas seulement à son actif nombre de réalisations politiques, culturelles, matérielles et économiques plus qu’appréciables (l’industrialisation du pays, la radicalisation de sa culture politique moderne etc.). La Chine maoïste a résolu le « problème paysan » au cœur du drame du déclin de l’Empire du Milieu pendant deux siècles décisifs (1750-1950). Je renvoie ici à mon ouvrage L’avenir du maoïsme (1981, page 57 ). De surcroît la Chine maoïste est parvenue à ces résultats en évitant les dérives les plus dramatiques de l’Union Soviétique : la collectivisation n’a pas été imposée par la violence meurtrière comme ce fut le cas avec le stalinisme, les oppositions au sein du Parti n’ont pas donné lieu à l’instauration de la terreur (Deng a été écarté, il est revenu…). L’objectif d’une égalité relative sans pareille, concernant tant la répartition des revenus entre les paysans et les ouvriers qu’au sein de ces classes et entre elles et les couches dirigeantes, a été poursuivi – avec des hauts et des bas bien sûr – avec ténacité et formalisé par des options de stratégie de développement qui font contraste avec celles de l’URSS (ces options ont été formulées dans les « dix grands rapports » au début des années 1960).
Ce sont ces succès qui rendent compte de ceux, ultérieurs, du développement de la Chine post maoïste à partir de 1980. Le contraste avec l’Inde qui, précisément, n’a pas fait de révolution, prend ici toute sa signification, non seulement pour rendre compte des parcours différents durant les décennies 1950 à 1980, mais encore des perspectives d’avenir probables (et/ou possibles) diverses. Ce sont ces succès qui expliquent que la Chine post maoïste, inscrivant désormais son développement dans la nouvelle mondialisation capitaliste (par « l’ouverture ») n’a pas subi de chocs destructeurs analogues à ceux qui ont suivi l’effondrement de l’URSS.
Les succès du maoïsme n’avaient pas pour autant réglé « définitivement » (de manière « irréversible ») la question de la perspective à plus long terme au bénéfice du socialisme. D’abord parce que la stratégie du développement des années 1950-1980 avait épuisé son potentiel et que, entre autre, une ouverture (fut-elle contrôlée) s’imposait (cf. L’avenir du maoïsme, pp 59-60 ), laquelle comportait, comme la suite l’a démontré, le risque de renforcer les tendances d’une évolution en direction du capitalisme. Mais encore parce que simultanément le système de la Chine maoïste combinait les tendances contradictoires au renforcement des options socialistes et à leur affaiblissement. Mao, conscient de cette contradiction, a tenté de tordre le bâton en faveur du socialisme par le moyen d’une « Révolution Culturelle » (de 1966 à 1974). « Feu sur le quartier général » (le Comité Central du Parti), siège des aspirations bourgeoises de la classe politique aux postes de commande. Mao a cru que, pour mener à bien cette correction du cours, il pouvait s’appuyé sur la « jeunesse » (ce qui, entre autre, a largement inspiré le 1968 européen – voir le film de Godard « La Chinoise »). La suite des évènements a montré l’erreur de ce jugement. La page de la Révolution Culturelle tournée, les partisans de la voie capitaliste se trouvaient encouragés à passer à l’offensive.
Le combat entre la voie socialiste, longue et difficile, et l’option capitaliste à pied d’œuvre, n’est certainement pas « définitivement dépassé ». Comme ailleurs dans le monde le conflit qui oppose la poursuite du déploiement capitaliste à la perspective socialiste constitue le vrai conflit de civilisation de notre époque. Mais dans ce combat le peuple chinois dispose de quelques atouts importants, qui sont l’héritage de la Révolution et du maoïsme. Ces atouts opèrent dans des domaines divers de la vie sociale ; ils se manifestent avec force entre autre par la défense par la paysannerie de la propriété d’Etat du sol agraire et la garantie de l’accès de tous à celui-ci.
Le maoïsme a contribué d’une manière décisive à prendre la mesure exacte des enjeux et du défi que représente l’expansion capitaliste/impérialiste mondialisée. Il nous a permis de placer au centre de l’analyse de ce défi le contraste centres/périphéries immanent à l’expansion du capitalisme « réellement existant », impérialiste et polarisant par nature, et d’en tirer toutes les leçons qu’il implique pour le combat socialiste, tant dans les centres dominants que dans les périphéries dominées.
Ces conclusions ont été résumées dans une belle formule « à la chinoise » : « les Etats veulent l’indépendance, les nations la libération, les peuples la révolution ».
Les Etats –c’est à dire les classes dirigeantes (de tous les pays du monde, quand elles sont autre chose que des laquais, courroies de transmission de forces extérieures) – s’emploient à élargir l’espace de mouvement qui leur permet de manœuvrer dans le système mondial (capitaliste) et de s’élever de la position d’acteurs « passifs » (condamnés à subir l’ajustement unilatéral aux exigences de l’impérialisme dominant) à celui d’acteurs « actifs » (qui participent au façonnement de l’ordre mondial).
Les Nations -c’est à dire les blocs historiques de classes potentiellement progressistes – veulent la libération, c’est à dire le « développement » et la « modernisation ».
Les peuples – c’est à dire les classes populaires dominées et exploitées – aspirent au socialisme. La formule permet de comprendre le monde réel dans toute sa complexité et, partant, de formuler des stratégies d’action efficace. Elle se situe dans une perspective de longue – très longue – transition du capitalisme au socialisme mondial, et, par là même, rompt avec la conception de la « transition courte » de la IIIe Internationale.
Le conflit capitalisme/socialisme et le conflit Nord/Sud sont indissociables.
Le conflit Nord/ Sud (centres/périphéries) est une donnée première dans toute l’histoire du déploiement capitaliste. C’est pourquoi la lutte des peuples du Sud pour leur libération – désormais victorieuse dans sa tendance générale- s’articule à la remise en question du capitalisme. Cette conjonction est inévitable.
Les conflits capitalisme/socialisme et Nord/Sud sont indissociables. Il n’y a pas de socialisme concevable hors de l’universalisme, qui implique l’égalité des peuples. Dans les pays du Sud les majorités sont victimes du système, dans ceux du Nord elles en sont les bénéficiaires. Les uns et les autres le savent parfaitement bien que souvent soit ils s’y résignent (dans le Sud) soit ils s’en félicitent (dans le Nord). Ce n’est donc pas un hasard si la transformation radicale du système n’est pas à l’ordre du jour dans le Nord, tandis que le Sud constitue toujours « la zone des tempêtes », des révoltes répétées, potentiellement révolutionnaires. De ce fait les initiatives des peuples du Sud ont été décisives dans la transformation du monde comme toute l’histoire du XX ième siècle le démontre.
Constater ce fait permet de situer dans leur cadre les luttes de classes dans le Nord : celui de luttes économiques revendicatives qui en général ne remettent en question ni la propriété du capital ni l’ordre mondial impérialiste. Cela est particulièrement visible aux Etats-Unis dans le cadre d’une culture politique du consensus. La situation est plus complexe en Europe du fait de sa culture politique du conflit opposant droite et gauche, depuis les Lumières et la révolution française, puis ensuite avec la formation d’un mouvement ouvrier socialiste et la révolution russe (cf S. Amin, Le virus libéral, 2003). Néanmoins l’américanisation des sociétés européennes, en cours depuis 1950, atténue graduellement ce contraste. De ce fait également les modifications de la compétitivité comparée des économies du capitalisme central, associées aux développements inégaux des luttes sociales, ne méritent pas d’être placées au centre des transformations du système mondial, ni au cœur des différentes variantes possibles des rapports entre les Etats-Unis et l’Europe, comme le pensent beaucoup des partisans du projet européen.
De leur côté les révoltes du Sud, quand elles se radicalisent, se heurtent aux défis du sous développement. Leurs « socialismes » sont de ce fait toujours porteurs de contradictions entre les intentions de départ et les réalités du possible. La conjonction, possible mais difficile, entre les luttes des peuples du Sud et celles de ceux du Nord constitue le seul moyen de dépasser les limites des uns et des autres. Cette conjonction définit ma lecture du marxisme. Une lecture qui part de Marx, refuse de s’arrêter à lui, ou Lénine ou Mao. Un marxisme conçu comme méthode d’analyse et d’action (la dialectique matérialiste) et non comme l’ensemble des propositions tirées de l’usage de celle ci, et donc un marxisme qui ne craint pas de rejeter certaines conclusions, fussent elles de Marx, un marxisme sans rivages, toujours inachevé.
Le capitalisme étant un système mondial et non la simple juxtaposition de systèmes capitalistes nationaux, les luttes politiques et sociales, pour être efficaces, devaient être conduites simultanément dans l’aire nationale (qui reste décisive parce que les conflits, les alliances et les compromis sociaux et politiques se nouent dans cette aire) et au plan mondial. Ce point de vue – banal à mon avis – me paraît avoir été celui de Marx et des marxismes historiques (« Prolétaires de tous les pays unissez-vous »), ou dans la version maoïste enrichie « Prolétaires de tous les pays, peuples opprimés, unissez-vous ».
Il est impossible de dessiner la trajectoire que dessineront ces avancées inégales produites par les luttes au Sud et au Nord. Mon sentiment est que le Sud traverse actuellement un moment de crise, mais que celle-ci est une crise de croissance, au sens que la poursuite des objectifs de libération de ses peuples est irréversible. Il faudra bien que ceux du Nord en prennent la mesure, mieux qu’ils soutiennent cette perspective et l’associent à la construction du socialisme. Un moment de solidarité de cette nature a bien existé à l’époque de Bandoung. A l’époque les jeunes Européens affichaient leur « tiers mondisme », sans doute naïf, mais combien plus sympathique que leur repliement actuel !
Sans revenir sur les analyses du capitalisme mondial réellement existant que j’ai développés ailleurs, je rappellerai simplement leurs conclusions : qu’à mon avis l’humanité ne pourra s’engager sérieusement dans la construction d’une alternative socialiste au capitalisme que si les choses changent aussi en Occident développé. Cela ne signifie en aucune manière que les pays de la périphérie doivent attendre ce changement et, jusqu’à ce qu’il se produise, se contenter de « s’ajuster » aux possibilités qu’offre la mondialisation capitaliste. Au contraire c’est plus probablement dans la mesure où les choses commenceront à changer dans les périphéries que les sociétés de l’Occident, contraintes de s’y faire, pourraient être amenées à leur tour à évoluer dans le sens requis par le progrès de l’humanité toute entière.
A défaut le pire, c’est à dire la barbarie et le suicide de la civilisation humaine, reste le plus probable. Je situe bien entendu les changements souhaitables et possibles dans les centres et dans les périphéries du système global dans le cadre de ce que j’ai appelé « la longue transition ».
Dans les périphéries du capitalisme mondialisé – par définition « la zone des tempêtes » dans le système impérialiste – une forme de la révolution demeure bien à l’ordre du jour. Mais son objectif est par nature ambigu et flou : libération nationale de l’impérialisme (et maintien de beaucoup, ou même de l’essentiel, des rapports sociaux propres à la modernité capitaliste), ou davantage ? Qu’il s’agisse des révolutions radicales de la Chine, du Viet Nam et de Cuba ou de celles qui ne le furent pas ailleurs en Asie, en Afrique et en Amérique latine, le défi demeurait : « rattraper » et/ou « faire autre chose » ? Ce défi s’articulait à son tour à une autre tâche considérée également prioritaire : défendre l’Union soviétique encerclée. L’Union soviétique, plus tard la Chine, se sont trouvées confrontées à des stratégies d’isolement systématique déployées par le capitalisme dominant et les puissances occidentales.
On comprend alors que, la révolution dans l’immédiat n’étant pas à l’ordre du jour ailleurs, la priorité ait été généralement donnée à la sauvegarde des Etats post révolutionnaires. Les stratégies politiques mises en œuvre – dans l’Union soviétique de Lénine puis de Staline et de ses successeurs, dans la Chine maoïste puis post maoïste, celles déployées par les pouvoirs d’Etat nationaux populistes en Asie et en Afrique, celles proposées par les avant-gardes communistes (qu’elles se soient situées dans le sillon de Moscou, ou de Pékin, ou qu’elles aient été indépendantes) se sont toutes définies par rapport à la question centrale de la défense des Etats post révolutionnaires.
L’Union soviétique, la Chine, le Vietnam et Cuba ont à la fois connu les vicissitudes des grandes révolutions et été confrontées aux conséquences de l’expansion inégale du capitalisme mondial. Ces pays ont néanmoins progressivement sacrifié -à des degrés divers- les objectifs communistes d’origine aux exigences immédiates du rattrapage économique. Ce glissement, abandonnant l’objectif de la propriété sociale par lequel se définit le communisme de Marx pour lui substituer la gestion étatique et s’accompagnant par le déclin de la démocratie populaire, étouffée par la dictature brutale (et parfois sanglante) du pouvoir post révolutionnaire, préparait l’accélération de l’évolution vers la restauration du capitalisme.
Dans les deux expériences la priorité a été donnée à la « défense de l’Etat post révolutionnaire » et les moyens internes déployés à cette fin ont été accompagnés de stratégies extérieures priorisant cette défense. Les partis communistes ont été alors invités à s’aligner sur ces choix non seulement dans leur direction stratégique générale mais même dans leurs ajustements tactiques au jour le jour. Cela ne pouvait produire rien d’autre qu’un affadissement rapide de la pensée critique des révolutionnaires dont le discours abstrait sur la « révolution » (toujours « imminente ») éloignait de l’analyse des contradictions réelles de la société, soutenu par le maintien des formes d’organisation quasi militaires contre vents et marées.
Les avant-gardes qui refusaient l’alignement, et parfois osaient regarder en face la réalité des sociétés post révolutionnaires, n’ont néanmoins pas renoncé à l’hypothèse léniniste d’origine (la « révolution imminente »), sans tenir compte que celle-ci était de plus en plus visiblement démentie dans les faits. Il en a été ainsi du trotskysme et des partis de la IVe Internationale. Il en a été ainsi d’un bon nombre d’organisations révolutionnaires activistes, inspirées parfois par le maoïsme, ou par le guevarrisme. Les exemples en sont nombreux, des Philippines à l’Inde (les naxalites), du monde arabe (avec les Nationalistes/communistes arabes -les qawmiyin- et leurs émules au Yémen du Sud) à l’Amérique latine (Guevarrisme).
Les grands mouvements de libération nationale en Asie et en Afrique, entrés en conflit ouvert avec l’ordre impérialiste, se sont heurtés, comme ceux qui ont conduit des révolutions au nom du socialisme, aux exigences conflictuelles du « rattrapage » (la « construction nationale ») et de la transformation des rapports sociaux en faveur des classes populaires. Sur ce second plan les régimes « post révolutionnaires » (ou simplement post indépendance reconquise) ont certainement été moins radicaux que les pouvoirs communistes, raison pour laquelle je qualifie les régimes en question en Asie et en Afrique de « nationaux – populistes ». Ces régimes se sont d’ailleurs parfois inspirés des formes d’organisation (parti unique, dictature non démocratique du pouvoir, gestion étatiste de l’économie) mises au point dans les expériences du « socialisme réellement existant ». Ils en ont généralement dilué l’efficacité par leurs options idéologiques floues et les compromis avec le passé qu’ils ont acceptés.
C’est dans ces conditions que les régimes en place comme les avant-gardes critiques (le communisme historique dans les pays en question) ont été invités à leur tour à soutenir l’Union soviétique (et plus rarement la Chine) et à bénéficier de son soutien. La constitution de ce front commun contre l’agression impérialiste des Etats-Unis et de leurs partenaires européens et japonais a certainement été bénéfique pour les peuples d’Asie et d’Afrique. Ce front anti-impérialiste ouvrait une marge d’autonomie à la fois pour les initiatives des classes dirigeantes des pays concernés et pour l’action de leurs classes populaires. La preuve en est fournie par ce qui est advenu par la suite, après l’effondrement soviétique.
Retour sur la question agraire
La question agraire, celle de l’avenir des paysanneries des trois continents (la moitié de l’humanité) est centrale dans la conceptualisation de la question nationale : associer et non dissocier modernisation, démocratisation de la société, progrès social accompli par l’option d’une voie de développement à orientation socialiste, affirmation et non dissolution de l’indépendance des nations.
Un regard en arrière sur l’histoire des sociétés du monde antérieur à la conquête européenne peut éclairer ici notre propos et peut être même inspirer des réponses socialistes efficaces au défi de notre temps. La Chine des siècles qui précèdent l’intervention brutale des Européens à partir de 1840 a mis en œuvre un modèle de développement agraire différent de celui inauguré par la voie capitaliste des « enclosures ». La voie chinoise – qui ne disposait pas de la possibilité de l’émigration massive de son surplus de paysans – était fondée sur l’intensification de la production (rendements à l’hectare en progression) par l’association d’une dose croissante de travail, des connaissances améliorées de la nature, des inventions techniques appropriées et l’élargissement de la sphère d’échanges marchands non capitalistes. Cette formule a été poursuivie par la Chine maoïste et même post maoïste. Elle avait fait en son temps, au XVIIIe siècle, l’admiration des Européens (le livre d’Etiemble, L’Europe chinoise en témoigne éloquemment) et inspiré les physiocrates français. On l’a oublié aujourd’hui et l’intérêt important particulier du livre de G. Arrighi est de nous le rappeler. C’est cette voie qui a donné à la Révolution française son caractère spécifique de révolution paysanne, fut-elle associée et progressivement dominée par la bourgeoisie. Je prétends qu’il faut garder ces réflexions présentes à l’esprit dans l’élaboration des politiques de développement à orientation socialiste d’aujourd’hui.
Car la voie capitaliste est-elle « plus efficace » ? L’idéologie dominante – celle du capitalisme – confond dans sa réponse rentabilité pour le capital et efficacité sociale. Si la voie capitaliste permet par exemple de multiplier par dix la production par travailleur rural en un temps défini, celle-ci peut paraître d’évidence d’une efficacité indiscutable. Mais si dans le même temps le nombre des emplois ruraux a été divisé par cinq, qu’en est-il de l’efficacité sociale de cette voie ?
La production totale aura été multipliée par deux, mais quatre ruraux éliminés sur cinq ne peuvent plus ni se nourrir par eux mêmes, ni produire un excédent modeste pour le marché. Si la voie paysanne qui stabilise le chiffre de la population rurale ne multiplie dans le même temps leur production par tête que par deux, la production totale, elle même doublée, nourrit tous les ruraux et produit un excédent commercialisable qui peut être supérieur à celui offert par la voie capitaliste dès lors qu’on déduit de celle-ci l’auto-consommation des paysans qu’elle élimine. Une comparaison entre la « voie française » et la « voie anglaise » au XIXe siècle illustrerait notre propos. La seconde n’a d’ailleurs été possible que grâce à l’émigration en masse et à l’exploitation forcenée des colonies. Les historiens chinois ont parfois eu l’intuition forte de la validité de cette comparaison entre les deux voies (Wen Tiejun nous le rappelle dans un article brillant, peu compris). Giovanni Arrighi (voir Adam Smith in Beijing), André Gunder Frank également (voir Re-Orient), comme l’historien français de la Chine Jean Chesneaux.
Fanon est mort avant que les victoires de Bandoung n’aient encore épuisé leurs effets, créant ainsi les conditions favorables à la contre offensive du capitalisme en déclin, en cours. Je ne ferai pas parler le disparu. Mais je n’ai pas le moindre doute que, vivant, il aurait poursuivi son combat pour la libération des peuples opprimés et le socialisme, seule alternative à la barbarie capitaliste. Nous aurions alors certainement continué à bénéficier de sa lucidité et de son courage.
Cri du Peuple 1871 : http://www.mleray.info/pages/frantz-fanon-international-le-conflit-capitalisme-socialisme-et-le-conflit-nord-sud-sont-indissoci–5978074.html
Samir Amin bibliographie
Le virus libéral , Le temps des Cerises, 2003 – ed espagnole Samir Amin, L’ethnie à l’assaut des Nations, Harmattan 1994 Samir Amin, Classe et Nation, Minuit, 1979 – ed espagnole Samir Amin, Pour un monde multipolaire, Syllepse 2005 – ed espagnole Samir Amin, L’avenir du Maoisme, Minuit 1981 –ed espagnole Samir Amin, Théorie et pratique du projet chinois de socialisme de marché, Alternatives Sud, Vol VIII, n° 1, 2001 Samir Amin , Pour la cinquième Internationale, Le Temps des cerises, 2006 – ed espagnole Samir Amin, L’ Eurocentrisme, Economica, 1988 ; nouvelle édition augmentée en cours de publication , Parangon , Lyon 2008 Samir Amin, Du Capitalisme à la Civilisation , Syllepse, 2008 Etiemble, L’Europe chinoise Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing, Verso 2007, ed espagnole André Gunder Frank, Re-Orient Amiya Bagchi, Perilous passage
Views: 0