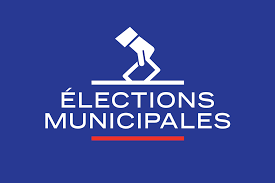L’Iran n’est ni l’Irak ni le Venezuela : un conflit ne serait ni rapide, ni bon marché, ni décisif et se transformerait inévitablement en une nouvelle guerre sans fin menée par les États-Unis. Nous montrons par ailleurs le rôle joué y compris à Davos par les marchés financiers. La baisse spectaculaire vendredi de l’or et l’argent a-t-elle pour seule raison la nomination du nouveau responsable de la FED résolument contre l’inflation ou a-t-elle été le résultat de garanties données par Trump et son entourage sur une guerre en Iran ? Quel rôle ont joué les monarchies du Golf, l’Arabie saoudite ? Le président américain Donald Trump a laissé entendre vendredi que la Maison Blanche avait communiqué en privé un ultimatum à l’Iran pour parvenir à un accord, sans toutefois le préciser publiquement. Interrogé par des journalistes à la Maison Blanche sur l’existence d’un tel ultimatum, Trump a répondu : « Eux seuls le savent avec certitude. » À la question de savoir si le Pentagone avait un calendrier pour réduire la présence militaire américaine au Moyen-Orient, Trump a déclaré : « Nous verrons bien. Ils doivent bien être déployés quelque part, alors autant qu’ils le soient près de l’Iran. » Ce qui apparait c’est que malgré leur armada celle-ci s’avère incapable d’occuper un pays et n’accomplit que des actes terroristes y compris sur le petit Cuba. C’est d’ailleurs la réponse de l’Iran à ceux qui placent les gardiens de la révolution comme des groupes terroristes: L’Iran déclare « terroristes » les armées européennes en représailles aux mesures de l’UE contre les gardiens de la révolution. Outre que quand on a ainsi diabolisé l’adversaire cela rend la négociation impossible alors que le système économico-politique en a un urgent besoin. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
par Bamo Nouri 30 janvier 2026

Les informations faisant état d’une présence navale américaine croissante dans le Golfe ont alimenté les spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient se préparer à une nouvelle guerre au Moyen-Orient, cette fois-ci contre l’Iran.
Le président américain Donald Trump a averti qu’il y aurait de « graves conséquences » si l’Iran ne se conformait pas à ses exigences d’arrêter définitivement l’enrichissement d’uranium, de limiter son programme de missiles balistiques et de mettre fin à son soutien aux groupes par procuration régionaux.
Pourtant, malgré le langage familier de l’escalade, une grande partie de ce qui se déroule ressemble davantage à une politique du bord du gouffre qu’à une préparation à la guerre.
L’histoire politique du président américain lui-même constitue un point de départ important pour comprendre ce phénomène. L’attrait électoral de Trump, tant en 2016 qu’en 2024, reposait en grande partie sur la promesse de mettre fin aux « guerres sans fin » des États-Unis et d’éviter les interventions coûteuses à l’étranger.
L’Iran incarne à lui seul la définition d’une telle guerre. Un conflit ouvert avec Téhéran serait presque certainement long et entraînerait d’autres pays de la région.
Il serait également difficile d’obtenir une victoire décisive. Pour un président dont l’image politique repose sur la retenue à l’étranger et la mise en œuvre de mesures de bouleversements à l’intérieur du pays, une guerre contre l’Iran contredirait la logique même de sa politique étrangère.
Parallèlement, la stratégie iranienne repose sur des décennies de préparation à ce scénario précis. Depuis la révolution de 1979, la doctrine militaire et la politique étrangère de Téhéran sont guidées par la nécessité de survivre face à une potentielle attaque extérieure.
Plutôt que de se doter d’une force conventionnelle capable de vaincre les États-Unis en combat ouvert, l’Iran a investi dans des capacités asymétriques : missiles balistiques et de croisière, recours à des alliés régionaux, cyberopérations et stratégies de déni d’accès, incluant missiles, systèmes de défense aérienne, mines navales, patrouilleurs rapides, drones et capacités de guerre électronique. Quiconque attaquerait l’Iran s’exposerait à des conséquences durables et de plus en plus graves.
C’est pourquoi les comparaisons avec l’Irak de 2003 sont trompeuses. L’Iran est plus vaste, plus peuplé, plus uni intérieurement et bien mieux préparé militairement à une confrontation prolongée.
Une attaque sur le territoire iranien ne constituerait pas la première phase d’un effondrement du régime, mais la dernière étape d’une stratégie défensive conçue précisément pour anticiper un tel scénario. Téhéran serait préparé à encaisser des dommages et est capable d’en infliger sur de multiples fronts, notamment en Irak, dans le Golfe, au Yémen et au-delà.
Avec un budget de défense annuel avoisinant les 900 milliards de dollars, il ne fait aucun doute que les États-Unis ont la capacité de déclencher un conflit avec l’Iran. Mais le défi pour les États-Unis n’est pas tant de déclencher une guerre que de la poursuivre.
Les guerres en Irak et en Afghanistan constituent un précédent édifiant. On estime qu’elles ont coûté aux États-Unis entre 6 et 8 billions de dollars, en incluant les soins de longue durée aux anciens combattants, les paiements d’intérêts et la reconstruction.
Ces conflits se sont étalés sur des décennies, ont systématiquement dépassé les prévisions de coûts initiales et ont contribué à l’explosion de la dette publique. Une guerre contre l’Iran – pays plus vaste, plus puissant et plus ancré dans la région – suivrait presque certainement une trajectoire similaire, voire plus coûteuse.
Le coût d’opportunité des conflits en Irak et en Afghanistan était potentiellement plus élevé, absorbant un capital financier et politique considérable à un moment où l’équilibre mondial des pouvoirs commençait à se modifier.
Alors que les États-Unis se concentraient sur les opérations de contre-insurrection et de stabilisation, d’autres puissances, notamment la Chine et l’Inde, investissaient massivement dans les infrastructures, la technologie et la croissance économique à long terme.
Cette dynamique est encore plus marquée aujourd’hui. Le système international entre dans une phase de rivalité multipolaire beaucoup plus intense, caractérisée non seulement par la compétition militaire, mais aussi par la course à l’intelligence artificielle, à l’industrie manufacturière de pointe et aux technologies stratégiques.
Un engagement militaire prolongé au Moyen-Orient risquerait d’enliser les États-Unis dans des distractions coûteuses en ressources, au moment même où la concurrence avec la Chine s’accélère et où les puissances émergentes recherchent une plus grande influence.
La position géographique de l’Iran aggrave ce risque. Située à la croisée de voies énergétiques mondiales essentielles, Téhéran a la capacité de perturber le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.
Même une perturbation limitée entraînerait une forte hausse des prix du pétrole, alimentant l’inflation mondiale. Pour les États-Unis, cela se traduirait par une augmentation des prix à la consommation et une diminution de la résilience économique, précisément au moment où une orientation stratégique et une stabilité économique sont plus que jamais nécessaires.
Il existe également un risque que la pression militaire se retourne contre le régime iranien sur le plan politique. Malgré un mécontentement populaire important, ce dernier a maintes fois démontré sa capacité à mobiliser le sentiment nationaliste face aux menaces extérieures. Une action militaire pourrait renforcer la cohésion interne, conforter le discours de résistance du régime et marginaliser les mouvements d’opposition.
Les précédentes frappes américaines et israéliennes contre les infrastructures iraniennes n’ont pas abouti à des résultats stratégiques décisifs. Malgré les pertes d’installations et de hauts responsables, la posture militaire globale de l’Iran et son influence régionale ont démontré leur capacité d’adaptation.
Rhétorique et retenue
Trump a maintes fois manifesté son désir d’être perçu comme un artisan de la paix. Il a présenté son approche au Moyen-Orient comme une dissuasion sans implication, citant les accords d’Abraham et l’absence de guerres de grande ampleur durant sa présidence. Cette position contraste fortement avec la perspective d’une guerre avec l’Iran, notamment une semaine après le lancement par le président américain de son « Conseil de la paix ».
Les accords d’Abraham reposent sur la stabilité régionale, la coopération économique et les investissements. Une guerre avec l’Iran mettrait en péril tous ces éléments. Malgré leur rivalité avec Téhéran, les États du Golfe, tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, ont fait de la désescalade régionale une priorité.
L’expérience récente en Irak et en Syrie le démontre. L’effondrement du pouvoir central a créé des vides de pouvoir rapidement comblés par des groupes terroristes, exportant l’instabilité plutôt que la paix.
D’aucuns estiment que les troubles internes en Iran offrent une opportunité stratégique pour exercer une pression extérieure. Bien que la République islamique soit confrontée à de réels défis intérieurs, notamment des difficultés économiques et un mécontentement social, il ne faut pas confondre cela avec un effondrement imminent. Le régime conserve des institutions sécuritaires puissantes et des soutiens fidèles, en particulier lorsqu’il se présente comme défenseur de la souveraineté nationale.
Pris ensemble, ces facteurs suggèrent que les mouvements et la rhétorique militaires américains actuels s’apparentent davantage à une signalisation coercitive qu’à une préparation à une invasion.
Nous ne sommes plus en 2003, et l’Iran n’est ni l’Irak ni le Venezuela. Une guerre ne serait ni rapide, ni bon marché, ni décisive. Le plus grand danger ne réside pas dans une décision délibérée d’invasion, mais dans une erreur d’appréciation. L’escalade verbale et le rapprochement militaire peuvent accroître le risque d’incidents et d’escalade involontaire.
Pour éviter ce dénouement, il faudra faire preuve de retenue, de diplomatie et reconnaître clairement que certaines guerres – même si elles sont brandies comme une menace – sont tout simplement trop coûteuses à mener.
Bamo Nouri est chercheur honoraire au département de politique internationale de City St George’s, Université de Londres.
Cet article est republié de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’ article original .
Views: 71