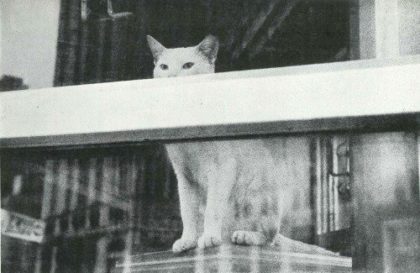Le week-end, c’est le moment « magazine » sur Histoireetsociété, et pour le modeste apprenti éditeur que je suis, ce n’est pas la partie la plus facile à commenter. Mais nous étions aujourd’hui (je rappelle que les articles apparaissent dans l’ordre inverse de leur publication, le dernier publié – celui-ci pour aujourd’hui, apparaît en tête) sur le changement du regard, pour voir ce qui nous était invisible car occulté. On sait qu’on ne voit complètement que ce que l’on est préparé à voir. L’attention est un processus complexe, sculpté par des millions d’années d’évolution des espèces, et pour l’humain qui est un être social de pensée et de langage, par des milliers d’années d’histoire. C’est tout le rôle de la parole comme libératrice car capable d’ouvrir notre attention à ce qui n’est pas perçu et donc de sortir notre pensée des carcans qui l’empêchent de voir et de connaître. Le paradoxe de l’idéalisme, c’est que la parole prend la place de la réalité et l’occulte. Il faut donc renverser, libérer en quelque sorte la parole d’elle-même pour lui redonner son sens, celui d’exprimer la réalité. C’est ce que fait Marx en ramenant la parole à l’être social qui la prononce, à sa vie matérielle et sociale. Allons voir ce film ! (note de Franck Marsal pour Histoireetsociété)
Alors qu’une rétrospective lui est consacrée à la cinémathèque, Christian Petzold nous livre ce très beau film qui semble être le rêve de ses personnages, les deux femmes surtout et leur relation étrange et réparatrice comme la chirurgie du même nom ou l’alchimie des affinités électives.
L e titre du film est emprunté à un morceau de Ravel qui revient en leitmotiv, une scie, pour marquer tout ce qui a été perdu des êtres après le séisme d’une vie, en remplacement des mots et de tout ce qui ne peut même plus être dit tant la souffrance a aboli tout ce qui relie au monde ces quatre individus qu’un accident rapproche par hasard. Il est des films comme de bien des autres productions « culturelles » ou dites telles… pour une bonne part leur réussite dépend non seulement d’un scénario mais d’une écriture. C’est la magie du cinéma. Vive le conte qui nous transforme en enfants crédules et le mélodrame qui fit pleurer Margot… le plaisir et l’écho politique et intellectuel qui fait ricochet sur tout ce qui reste allusif, le paysage, les bruits, les silence et le jeu des acteurs : une énigme non résolue, sans cesse déroutante. Un conte allemand comme ceux de Grimm, d’Hoffmann, avec sa familière étrangeté, une histoire de sorcières et d’enfants égarés.
Durant les premières séquence nous sommes sur la sa surface du miroir, une voiture rouge dans laquelle quatre personnages ont pris place et trois d’entre eux, deux hommes et une femme qui se réjouissent d’un weekend de fête. La quatrième, Laura est totalement absente, sauf à la musique, elle a une oreille absolue tout le reste lui demeure étranger dans cette voiture où elle part en weekend avec son compagnon, le producteur de ce dernier et sa compagne, elle est enfermée dans son mutisme. Laura est inerte, sauf un bref moment où les quatre passent dans leur voiture rouge devant une maison, dans la campagne berlinoise qui fut la RDA. Là une femme, vêtue de noir, peint une clôture en blanc, les deux femmes se happent du regard: le sens a ressurgi un bref instant, mais quand la silhouette sombre a disparu, Laura retombe dans la torpeur, l’impossibilité de participer à ce weekend, elle est malade… Son compagnon accepte de la raccompagner pour qu’elle retourne chez elle à Berlin. A quelques centaines de mètres de là où réside l’étrange femme en noir, la voiture fait un tonneau. Betty, forte et dense, avec des gestes précis et efficaces leur porte secours (Barbara Bauer une très grande actrice qui est assez peu connue en France) … Le compagnon de Laura meurt, on ne voit pas l’accident, le bruit, puis simplement dans le silence des champs aux alentours, des bosquets, le cadavre du jeune homme et le sang de sa tête sur une pierre. Cette mort est sans signification pour Laura comme pour nous, la réalité du film est dans la survie miraculeuse de Laura et dans la manière dont elle s’accroche à cette femme inconnue Betty, qui s’occupe d’elle comme une mère aimante, la recueillant dans sa maison et l’aidant à s’ouvrir au monde.
Peu à peu les deux femmes attirent dans leur orbite le mari et le fils de Betty qui s’étaient éloignés de ce qui nous est laissé entendre être la « folie » de Betty,. La femme en noir, épanouie, chaleureuse est aussi la sorcière, la souffrance incarnée et celle qui peut-être nous impose son rêve. Parce que la mélancolie de Laura n’est jamais élucidée ni pourquoi Laura semble ignorer la situation, alors qu’elle porte les vêtements de la disparue, utilise son vélo, joue sur son piano ? De qui accepte-t-elle d’être la doublure… Tant que les mots ne sont pas dits la fiction dans laquelle chacun trouve son compte peut tisser autour de nous un cocon d’harmonie.
Mais quelqu’un parlera et l’apaisement devient un jeu de dupe. Tout cela est narré sur le monde des contes allemands, Grimm, cette intervention du mythe, du fantastique, d’un rapport primaire à la nature, au cœur de la littérature même chez Heine si proche de Marx le roi des Aulnes, la Lorelei. L’objet y devient un signe, la voiture rouge, la clôture peinte en blanc, le clavecin désaccordé… Et ce signe a d’autant plus de force qu’il intervient dans le silence d’un paysage traversé par le chant des oiseaux, la rareté de la parole des personnages, Betty qui berce l’enfant, la borde, la met au lit et interdit de dire autre chose que le bonheur de partager un repas autour d’une table… En réussissant à subjuguer ses deux hommes prolétaires, qui ne savent que faire, réparer, trafiquer les compteurs des voitures, et fuient toute discussion en se jetant sur le bricolage… Ce sont les exclus de la désindustrialisation de la RDA, parce que nous sommes bien dans l’hinterland de l’ex-RDA, là où les usines sont devenus des garages et les prolétaires cherchent un havre, des gestes, ceux du bricolage pour les petits bourgeois de la ville… Tout est « remplacement », tant qu’on bricole sans dire…
Mais comme le disait Straub et Hulliet « les yeux ne peuvent en tout temps se fermer » même au son d’une chanson, d’une musique qui remplace les mots, quand ce qui ne devait pas être dit est révélé par le fils qui pourtant a du mal à prononcer la moindre explication, tout à coup le miroir de l’eau devient tempête parce que la parole, le concept ne peut que foirer…
Que peut en faire le cinéma ? C’est autour de l’écoute de la musique et des silences de l’image que tout ne s’écroule pas, est-ce bien vrai ? ou Betty a définitivement sombré ? Et l’arrangement de la fin serait non l’acceptation du compromis nécessaire pour vivre ensemble dans ce temps où tout s’écroule en jouant sur la mystérieuse alchimie des « affinités électives » mais en fait ce serait l’ultime illusion, la rupture idéaliste, la folie (comme celle de Lenz) qui en a définitivement terminé avec la réalité ? Le fait est que l’auteur se référant à une lettre d’Heinrich von Kleist raconte un de ces moments si typiquement allemand (je pense en particulier au magnifique cauchemar de Lenz de Buchner), l’auteur du rêve et du récit une nuit à Würzburg ne pouvant trouver le sommeil à cause de la chaleur sort de son logis par une porte dérobée. Il lève les yeux, la porte en pierre est une voute proche de s’écrouler si les pierres ne se retenaient mutuellement dans cette chute. Il n’y a pas de morale mais le constat que c’est quand tout est proche de l’effondrement que se créent les voutes sous lesquelles nous humains, êtres si perdus, si acharnés à vivre, nous pouvons vivre et être même consolés.
Vous n’avez pas besoin de connaitre la littérature allemande, le suicide de Von Kleist, ni vous souvenir du prince de Homburg dans le palais des papes avec Gérard Philippe, pour percevoir le désespoir de tous ceux qui ont raté la révolution française, ni même de ce que fut la fin de la RDA… ni la manière dont les exilés du nazisme se rencontraient à Santa Monica, ce que fut le maccarthysme, et comment à chaque fois, ils tentaient de survivre à l’écroulement y compris de leur langue, de leur univers… Ce savoir-là n’est pas indispensable pour prendre du plaisir au film, il suffit de redevenir un enfant écoutant sa mère lui lire un conte avant de s’endormir. Mais moi, j’ai eu les bombes et la fuite angoissée de mes pères et mères comme un loup au bord de mon berceau, une enfant gibier protégée seulement par l’armée rouge… Mais cela n’aurait pas suffi pour me faire partager le traumatisme allemand, dans ce relatif équilibre du sens que furent les trente glorieuses, il y a l’effondrement du mur de Berlin, mes héros devenus criminels, j’ai passé cinq années après la chute du socialisme à l’est durant lesquels j’ai découvert que les seuls avec qui j’avais un langage commun étaient les antinazis allemands, une fois de plus défaits comme aujourd’hui, des Luthériens foudroyés (1). Et encore aujourd’hui, junge Welt dit ma révolte, que la France mon pays ne peut entendre. Tout cela se confond comme pour Betty avec une plaie qui jamais ne se referme, celle de la mort de l’enfant…
Point n’est besoin vous dis-je d’un tel détour, celui de l’histoire de cette école de Berlin qui un jour nous envoya Good Bye Lénine, et dans le lointain les blasphèmes d’Heiner Muller dans Quartett. Il reste l’éternel Wim Wenders et ses ailes du désir sur Berlin, mais aussi Herzog que s’apprête à fêter la biennale de Venise, nous avons définitivement perdu l’honneur de Katharina Blum et de la Bande à Bader… Vous n’avez pas besoin d’être hanté par cette mémoire-là, le film est exquis, on peut se laisser gagner par la délicatesse du propos, la musique qui dit l’impossibilité d’élucider totalement parce que nous ne sommes pas dieu omniscient comme dans le récit classique mais que nous devons mettre notre entendement fragile au niveau des sens, du paysage, des regards, des gestes, des rares paroles.
Enfin j’y tiens pour en saisir le « message » idéologico-politique, il faudrait que vous acceptiez de connaitre l’école allemande de cinéma, depuis le grand Fritz Lang, la UFA jusqu’à la résurrection des années soixante et dix, puis tous les aléas des écroulements subis dans les années quatre vingt et quatre vingt dix, la résurrection permanente de ce cinéma y compris sous des formes proches de la nouvelle vague, ce qui m’est étranger sauf pour Godard. Cette connaissance du contexte a besoin de connaitre les conditions matérielles d’existence de la « création cinématographique, le langage « international des festivals », de la critique, les tentatives de créer une production indépendante comme Christian Petzold l’a tenté, n’est pas le moins intéressant si l’on en suit la critique telle que la pratiquait Sadoul. Le cinéma est un art et une industrie qui a besoin de capitaux.
Mais il y a encore autre chose, c’est « l’idéologie allemande » qui rend ce film et plus généralement l’école allemande un monde toujours en décalage avec la France. On pense à cet énorme volume à travers lequel Marx et Engels ont pour la première fois défini le matérialisme historique. Parfois on n’en publie que la première partie consacrée à Feuerbach, mais là où vraiment sur un mode polémique Marx et Engels dégagent leur propre dialectique matérialiste de Hegel et de la mauvaise conscience des hégéliens de gauche c’est dans la troisième partie Max Stirner, L’Unique et sa propriété ; Marx s’acharnant sur Stirner en l’appelant “Saint Max”, le comparant à Don Quichotte, et se livrant à une critique presque mot pour mot du livre plus volumineuse que le livre qu’il attaque, plus volumineuse même que l’ensemble de l’œuvre de Stirner. C’est bien ces questions-là aussi que le film prétend régler : que peut la parole devant l’écroulement. quand le prolétariat vit d’expédients et que l’Allemagne se trouve une fois de plus à la croisée des chemins comme le reste de l’Europe.
Marx s’insurge sur la manière dont l’idéologue allemand Max Stirner regrette que la « concurrence » ait mis en cause les biens « consacrés », les biens spirituels « consacrés » qui définiraient l’humanité … Consacrés et garantis par qui ? dit Marx. Par l’homme ou par le « concept », « la vie », ‘la liberté de la personne », « religion », honneur », « décence et pudeur ». Dans le fond c’est tout le travail du film face aux pierres de la voûte, de ce qui s’effondre dans le romantisme allemand, dans quel espace peut-on encore vivre en harmonie entre humains et la nature? « Tous ces « biens consacrés », Steiner « peut bien dans les pays développés les prendre sinon à « l’homme comme tel », mais à coup sûr « aux hommes réels : naturellement, par la voie et selon les règles de la concurrence. Le grand bouleversement de la société opéré par la concurrence, qui a dissous en purs rapports monétaires les relations des bourgeois entre eux et avec les prolétaires, en changeant tous les « biens consacrés » surnommés en article de commerce, en détruisant pour les prolétaires, tous les rapports naturels et traditionnels, familiaux et politiques par exemple de même que toutes leurs superstructures idéologiques – cette formidable révolution, ce n’est évidemment pas de l’Allemagne qu’elle est partie. L’Allemagne y a joué un rôle purement passif, elle a laissé prendre ses biens consacrés, sans même en recevoir le prix courant (Karl Marx œuvre philosophique la pléiade p.1267)
Ce rôle passif face à la mère Allemagne est déjà celui que Brecht attribue aux paysans et soldats entraînés malgré eux dans la guerre de Trente ans. Oui mais il ne faut pas aussi jeter l’enfant avec l’eau du bain, peut-être faut-il voir que le monde est entré dans un tel ébranlement qu’il faut aussi rester disponibles à ce qui oblige à revoir la base d’une reconstruction commune, parce que ce qui se présente nous contraint à tous bouger pour une action commune…
Bref, hier sur la Canebière à Marseille, il y avait un groupe d’Allemands qui tranchait par le volume, taille et carrure, par la rousse blondeur de ses membres sur le tout Marseille basané de cette allée. Une femme blonde aux yeux verts faisait une lecture de textes en allemand, j’ai cru reconnaitre Cristina Wolf, mais je me suis probablement trompée, la Cassandre de RDA est-elle encore une référence ? pas plus qu’Heinrich Mann.. peut-être s’agissait-il de Klaus Mann qui serait plus adapté à la période. J’ai interpellé le groupe en leur demandant s’ils étaient des antifascistes allemands. Ils ont tous approuvé les yeux brillants et quand j’ai salué le tout d’un Wunderbar retentissant ils m’ont regardée avec une intense reconnaissance puisque je leur accordais la rédemption : est-ce que nous sommes proches ? je l’ignore… ce que je sais est que les rares qui savent qu’ils ont été vaincus sont aussi ceux qui méritent d’être au défilé des vainqueurs pour un autre monde pour inventer une relation réparatrice comme la chirurgie du même nom et que le cinéma cela sert à nous le faire sentir…
Danielle Bleitrach
(1) Danielle Bleitrach, avec la collaboration de Richard Gehrke et Nicole Amphoux ; Bertolt Brech et Fritz Lang, le nazisme n’a jamais été éradiqué. Lettmotif 2018
Views: 7