Un texte fondamental à lire et à relire. A la fois passionnant, ultra clair et qui remet la théorie marxiste au coeur du mouvement révolutionnaire. Enfin une base sur laquelle les communistes européens, américains, du Sud global et de l’Orient pourraient construire une lutte commune (note de Marianne Dunlop et traduction de Danielle Bleitrach)

Comment le marxisme occidental transforme la violence coloniale en « théorie de l’histoire » pour sauver l’ordre colonial
Par Prince Kapone | Informations militarisées | 14 décembre 2025
Quand la « théorie de l’histoire » devient un alibi pour l’empire
Cet essai constitue une intervention polémique dans un récent entretien accordé à Jacobin au sociologue Vivek Chibber de l’Université de New York, publié sous forme de transcription d’un épisode de l’émission « Confronting Capitalism ». Dans cet échange, Chibber défend une position marxiste occidentale désormais bien connue : le capitalisme serait né principalement d’une transition agraire interne en Angleterre aux XVe et XVIe siècles ; le pillage colonial n’aurait joué aucun rôle constitutif dans son essor ; et les tentatives contemporaines de lier le développement du capitalisme au colonialisme représenteraient une dérive confuse, empiriquement insoutenable et politiquement réactionnaire vers un « réductionnisme racial ». L’entretien est présenté comme une correction objective d’un argument de gauche prétendument « à la mode », mais ce qui suit n’est pas une clarification neutre. Il s’agit d’un exercice de délimitation idéologique qui restreint le marxisme à une économie politique favorable aux colons, vide l’empire du cœur de l’analyse capitaliste et réhabilite le socialisme anticolonial dans le cadre académique. Ce qui suit est une réfutation systématique de cette ligne, fondée sur le matérialisme historique, l’économie politique anticoloniale et les réalités vécues de la domination impériale.
Jacobin introduit cette conversation sur le ton d’un arbitre qui a déjà désigné le vainqueur. L’animateur nous annonce qu’un argument « à la mode » circule à gauche – selon lequel l’Occident s’est enrichi grâce au pillage colonial – puis tend le micro à Vivek Chibber, qui réagit comme un propriétaire rabrouant ses locataires : « Absurde ! », « Pas la moindre once de vérité ! », « C’est du grand n’importe quoi ! ». Cette introduction n’est pas simplement un style de débat. C’est une posture idéologique. Elle ne commence pas par clarifier les arguments et les enjeux. Elle commence par ridiculiser toute une tradition anticoloniale comme s’il s’agissait d’une mode passagère sur les réseaux sociaux, d’une panique morale, d’un dysfonctionnement de la culture jeune nécessitant l’intervention d’un adulte.
L’information instrumentalisée part d’un point de départ différent : ni des convenances, ni des modes académiques, ni de la mythologie bien-pensante selon laquelle le capitalisme s’expliquerait sans le récit sanglant des conquêtes. Si vous voulez comprendre le capitalisme, vous ne commencez pas dans une salle de séminaire. Vous commencez là où le système a commencé : dans la violente réorganisation des terres, du travail et de la vie – dans la transformation des êtres humains en « mains », des territoires en « propriété » et des continents entiers en mines à ciel ouvert gardées par la loi, les armes et la croix. Et vous ne traitez pas le colonialisme comme une malheureuse digression, comme un chapitre obscur que l’on saute pour arriver au « vrai » récit des fermes anglaises et des incitations du marché. Le colonialisme n’est pas un accessoire de l’histoire capitaliste. C’est l’une des méthodes par lesquelles le monde capitaliste a été construit et maintenu – non pas parce que l’argent est magique, mais parce que le pouvoir est organisé.
Dès le départ, Chibber s’emploie à réduire la question à un simple raccourci, la rendant facile à balayer d’un revers de main. Il veut réduire l’argument à : « le pillage a créé le capitalisme », au sens simpliste où un tas d’or transforme automatiquement un seigneur féodal en capitaliste industriel. Puis il crie victoire sur cette caricature. Soit. On peut admettre que l’argent ne se transforme pas miraculeusement en capital simplement parce qu’il change de mains par le vol. Mais là n’est pas, et n’a jamais été, le cœur du débat anticolonial. L’argument central est que l’essor et la reproduction du capitalisme ont nécessité une construction du monde par la coercition : la séparation forcée des peuples de leurs terres, la fabrication de la dépendance, la création d’un travail discipliné, la construction d’un marché mondial selon les règles impériales et le transfert constant de la valeur du travail colonisé vers l’accumulation métropolitaine. Autrement dit, ce n’est pas « le pillage qui crée les usines », mais « la conquête et la coercition créent les conditions dans lesquelles les usines, les marchés et le salariat deviennent dominants, extensibles et imposés ».
Ce que Jacobin défend ici, ce n’est pas un désaccord technique sur la comptabilité médiévale, mais une frontière politique. Car dès lors qu’on admet que le capitalisme est indissociable de la conquête coloniale et du vol des terres par les colons – dès lors qu’on admet que « l’accumulation primitive » n’est pas une métaphore mais un régime d’expropriation – on est forcé d’affronter des questions dérangeantes que le marxisme occidental a éludées pendant des générations. Des questions comme : qui a profité matériellement de l’organisation coloniale du monde ? Quelles formations de classes ont été stabilisées au sein du noyau impérial par la surexploitation de la périphérie ? Que signifie la « solidarité » lorsque le salaire social et la consommation à bas prix de la métropole ont été historiquement liés au travail non libre, au travail forcé et au travail dépossédé des colonisés ? Et que signifie même le socialisme s’il refuse de rompre avec les rapports de propriété, les frontières et les mythes nationaux forgés par la conquête ?
Voilà pourquoi l’insulte initiale est si importante. Il ne s’agit pas simplement d’arrogance, mais de discipline. L’objectif est de désamorcer l’accusation anticoloniale avant qu’elle ne se transforme en programme. Il s’agit de faire passer l’argument des colonisés pour un moralisme à la mode, afin que le lecteur puisse se sentir « matérialiste » tout en restant politiquement inoffensif – une inoffensivité telle qu’on peut citer Marx avec aisance tout en traitant le monde colonial comme un simple décor. Mais le marxisme, lorsqu’il est vivant, ne sert pas de filtre à la parole pour les radicaux respectables. Il sert d’arme : il nomme l’expropriation, il identifie les forces de classe qui sous-tendent le récit, et il interroge la ligne défendue et ses partisans. Ainsi, avant même d’examiner une à une les affirmations historiques de Chibber, il nous faut nommer l’opération en cours : la transformation du colonialisme de structure en arrière-plan, de violence constitutive en commentaire optionnel, et de question politique vivante en un argument fallacieux « discrédité ».
Section par section, nous allons déconstruire cette conversion. Nous allons sortir cet argument du carcan rassurant que Jacobin lui a construit et le replacer là où il a sa place : dans le monde réel, où la transition vers le capitalisme n’était pas un documentaire anglais bien ficelé sur les marchés apprenant à gouverner la société, mais une guerre mondiale pour la terre, le travail et la souveraineté – une guerre dont les répercussions continuent de déterminer qui mange, qui travaille, qui migre et qui meurt. Et nous allons montrer que la fonction de cette ligne jacobine n’est pas seulement de remporter un débat, mais de rendre le socialisme occidental compatible avec l’ordre colonial en dissolvant la contradiction coloniale dans une « théorie de l’histoire ».
L’homme de paille qui sauve le colon : « L’or n’a pas créé le capitalisme »
On peut désormais analyser objectivement la manœuvre principale de Chibber. Il part d’une critique anticoloniale réelle et sérieuse – l’idée que l’essor de l’Europe est indissociable de la conquête, de l’esclavage et de la construction d’un marché mondial impérial – et la réduit à une formule simpliste : « le pillage a engendré le capitalisme ». Puis il combat cette formule comme si elle détenait la vérité absolue. C’est la plus vieille ruse du répertoire de la gauche bien-pensante : prendre un argument structurel sur le pouvoir, le transformer en une caricature sur l’argent, puis déclarer cette caricature vaincue. Le public repart avec l’impression d’avoir assisté à une démolition matérialiste radicale, alors qu’en réalité, il a assisté à un exorcisme politique : l’éviction du colonialisme du cœur du récit capitaliste, afin que ce dernier puisse retrouver son confortable foyer européen.
Examinons de près la manière dont il présente Marx. Il affirme que les remarques de Marx sur le vol et le pillage colonial dans les chapitres consacrés à l’accumulation primitive étaient une « stratagème rhétorique », voire une « erreur rhétorique », une digression qui aurait induit le lecteur en erreur en le conduisant à un argument que Marx aurait soi-disant passé les chapitres suivants à réfuter. Il ne s’agit pas d’une simple divergence d’interprétation ; c’est une réduction délibérée de la portée historique de Marx. Marx ne se livre pas à un sermon sur la question de savoir si le premier capitaliste était frugal ou criminel. Il retrace la naissance d’un nouvel ordre social par la coercition, le droit, la violence d’État et l’expropriation – la séparation des producteurs et des conditions de production – et montre comment cette séparation n’est pas un événement privé, mais un processus d’envergure historique mondiale. Lorsque Chibber qualifie l’accent mis par Marx sur le colonialisme d’erreur rhétorique, il ne corrige pas Marx lui-même, mais les implications politiques de sa pensée.
Voici la version honnête du débat, en termes simples. Personne de sérieux ne prétend qu’une cargaison d’argent transforme automatiquement un seigneur féodal en capitaliste, comme dans un conte de fées où l’argent embrasse la grenouille du féodalisme et fait surgir le prince de l’industrie. L’argent n’est pas un moteur en soi. Il ne devient capital que dans un ordre social qui encourage et récompense l’accumulation, la concurrence et l’expansion. Soit. Mais ce que Chibber refuse d’aborder, c’est la manière dont cet ordre social s’est construit, s’est stabilisé et s’est mondialisé. Il veut cantonner la violence à un contexte local et limiter l’explication : les enclosures ici, la dépendance au marché là, et le reste du monde comme simple décor. Or, le capitalisme ne s’est pas développé en Angleterre comme une plante poussant dans une serre hermétique. Il s’est imposé comme un système de construction coercitive du monde, un système qui a engendré une « dépendance au marché » non seulement en chassant les paysans des terres anglaises, mais aussi en chassant des peuples entiers de leurs terres, en brisant la reproduction communautaire et en forçant les colonisés à entrer dans les circuits de l’empire par le biais des impôts, des monopoles, des régimes de travail forcé et du « commerce » des canonnières.
L’argument marxiste anticolonial, correctement formulé, est structurel et relationnel : la transition et l’expansion du capitalisme sont indissociables de la construction violente d’un marché mondial et du transfert systématique de la valeur du travail et des terres colonisées vers l’accumulation métropolitaine. Il ne s’agit pas d’un slogan moral, mais d’économie politique. Le système esclavagiste atlantique n’est pas un triste épisode marginal ; c’est un régime de travail qui a généré des marchandises, des profits et des capacités étatiques à une échelle qui a remodelé les possibilités d’accumulation de la métropole et bâti l’infrastructure de la finance, du transport maritime, des assurances et de l’industrie modernes. Le vol des terres par les colons n’est pas une « brutalité précapitaliste » ; c’est la création d’une base foncière gigantesque, d’une frontière des ressources et d’un ordre racial de contrôle du travail qui devient un socle durable pour le développement capitaliste. L’impérialisme n’est pas la suite logique qui commence à la fin du XIXe siècle ; c’est le prolongement et la maturation de cette même logique coercitive par laquelle le capital s’assure le contrôle du travail, des ressources et des marchés lorsque le « libre échange » s’avère insuffisant.
Chibber tente d’éluder cette question en insistant sur le fait que le véritable secret réside dans la « dépendance au marché », que le capitalisme naît lorsque les individus sont contraints de rivaliser pour survivre. Soit. Admettons cette définition. Dès lors, la question se pose : par quels moyens, et à quelle échelle, cette dépendance a-t-elle été fabriquée ? Et dès lors qu’on pose cette question honnêtement, sa distinction simpliste s’effondre. Car la dépendance au marché n’a pas été créée par les seuls propriétaires terriens anglais ; elle a été imposée par les États impériaux. Elle a été imposée par les enclosures et les lois sur le vagabondage en Angleterre, certes, mais aussi par la conquête, la dépossession, l’esclavage, l’engagement sous contrat, la culture forcée, les systèmes de tribut, les traités inégaux et la fiscalité coloniale à l’étranger. Le fouet et le contrat ne sont pas des opposés dans cette histoire ; ils sont complémentaires. Le capital ne se contente pas de « découvrir » les marchés. Il brise les sociétés jusqu’à ce que les marchés deviennent incontournables. Et c’est dans le monde colonisé que cette destruction a souvent été la plus directe, la plus brutale et la plus révélatrice.
C’est pourquoi l’exemple espagnol-portugais, que Chibber brandit comme un marteau, n’atteint pas son but. Même si l’or n’a pas transformé les rapports de classes ibériques en un capitalisme agraire à l’anglaise, il n’en découle pas que l’extraction coloniale ait été sans importance dans l’essor du capitalisme comme système mondial. Cela montre simplement que le pillage peut être absorbé et détourné au sein de structures de classes particulières – qu’un ordre féodal-rentier peut dilapider ses richesses en guerres, en quête de luxe et en stagnation. Mais le système ne s’arrête pas aux frontières nationales. La question n’est pas de savoir si les richesses ont « fait de l’Espagne une nation capitaliste », mais comment la restructuration impériale du commerce, des prix, des finances publiques, des capacités de guerre et des circuits mondiaux des matières premières a créé les conditions permettant à certaines formations capitalistes de se consolider puis de dominer. La méthode de Chibber consiste à traiter les pays comme des vases clos et à reléguer l’économie mondiale au second plan. Ce n’est pas du matérialisme. C’est du nationalisme méthodologique déguisé en rigueur.
Il nous faut affirmer clairement ce qui se joue politiquement lorsque Jacobin fixe les conditions de cette manière. L’homme de paille n’est pas innocent. Il sert de prétexte. Si l’argument anticolonial se réduit à « l’or a créé le capitalisme », la seule réaction « adulte » consiste à lever les yeux au ciel et à revenir à un récit où les transformations de classes internes à l’Europe constituent l’événement principal et où le colonialisme n’est, au mieux, qu’une tache morale. Ce récit engendre un socialisme qui peut rester fidèle au bon sens des colons : oui, le capitalisme est mauvais, mais la contradiction coloniale n’est pas fondamentale ; oui, les travailleurs souffrent, mais l’empire n’est pas une structure vivante qui façonne le paysage social ; oui, l’histoire a été violente, mais la violence n’est pas l’architecture du présent. Autrement dit : un socialisme qui critique le capital tout en laissant largement intact l’ordre impérial de la propriété.
Notre tâche consiste donc à rétablir le véritable argument que Chibber tente d’occulter. Le débat ne porte pas sur la capacité de l’argent, à lui seul, à créer le capitalisme. Il porte sur la possibilité de décrire fidèlement la « structure économique » du capitalisme sans mettre l’accent sur la fabrication coloniale de la propriété, du travail et de la dépendance à l’échelle mondiale. Chibber souhaite que le colonialisme soit ou bien négligeable, ou bien simplement accessoire — un phénomène que l’on pourrait qualifier d’« abomination » et ensuite poliment passer sous silence. Weaponized Information affirme le contraire : le colonialisme et la conquête par les peuples ne sont pas seulement des crimes commis parallèlement au capitalisme ; ils font partie intégrante des processus matériels par lesquels le capitalisme a été construit, étendu et défendu, et ils demeurent profondément ancrés dans la manière dont la valeur est captée, dont le travail est discipliné et dont le noyau impérial se reproduit aujourd’hui.
L’Angleterre n’était pas une île : comment les mythes de la « transition interne » dissimulent l’empire.
Après avoir réduit l’argument anticolonial à un homme de paille, Chibber avance son argument principal : l’Angleterre est devenue capitaliste avant de posséder un empire, donc le colonialisme ne peut être considéré comme constitutif de l’essor du capitalisme. L’Espagne et le Portugal ont eu des empires et ont stagné ; l’Angleterre, sans empire, a connu une croissance fulgurante. Affaire classée. Cela est présenté comme une évidence empirique implacable. En réalité, il s’agit d’une manipulation historique qui repose sur des omissions délibérées, une chronologie sélective et un refus de théoriser l’empire comme un système plutôt que comme un drapeau planté sur un territoire lointain.
Commençons par la falsification la plus flagrante. L’Angleterre ne s’est pas développée dans un splendide isolement, inventant patiemment le capitalisme tandis que le reste du monde évoluait ailleurs. Bien avant l’empire formel des XVIIIe et XIXe siècles, l’Angleterre était déjà une puissance coloniale dans les faits. L’Irlande lui servait de laboratoire. La conquête violente, la mise en place de plantations, l’accaparement des terres et la manipulation démographique imposées à l’Irlande n’étaient pas des épisodes marginaux ; il s’agissait de répétitions générales. Les techniques d’enclosure, de droit de propriété, de dépendance forcée au marché et de contre-insurrection y furent perfectionnées avant d’être exportées. Narrer la transition de l’Angleterre en faisant abstraction de l’Irlande n’est pas une simplification innocente. C’est une manœuvre coloniale : effacer la colonie pour que la métropole puisse apparaître comme une puissance autogérée.
Il en va de même pour l’intégration précoce de l’Angleterre au système atlantique. La piraterie, la course, la traite négrière, les compagnies à charte et la guerre navale n’étaient pas des luxes tardifs de l’empire ; il s’agissait de pratiques constitutives par lesquelles l’État anglais a appris à conjuguer accumulation et coercition. Capital marchand, violence d’État et pillage outre-mer étaient déjà intimement liés au déroulement de la transformation agraire anglaise. L’idée que le capitalisme anglais soit né « avant l’empire » n’est valable que si l’empire est défini de manière restrictive comme une possession territoriale formelle plutôt que comme un mode d’expropriation organisée s’exerçant par le biais de monopoles commerciaux, de marchés aux esclaves, de guerres et d’expansion des colonies. Cette définition n’est pas rigoureuse sur le plan historique. Elle relève d’une hygiène idéologique.
L’exemple espagnol-portugais de Chibber s’effondre sous le même examen. Il traite chaque pays comme un récipient hermétique, comme si le capitalisme était une expérience de chimie nationale dont les résultats seraient comparables en maintenant tous les autres facteurs constants. Or, le capitalisme n’est pas né d’une série d’expériences nationales. Il est né comme un système mondial. Les flux de métaux précieux ibériques ont remodelé les structures de prix européennes, les finances publiques, la compétition militaire et les circuits commerciaux à travers le continent. Même si la structure de classes interne de l’Espagne a canalisé cette richesse vers la guerre, la rente et la stagnation, les effets ne se sont pas arrêtés aux Pyrénées. Le développement capitaliste ailleurs s’est nourri de ces bouleversements. Dire « L’Espagne a stagné, donc le pillage n’a aucune importance » revient à dire qu’un incendie n’a pas entraîné la croissance d’une ville parce que les cendres se sont déposées de manière inégale.
Plus fondamentalement, l’argumentation de Chibber repose entièrement sur l’isolation de la « transition » en un événement agraire purement interne. Les enclosures contraignent les paysans à se tourner vers le marché ; la dépendance au marché engendre la concurrence ; la concurrence stimule la productivité. Point final. Mais ce récit s’effondre dès lors qu’on s’interroge sur la manière dont ce marché a été maintenu, étendu et stabilisé. Un marché n’est pas une horloge qui se remonte toute seule. Il requiert une demande, des intrants, des débouchés et une application rigoureuse de la loi. La conquête coloniale a fourni ces quatre éléments. Les colonies ont fourni la terre, la main-d’œuvre, les matières premières et des marchés captifs. Elles ont absorbé les surplus de production, discipliné la main-d’œuvre par la terreur raciale et généré des superprofits qui ont alimenté l’accumulation. La classe ouvrière anglaise n’a pas affronté le capitalisme dans un système isolé. Elle s’est confrontée à un système qui s’étendait déjà vers l’extérieur, qui se nourrissait déjà de la violence coloniale, qui construisait déjà un marché mondial dont le centre de gravité se situait en Europe, mais dont la vitalité provenait d’ailleurs.
C’est là que l’invocation par Chibber de la « dépendance au marché » se retourne contre lui. Il insiste sur le fait que le capitalisme naît lorsque les individus n’ont d’autre choix que de vendre leur force de travail pour survivre. Certes. Mais comment cette situation s’est-elle reproduite au-delà des frontières anglaises ? Comment des millions de personnes en Afrique, en Asie et dans les Amériques ont-elles été rendues dépendantes de marchés qu’elles ne contrôlaient pas ? Par le biais d’impôts payables uniquement en monnaie coloniale, par la culture forcée de produits d’exportation, par la destruction des systèmes fonciers communautaires, par l’esclavage et le serment d’engagement, par la force et la brutalité. La dépendance au marché ne s’est pas propagée pacifiquement depuis l’Angleterre comme des ondulations à la surface d’un étang. Elle a été imposée, de manière inégale et violente, par le pouvoir impérial. La qualifier de « supplémentaire » au cœur même du capitalisme revient à confondre géographie et structure.
Chibber voudrait nous faire croire que, puisque les rapports de classes agraires en Angleterre ont évolué en premier, l’empire est forcément secondaire. Or, chronologie n’est pas causalité, et priorité n’est pas synonyme de pureté. La transformation interne du capitalisme et son expansion externe n’étaient pas des chapitres successifs d’un manuel ; il s’agissait de processus qui se renforçaient mutuellement. Les enclosures en Angleterre ont produit un surplus de main-d’œuvre ; les colonies ont absorbé les surplus de biens et de capitaux ; les profits coloniaux ont renforcé l’État ; l’État a imposé les rapports de propriété ; et le cycle s’est intensifié. Déconstruire ces éléments et les classer comme « essentiels » ou « accessoires » n’est pas une analyse matérialiste. C’est un choix politique : quelles violences sont fondamentales et lesquelles peuvent être considérées comme des conséquences malheureuses ?
C’est là que l’analyse du colonialisme de peuplement devient incontournable, et que le marxisme occidental commence à s’inquiéter. Le colonialisme de peuplement n’est pas seulement une extraction ; c’est un remplacement. Il crée des régimes de propriété durables, des hiérarchies raciales du travail et un contrôle territorial qui ancrent l’accumulation capitaliste pendant des siècles. La transition de l’Angleterre ne peut être comprise sans reconnaître que le même pouvoir d’État qui a asservi les paysans a également conquis des terres, expulsé des peuples et construit un ordre mondial du travail racialisé. L’« intérieur » et l’« extérieur » ne sont pas des sphères séparées. Ce sont les deux faces d’un même projet de classe.
L’affirmation selon laquelle l’Angleterre « connaissait le capitalisme avant l’empire » n’est donc pas une constatation empirique neutre. Il s’agit d’un rempart narratif. Sa fonction est de préserver une version du marxisme qui peut critiquer les propriétaires terriens sans inculper les colons, analyser les classes sociales sans s’attaquer à la propriété coloniale, et imaginer le socialisme émergeant du cœur impérial sans remettre en question les structures qui ont rendu ce cœur possible. L’information instrumentalisée rejette ce rempart. Le capitalisme n’est pas né en Angleterre pour ensuite se répandre accidentellement dans le monde. Il a été forgé par la conquête et le mouvement des enclosures, stabilisé par le colonialisme de peuplement et l’esclavage, et étendu par la domination impériale. Toute explication qui dissocie ces processus n’éclaire pas les origines du capitalisme ; elle les édulcore.
« Consensus », eurocentrisme et l’art de clore le débat
À ce stade de son argumentation, Chibber brandit l’arme académique ultime : le consensus. On nous affirme que la question des origines du capitalisme est réglée, que les données sont là, que les historiens de l’économie sérieux s’accordent à dire que l’Angleterre et les Pays-Bas ont divergé en premier, et que quiconque persiste à considérer le colonialisme comme constitutif est soit dans l’erreur, soit idéologique, soit flirte avec un « eurocentrisme » inversé. Il ne s’agit pas d’une analyse, mais d’une autorité qui s’exprime au passif. « Il existe une abondante littérature sur le sujet. » « Il existe un consensus fort. » Traduction : arrêtez de poser les mauvaises questions.
Mais le consensus n’est pas la vérité, et encore moins l’innocence. Tout consensus se construit en décidant quelles questions sont légitimes et lesquelles sont écartées comme parasites. Le consensus du marxisme politique repose sur une exclusion préalable : les relations coloniales sont considérées comme extérieures au « véritable » récit de la transition. Une fois cette frontière tracée, il devient facile de crier victoire. La transformation agraire de l’Angleterre expliquerait le capitalisme ; l’empire, autre chose. Le problème n’est pas que la transition agraire anglaise n’ait pas eu lieu. Le problème est que ce cadre d’analyse transforme un système historique mondial en un conte moral national, puis s’auto-congratule de sa rigueur méthodologique.
Lorsque Chibber se moque de l’accusation d’eurocentrisme, il la définit délibérément de manière erronée. L’eurocentrisme ne consiste pas à « situer un événement en Europe lorsqu’il s’y est produit ». L’eurocentrisme consiste à considérer l’Europe comme un moteur autonome de l’histoire, tandis que le reste du monde n’apparaît que comme un arrière-plan, un réservoir de ressources ou un récepteur passif. Il s’agit de présenter le capitalisme comme si l’Europe s’était développée en premier, puis avait interagi avec le reste du monde, plutôt que comme un système ayant émergé par la coercition, la conquête et la réorganisation à l’échelle mondiale. On peut reconnaître la divergence initiale de l’Angleterre tout en restant eurocentrique si l’on considère cette divergence comme suffisante en elle-même et analytiquement complète.
La manipulation est subtile mais décisive. Chibber pose la question suivante : existait-il ailleurs, avant l’Angleterre, un système capitaliste identifiable ? Si ce n’est pas le cas, situer l’origine du capitalisme en Angleterre ne saurait être eurocentrique. Mais cela déplace le débat de la structure à la chronologie. L’argument anticolonial n’est pas que la Chine ou l’Inde possédaient des usines identiques à celles du Lancashire en 1500. Il est que la trajectoire capitaliste de l’Europe ne peut s’expliquer sans l’incorporation violente du reste du monde dans un système hiérarchique d’extraction de valeur. Le capitalisme n’a pas besoin de formes identiques partout pour être constitutif. Il requiert des relations asymétriques. Il requiert des centres et des périphéries. Il requiert des zones de main-d’œuvre bon marché, de travail forcé et de terres volées. Nier cela, ce n’est pas défendre le matérialisme ; c’est le mutiler.
Le discours de Chibber sur le taux de croissance poursuit le même objectif idéologique. L’Angleterre connaît une croissance fulgurante ; l’Asie et le reste de l’Europe sont à la traîne ; ainsi, le capitalisme est expliqué. Or, les courbes de croissance ne s’expliquent pas d’elles-mêmes. Elles décrivent des résultats, non des causes. Ce qu’elles occultent, c’est la manière dont ces courbes ont été produites et maintenues. La croissance « explosive » de l’Angleterre ne s’est pas produite en vase clos. Elle a coïncidé avec la consolidation de l’esclavage atlantique, l’expansion des colonies, la militarisation des routes commerciales et la soumission de vastes populations au pouvoir impérial. Ces éléments n’étaient pas fortuits. Ils constituaient le contexte mondial qui a permis à la croissance de se poursuivre au lieu de s’enrayer sous le poids de ses propres contradictions.
C’est là que les Patnaik, Samir Amin, Hosea Jaffe et John Smith deviennent indispensables – et que le cadre théorique de Chibber s’effondre. La croissance du capitalisme a nécessité des mécanismes pour gérer la demande, s’assurer des intrants bon marché et extraire la plus-value au-delà des frontières nationales. L’impérialisme n’est pas une conséquence du succès du capitalisme ; c’est une solution à ses limites internes. En considérant les relations impériales comme une option analytique, le marxisme politique finit par expliquer le décollage initial, mais laisse la domination à long terme inexpliquée. Il peut expliquer comment le moteur a démarré, mais pas comment il a continué à fonctionner sans s’autodétruire.
L’appel au consensus remplit également une fonction disciplinaire au sein de la gauche. Il signifie aux militants, aux organisateurs et aux intellectuels colonisés que le débat est clos, que l’insistance anticoloniale est anachronique et que le seul marxisme respectable est celui qui se cantonne à l’histoire agraire européenne. Ce n’est pas un hasard. Un marxisme qui relègue l’empire au second plan peut se concentrer sans risque sur la redistribution au sein de son noyau, sur les États-providence et la social-démocratie, sans remettre en question les rapports de propriété impériaux qui rendent ces projets possibles. Un marxisme qui place le colonialisme au centre du débat aboutit à une conclusion différente : le socialisme ne peut être national, colonial ou à l’abri de la lutte mondiale contre la domination impériale.
Ainsi, lorsque Chibber qualifie l’accusation d’eurocentrisme d’« absurde », il affirme en réalité que les règles du jeu sont déjà établies, et ce, de manière à protéger la gauche occidentale d’une remise en question plus profonde. L’information instrumentalisée rejette ce confort. La question n’est pas de savoir si l’Angleterre a divergé en premier. La question est de savoir si le capitalisme, en tant que système qui domine aujourd’hui la planète, peut s’expliquer sans considérer la conquête coloniale, l’esclavage et la hiérarchie impériale comme des structures fondatrices. Tout consensus qui répond « oui » à cette question n’est pas neutre. Il s’agit d’un acte politique.
Et ce travail politique a des conséquences. Il engendre un socialisme capable de critiquer le capital tout en restant muet sur le vol des terres, les frontières et l’impérialisme. Il produit une théorie lisible dans les revues occidentales, mais inutilisable pour les masses colonisées qui subissent au quotidien les conséquences de « l’accumulation primitive ». Aujourd’hui, nous dénonçons cette opération, non pour remporter un débat académique, mais pour préparer le terrain à un marxisme enfin à la hauteur du monde que le capitalisme a réellement façonné.
De l’économie politique à la panique morale : comment le « réductionnisme racial » remplace l’analyse
Après avoir réduit le capitalisme à une transition agraire anglaise et l’avoir isolée de l’empire, Chibber opère son revirement politique le plus radical. Il affirme que le retour des explications coloniales n’est pas motivé par des preuves ou l’histoire, mais par une dérive vers le « réductionnisme racial », par le discours sur la « suprématie blanche mondiale », par une gauche qui aurait soi-disant abandonné la question de classe au profit de l’identité. Ce n’est pas une simple digression : c’est la pierre angulaire idéologique de toute son argumentation. Une fois l’analyse coloniale reformulée en moralisme racial, elle peut être rejetée sans même s’intéresser à ses fondements matériels.
Mais les faits historiques ne corroborent pas cette caricature. Le marxisme anticolonial n’est pas né d’une indignation morale face à la suprématie blanche. Il a émergé de luttes concrètes pour la terre, le travail et la souveraineté. Nkrumah ne théorisait pas l’« identité » ; il analysait comment l’indépendance politique sans contrôle économique reproduit la dépendance. Rodney ne recensait pas les fautes morales ; il montrait comment le développement de l’Europe était matériellement lié au sous-développement de l’Afrique. Amin ne faisait pas allusion à la race ; il décrivait un système mondial structuré par des échanges inégaux. Ces analyses se sont forgées dans la confrontation avec l’administration coloniale, les régimes de travail forcé, la coercition liée aux cultures de rente et la violence d’État impériale. Elles s’appuient sur l’économie politique, et non sur la confession de foi.
L’accusation de Chibber ne tient que parce qu’elle confond nation, race et classe en un seul concept confus, puis qu’elle en impute la responsabilité à ses adversaires. Le discours anticolonial ne prétend pas que l’exploitation est due à la couleur blanche des Européens. Il affirme plutôt que le capitalisme s’est développé au sein d’un ordre mondial colonial où la racialisation est devenue un instrument de contrôle du travail, de légitimation de la propriété et de domination politique. La race n’est pas la cause, mais l’instrument. Reconnaître cela ne revient pas à renoncer à l’analyse de classe, mais à préciser comment la domination de classe s’est concrètement opérée à l’échelle mondiale, façonnée par la conquête et la colonisation.
Il est essentiel de comprendre la séquence historique concrète. Dans les colonies de peuplement, les terres furent accaparées et les populations déplacées ou anéanties afin de créer un territoire propice à l’accumulation. Dans les plantations, le travail forcé des esclaves et des semi-esclaves générait des produits d’exportation sous des régimes de coercition absolue. Dans les sociétés agraires colonisées, les impôts payables uniquement en monnaie coloniale contraignirent les paysans à la dépendance du marché et au salariat. Ces processus furent organisés par les États impériaux et justifiés par des idéologies raciales, mais ils étaient dictés par les impératifs de l’accumulation. Qualifier cela de « réductionnisme racial » revient à inverser la causalité et à occulter les mécanismes qui ont produit la race et la classe sous leurs formes modernes.
Ce qui disparaît dans l’analyse de Chibber, c’est la question de l’incorporation. Le capitalisme ne s’est pas contenté d’exploiter la main-d’œuvre colonisée à l’étranger tout en laissant la métropole intacte. Il a également réorganisé les rapports de classe au sein même de ces métropoles. L’accès des colons à la terre, les superprofits impériaux et les matières premières bon marché ont remodelé l’économie politique de l’Europe et de l’Amérique du Nord, modifiant les structures salariales, les modes de consommation et l’équilibre des forces de classe. Il ne s’agit pas d’affirmer que tous les travailleurs des métropoles étaient uniformément privilégiés, ni que la lutte des classes a disparu. Il s’agit d’affirmer que le terrain de cette lutte était conditionné par les rapports impériaux. Ignorer ce conditionnement ne préserve pas l’analyse de classe ; cela l’appauvrit.
L’accusation de « réductionnisme racial » remplit également une fonction prospective. Elle délégitime les luttes contemporaines qui ciblent les frontières, le vol de terres, le contrôle carcéral et le militarisme impérial en les présentant comme des distractions par rapport aux « véritables » luttes de classe. Or, ces institutions ne sont pas des vestiges culturels ; ce sont des mécanismes par lesquels la dépendance au marché est aujourd’hui imposée. Les régimes migratoires encadrent le travail à l’échelle mondiale. L’endettement et l’austérité reproduisent la dépossession dans le monde postcolonial. Les forces de police militarisées et les prisons gèrent les populations excédentaires au sein des pays centraux. Traiter ces mécanismes comme secondaires par rapport à un rapport salarial abstrait, c’est confondre la forme superficielle de l’exploitation avec sa structure globale.
Historiquement, la gauche a déjà été confrontée à cette manœuvre. Chaque fois que des peuples colonisés ou opprimés insistent sur l’importance de leur situation spécifique – que la terre, la nation et le pouvoir d’État ne sont pas interchangeables avec les rapports de production – une frange de la gauche métropolitaine les accuse de régionalisme, de nationalisme, voire, aujourd’hui, de racisme. Cette accusation sert à recentrer la théorie dans la métropole et à réaffirmer un universalisme qui érige tacitement les conditions impériales en norme. Ce qui est présenté comme une défense de la classe est, en réalité, la défense d’une position de classe particulière au sein du système mondial.
Une analyse matérialiste concrète mène ailleurs. Elle montre que le développement du capitalisme a nécessité des formes différenciées de coercition selon les territoires ; que la racialisation a historiquement joué un rôle fonctionnel dans cette différenciation ; et que la lutte des classes s’est toujours déroulée au sein de ces inégalités structurées. Énoncer ces faits ne revient pas à substituer la race à la classe. Il s’agit de refuser une abstraction simpliste qui traite les paysans anglais, les Africains réduits en esclavage, les agriculteurs colonisés et les ouvriers agricoles comme des unités interchangeables dans un récit de transition schématique unique.
La véritable question n’est donc pas de savoir pourquoi certains parlent trop de race, mais pourquoi un certain marxisme s’obstine à considérer l’empire comme un facteur extérieur perturbateur plutôt que comme un principe organisateur. La réponse de Chibber consiste à moraliser le problème et à le qualifier de déviation. Weaponized Information prône une approche différente : revenir à l’histoire concrète de la manière dont le capitalisme a réellement organisé le travail, la terre et le pouvoir à l’échelle mondiale, et laisser la théorie répondre à cette réalité au lieu de la contrôler. Il ne s’agit pas de politique identitaire, mais d’un matérialisme lucide.
Quand la métropole dévore le monde : transfert de valeurs impériales et reproduction de la paix de classe « domestique »
Chibber tente de clore la controverse en concédant un point moral tout en rejetant l’aspect matériel. Le colonialisme, dit-il, était « une abomination », motivé par des « incitations matérielles ». Soit. Puis il tranche : on peut l’admettre, mais on ne peut affirmer que le capitalisme occidental est né du pillage, et encore moins que l’Occident se maintient riche grâce à l’exploitation continue du Sud. C’est là que le débat cesse d’être une discussion médiévale sur l’Angleterre pour devenir une question d’économie politique moderne : quels sont les mécanismes matériels de reproduction de la richesse au cœur de l’empire, et comment ces mécanismes sont-ils liés à l’organisation du travail, de la production et des échanges à l’échelle mondiale ?
Les conditions historiques concrètes de l’ère moderne ne permettent pas la séparation nette que souhaite Chibber. À partir du XIXe siècle, le capitalisme n’est plus un simple système national ponctué d’aventures occasionnelles outre-mer. C’est un marché mondial organisé par la puissance impériale. Le centre ne se contente pas de « commercer » avec la périphérie ; il structure les conditions de production, de prix, de finance et de politique étatique. L’administration coloniale et, plus tard, le néocolonialisme n’étaient pas des crimes ponctuels. Il s’agissait de dispositifs institutionnels garantissant à la périphérie un approvisionnement en main-d’œuvre bon marché, en matières premières à bas prix et en biens stratégiques, tout en limitant sa capacité à s’industrialiser, à contrôler les flux de capitaux et à définir ses priorités de développement souveraines.
Il ne s’agit pas d’un slogan sur le « pillage ». Il s’agit de l’architecture historique des échanges inégaux et de la hiérarchie mondiale du travail. La valeur est captée non seulement là où elle est produite, mais aussi là où elle est réalisée, tarifée, financée, assurée, transportée et monopolisée. Lorsque la production est géographiquement dispersée mais contrôlée par la planification d’entreprise, la propriété intellectuelle, les règles commerciales et le pouvoir financier, le surplus généré par les travailleurs en périphérie ne reste pas là où ils vivent. Il est approprié par la structure du marché mondial. Ce n’est pas une affirmation mystique ; c’est ainsi que fonctionnent concrètement les chaînes d’approvisionnement modernes et le contrôle monopolistique : les segments à forte intensité de main-d’œuvre et à bas salaires sont externalisés vers le Sud, tandis que les activités à forte marge sont concentrées au centre.
L’histoire le démontre clairement. Sous le régime colonial, de vastes régions furent réorganisées autour d’économies d’exportation, contraintes à la dépendance aux cultures de rente et privées de toute autonomie industrielle. Après la décolonisation officielle, les mécanismes changèrent de forme mais non de fonction : les régimes d’endettement, l’ajustement structurel, les conditionnalités commerciales, les hiérarchies monétaires, l’intimidation militaire et les alliances de classe compradores perpétuèrent un modèle où la périphérie demeure un réservoir de main-d’œuvre et de ressources bon marché. L’accumulation « avancée » du centre impérial est indissociable de ce système car elle contribue sans cesse à réduire les coûts de production, à étendre le champ de l’exploitation et à écouler les capitaux excédentaires.
C’est ici que la question du compromis de classe « intérieur » se concrétise. Au cœur du système économique national, le salaire social, les biens de consommation bon marché et les périodes de stabilité relative n’ont jamais été le fruit de la seule productivité nationale. Ils étaient également conditionnés par une division internationale du travail où les régions colonisées et dépendantes subissaient une part disproportionnée de coercition, de répression et de misère. Cela ne signifie pas pour autant que les travailleurs du centre vivaient confortablement ou que la lutte des classes était une fiction. Cela signifie que le rapport de forces et le terrain matériel de la lutte étaient façonnés par les relations impériales. Lorsque des matières premières bon marché affluent grâce à une main-d’œuvre surexploitée à l’étranger, le capital se trouve en mesure de gérer les salaires et de maintenir la stabilité politique sans perdre le contrôle. Lorsque des superprofits sont possibles grâce à l’extraction outre-mer et aux avantages monopolistiques, les réformes deviennent plus abordables et la paix sociale plus accessible.
L’affirmation de Chibber selon laquelle « le Nord global exploite collectivement le Sud global » est « empiriquement erronée » repose sur une vision réductrice de l’exploitation : la coercition directe d’un État colonial, le vol manifeste de métaux précieux, l’image littérale d’un conquistador et de son coffre rempli d’or. Or, le capitalisme est bien plus complexe que cette caricature qu’il cherche à réfuter. Ses mécanismes modernes sont structurels : pouvoir de fixation des prix, domination financière, inégalité des rapports de force, contrôle des technologies et des marchés par les entreprises, et application politique de ces arrangements par le biais de sanctions, de coups d’État et, si nécessaire, de pressions militaires. La question n’est pas de savoir si chaque travailleur occidental reçoit un chèque de dividendes estampillé « impérialisme ». La question est de savoir si la reproduction de l’accumulation au cœur du système est conditionnée par un transfert systématique de valeur depuis la périphérie. Sur ce point, les données historiques convergent : oui.
Il existe également une contradiction plus profonde dans le cadre d’analyse de Chibber lui-même. Il reconnaît que le capitalisme cherche constamment à étendre la marchandisation et que les luttes pour la démarchandisation – l’État-providence, les droits sociaux, l’accès aux biens de première nécessité en dehors du marché – demeurent centrales. Or, dans l’histoire réelle du capitalisme, la capacité à tolérer une démarchandisation partielle au sein du centre a souvent été liée à la marchandisation et à la coercition continues de la périphérie. Autrement dit, le système impérial mondial n’enrichit pas seulement « quelques capitalistes ». Il contribue à structurer les conditions dans lesquelles le capital peut négocier, concéder et se replier au sein du centre tout en poursuivant son expansion mondiale. Les réformes intérieures ont été maintes fois obtenues par la domination extérieure. Il ne s’agit pas d’une condamnation morale, mais d’un constat historique.
Une fois ce principe assimilé, la fonction de la ligne jacobine apparaît plus clairement. Si l’extraction coloniale est considérée comme historiquement brutale mais structurellement secondaire, alors le socialisme peut être envisagé comme un projet de redistribution purement interne au cœur de l’empire : organiser les travailleurs, taxer les riches, étendre l’État-providence et appréhender le système mondial comme une préoccupation humanitaire plutôt que comme une relation économique constitutive. Ce n’est pas un hasard. C’est l’utilité de classe et de nation de ce cadre. Il produit une politique qui peut être radicale au sein de la métropole tout en restant vague, prudente, voire évasive quant aux mécanismes impériaux qui façonnent la métropole telle qu’elle est.
Weaponized Information prône un matérialisme plus strict. Le capitalisme se reproduit à travers une hiérarchie mondiale du travail et de la captation de la valeur. Le terrain de classe « national » au sein du centre est indissociable de la structure internationale d’exploitation et de dépendance. Rompre ce lien ne permet pas d’obtenir un marxisme plus lucide. On aboutit à un marxisme incapable d’expliquer pourquoi la périphérie demeure systématiquement contrainte, pourquoi la coercition s’y concentre sans cesse et pourquoi le centre conserve un avantage structurel malgré ses prédications en faveur du libre marché. Dans la section suivante, nous examinerons concrètement comment le pouvoir d’État, les frontières, les régimes de travail et la contre-insurrection imposent ce système mondial dans la pratique, y compris au sein même du noyau impérial.
L’État n’est pas un arbitre : coercition, frontières et application de la réalité capitaliste
Pour achever la démolition du paradigme de Chibber, il nous faut affronter ce que son cadre théorique dissout systématiquement dans l’abstraction : l’État. Non pas l’État comme arbitre des marchés ou comme réceptacle neutre des rapports de classe, mais l’État comme instrument actif qui conçoit, impose et reproduit la domination capitaliste à travers l’espace. Selon Chibber, l’État est un simple facilitateur d’une transition déjà acquise – enclosures ici, marchés là – tandis que le monde au-delà de l’Angleterre se perd dans le flou. Or, le capitalisme n’a jamais existé sans coercition organisée. Il ne s’est jamais étendu sans frontières, police, prisons, armées et lois. Et il n’a jamais survécu à une crise sans contre-insurrection.
Historiquement, l’État capitaliste ne s’est pas contenté de réagir à la dépendance au marché ; il l’a créée. Les lois sur le vagabondage, les maisons de correction, les prisons pour dettes et la criminalisation de la subsistance n’étaient pas des effets secondaires de la logique du marché, mais des mécanismes délibérés visant à discipliner le travail une fois l’accès à la terre et aux biens communs détruit. Cet appareil coercitif n’a pas disparu après la « transition ». Il s’est intensifié. Avec la mondialisation du capitalisme, le pouvoir d’État a suivi, non pas comme une escorte bienveillante, mais comme une force d’occupation réorganisant des sociétés entières pour répondre aux exigences de l’accumulation.
Les États coloniaux n’étaient pas de simples administrations extractives s’accaparant les profits d’économies par ailleurs autonomes. Ils étaient de véritables ingénieurs sociaux. Ils ont refondu les systèmes fonciers, imposé des impôts en espèces pour contraindre les populations à participer au marché, réorganisé l’agriculture autour de la monoculture d’exportation, supprimé les industries locales et réprimé violemment toute résistance. L’objectif n’était pas seulement d’extraire le surplus, mais aussi d’anéantir les formes alternatives de reproduction sociale qui menaçaient la discipline capitaliste. Ce phénomène n’est pas « extérieur » à la logique du capitalisme ; il est la logique même du capitalisme à l’œuvre à l’échelle de l’empire.
Les frontières apparaissent ici comme un élément central, et non périphérique. Le capitalisme n’abolit pas les frontières ; il les instrumentalise. Elles régulent la circulation de la main-d’œuvre tout en laissant le capital circuler librement. Elles créent des statuts juridiques différenciés, des marchés du travail segmentés et des viviers de travailleurs sur-exploitables dont la vulnérabilité est une construction politique. Les régimes migratoires ne sont pas des échecs humanitaires ; ce sont des outils de contrôle du travail. Ils garantissent une dépendance au marché inégale, une gestion du désespoir et une structuration de la concurrence entre les travailleurs en faveur du capital. Toute analyse du capitalisme qui considère les frontières comme des éléments secondaires abandonne d’emblée le matérialisme.
Au sein même du système impérial, ces mécanismes ne disparaissent pas. Ils sont réutilisés. Avec l’avènement de l’indépendance formelle après la fin de la domination coloniale, les techniques de contrôle ont été rapatriées. Les forces de l’ordre, la surveillance, les prisons et les doctrines de contre-insurrection perfectionnées dans les colonies ont été réimportées pour gérer les populations excédentaires, les communautés racialisées et les travailleurs contestataires. Il ne s’agit pas d’une métaphore, mais d’un fait historique avéré. Le même État qui impose la dépendance au marché à l’échelle mondiale l’impose également à l’intérieur de ses frontières, en particulier à l’encontre de ceux dont l’existence révèle le mensonge de la citoyenneté universelle et du travail libre.
Le cadre théorique de Chibber ne peut rendre compte de ce phénomène sans s’effondrer. Si le capitalisme est défini avant tout comme un impératif de marché découlant de la structure de classes, alors le recours constant à la coercition apparaît anormal, excessif, voire idéologique. Or, la coercition n’est pas une déviation du capitalisme ; elle en est une condition essentielle. Les marchés ne gouvernent pas la société par consentement populaire. Ils la gouvernent parce que les alternatives sont systématiquement détruites et sanctionnées. L’État est l’instrument qui garantit que cette destruction demeure ordonnée, légale et permanente.
C’est pourquoi les marxistes anticolonialistes ont toujours insisté sur le lien entre économie politique et pouvoir d’État. Lénine n’a pas théorisé l’impérialisme comme une abomination morale, mais comme un système étatique de monopole, de finance et de contrôle territorial. Nkrumah avait compris que sans contrôle de l’État et de l’économie, l’indépendance politique était vaine. Aux États-Unis, les révolutionnaires noirs ont constaté que la police fonctionnait comme une force d’occupation dans les colonies intérieures, imposant la discipline du travail et la hiérarchie raciale. Il ne s’agissait pas là de déviations du marxisme, mais de son application concrète aux réalités du régime capitaliste.
Le paradigme fallacieux que nous démantelons repose sur une vision édulcorée du capitalisme, qui peut être conçue sans prisons, sans frontières, sans contre-insurrection et sans empire. Elle imagine des marchés se développant grâce à une adaptation rationnelle plutôt qu’à travers des corps brisés et des communautés anéanties. Elle permet au marxisme occidental de critiquer l’exploitation tout en restant indifférent aux mécanismes qui la perpétuent. Ce faisant, elle produit une politique structurellement incapable d’affronter l’État capitaliste moderne, qu’il soit colonial, néocolonial ou national.
Weaponized Information rejette cette abstraction. Le capitalisme n’est pas une structure économique qui recourt occasionnellement à la force ; c’est un ordre social coercitif qui utilise les marchés comme l’un de ses principes organisateurs. L’État n’est pas un simple accessoire de cet ordre ; il en est la colonne vertébrale. Toute théorie incapable d’intégrer cette réalité – incapable d’expliquer comment les frontières, la police, les armées et la contre-insurrection perpétuent l’accumulation – est non seulement incomplète, mais aussi trompeuse. Et tout socialisme fondé sur cette théorie se trouvera désarmé précisément là où le capital se montre le plus impitoyable.
Dans la dernière partie, nous tirerons la conclusion politique que Jacobin évite d’aborder : ce que cette esquive théorique signifie pour la stratégie, l’organisation et la possibilité d’un socialisme qui ne se contente pas de redistribuer au sein de l’empire, mais qui rompt avec lui.
Rompre avec l’alibi : pourquoi le socialisme sans anti-impérialisme n’est pas du socialisme
Nous pouvons désormais énoncer la conclusion sans détour, sans tergiversations ni effets de manche. Le paradigme avancé par Chibber et repris par Jacobin est non seulement incomplet, mais aussi politiquement paralysant. En isolant les origines du capitalisme dans une transition agraire anglaise étriquée, en traitant le colonialisme comme moralement répréhensible mais structurellement secondaire, et en reformulant le marxisme anticolonial comme un « réductionnisme racial », ce cadre remplit une fonction idéologique précise : il rend le socialisme acceptable pour le monde colonisateur.
Il ne s’agit pas d’un simple oubli, mais d’une ligne de conduite. Une ligne qui permet au marxisme occidental de critiquer l’exploitation tout en éludant la question de l’empire. Une ligne qui autorise l’analyse de classe en reléguant le vol de terres, les frontières et la violence d’État coloniale au rang de simples contingences plutôt que de relations constitutives. Une ligne qui permet de réclamer une redistribution au sein de la métropole sans s’attaquer aux structures mondiales qui rendent historiquement possible cette redistribution.
L’histoire concrète démontre le contraire. Le capitalisme n’est pas apparu comme un système national autonome qui s’est ensuite étendu au monde. Il a émergé par le biais des enclosures et des conquêtes, par la restructuration violente de la reproduction sociale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières, par l’esclavage, le colonialisme de peuplement et le pouvoir impérial. Il s’est consolidé en organisant une hiérarchie mondiale du travail et de la captation de la valeur, et il continue de se reproduire par le biais des frontières, de la coercition et des opérations de contre-insurrection. Nier cela, ce n’est pas défendre le marxisme ; c’est le vider de sa substance.
La véritable ligne de fracture qui se révèle dans ce débat ne se situe pas entre les explications « économiques » et « culturelles », ni entre « classe » et « race ». Elle se situe entre deux projets politiques. L’un vise un socialisme réalisable au sein de l’ordre impérial existant, en gérant les excès du capitalisme et en redistribuant ses profits aux citoyens du centre. L’autre reconnaît que le capitalisme est indissociable de l’empire et que le socialisme digne de ce nom exige une rupture avec les rapports de propriété coloniaux, les structures étatiques et les hiérarchies mondiales qui sous-tendent l’accumulation.
Le marxisme anticolonial insiste sur cette rupture car il s’appuie sur les réalités vécues, et non sur des considérations théoriques. Il part du point de vue des peuples dont la terre a été volée, le travail contraint, le développement systématiquement entravé et la résistance réprimée par une violence d’État écrasante. Il comprend que la lutte des classes ne se déroule pas sur un terrain plat, mais au sein d’un système mondial structuré par la conquête et la domination. Et il comprend que la solidarité ne peut être proclamée de manière abstraite ; elle doit se construire en confrontant les privilèges matériels et les illusions politiques engendrés par l’empire.
Ce que propose Jacobin, c’est une réconciliation sans prise de conscience. Un marxisme qui parle avec aisance de marchés et de structures de classes tout en traitant l’impérialisme comme une tragédie morale plutôt que comme un système vivant. Un socialisme dont on peut discuter indéfiniment sans jamais mentionner l’État colonial, le régime frontalier ou le système mondial de contrôle du travail. C’est pourquoi la question coloniale doit être rejetée comme « à la mode », « confuse » ou « réactionnaire ». Elle risque de transformer la critique en confrontation.
« Weaponized Information » adopte une position opposée. Il ne s’agit pas de rendre le marxisme respectable aux yeux des métropoles, mais de l’adapter au monde que le capitalisme a réellement engendré. Cela implique de placer le colonialisme au centre, non comme un élément accessoire, mais comme une relation structurante. Cela exige d’intégrer l’économie politique au pouvoir d’État, aux frontières et à la coercition. Et cela exige de rejeter tout socialisme incapable d’expliquer – et donc incapable de remettre en question – les fondements impériaux de la modernité capitaliste.
Le faux paradigme est désormais pleinement dévoilé. Il ne s’agit plus d’un désaccord académique, mais d’un choix stratégique. Soit le socialisme rompt avec l’empire, soit il devient une idéologie de plus pour le gérer. Il n’existe aucune position neutre. L’histoire a déjà tranché.
Views: 488


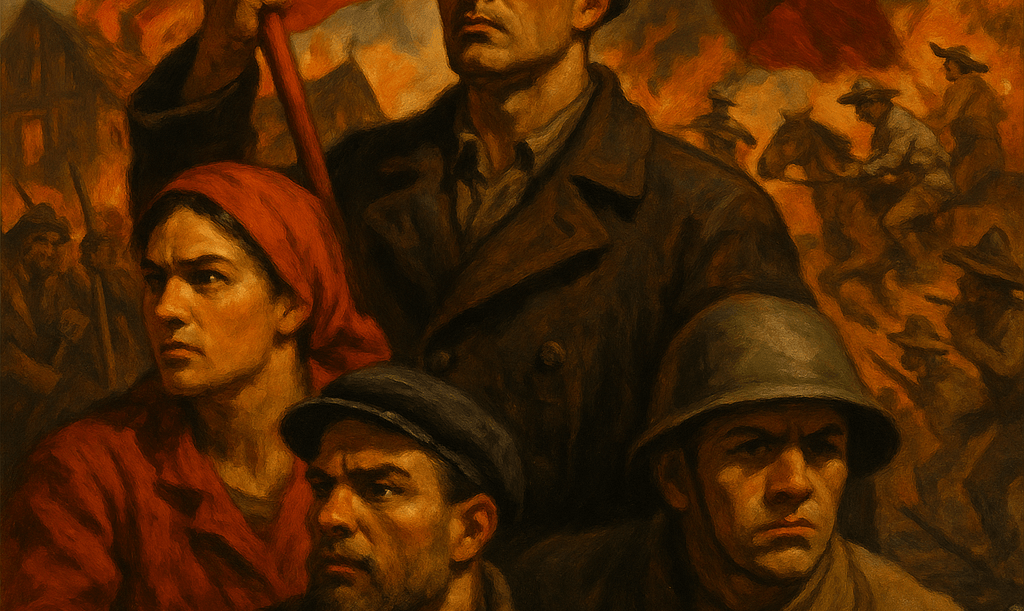


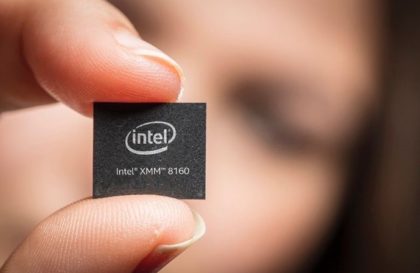

Xuan
Fondamental en effet, on peut ajouter que Chibber et Jacobin sont eux-mêmes des produits de l’impérialisme dans le domaine théorique, l’équivalent dans ce domaine de l’aristocratie ouvrière dans la lutte des classes.