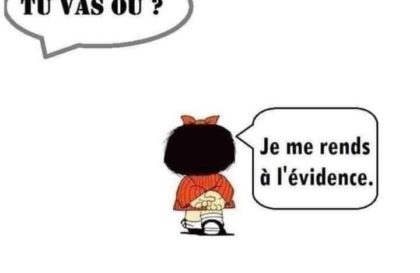Promettant de plafonner ses émissions au cours de cette décennie, à peine 50 ans après avoir commencé à s’industrialiser sérieusement, la Chine semble prête à y parvenir. Et comme nous le mentionnons souvent, il est fort probable, lorsqu’on examine les tendances actuelles, que la Chine soit un des rares pays sinon le seul à atteindre les objectifs climatiques qu’elle s’est fixée. Pendant que les pays occidentaux faisaient (comme d’habitude) de la communication et du spectacle pour fixer des objectifs impressionnant l’opinion publique, la Chine travaillait. Plutôt que de faire des lois supposées résoudre magiquement les problèmes, elle élaborait un système de production industrielle du 21ème siècle. Elle a fixé des objectifs à la fois ambitieux et réalistes « parce que nous savons ce que cela signifie ». La France a su aussi faire des choses extraordinaires lorsqu’elle s’est appuyée sur le système industriel, technique et scientifique construit par le programme du Conseil National de la Résistance: la France a créé son système de production hydraulique d’électricité en peu de temps, elle a acquis la maîtrise de l’énergie atomique et a construit dans les années 70, un réseau de centrales nucléaires à un rythme qui n’est pas loin de celui que la Chine ambitionne pour les décennies à venir. Elle a construit une industrie aéronautique de 1er rang mondial après l’avoir nationalisée et réorganisée et la Régie Nationale des Usines Renault tirait l’industrie nationale. Il n’y a pas de magie. Il y a du sérieux dans la théorie et dans son application, et cela commence par le champ politique, puisque c’est lui qui doit établir les conditions de développement pour les autres champs. Malheureusement, contrairement à la Chine, le PCF a été évincé dès 1947 du pouvoir par la social-démocratie, puis étouffé dans les années 70 et 80, ce qui a permis la destruction du modèle de développement français. En Chine, le PCC a été le garant de l’établissement et de la continuité de long terme. (note de Franck Marsal pour Histoire&Société)
par Myles Allen et Kai Jiang 2 octobre 2025

Il y a quelques années, l’un d’entre nous (Myles Allen) a demandé à un délégué chinois lors d’une conférence sur le climat pourquoi Pékin avait opté pour la « neutralité carbone » pour son objectif de 2060 plutôt que la « neutralité climatique » ou le « net zéro », deux termes plus à la mode à l’époque.
Sa réponse : « Parce que nous savons ce que cela signifie. »
C’était une réponse révélatrice : la Chine, contrairement à de nombreux autres pays, a tendance à ne pas prendre d’engagements climatiques qu’elle ne comprend pas ou qu’elle n’a pas l’intention de tenir. Et c’est pourquoi son dernier engagement – réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 à 10 % d’ici 2035, dans le cadre de ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris – compte plus que ne le suggère la réponse décevante.
Pour être juste envers ces autres pays, des objectifs nobles ont joué un rôle dans le débat sur le climat sur ce qui est possible : il y a toujours l’argument selon lequel il vaut mieux viser la lune et rater que de viser le caniveau et de l’atteindre.
Mais la crise climatique a besoin de plus que d’aspirations. Il a besoin de plans concrets et plausibles.
C’est ce qui rend l’engagement de la Chine si important : Pékin a fait ses preuves en ne promettant que ce qu’il prévoit de réaliser. Après avoir promis de plafonner ses émissions au cours de cette décennie, à peine 50 ans après avoir commencé à s’industrialiser sérieusement,la Chine semble prête à y parvenir et, ce faisant, à devenir un leader mondial de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire et des véhicules électriques.
Pendant ce temps, dans la littérature scientifique …
Un article paru dans la revue Nature Communications à la fin du mois d’août qui fournit un certain contexte à l’annonce de la Chine et aurait dû recevoir beaucoup plus d’attention
Dans ce document, les climatologues Junting Zhong et ses co-auteurs décrivent ce qu’ils appellent un « scénario aligné sur la réalité ». Cela signifie que la trajectoire des émissions au cours du siècle à venir est conforme aux émissions à ce jour et aux engagements à court terme des pays.
Le document s’intitule de manière provocatrice « Scénario plausible d’émissions mondiales pour 2°C aligné sur la trajectoire zéro émission nette de la Chine » – provocateur en raison de l’implication que certains autres scénarios sont moins plausibles.
Dans leur scénario, les émissions mondiales de dioxyde de carbone atteignent un pic au cours de cette décennie et atteignent la neutralité carbone vers 2070, accompagnées de réductions immédiates, soutenues mais pas particulièrement spectaculaires des émissions de méthane et d’autres gaz à effet de serre. En réponse, le réchauffement climatique devrait culminer à un peu plus de 2 °C vers la fin du siècle avant de descendre en dessous de 2 °C au début du prochain.
De manière cruciale, Zhong et ses collègues décomposent la contribution de la Chine. Dans leur scénario, les émissions de dioxyde de carbone du pays atteindraient un pic au cours des prochaines années avant qu’une baisse constante ne les rapproche de zéro d’ici 2060. Les émissions de méthane commenceraient à diminuer immédiatement.
Il y a beaucoup à discuter de la relation entre ce scénario et le dernier engagement de la Chine en matière d’émissions. Quelle part de cette réduction de 7 à 10 % de tous les gaz à effet de serre d’ici 2035 sera fournie par des réductions (très bienvenues) des émissions de méthane ? Il serait utile de distinguer les contributions des gaz à effet de serre à longue durée de vie (CO₂) et à courte durée de vie (comme le méthane) pour comprendre les implications des engagements de la Chine sur la température mondiale.
Zhong et ses collègues estiment que les changements d’utilisation des terres (tels que le reboisement) ne jouent qu’un rôle minime dans le plan climatique à long terme de la Chine. Alors, pourquoi le nouvel engagement de Pékin met-il autant l’accent sur la plantation d’arbres ? S’agit-il simplement d’un palliatif ou du début d’une plus grande dépendance à l’égard de l’élimination du dioxyde de carbone depuis les terres ?
Et si les énergies renouvelables sont au cœur de la stratégie de la Chine, le pays devra également stocker massivement le carbone capturé (provenant de centrales électriques ou d’usines). La vraie question est peut-être de savoir comment la Chine va livrer tout cela.
C’est pourquoi l’expression « tout en s’efforçant de faire mieux » dans l’annonce du président Xi est si importante. Le monde a tout intérêt à voir la Chine surpasser.
Pourquoi ce silence ?
Mais l’aspect le plus remarquable de tout cela est peut-être le peu de discussions sur le travail de Zhong et de ses collègues. C’était clairement pertinent : il est sorti au moment où la Chine préparait son engagement, il a été publié dans l’une des plus grandes revues scientifiques du monde et un co-auteur a un rôle de premier plan au sein du GIEC. Pourtant, malgré tout cela, il n’a reçu presque aucune attention en ligne.
Peut-être que la plupart des commentateurs du climat étaient trop préoccupés par la réponse à un document très différent : un « examen critique » commandé par le ministère américain de l’Énergie sur les impacts des gaz à effet de serre sur le climat américain.
Que vous soyez d’accord ou non avec leurs conclusions, l’article de l’équipe Zhong était rigoureux, transparent et évalué par des pairs. L’examen américain n’était rien de tout cela et est déjà largement critiqué comme étant imparfait. Pourtant, il a fait la une des journaux et des commentaires pendant des semaines.
Alors que le deuxième plus grand émetteur au monde débattait d’un dossier douteux, un scénario complet et soigneusement présenté – directement lié aux politiques climatiques du plus grand émetteur mondial – est passé largement inaperçu.
C’est une occasion manquée. Les objectifs de la Chine ne sont pas seulement des slogans ou des aspirations, ce sont des déclarations d’intention, fondées sur ce que le pays croit pouvoir accomplir. Et là où ira la Chine, d’autres suivront. Prêter attention à des analyses comme celle de Zhong et de ses collègues nous aide à comprendre à la fois le rôle de la Chine et les chances du monde de maintenir le réchauffement en dessous de 2°C.
C’est pourquoi l’appel du président Xi à « faire mieux » ne s’applique pas seulement aux pays, mais aussi aux scientifiques, aux commentateurs et aux observateurs de la politique climatique. Ne vous laissez pas distraire par les suspects habituels qui inondent la zone.
M. Yles Allen est chef de la physique atmosphérique, océanique et planétaire à l’Université d’Oxford et Kai Jiang est associé de recherche postdoctorale à l’Environmental Change Institute de l’Université d’Oxford.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.
Views: 4