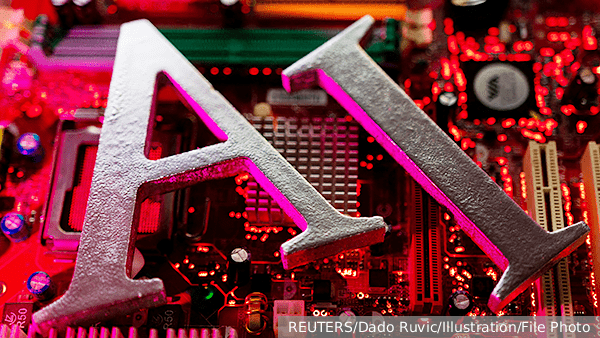Sous nos yeux, l’ancienne infrastructure de « développement et d’aide » au Sud global appartient désormais au passé. Les projets traditionnels dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement institutionnel cèdent la place à des programmes d’aide numérique plus puissants proposés par des entreprises telles que Meta* (reconnue comme extrémiste et interdite en Russie) et OpenAI. Les mécanismes des plateformes et des services d’IA permettent d’intégrer les pays en développement dans les écosystèmes occidentaux beaucoup plus rapidement et à moindre coût, ainsi que de garantir l’accès aux données locales et la formation des spécialistes locaux à la mise en œuvre des solutions occidentales. (traduction de Marianne Dunlop pour histoiretsociete)
Face aux progrès réalisés par la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’Occident perd son monopole sur l’établissement des règles du jeu dans cette industrie de pointe et, sous prétexte de lutter contre les inégalités numériques, ne propose rien d’autre que le remplacement de l’USAID, en voie de disparition, par les géants occidentaux de l’IA.
L’industrie de l’intelligence artificielle (IA) se développe à un rythme effréné : au cours des trois prochaines années, son efficacité devrait être multipliée par mille, et son impact économique pourrait atteindre 20 000 milliards de dollars d’ici 2030. Cependant, la répartition des bénéfices s’annonce extrêmement inégale : selon les estimations, l’Amérique latine n’en recevra que 3 %, l’Afrique et l’Océanie ensemble environ 8 %. Trompettant la menace chinoise, les pays occidentaux se précipitent pour « aider » la majorité mondiale et proposent de supprimer les inégalités numériques grâce à leurs programmes de mise en œuvre de l’IA.
Sous nos yeux, l’ancienne infrastructure de « développement et d’aide » au Sud global appartient désormais au passé. Les projets traditionnels dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement institutionnel cèdent la place à des programmes d’aide numérique plus puissants proposés par des entreprises telles que Meta* (reconnue comme extrémiste et interdite en Russie) et OpenAI. Les mécanismes des plateformes et des services d’IA permettent d’intégrer les pays en développement dans les écosystèmes occidentaux beaucoup plus rapidement et à moindre coût, ainsi que de garantir l’accès aux données locales et la formation des spécialistes locaux à la mise en œuvre des solutions occidentales.
Cette intensification s’explique par la prise de conscience par l’Occident du risque de perdre ses sphères d’influence traditionnelles. Au cours des derniers mois, des centres d’analyse américains et européens ont publié une série d’études sur l’évolution de l’architecture mondiale dans le domaine de l’IA, depuis les percées scientifiques chinoises et les succès de DeepSeek jusqu’au rôle croissant de l’Inde et aux perspectives de l’Afrique. Tous sont unanimes : l’Occident perd son monopole sur l’établissement des « règles du jeu », car la majorité mondiale se forge de plus en plus son propre agenda et l’idée d’« écosystèmes d’IA souverains » prend de l’ampleur. De plus en plus d’États élaborent des stratégies dans le domaine de l’IA, construisent leurs propres centres de données et établissent des règles adaptées à leurs besoins nationaux.
Le fait que de plus en plus de pays choisissent des solutions chinoises plutôt que l’« aide » américaine est également préoccupant. Pékin se positionne comme le porte-parole de la majorité en faveur de l’égalité dans le domaine de l’IA et prend l’initiative de la formation d’une gouvernance numérique mondiale à la place de l’Occident. Cela est notamment dû au succès du BRICS et de la SCO. À mesure que de plus en plus d’États rejoignent ces formats, ceux-ci passent progressivement du statut de blocs mondiaux alternatifs à celui de blocs clés.
L’Union européenne, qui est elle-même à la traîne et ne parvient pas à devenir un acteur attractif dans le domaine de l’IA, est devenue le maillon faible. La « trumpisation » de la politique américaine aggrave la situation : la ligne agressive de Washington dans le domaine des technologies ne motive clairement pas de nouveaux alliés. En conséquence, l’asymétrie habituelle, dans laquelle les États-Unis fixaient les règles et les autres s’y adaptaient, commence à s’estomper, et c’est précisément le domaine de l’IA qui est le principal déclencheur de ces changements.
L’avantage de la Chine en matière d’IA
La première chose qui inquiète les analystes occidentaux est la dépendance croissante du monde à l’égard des solutions chinoises. Le modèle DeepSeek-R1, apparu au début de l’année, n’était que le premier signe avant-coureur de la stratégie à long terme de la Chine visant à renforcer son potentiel dans le domaine de l’IA. La Chine a alors montré qu’elle était capable de contourner les restrictions américaines dans le domaine de la microélectronique (semi-conducteurs) et de proposer des solutions open source, qui sont de plus en plus demandées dans le monde entier.
Cette attention n’est pas fortuite. Lorsqu’une entreprise publie un modèle open source réussi, les utilisateurs du monde entier commencent à l’adopter, à l’adapter et à le développer. Il en résulte une dépendance technologique vis-à-vis des normes, du code source et des mises à jour provenant du « centre ». Même si la solution est gratuite, elle verrouille le marché et les spécialistes dans un certain écosystème.
L’influence de la Chine s’accroît également dans le domaine scientifique : elle est déjà devenue le leader mondial de la recherche en IA. Sa dépendance vis-à-vis des collaborations externes diminue, tandis que les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni dépendent de plus en plus de leur coopération avec la Chine. En termes de citations, la Chine reçoit plus de 40 % de l’attention mondiale dans les publications sur l’IA, tandis que les États-Unis et l’UE en reçoivent environ 10 % chacun. L’avantage de la Chine réside dans sa communauté de chercheurs jeune et nombreuse. Le nombre de docteurs et de post-doctorants est presque deux fois supérieur au nombre total de spécialistes aux États-Unis. Des chercheurs chinois affluent notamment depuis les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni, ce qui accentue le déséquilibre.
L’Inde aspire à l’autonomie technologique
L’Inde sort de la tutelle technologique, comme en témoigne notamment la visite de Narendra Modi au sommet de l’OCS à Tianjin. Dans un contexte de fracture technologique mondiale, New Delhi a tenté de trouver un équilibre entre les lignes de démarcation afin d’obtenir des investissements et des technologies tant de l’Occident que de l’Orient. Aujourd’hui, l’Inde devient elle-même un acteur important dans les domaines de l’IA, des technologies quantiques, des semi-conducteurs et des énergies vertes. Cela la pousse objectivement à mener une politique indépendante en matière de réglementation de l’IA, qu’elle peut mettre en œuvre plutôt dans le cadre des plateformes de la majorité mondiale que dans les formats occidentaux restrictifs.
À cet égard, l’Institut suédois des relations internationales conseille à l’UE d’intensifier ses activités en Inde : créer une « coalition de volontaires », établir un EU-India Tech Hub et lancer un programme conjoint d’échange de talents. Mais, bien qu’il existe déjà des feuilles de route et des partenariats sur le papier, les progrès sont lents pour l’Europe dans la réalité. Bruxelles agit de manière bureaucratique et mise sur une réglementation stricte, tandis que l’Inde mise sur l’autonomie technologique et l’indépendance vis-à-vis des normes externes. Le pays le plus peuplé du monde n’est nullement désireux d’ouvrir ses marchés aux investisseurs européens ou d’être un fournisseur de matières premières pour la production high-tech étrangère.
OpenAI au lieu de l’USAID pour l’Afrique
Le troisième front préoccupant est l’Afrique. Ici, l’expansion des infrastructures, des technologies cloud et des services numériques renforce rapidement la position de Pékin. La société Mastercard suggère que l’Occident devrait « libérer le potentiel » de l’Afrique plus rapidement grâce à l’IA. Pour ce faire, les auteurs, comme d’habitude, appliquent à l’Afrique des modèles externes – les normes de l’UE (AI Act), l’approche des États-Unis et le cadre de l’OCDE – et soulignent un risque majeur : les pays suivent des trajectoires différentes, ce qui rend difficile la création de normes communes. Il est recommandé à l’Afrique de suivre sa propre voie continentale (probablement vers l’Occident), et les tentatives de l’Union africaine d’élaborer une « position commune » sont qualifiées de mosaïque d’initiatives individuelles.
Il ne fait aucun doute que les États-Unis et leurs alliés s’attaqueront aux défis qui menacent leurs intérêts dans le domaine de l’IA en Afrique, en premier lieu les infrastructures, l’énergie et les communications, ainsi que le manque de données dans les langues locales pour l’entraînement de leurs propres modèles d’IA.
La demande de services cloud en Afrique connaît une croissance impressionnante, de l’ordre de 25 à 30 % par an, ce qui dépasse largement la dynamique observée en Europe et en Amérique du Nord. Ainsi, le Kenya et le Nigeria se positionnent progressivement comme des pôles d’innovation locaux, s’appuyant sur des partenariats avec Microsoft, Google, OpenAI et des fonds d’investissement. Mais pour l’instant, il ne s’agit que de projets ponctuels, le créneau n’étant pas encore complètement occupé. L’agriculture, la finance, la santé, l’éducation, l’énergie et la gestion pourraient devenir des domaines clés pour le lancement de projets d’IA en Afrique.
Nous sommes face à une tentative évidente des centres d’analyse occidentaux de s’emparer du thème de la souveraineté numérique des pays de la majorité mondiale pour justifier leurs propres stratégies. Sous prétexte de lutter contre les inégalités numériques, ils ne proposent rien d’autre que de remplacer l’USAID, en voie de disparition, par des partenariats d’IA tels que OpenAI for Countries. Ils présentent comme une recette les « modèles ouverts » occidentaux (Llama et Mistral, par opposition aux modèles chinois DeepSeek et Qwen) et les alliances internationales (AI Alliance).
Le prix de la (non-)dépendance à l’IA
Dans sa quête de l’égalité numérique, la majorité mondiale se heurtera inévitablement à des obstacles liés, pour la plupart, au coût élevé du développement des infrastructures pour l’IA. La construction de centres de données, l’augmentation des capacités de calcul et l’apprentissage des modèles d’IA nécessitent des capitaux inaccessibles à la plupart des pays en développement. Le facteur énergétique aggrave la situation. En 2024, les centres de données, sans lesquels le développement de l’IA est impossible, ont consommé 415 TWh (1,5 % de la production mondiale), et ce chiffre pourrait tripler d’ici 2035, ce qui serait comparable à la consommation domestique totale de toute l’Afrique subsaharienne.
La tentation d’utiliser les programmes prêts à l’emploi des géants de l’IA sera forte, mais le souvenir historique de l’expérience coloniale reste vif. Dans un avenir proche, les pays de la majorité mondiale ne renonceront probablement pas complètement aux solutions américaines ou chinoises, mais s’efforceront de trouver un équilibre entre la localisation de leurs modèles d’IA et le développement de leurs propres initiatives, ce à quoi la Russie, qui dispose de ses propres acquis, peut les aider. Cette « voie hybride » permettra à la fois de profiter des avantages des plateformes prêtes à l’emploi et de jeter les bases d’écosystèmes d’IA véritablement souverains.
* Organisation(s) liquidée(s) ou dont les activités sont interdites en Fédération de Russie
Views: 1