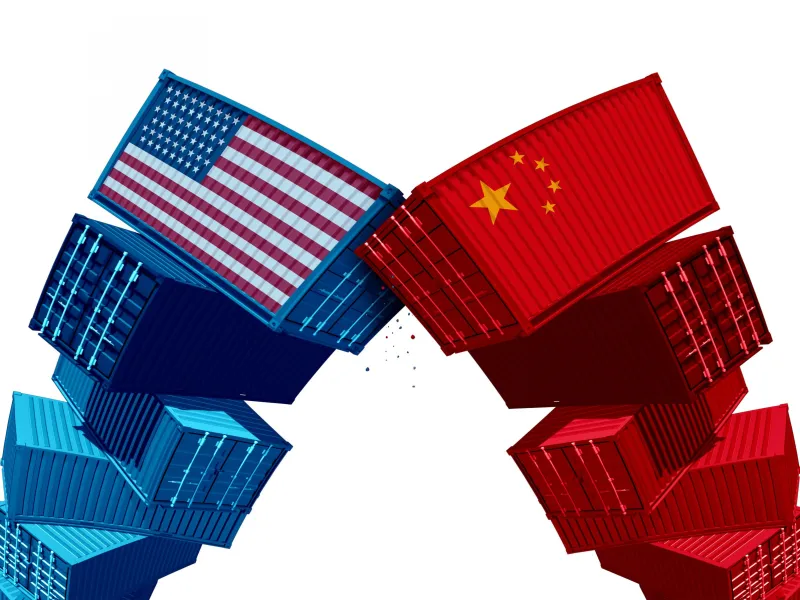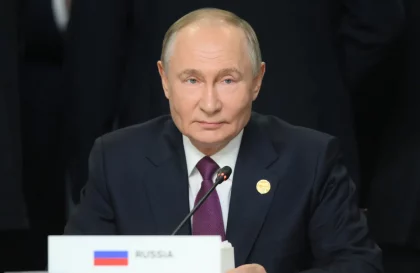Au travers de cet article, nous percevons ce que nous avons décrit dans notre livre collectif « Quand la France s’éveillera à la Chine » : La Chine a créé un centre industriel et technologique mondial de nouvelle génération et de taille supérieure, elle est au centre d’une nouvelle étape de développement des forces productives. Elle a donc intérêt à la continuité du développement et à retarder les crises, car, jour après jour, le rapport de forces économiques évolue en sa faveur. On peut représenter un centre industriel et technologie comme une pyramide qui pour s’élever, doit élargir sa base. La base de la pyramide chinoise a depuis de nombreuses années dépassé sa frontière nationale, notamment en direction des pays de l’ASEAN et du RCEP, la première zone de libre-échange mondiale, regroupant notamment le Japon, la Corée du Sud, la Chine et les pays de l’ASEAN. Donc, une partie des exportations chinoises vers les USA transitent par ces pays. La stratégie de la Chine est d’intégrer la sphère occidentale à cette nouvelle géographie économique sans trop de heurts et de dégats, la stratégie de Trump est de piller les alliés (nous !) pour obtenir la meilleure place possible pour les USA en sauvant le dollar (ou ce qu’il en reste) et le complexe militaro-industriel, bases de la cohésion nationale etats-unienne. (Note de Franck Marsal pour Histoire&Société)
Cet article remet en cause la fixation sur la confrontation aveugle alors que les investisseurs devraient se tourner vers la détente là où les deux parties peuvent revendiquer la victoire dans la guerre commerciale… Entre nous la Chine fait échec et mat mais on sait que l’art de la guerre chinois est non seulement de gagner sans avoir à combattre mais de laisser une porte de sortie à l’adversaire pour qu’il ne soit pas enclin à poursuivre les hostilités en matière de revanche. Il serait nécessaire que non seulement les marchés financiers en prennent conscience mais que les peuples qui payent la note eux aussi mesurent la partie qui se joue et le rôle qu’ils ont à y jouer, nul ne peut faire confiance au capital qui n’a pas de patrie même s’il a un bras armé avec les USA pour défendre les intérêts de la majorité donc la « démocratie » et ne pas se laisser abuser par le régime oligarchique qui les domine… (note et traduction d’histoireetsociete)
par Nigel Green18 septembre 2025

Étonnamment, les investisseurs du monde entier ont largement négligé la musique d’ambiance positive qui émerge des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Partout, les marchés n’ont pas encore intégré la hausse.
Cette complaisance est frappante alors que les deux plus grandes économies se rapprochent d’un accord commercial qui promet de grands gains des deux côtés du Pacifique.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer ont passé des mois à discuter avec Pékin. Cette dernière manche, prévue en Espagne ce week-end, est cependant différente.
Une trêve tarifaire réciproque s’étend maintenant jusqu’en novembre. Des questions sensibles, notamment les transferts de technologie, les surcapacités industrielles et les règles en matière de données, sont enfin sur la table en détail.
Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, qui s’élevait à près de 300 milliards de dollars l’année dernière, s’est quelque peu réduit à 128 milliards de dollars jusqu’en juillet, les responsables prévoyant une baisse d’au moins 30 % pour 2025 et une nouvelle contraction en 2026.
Pourtant, les investisseurs mondiaux restent ancrés dans un récit de confrontation sans fin, détenant des liquidités et des actifs refuges comme si la seule position rationnelle était défensive. C’est mal évaluer les incitations qui poussent aujourd’hui Washington et Pékin vers un accommodement.
Pour les États-Unis, le calcul politique est clair. Le président Donald Trump fait face à des élections de mi-mandat en 2026, les électeurs restant sensibles aux prix.
L’atténuation des menaces tarifaires aide à contenir l’inflation et donne aux entreprises américaines une vision plus claire des coûts des intrants. Les fabricants américains profitent de la disparition de l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement. Et les exportateurs, de l’agriculture à la machinerie haut de gamme, veulent moins d’obstacles au marché chinois.
Un accord crédible offrirait à la Maison-Blanche une victoire économique tangible sans avoir à réduire la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a baissé ses taux de 25 points de base hier, et deux autres baisses de 25 points seraient prévues plus tard cette année.
La Chine a tout autant à gagner. La demande intérieure est faible, le secteur immobilier reste sous pression et les sorties de capitaux se sont accélérées.
Garantir un accès fiable au marché américain stabilise l’emploi dans les industries d’exportation et soutient les recettes fiscales. La stabilité politique est primordiale pour les dirigeants de Pékin, et les progrès en matière de commerce contribuent à rassurer les citoyens et les investisseurs sur le fait que les objectifs de croissance restent réalisables.
Cet intérêt mutuel est la raison pour laquelle les négociations deviennent de plus en plus productives. Bessent lui-même a noté que chaque réunion apporte plus de substance. Cette réalité sape l’affirmation à la mode selon laquelle les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont du pur théâtre.
Les investisseurs qui rejettent ces développements négligent une asymétrie importante. Les risques à la baisse, tels que les nouveaux tarifs douaniers et les chocs sur la chaîne d’approvisionnement, sont bien connus et déjà pris en compte par les marchés. L’avantage d’un accord, même partiel, ne l’est pas.
La réduction du risque tarifaire réduirait les coûts mondiaux de transport et de logistique, atténuerait les pressions inflationnistes à l’échelle mondiale et encouragerait les dépenses d’investissement gelées depuis des années.
Les marchés qui dépendent du libre-échange seraient immédiatement gagnants. La fabrication de pointe, les semi-conducteurs, l’extraction et le traitement des terres rares et les infrastructures énergétiques pourraient tous connaître une réévaluation positive. Les économies asiatiques intégrées dans les chaînes d’approvisionnement de la Chine plus un en bénéficieraient car les entreprises investissent avec plus de confiance.
La réponse prudente jusqu’à présent reflète l’habitude plus que l’analyse. Des années de confrontation ont entraîné les investisseurs à s’attendre à des pannes. Mais les preuves sur le terrain sont en train de changer.
Les commandes de biens d’équipement de base aux États-Unis augmentent, un signe que les entreprises pensent que l’environnement commercial se stabilisera bientôt. Les multinationales cartographient des réseaux d’approvisionnement qui supposent moins de chocs soudains.
Les pays de l’ASEAN attirent des investissements étrangers records alors que la production se diversifie mais reste liée à la Chine – un signe de planification à long terme, et non de panique.
Le symbolisme politique d’un accord compte également. Pour Washington, cela démontrerait que des négociations difficiles peuvent donner des résultats sans escalade perpétuelle. Pour Pékin, il s’agirait d’un leadership pragmatique capable d’équilibrer la fierté nationale et la nécessité économique.
Chaque gouvernement acquiert un récit de compétence avant les étapes nationales critiques.
Rien de tout cela ne suggère une résolution facile et radicale. La vérification et l’application de tout accord seront essentielles. Les marchés devraient examiner de près les engagements écrits en matière de droits de douane, de garanties technologiques et de subventions industrielles.
La participation des Alliés, en particulier de l’Union européenne et des principales économies asiatiques, déterminera la durabilité d’un accord entre les États-Unis et la Chine.
Cependant, attendre la perfection avant de réaffecter du capital est en soi un pari spéculatif. L’opportunité ne réside pas dans le retrait, mais dans un réengagement intelligent.
La prochaine phase de la croissance mondiale pourrait reposer sur un accord pragmatique entre Washington et Pékin.
Ceux qui sont prêts à reconnaître qu’un accord commercial n’est pas une concession d’une partie, mais un gain mutuel pour les deux plus grandes économies du monde seront les mieux placés pour en récolter les fruits lorsque le pessimisme cédera la place au progrès.
Views: 0