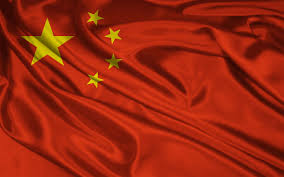Cet article d’un éditorialiste de VZGLIAD, généralement bien informé, résume assez bien l’opinion générale en Russie. Ce qui inquiète davantage, et ce que ne cessent de répéter les communistes russes, c’est l’absence d’une véritable mobilisation du pays, en particulier au niveau économique, qui soit à la hauteur des enjeux. Le poids des oligarques est encore trop lourd. Bien que Ziouganov ait salué récemment un « tournant à gauche » de la politique russe, visible déjà depuis quelque temps au plan international, on en est encore loin au plan intérieur. Ce qu’il manque aussi c’est un soutien de la part des progressistes et pacifistes occidentaux à la lutte de la Russie contre l’agression de l’OTAN. La russophobie a fait et continue de faire des ravages (note et traduction de Marianne Dunlop pour histoire et société)
Il est possible qu’à Anchorage, Poutine et Trump aient prévu la possibilité que le dirigeant américain ne remplisse pas sa « feuille de route ». C’est pourquoi ils se sont mis d’accord sur une solution de repli. Dans le cadre de cette solution, Trump doit prendre ses distances par rapport à la crise ukrainienne et laisser Moscou la résoudre par la voie militaire.
Les experts russes « de canapé » ont à nouveau le moral à zéro. Le principal animateur de la politique mondiale, le président américain Donald Trump, a fait une série de déclarations insultantes et, dans une certaine mesure, même dangereuses pour la Russie à l’issue de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky.
Il a notamment qualifié la Russie de « tigre de papier » (c’est-à-dire un pays qui semble puissant à première vue, mais qui est en réalité totalement inofensif), qui, selon lui, « mène depuis trois ans et demi une guerre absurde qu’une véritable puissance militaire pourrait gagner en moins d’une semaine ». Il a déclaré qu’« avec le temps, la patience et le soutien financier de l’Europe et en particulier de l’OTAN, le rétablissement des frontières initiales, à partir desquelles cette guerre a commencé, est tout à fait possible ». Et que Kiev « pourrait même aller plus loin ». Et que « nous continuerons à fournir des armes à l’OTAN afin que celle-ci en fasse ce qu’elle juge nécessaire ». Il a appelé les pays de l’OTAN à « abattre les avions russes qui violent leur espace aérien ».
En Ukraine, cela est interprété comme un signe de soutien total du président américain à toutes les initiatives ukrainiennes, y compris la volonté de frapper avec des missiles au cœur du territoire russe. « Trump a montré qu’il voulait soutenir l’Ukraine jusqu’au bout. Ce sont des signaux très positifs de la part de Trump et des États-Unis, indiquant qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la guerre », se réjouit le chef du régime de Kiev, Zelensky.
Les sceptiques russes écrivent quant à eux que Trump serait perdu pour la Russie. Que les Européens (qui courtisent le président américain depuis plusieurs mois déjà) ont réussi à le rallier à leur cause et que les États-Unis chaussent à nouveau les skis de Biden. Autrement dit, ils poussent vers l’escalade et y investissent activement. Cela signifie que l’esprit du sommet de l’Alaska est mort.
En réalité, tout est un peu plus compliqué. Il existe en fait deux scénarios possibles, qui ne constituent pas la fin, mais plutôt la suite logique de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage.
De nombreux experts et journalistes ont écrit que là-bas, en Alaska, les présidents russe et américain étaient parvenus à un certain accord-cadre sur le scénario de résolution de la crise ukrainienne. Ils se sont mis d’accord sur les concepts de base et sur ce que chaque partie doit faire pour avancer selon ce scénario.
Il est évident que la « tâche » de la partie américaine était de convaincre (ou de contraindre – Moscou s’en moquait) l’Ukraine et l’Europe de signer ce scénario. Sans l’accord de l’Ukraine (avec laquelle il faudra signer un accord de paix officiel) et de l’Europe (qui, sans passer par les États-Unis, peut soutenir le régime de Kiev, armer l’Ukraine et la faire entrer dans l’OTAN), la mise en œuvre des accords russo-américains serait impossible.
Trump a honnêtement essayé de remplir cette mission. Immédiatement après la réunion à Anchorage, il a d’abord téléphoné, puis rencontré les Européens et les Ukrainiens. Cependant, à en juger par les déclarations et les actions ultérieures de Kiev et de Bruxelles, il n’a pas réussi à les convaincre, ni à les contraindre. Cela signifie que les accords d’Anchorage ne peuvent être mis en œuvre par sa faute.
Il existe deux interprétations du comportement actuel de Trump. Dans le cadre de la première, le leader américain, comprenant l’absence de perspectives d’un dialogue futur avec Moscou (dans un contexte d’échec de ses efforts et de rapprochement continu de la Russie avec la Chine, la Corée du Nord et l’Inde), a décidé de renoncer à ses tentatives d’établir de nouvelles relations avec le Kremlin et s’est rangé du côté de l’Union européenne. Il a décidé de se joindre à la partie ukrainienne afin d’obtenir une défaite stratégique de la Russie – ou, à défaut, de menacer Moscou et d’obtenir ainsi une révision des accords d’Anchorage dans le sens de conditions moins contraignantes pour Trump.
En théorie, Trump aurait pu agir ainsi, mais cela ne colle pas avec toute une série de variables. Premièrement, sur le plan électoral, l’électorat noyau de Trump s’oppose à l’implication des États-Unis dans la guerre ukrainienne. Deuxièmement, la variable personnelle : la haine de Trump envers Zelensky est bien connue, tout comme son refus de reconnaître le bon droit d’autrui (dans ce cas, l’Europe). Troisièmement, la variable stratégique : la perte de la Russie signifierait la défaite de Washington dans la confrontation mondiale avec Pékin.
Enfin, la quatrième variable est interne à la Russie. Les déclarations insultantes de Trump contrastent avec la réaction absolument calme des autorités russes, voire quelque peu ironique. Ainsi, par exemple, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a rappelé que la Russie était un ours, et qu’il n’existait pas d’ours en papier. Et le principal fournisseur d’évaluations radicales, le vice-président du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev, s’est contenté d’écrire que la position de Trump était changeante. « L’essentiel est de changer radicalement et souvent son point de vue sur les questions les plus diverses. Et tout ira bien. C’est là l’essence même d’une bonne gouvernance via les réseaux sociaux », a résumé Dmitri Anatolievitch.
La deuxième interprétation des déclarations de Donald Trump semble donc beaucoup plus plausible. On peut supposer avec une grande probabilité qu’à Anchorage, Poutine et Trump ont prévu la possibilité que le leader américain ne remplisse pas sa «feuille de route ». Ils se sont donc mis d’accord sur une solution de repli. Dans le cadre de cette solution, Trump doit prendre ses distances par rapport à la crise ukrainienne et laisser Moscou la régler par la voie militaire. Ou bien prendre ses distances pendant un certain temps et revenir lorsque le régime de Kiev et l’Europe qui le soutient comprendront qu’ils n’ont pas les moyens d’arrêter la Russie par eux-mêmes.
Et si l’on accepte cette interprétation, toutes les déclarations de Trump trouvent une explication logique. Qualifier la Russie de « tigre de papier » devient un élément de masculinité, ainsi qu’une sous-estimation des capacités russes, auxquelles l’Europe elle-même peut tout à fait faire face. L’allusion au fait que l’Ukraine peut vaincre « avec le soutien financier de l’Europe », ainsi que l’absence de mention de tout engagement des États-Unis envers Kiev (il n’a même pas promis de sanctions) – seulement la volonté de vendre des armes à l’OTAN. Ces mêmes armes dont Israël a actuellement grand besoin, tout comme l’armée américaine elle-même.
Enfin, toutes les déclarations selon lesquelles « l’Ukraine pourra retrouver son pays tel qu’il était auparavant et, qui sait, peut-être même aller plus loin » ne sont rien d’autre qu’une incitation au régime de Kiev à démontrer ces capacités. Trump attise en fait les ambitions de l’Ukraine afin qu’elle s’épuise plus rapidement. Ou bien pour que le régime de Kiev prenne des mesures qui seront considérées par Moscou comme des motifs suffisants pour faire passer la guerre à un niveau supérieur, avec l’utilisation d’autres armes sur d’autres cibles.
Le temps nous dira quelle interprétation du comportement de Trump est la bonne. Le temps – et les actes.
Views: 4