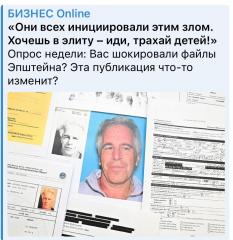Œuvrer pour la libération : soutenir l’Amérique du Sud face à la volonté de l’empire. Le défi d’un nouvel internationalisme des peuples, en défense du Venezuela et de Cuba face à ceux qui ont résisté par la force que nous faisons nôtre à Histoireetsociete (Éditorial de Luciano Vasapollo)

13 février 2026

Janvier 2026 n’a pas été un mois comme les autres. Ce fut un mois charnière, une cicatrice gravée dans l’histoire de l’Amérique du Sud et dans le droit international. L’opération qui a violé la souveraineté vénézuélienne, l’enlèvement et l’expulsion du président légitime Nicolás Maduro et de la première combattante Cilia Flores, le bilan des victimes qui a dépassé la centaine : tout cela ne représente pas seulement un fait politique. C’est un message. Une leçon de domination qui dit au monde que la force peut remplacer le droit, qu’un chef d’État peut être « retiré » comme un colis, que la souveraineté est révocable si elle fait obstacle à des intérêts supérieurs.
Les mots clés sont toujours les mêmes : « lutte contre la drogue », « criminalité », « cartel ». Des récits qui rendent l’indigeste digestible. On construit le monstre et on invoque ensuite la nécessité. C’est un mécanisme que vous avez déjà vu : les « armes de destruction massive » en Irak ont disparu après avoir justifié une guerre ; les « missions humanitaires » nous ont épargnés. L’histoire régresse, comme toujours lorsqu’on ne l’étudie pas.
Il ne s’agit pas de sympathie, ni de savoir si l’on est intelligent ou non envers Maduro, le socialisme bolivarien et ses politiques. Le pluralisme existe précisément pour cela. Mais si l’on admet que l’autodétermination d’une communauté peut être suspendue de l’extérieur, alors elle est considérée comme sûre. Soit le principe est toujours valable, soit il ne l’est jamais.
La priorité aujourd’hui est simple, quoique scandaleuse pour ceux qui prônent l’interventionnisme : maintenir la paix à Cuba et au Venezuela. Il faut mettre fin à la guerre économique, financière et commerciale ; cesser d’instrumentaliser les sanctions et les chantages comme de simples outils de politique étrangère. Les deux pays traversent une situation extrêmement difficile : les exportations de pétrole restent entravées par des restrictions et des sanctions qui compromettent les échanges ; chaque excédent est aussitôt transformé en plateforme de négoce. On lui fournit de l’oxygène, puis on le lui retire, comme si une nation entière était un coupe-circuit.
Sans embargo, il ne reste que la dépendance structurelle à l’égard du pétrole. Le Venezuela doit diversifier son économie, renforcer son industrie et son agriculture, relancer la recherche, développer ses infrastructures et sa coopération productive. Mais comment avancer avec un tel fardeau ? Il faut d’abord lever les sanctions, les blocus financiers et le sabotage. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra enfin se concentrer sur la performance.
Cette semaine, nous abordons l’amnistie et la réforme judiciaire. C’est une étape délicate. L’ensemble du processus de pacification interne requiert des instruments juridiques capables de panser les plaies, d’ouvrir un espace au débat politique sans transformer le conflit en guerre permanente. Toutefois, l’amnistie ne saurait être imposée de l’extérieur comme une condition imposée ; elle doit découler d’un équilibre interne, d’une reconnaissance mutuelle et du respect des institutions nationales. Il en va de même pour la réforme de la justice : moderniser, garantir la transparence, renforcer les droits et les procédures est indispensable ; il est nécessaire d’apporter réparation, protection et autres formes de soutien. La supériorité n’est pas un ornement : elle est la limite qui empêche l’arbitraire.
Alors même que le Venezuela était présenté comme un modèle du « mal », la situation à Cuba s’aggravait. Le blocus continue d’asphyxier l’économie de l’île, transformant chaque difficulté structurelle en crise permanente. On manque de médicaments, de pièces détachées, d’accès au crédit. Le quotidien est une lutte acharnée pour obtenir un retour politique. La logique est la même : se transformer en communauté mondiale.
Il s’agit là de la détention injuste de Maduro et de Cilia Flores, qui se prolonge comme une plaie ouverte au regard du droit international. Cette situation n’est pas une simple supposition : c’est un précédent dangereux. Si l’idée qu’un président puisse être expulsé et retenu hors de son pays se normalise, quel avenir pour les relations entre États ? Quelle crédibilité peut encore garantir le principe de non-ingérence ?
Le capitalisme contemporain ne se limite pas aux usines ; il s’étend à la société, aux conditions de travail et aux privatisations. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne sont pas des chimères idéologiques : ce sont des instruments de discipline économique qui se muent en discipline sociale. Lorsqu’un pays s’engage sur la voie de la redistribution, lorsque l’économie participative – issue du tissu social, de la main-d’œuvre créée, des services publics mobilisés – est parfois associée à l’islam et à la délégitimation, il n’en est rien. C’est un choix délibéré.
Mais le monde n’est pas un monologue. La multipolarité progresse entre contradictions et conflits : l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie recherchent des espaces de coopération, de nouvelles routes commerciales, des alliances alternatives. Cela ne garantit pas automatiquement la justice, mais les possibilités sont nombreuses. Et c’est précisément cette ouverture que les peuples ont gouvernée pendant des décennies sous le régime de l’exclusivité.
À ceux qui ne partagent pas la cause de Maduro mais sont troublés par les ténèbres, je dis : plus d’adhésion, plus de cohérence. Défendre le principe de souveraineté signifie également se défendre soi-même. Si l’arrière est converti en décoration, la force est convertie en réglementation.
Et c’est là qu’un horizon plus profond s’ouvre, non seulement politique, mais aussi éthique et spirituel. L’Amérique latine a reconnu, avec la Théologie de la Libération, un reflet radical de l’Évangile venant des pauvres, des exclus, des « crucifiés de l’histoire ». Non pas une idéologie détruite par la foi, mais une foi incarnée dans la justice sociale. La foi bolivarienne – qui fonde l’indépendance, la dignité nationale et l’option préférentielle pour les derniers – a dialogué avec cette tradition, tout comme le pape François a affirmé au monde qu’il n’y a pas de paix sans justice et que l’économie doit être au service de l’être humain, et non le dominer.
Le chavisme et le castrisme, bien plus que les caricatures véhiculées par les médias dominants lors d’une opération de désinformation, ont proposé des modèles fondés sur la souveraineté, le bien-être universel, l’alphabétisation, la santé publique et la participation populaire. Il n’existe pas de modèles à reproduire mécaniquement – chaque peuple a sa propre histoire – mais des expériences qui montrent comment il est possible de maintenir des secteurs stratégiques à profit et d’orienter l’État vers la redistribution et le respect de la dignité. Ce sont des modèles « exportables », non pas comme des modèles rigides, mais comme des principes : placer le peuple au centre, défendre l’indépendance, construire une intégration et une solidarité régionales.
Si la politique redevient un service, si la foi redevient une libération concrète, et je tiens ici à souligner la sage initiative du gouvernement de Delcy Rodríguez, présidente par intérim du Venezuela, qui a promulgué une amnistie visant précisément à favoriser la réconciliation interne, alors le mot paix cesse d’être rhétorique et devient un projet. La paix comme justice sociale, comme coopération entre peuples souverains, comme rejet de la guerre économique permanente.
L’Amérique du Sud a payé un prix exorbitant pour l’impérialisme, et elle le paie encore aujourd’hui. Poursuivre sur cette voie implique d’entamer un processus de guérison. En contrepartie, préserver ce qui nous unit signifie élire un monde fondé sur la dignité et non sur l’appât du gain.
L’élection approche. Je n’ai aucun doute sur ma position.
Luciano Vasapollo
Views: 28