Il faut relancer le débat sur l’échec stratégique de la « gauche » et particulièrement des partis communistes européens, non pas depuis 15 ans et l’émergence de cette « nouvelle nouvelle gauche » mais depuis 50 ans, depuis le tournant euro-communiste, le dos tourné aux pays socialistes (qui a contribué à alimenter la crise de 1989-1991) et l’abandon de la perspective de la révolution sociale. Cet article a le mérite de soulever ce débat et de nous permettre un retour particulier sur les quinze dernières années, mais je dois dire que je suis davantage en accord avec le commentaire de Danielle qui en appelle au retour au combat communiste, qu’avec les conclusions de l’article où l’on sent poindre le renouvellement d’une nouvelle tentative de la « gauche radicale ». La « gauche » moderne, c’est en fait le nom qui a été donné, notamment en France, à un projet politique de réinvention du réformisme et de l’opportunisme destiné à marginaliser les partis communistes, à empêcher leur reconstruction. « L’union de la gauche » était censée permettre de « changer la vie », puis de « combattre l’extrême-droite ». Elle a surtout servi à empêcher la sévère critique que méritaient le réformisme et l’opportunisme. Sur ces bases fausses, les acquis historiques de la Libération ont été liquidés, l’industrie a été détruite, les classes populaires ont été laminées et l’extrême-droite a prospéré comme jamais. Le projet de Thorez, Duclos, Frachon et de toute cette génération qui a construit le parti et en a fait la première force politique du pays n’était pas celui-là. C’était l’unité de la classe ouvrière, par le Front Unique ouvrier, qui dénonça sans relâche le réformisme, en particulier dans le mouvement syndical, développant une puissante génération de cadres syndicaux révolutionnaires, qui formeront l’ossature de la CGT réunifiée de 1945. C’était ensuite, lorsque les conditions historiques avaient évolué, c’est-à-dire lorsque la social-démocratie comprit que le développement du fascisme menait à sa liquidation avec les exemples italien, allemand et espagnol et réalisait un tournant politique en conséquence, lorsque le peuple dans son ensemble réalisait l’imminence du danger fasciste, l’unité du peuple à travers le Front populaire. Enfin, après une nouvelle étape historique, lorsque la trahison des classes dirigeantes fut consommée, ce fut l’unité de la nation à travers le Front National, le vrai, celui de la résistance et non l’organisation fondée par Le Pen et des résidus des SS dans les années 1970. L’articulation de ces trois étapes peut se présenter différemment dans des conditions historiques nouvelles, qui sont celles, comme le dit Danielle, du vent de l’histoire qui tourne, sous l’effet du développement historique des pays du Sud, dans la brèche ouverte contre le mur du sous-développement par la Chine socialiste. Mais la réarticulation nécessite une analyse fine et réaliste, et non la confusion la plus totale des notions pour servir simplement de couverture au pire opportunisme, schéma que nous voyons malheureusement se reproduire sans fin depuis des décennies (note de Franck Marsal pour Histoire&Société).
Ces décennies, comme je l’analyse dans mon livre à paraître en 2026, le Zugzwang ou la fin du libéralisme libertaire, et après ? (1) ont commencé au moins dans le années 1980, et celle qui s’étend en Europe à partir de 2010, dans le monde, a atteint aujourd’hui la fin peu glorieuse de cette dérive qui a été d’abord comme Syriza anticommuniste sur le fond. C’est ce qui se passe en France, avec l’incapacité à se mobiliser contre la guerre et les sordides élections municipales. Depuis 1980, le PCF s’est auto-liquidé et ceux qui ont accompli cela sont toujours en place, censurent, étouffent tout ce qui peut naître, entretiennent la division, la médiocrité (2). Cela s’accompagne de ce parfum de mort autour de l’icône que parait mériter la « République française » et sur laquelle, à l’inverse de cette incroyable classe politico-médiatique j’ai honte de voir ce qu’elle est devenue, comme notre malheureux pays en plein accès de pétainisme. C’est cette histoire qui est en train de s’achever alors que le « vent de l’Histoire » a tourné que je décris dans « le Zugzwang » ou « c’est la fin du libéralisme libertaire, et après? « . Ceux qui auront le courage et la lucidité de tirer un trait sur les « illusions » de l’eurocommunisme, du mitterrandisme se placeront peut-être en position de la victoire d’un autre monde et ils surmonteront les divisions en choisissant le sens de l’histoire, de la paix et du développement (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete).
(1) je rappelle que le Le zugzwang est une situation aux échecs où le joueur n’a plus aucun mouvement favorable possible – toute action de sa part entraîne une détérioration fatale de sa position sur le plateau de jeu.
(2) après la prestation du député de la Seine saint Denis, Peu, président du Groupe de la Gauche démocratique, au meeting de la LFI, qui vise entre autres le maire de Saint-Amand-les-Eaux, il va peut-être être difficile d’expliquer qu’il est légitime de censurer l’ignoble stalinienne que serait Danielle Bleitrach dans l’Huma, la propriété des mêmes… et que tout cela ne fait pas le lit de l’extrême-droite, je dis ça, je dis rien, de toute façon malheureusement cela n’a plus grande importance…
Par Vladimir Bortun
Il y a dix ans, des partis contestataires du sud de l’Europe étaient élus sur la promesse de transformer le capitalisme. Leur échec recèle des leçons que la gauche contemporaine ne peut ignorer.

Alors que de nouveaux projets de gauche prennent de l’ampleur – du récent triomphe de Mamdani à l’émergence d’un nouveau parti de gauche en Grande-Bretagne – il est pertinent de revenir sur le « moment de la gauche » en Europe dans les années 2010. Il y a dix ans, les espoirs étaient grands. Bien que le gouvernement SYRIZA vienne de capituler face à la Troïka, on fondait encore des espoirs sur d’autres partis de gauche d’Europe du Sud (Podemos, le Bloc de Gauche), un Parti travailliste britannique revigoré et le nouveau parti de Mélenchon en France. Dix ans plus tard, pourtant, le néolibéralisme reste fermement ancré, de plus en plus autoritaire et ouvertement belliciste. Pire encore, l’extrême droite s’est imposée comme le principal adversaire du centre politique, malgré le caractère largement illusoire de sa prétendue rupture avec l’orthodoxie néolibérale. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pendant une grande partie de la période qui a suivi la Guerre froide, la gauche radicale européenne est restée marginale. L’effondrement du bloc de l’Est a non seulement sapé le socialisme d’État comme modèle, mais aussi l’idée même d’une alternative systémique au capitalisme. Les années 1990 et 2000 ont été marquées par le triomphe de l’hégémonie néolibérale et l’érosion de la conscience de classe. Durant cette période, la gauche radicale a recueilli en moyenne à peine 6,6 % des suffrages aux élections nationales.
Pourtant, le tournant néolibéral de la social-démocratie a créé un vide politique. À partir de la fin des années 1990, de nouvelles formations de gauche ont émergé : Die Linke en Allemagne, le Parti de Gauche en France, SYRIZA en Grèce, le Bloco de Esquerda au Portugal et, plus tard, Podemos en Espagne. Ces partis se sont positionnés comme des alternatives à la fois à la social-démocratie néolibéralisée et aux partis communistes sclérosés, incapables de se connecter aux nouvelles franges militantes issues du mouvement altermondialiste.
La crise de la zone euro des années 2010 a offert une opportunité à ces partis. En Grèce, en Espagne et au Portugal, l’austérité, imposée initialement par des gouvernements de centre-gauche, a provoqué d’importantes vagues de résistance populaire. Si les syndicats ont parfois joué un rôle, la contestation a surtout pris la forme de mouvements sociaux de masse, de désobéissance civile et de réseaux de solidarité citoyenne. Certains de ces nouveaux partis, notamment SYRIZA et Podemos, se sont intégrés avec succès à ces mouvements et en sont devenus les instruments politiques.
Au milieu de la décennie, alors que la mobilisation de masse s’essoufflait, les opportunités électorales atteignaient leur apogée. Rien qu’en 2015, SYRIZA accédait au pouvoir en Grèce, Podemos et Bloco réalisaient des résultats historiques, Jeremy Corbyn prenait la tête du Parti travailliste et Bernie Sanders lançait une campagne qui relançait la social-démocratie aux États-Unis. Avant Trump et le Brexit, il semblait que la gauche radicale avait pris l’ascendant, allant même jusqu’à empêcher l’extrême droite d’entrer au Parlement en Espagne et au Portugal.
Aucune de ces forces, cependant, n’a tenu ses promesses. La capitulation de SYRIZA face à la Troïka en juillet 2015 a marqué un tournant. Après avoir brièvement contesté l’austérité, le gouvernement a accepté un nouveau plan de sauvetage, de nouvelles coupes budgétaires et d’importantes privatisations. Ces politiques ont ouvert la voie au retour au pouvoir de la droite et à la transformation de SYRIZA en un parti social-démocrate de premier plan. Au Portugal, le soutien parlementaire prolongé du Bloco à un gouvernement de centre-gauche n’a eu que peu d’influence sur les politiques publiques, aboutissant à un effondrement électoral et à la montée du parti d’extrême droite Chega. Podemos a suivi une trajectoire similaire en entrant au gouvernement avec le PSOE, perdant ainsi son image d’opposant au système tout en permettant à son principal partenaire de s’attribuer le mérite de réformes modestes. Aujourd’hui, Podemos végète en bas des sondages, tandis que Vox progresse régulièrement.
Malgré l’opportunité historique créée par la crise financière, la gauche radicale n’est pas parvenue à infléchir l’ordre néolibéral. Des contraintes objectives étaient bien réelles : des syndicats faibles, un développement inégal au sein de l’UE, une classe ouvrière européenne fragmentée et, de fait, une gauche européenne elle aussi fragmentée. La conscience de classe s’est partiellement rétablie depuis 1989, mais elle demeure largement réformiste, hésitante à tirer des conclusions systémiques, même face à la catastrophe climatique, aux guerres et à l’aggravation des inégalités. Des décennies de domination néolibérale continuent de façonner l’horizon politique.
Pourtant, ces obstacles n’étaient pas insurmontables. La gauche radicale, certes contrainte par son contexte, a néanmoins fait des choix décisifs. Dans différents contextes nationaux, ces partis partageaient des caractéristiques programmatiques, stratégiques et organisationnelles communes qui expliquent à la fois leur ascension fulgurante et leur déclin, tout aussi rapide, qui a suivi.
Du radicalisme au réformisme
Être radical, c’est s’attaquer aux problèmes à la racine, c’est-à-dire au capitalisme lui-même. De ce point de vue, la gauche radicale des années 2010 était radicale par essence. Ces partis sont issus de traditions communistes non staliniennes : Bloco, des courants trotskistes, maoïstes et eurocommunistes ; SYRIZA, d’une coalition centrée sur le Synaspismos eurocommuniste ; Podemos, d’un mélange d’intellectuels populistes de gauche, de trotskistes et de militants indignés .
Avec le temps, cependant, leurs programmes se sont progressivement modérés. Les premières revendications de SYRIZA en faveur de la nationalisation ont cédé la place, dès 2015, à une plateforme social-démocrate se limitant à l’opposition à l’austérité et à la restauration de l’État-providence, sans même remettre en question l’appartenance de la Grèce à la zone euro. Ce refus d’envisager une rupture avec l’union monétaire a fatalement affaibli la position de négociation de SYRIZA et reflétait une vision néo-réformiste plus large : la tentative d’apaiser le capitalisme néolibéral par la représentation plutôt que par la confrontation.
Les défenseurs de cette approche affirmaient qu’une sortie de la zone euro aurait été catastrophique. Ce faisant, ils ne faisaient que reproduire la logique du « TINA » (« il n’y a pas d’alternative ») et supposaient un équilibre statique des forces de classe. Pourtant, le référendum Oxi a brièvement démontré la possibilité d’un changement radical, si le gouvernement avait choisi de mobiliser sa base et de mettre en œuvre des mesures telles que le contrôle des capitaux, la nationalisation des banques et une politique industrielle étatisée. Cette alternative n’a jamais été sérieusement envisagée, car SYRIZA avait déjà renoncé à tout programme de transition au-delà du capitalisme.
Bloco a suivi une trajectoire similaire. Axé principalement sur la défense de l’État-providence, il a soutenu à deux reprises un gouvernement social-démocrate sans proposer d’alternative socialiste crédible. Lorsqu’il a retiré son soutien en 2022, il était devenu indissociable du statu quo et en a payé le prix électoral. La trajectoire modérée de Podemos a été encore plus rapide : adoptant ouvertement un programme néo-keynésien et social-démocrate, il a obtenu des réformes gouvernementales limitées, mais celles-ci ont été instrumentalisées politiquement par le PSOE.
Cette modération programmatique était motivée par des considérations électorales. En quête d’« éligibilité », ces partis se sont limités à ressusciter des éléments du keynésianisme d’après-guerre – hausse des impôts, protection sociale, services publics – associés à une politique culturelle progressiste. Or, les conditions qui permettaient jadis de telles réformes au sein du capitalisme n’existent plus. Dans la polycrise actuelle, le néo-réformisme ne conduit pas à la réforme, mais à l’adaptation et, à terme, à l’absorption par le statu quo.
Des rues aux institutions
L’essor de la gauche néo-réformiste reposait non seulement sur les programmes anti-austérité, mais aussi sur son engagement précoce auprès des mouvements de masse. SYRIZA, Bloco et Podemos ont d’abord fonctionné comme des partis-mouvements, transformant la résistance sociale en capital politique. Les liens étroits de SYRIZA avec les mouvements sociaux grecs ont permis son ascension fulgurante en 2012, lorsqu’elle a détrôné le PASOK comme principal parti de gauche. Cependant, ce succès a engendré un relâchement. Face au déclin de la mobilisation sociale, le parti s’est résolument tourné vers la politique parlementaire, négligeant les forces populaires qui l’avaient initialement porté.
Ce tournant institutionnel a abouti à la dépendance de SYRIZA envers les négociations de haut niveau avec la Troïka. Le référendum Oxi aurait pu marquer un retour à la mobilisation de masse et une contestation européenne de l’austérité. Au lieu de cela, il est resté une manœuvre tactique au sein d’une stratégie globale confinée aux limites de la démocratie capitaliste. Le parti a perdu pour avoir choisi de jouer à un jeu dont les règles avaient été fixées par ses adversaires.
L’obsession parlementaire du Bloco, durant ses années de soutien à un gouvernement minoritaire, a également érodé son ancrage populaire. Podemos s’est institutionnalisé encore plus rapidement, proclamant explicitement un passage de la mobilisation aux institutions moins d’un an après sa fondation. Lors de la crise catalane de 2017, il s’est limité à un réformisme constitutionnel tandis que des manifestations de masse se déroulaient dans les rues.
Au niveau européen, l’institutionnalisme était encore plus marqué. La coopération transnationale était minimale, se limitant à des gestes symboliques et à une faible coordination au Parlement européen. Même lors de la confrontation de SYRIZA avec la Troïka, aucun effort sérieux n’a été entrepris pour constituer un front paneuropéen contre l’austérité. L’occasion de raviver l’internationalisme de gauche a été gâchée, laissant aujourd’hui la gauche radicale européenne plus fragmentée que jamais depuis 1989.
Organisation interne
La modération programmatique et l’institutionnalisation stratégique se sont reproduites en interne. Les partis, initialement pluralistes et démocratiques, se sont progressivement bureaucratisés, souvent pour étouffer la dissidence interne face à cette modération. La transformation de SYRIZA d’une coalition en un parti unitaire était logique, mais elle s’est traduite par une concentration du pouvoir au sommet, privant de pouvoir la base. L’entrée au gouvernement a accéléré ce processus, ouvrant la voie aux carriéristes et à une dérive constante vers la droite. L’élection, certes éphémère, d’un ancien banquier de Goldman Sachs à la tête du parti a symbolisé sa dégénérescence.
Bloco et Podemos ont suivi des trajectoires comparables. Les organisations fondatrices de Bloco se sont dissoutes dans un appareil étroitement contrôlé, tandis que Podemos a rapidement centralisé la prise de décision grâce à des mécanismes en ligne qui ont atomisé ses membres. La participation massive initiale a cédé la place à une démobilisation et à une personnalisation autour d’Iglesias, dont le départ a laissé un vide qui reste à combler. Paradoxalement, tous ces développements étaient justifiés, souvent explicitement, par un rejet du centralisme démocratique « léniniste », mais ce que la gauche néo-réformiste a finalement reproduit, c’est sa caricature bureaucratique : un centralisme sans démocratie. Ce faisant, elle a trahi sa promesse initiale de construire un parti de gauche d’un genre nouveau.
Leçons pour la gauche
Après des décennies de néolibéralisme et dans un contexte de polycrise systémique croissante, la gauche européenne est confrontée à une crise qui s’annonce longue et profonde. Les syndicats sont affaiblis, les partis ouvriers de masse ont disparu, la conscience de classe est en décalage avec les réalités matérielles et la gauche révolutionnaire est fragmentée et marginalisée. Dans ce contexte, l’expérience de la gauche d’Europe du Sud, dix ans plus tard, offre trois enseignements importants.
Premièrement, la gauche ne peut se contenter de gérer le capitalisme. Les réformes sont nécessaires, mais elles doivent s’inscrire dans un programme radical de démocratie économique et politique. Sans ce lien entre les revendications immédiates et la transformation systémique, le réformisme est voué à l’échec.
Deuxièmement, le véritable pouvoir émane de la mobilisation des masses. La politique électorale et l’activisme citoyen ne sont pas des voies alternatives, mais des stratégies complémentaires, les deux faces d’une même pièce. Les partis de gauche radicale doivent redevenir des partis-mouvements et le rester, plutôt que de troquer l’un contre l’autre au premier signe de succès électoral.
Troisièmement, l’unité est essentielle. La fragmentation au sein de la gauche radicale dépasse aujourd’hui largement les véritables divergences politiques. De même, tout projet d’unité doit être pluraliste et démocratique, alliant débat interne et action coordonnée. Correctement compris et appliqué (et non pas simplement revendiqué de façade), le centralisme démocratique demeure indispensable.
Le capitalisme a longtemps clamé son invincibilité. Une grande partie de la gauche a intériorisé cette idée, limitant ses ambitions à la gestion ou à une réforme superficielle du système. Pourtant, les inégalités, l’autoritarisme, la catastrophe climatique et la guerre poussent de plus en plus de personnes à remettre radicalement en question ce système qui, comme tous les systèmes qui l’ont précédé, pourrait sembler immuable. La gauche doit s’adapter à ce courant historique et retrouver le courage de lutter pour une société nouvelle.
Contributeurs
Vladimir Bortun est un politologue spécialiste des partis de gauche, des élites politiques et de la politique transnationale. Il est l’auteur de *Crise, austérité et coopération transnationale entre partis en Europe du Sud : la décennie perdue de la gauche radicale* .
Views: 433




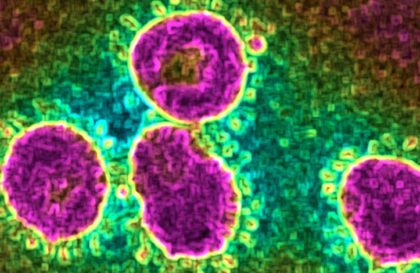
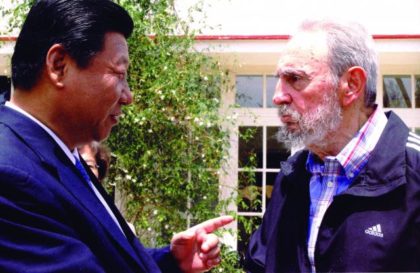

RV
…/… Être radical, c’est s’attaquer aux problèmes à la racine, c’est-à-dire au capitalisme lui-même. De ce point de vue, la gauche radicale des années 2010 était radicale par essence. …/…
Cette affirmation demanderait un minimum de développement, non ?
…/… Le capitalisme a longtemps clamé son invincibilité. Une grande partie de la gauche a intériorisé cette idée, limitant ses ambitions à la gestion ou à une réforme superficielle du système. …/…
Celle-ci me parait plus en adéquation avec notre réalité présente.
Concernant le volet économique je vous soumets ces propositions de Paul Jorion publiées dans Le Monde Économie le 24.04.2012.
Elles me paraissent radicales et il me semble qu’aucun parti ou mouvement ou syndicat ne s’en soient jamais soucié mis à part les hausses de salaire. Mais je peux me tromper, bien sur.
* Accorder à nouveau la priorité aux salaires plutôt que favoriser l’accès au crédit, lequel est nécessairement cher et se contente de repousser à plus tard la solution de problèmes se posant d’ores et déjà.
* Bannir la spéculation en rétablissant les articles de loi qui l’interdisaient dans la plupart des pays jusqu’au dernier quart du XIXe siècle.
* Mettre hors d’état de nuire les paradis fiscaux en interdisant aux chambres de compensation de communiquer avec eux dans une direction comme dans l’autre.
* Abolir les privilèges des personnes morales par rapport aux personnes physiques, privilèges ayant permis de transformer de manière subreptice dans nos démocraties le suffrage universel en suffrage censitaire.
* Redéfinir clairement dans les textes légaux l’actionnaire d’une société comme étant l’un de ses créanciers (un contributeur d’avances, autrement dit un prêteur) et non l’un de ses propriétaires.
* Établir les cours à la Bourse par fixing journalier ou hebdomadaire.
* Éliminer le concept de « prix de transfert » qui permet aux sociétés d’échapper à l’impôt par des jeux d’écriture entre maison-mère et filiales.
* Supprimer les stock-options pour instaurer une authentique participation universelle.
* Ré-imaginer les systèmes de solidarité collectifs, au lieu des dispositifs spéculatifs voués à l’échec en raison de leur nature pyramidale que sont l’immobilier ou l’assurance-vie, par lesquels on a cherché à les remplacer.
Xuan
Il ne s’agit pas de l’invincibiblité du capital mais de celle de l’Etat qui est son instrument.
Et les réformes de Jorion, aussi utiles soient-elles, n’auraient de légitimité et d’existence qu’après la prise du pouvoir par l’avant-garde organisée du prolétariat, son parti communiste.
Toute notre expérience le démontre et d’abord ce bilan historique de Bortun, dont lui-même ne tire pas les conclusions qui s’imposent. Aucune société nouvelle ne peut remplacer la société capitaliste si l’Etat n’est pas renversé et seul un parti révolutionnaire peut diriger une telle entreprise. Il ne peut pas la confier à la social-démocratie sinon c’est elle qui dirige et qui prolonge l’agonie. L’union de la gauche ne peut s’établir qu’avec la fin de la direction social-démocrate. L’unité elle-même impose la destruction radicale de cette direction dans tous les domaines, idéologique, politique et organisationnel.