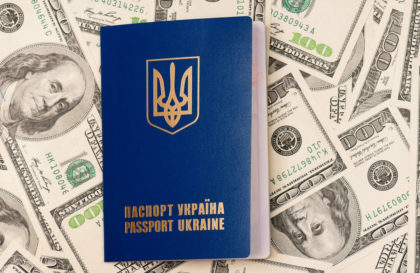En ce moment, il est difficile de croire que l’on pourra remonter à l’origine de ce qui nous a détruit, nous les communistes occidentaux, français et avec nous la nation française elle-même, une vie politique qui avait du sens, ce qui manque cruellement à tout ce landernau qui tel les insectes de la nuit se tordent et se débattent sous les projecteurs d’une vie politique réduite à cette exposition. Une vie politique qui fonctionne avec des « coups » et des propositions que rien ne rend crédible surtout pas l’état de conscience rétréci que l’on a entretenu dans un peuple excédé avec le renoncement au théorique comme l’a été la destruction de l’organisation militante et citoyenne – celle qui donnait encore du sens aux élections – et de la profondeur historique aux enjeux des dites élections. S’agiter en s’imaginant que l’on va pouvoir longtemps proclamer la paix et le travail sans le moindre effort en ce sens est la reconnaissance d’un « malaise » dans notre « civilisation » sans encore oser la prise de conscience de la réalité géopolitique du « monde dit multipolaire » qui est déjà là, même si on continue à feindre de l’ignorer et à mesurer que la tension vers le socialisme, est déjà la phase d’aujourd’hui alors que Trump le syndic de faillite tente de survivre en prenant ses « alliés » comme des marchepieds. Difficile de croire aux « possibles » mais peut-on faire autrement et ne pas laisser la chance à ce filet d’espérance qui parle encore de « travail » et de paix en espérant qu’il y aura un sursaut de la base pour donner du contenu à cette proclamation. (note et traduction de Danielle Bleitrach)
Monde 18 novembre 2025

LES CONDITIONS POUR REPARLER DE SOCIALISME
Par Piero Bevilacqua
À l’époque, les forces politiques que nous appelons aujourd’hui la Gauche étaient connues sous le nom de Mouvement ouvrier (partis communistes et socialistes, syndicats de classe, etc.), elles opéraient dans leurs sphères nationales respectives, animées par la conscience d’être héritiers d’une longue histoire de lutte et de conquête, d’appartenir à un mouvement international et d’avancer vers l’avenir selon un programme de revendications immédiates et un projet de construction d’une société. Tout ce processus, qui a impliqué des millions de personnes, s’est accompagné d’une analyse constante et d’un développement intellectuel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des parties, qui ont apporté analyse, connaissances et perspectives pour les besoins quotidiens. Depuis plusieurs décennies, cette dimension intellectuelle, culturelle, morale et eschatologique qui accompagnait l’action politique a été abandonnée par presque tous les partis. L’héritage théorique qui donnait de la profondeur à l’action pratique a été abandonné comme de la ferraille. Aujourd’hui, tout tourne autour du présent, et l’horizon du front réformiste se limite, au mieux, à des revendications de « plus de ressources pour la santé publique », « plus d’argent pour les écoles », « plus grande équité sociale » et aux banalités habituelles de la propagande. Ce que j’ai l’intention d’illustrer ici, c’est pourquoi cela s’est produit et quelles forces historiques ont conduit à la défaite actuelle. Et, sur la base de cette clarification, je voudrais suggérer les conditions qui peuvent revitaliser la politique en tant qu’agent de transformation sociale, un projet pour une nouvelle organisation de la société. Je commence par affirmer que le grand effondrement subi par le mouvement ouvrier organisé a été, à mon avis, causé par deux agents et processus convergents : le succès de l’initiative capitaliste dans deux pays clés, le Royaume-Uni et les États-Unis, et l’effondrement de l’Union soviétique.
1. La soi-disant mondialisation depuis les années 1990 oppose la mobilité mondiale du capital à la fixité nationale du travail et aux contraintes de la politique dans l’espace de l’État-nation.
Une asymétrie marquée est apparue. En réponse aux revendications syndicales, le capital peut fuir vers les pays pauvres pour exploiter leur travail, tandis que les travailleurs des sociétés industrialisées plus anciennes manquent de ressources. Ainsi, le conflit s’affaiblit, la politique de classe disparaît et l’administration du statu quo est maintenue. De plus, les doctrines néolibérales ont eu une grande capacité de pénétration hégémonique, se présentant, à cette période historique, comme un vaste patrimoine d’idées, chargé de propositions libératrices et d’une grande attraction. Quiconque lit certaines œuvres de Friedrich von Hayek, par exemple, ne peut s’empêcher d’être surpris par le radicalisme presque anarchique avec lequel il exalte les libertés individuelles. Cependant, au-delà du pouvoir que le mouvement néolibéral a réussi à déployer pour rallier les élites occidentales, ce paradigme d’idées a non seulement attaqué un marxisme réduit à une idéologie de développement économique, mais a aussi fait que les réalisations de la classe ouvrière des décennies précédentes (qui avaient sapé, à cause de puissants mouvements de protestation, le processus d’accumulation capitaliste) semblaient être des enracinements bureaucratiques et des privilèges corporatifs qui freinaient le développement et empêchaient la machine économique de produire de la richesse avec plus de liberté et d’étendue. Cette richesse qui, selon la théorie trompeuse du ruissellement, pourrait alors être utilement répartie aussi entre les classes ouvrière et populaire. C’était, au fond, le message simple et puissant qui a séduit même les dirigeants communistes et socialistes, et qui continue de les séduire, même s’ils ne sont plus communistes ni socialistes.
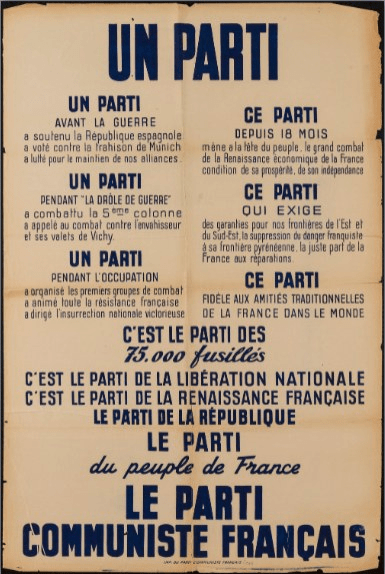
2. Cette interprétation du capitalisme, qui le situe comme sans classes et avec une vision développementiste, a contribué de manière significative à une évaluation profondément erronée de la dissolution de l’URSS : un événement qui a poussé les forces progressistes à considérer l’histoire de la première révolution prolétarienne comme une grande erreur. L’immobilité bureaucratique de cette société, encore plus évidente dans l’élan éblouissant que les sociétés capitalistes occidentales avaient acquis, facilita l’acceptation de cette version. Je dois maintenant souligner que dans cette grande expérience qu’a été la Révolution d’Octobre, il y a eu des limitations et des erreurs initiales, en partie liées à l’immaturité historique de la situation russe, en partie de nature théorique, qu’on ne peut ignorer. Peut-être les plus importantes furent la demande d’une économie entièrement gérée d’en haut et l’abolition totalitaire du marché. C’est un point que nous devrons aborder si nous voulons rétablir une société socialiste, mais interpréter l’expérience soviétique du point de vue occidental est non seulement historiquement erroné et injuste, mais a aussi facilité la dissolution de la gauche et conduit aux aberrations bellicistes actuelles.
C’est une erreur, car cela ignore les grandes avancées sociales réalisées à cette époque : écoles et universités ouvertes à tous, soins de santé gratuits et de qualité, transports publics abordables, alimentation abordable (bien que mal répartie) et rythme de travail décent. Et la protection contre la misère est sans aucun doute l’une des libertés les plus importantes. Un niveau d’égalitarisme qui ne peut qu’être admiré aujourd’hui, surtout à la lumière des immenses inégalités dans lesquelles sont tombées les sociétés capitalistes. Aujourd’hui, la pauvreté de la classe ouvrière et l’esclavage rural ont refait surface. Je rappelle ici que, pendant la guerre froide, une tactique de communication pernicieuse a dominé l’Occident. Au lieu de comparer les problèmes de l’URSS à ceux de l’Occident et vice versa, nos médias comparaient les lacunes soviétiques aux aspects les plus réussis de la société américaine et européenne. Ainsi, dans l’imaginaire occidental, cette société a été ensevelie sous le stéréotype unidimensionnel du pouvoir censorial et antilibéral et de l’insuffisance de l’appareil de distribution.
De plus, l’évaluation des causes de l’effondrement de l’URSS souffre d’une grave erreur, car elle manque d’une perspective de classe sur les processus et, plus précisément, d’une perspective historique. En effet, la construction de l’État soviétique ne peut être distraite du contexte des soixante-dix ans durant lesquels il a opéré et, surtout, des guerres, du sabotage et des luttes politiques, culturelles et médiatiques avec lesquelles l’Occident a tenté de l’étouffer. Le siège a commencé l’année de sa fondation, en 1918, avec le déclenchement de la guerre civile et l’envoi de forces expéditionnaires européennes et américaines pour soutenir l’Armée blanche. On oublie presque toujours que l’invasion d’Hitler en 1941 était aussi motivée par le désir d’étouffer l’État communiste dans ce pays. L’importance de cette guerre pour le développement futur de la société soviétique est donc ignorée. La Russie a subi non seulement entre 20 et 27 millions de morts, mais aussi d’innombrables personnes mutilées et handicapées, avec lesquelles l’économie et l’industrie soviétiques, dévastées par les bombardements allemands, ont dû composer dans la période d’après-guerre. Et c’était contre un pays si affaibli que, à partir de 1945, sous l’administration Truman, les États-Unis lancèrent la guerre froide et la campagne anticommuniste. Depuis lors, l’URSS, qui avait toujours vécu avec le syndrome d’encerclement, a été contrainte de gaspiller d’immenses ressources dans des politiques d’armement, détournant les investissements des matières premières et déformant irrémédiablement son économie avec de graves conséquences sociales et politiques. Cela a duré près de 70 ans. Bien sûr, cela n’absous pas la dictature stalinienne précédente, ni les presque deux décennies d’inertie bureaucratique de Brejnev, ni les diverses erreurs des classes dirigeantes. Mais l’histoire de l’URSS, qui n’est pas celle de n’importe quel pays, mais celle d’un État anticapitaliste, d’un État socialiste, ne peut être comprise sans connaître l’histoire de la politique étrangère américaine, c’est-à-dire la lutte systématique et implacable menée contre elle par l’État capitaliste le plus puissant de la planète.
3. Les derniers dirigeants des partis communistes et socialistes européens n‘ont pas compris la signification anti-socialiste et anti-ouvrière de la victoire du monde capitaliste. Ils appréciaient et valorisaient la conquête des libertés formelles et la vague de libéralisme qui a inondé cette société inefficace, mais ils condamnaient la mémoire de ce pays sans rien comprendre, sans même considérer la catastrophe qui a frappé la société russe avec « l’ouverture au marché » durant la décennie de Boris Eltsine. Une longue damnatio memoriae qui a créé une fracture épique non seulement avec le passé russe, mais aussi avec toute l’histoire du mouvement ouvrier commencé au XIXe siècle. Par conséquent, lorsque Vladimir Poutine a pris la présidence de la Fédération, redonnant vie à un pays dévasté et anarchique, et ne pouvant le faire que par un processus systématique et autoritaire de reconstitution du pouvoir de l’État, ils ne considéraient que les éléments illibéraux d’une telle opération. Ils ont oublié que le président russe dirigeait désormais une société capitaliste ouverte au marché, au point qu’en 2002, il avait demandé à rejoindre l’OTAN.
L’abandon des catégories de classe dans l’analyse sociale et l’adoption de paradigmes néolibéraux ont conduit les représentants et intellectuels de la gauche résiduelle à interpréter les présidences de Poutine comme une réédition, avec de nouvelles formes, du pouvoir soviétique : Poutine en Staline moderne. Parallèlement, l’acquisition d’une vision euro-atlantique les a empêchés de percevoir l’agressivité sans précédent de l’empire mondial qu’étaient devenus les États-Unis : une puissance absolue qui exportait la démocratie au monde entier par des bombes et qui, après avoir gagné la guerre froide, cherchait à démanteler la Russie. Cela explique pourquoi la majorité du front démocratique et de gauche, tant en Italie qu’en Europe, avait peu de compréhension de la guerre en Ukraine et interprétait l’invasion de Poutine, qui – comme nous le savons aujourd’hui grâce à une bibliographie abondante – a été provoquée par le déploiement de l’OTAN à ses frontières et par le bruit des bombes ukrainiennes dans les régions russophones – comme une expression du revanchisme du « dictateur de Moscou ». Ainsi, interpréter la réponse armée de l’Ukraine à l’invasion russe comme la résistance de la démocratie contre l’Empire était l’option la plus simple et la plus rassurante pour ce front politique. Mais cette position majoritaire au sein des partis politiques, qui a conduit nombre de leurs dirigeants à converger vers les mêmes positions belliquistes que la plupart des membres de la droite (et même à les dépasser en ferveur de guerre), n’a pas seulement contribué à la défaite européenne actuelle. Cette interprétation nous empêche de comprendre le processus grandiose de changement dans l’équilibre global qui se déroule.
L’essor du Front des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui gouvernent une grande partie de la population mondiale, indique que les pays occidentaux ne peuvent plus piller leurs économies comme ils l’ont fait depuis cinq siècles. C’est fini. La Chine, l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et l’Iran – malgré les sanctions américaines – avec des économies industrielles florissantes et des populations jeunes, se développent rapidement et souhaitent négocier avec les puissances traditionnelles à armes égales.
Mais ce n’est pas tout. Le scénario véritablement catastrophique pour les États-Unis et l’Europe est que la tendance à la financiarisation, inhérente au capitalisme mature, sera accentuée par une concurrence insoutenable des pays émergents. Économies fictives, désindustrialisation, dette publique, chômage, bulles spéculatives sur le point d’éclater – c’est l’avenir possible pour les États-Unis et l’UE. Certains analystes sont confiants dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour réactiver le processus d’accumulation. Mais le potentiel économique de cette technologie réside dans la génération de richesse avec de moins en moins d’efforts : elle deviendra insoutenable dans une société organisée selon les horaires de travail du XIXe siècle et selon l’ancienne logique capitaliste. C’est la perception, plus ou moins claire, de cet avenir imminent qui conduit au désespoir parmi les élites occidentales, inadéquates et improvisées. Le comportement impitoyable de Trump, même face aux économies de ses alliés européens, n’est pas l’expression de sa psychopathie, mais le fruit d’une compréhension du piège dans lequel l’Empire est tombé. C’est le lion blessé et encerclé qui rugit et attaque à droite et à gauche.
4. C’est de cette perspective que nous devons analyser les faits et essayer d’imaginer quelles voies pourraient être empruntées pour une nouvelle vision stratégique des forces progressistes.
La première erreur que nous devons éviter est d’évaluer les forces du Sud global en fonction de ses systèmes internes. Bien que largement dirigés par des régimes illibéraux, il est nécessaire de se demander seulement si ces pays, libérés de la menace d’un changement de régime mené par les États-Unis, peuvent évoluer dans une direction démocratique et libérale. Qu’on le veuille ou non, c’est une vérité historique : notre libéralisme (et, plus récemment, notre démocratie) a été fondé sur la domination d’autres économies. Cela a empêché d’autres pays d’atteindre leurs propres réussites. D’un autre côté, il est clair que si un État du Sud global est amené à considérer chaque mouvement de protestation qui s’y installe comme une menace pour sa sécurité (parce que la CIA le manipule secrètement pour le renverser), la réponse sera toujours répressive. Et cela criminalise actuellement, et continuera de criminaliser, les conflits de classes dans de nombreuses régions de la planète. Par conséquent, la sécurité géopolitique de ces pays favorise le développement des partis politiques et des syndicats, des forces populaires et démocratiques.
Mais il existe une autre raison stratégique pour laquelle nous devrions accueillir favorablement ce développement. Ces pays conservent encore un immense héritage que nous avons perdu : une autonomie politique relative. Les États n’ont pas été privatisés, comme cela s’est produit en Occident. Ils ne se sont pas retrouvés entre les mains d’une classe politique vassale au service des intérêts des grands groupes industriels et financiers. Il suffirait de regarder non seulement Trump, qui entre et sort du monde des affaires pour occuper la présidence des États-Unis, mais aussi le chancelier Merz, qui est passé de BlackRock, le géant de la gestion d’actifs, à la direction de l’Allemagne, ou Draghi, globe-trotters de la finance internationale. L’élite politique, avec la disparition des grands partis de masse, est devenue une classe d’intermédiaires qui, si elle veut survivre, doit servir des intérêts plus puissants que ceux d’un État souverain. Et non seulement l’État est soumis à des intérêts particuliers, mais la société elle-même tend à se dissoudre dans l’accumulation progressive et privée de ses ressources. Cependant, ce n’est pas le cas des États que, de manière indiscriminée et avec une superficialité étonnante, nous méprisons comme autocratiques. Là-bas, la politique, autant que possible, même dans une économie substantiellement capitaliste, fonctionne principalement selon la logique publique, en tenant compte des intérêts collectifs du pays.
Par conséquent, la défaite des groupes dominants américains et de ce qui reste de l’UE, ainsi que l’affirmation d’un ordre international coopératif, constituent une condition indispensable pour rouvrir les perspectives d’un socialisme possible au XXIe siècle. Non seulement parce que, si le capital ne trouve plus de conditions favorables dans les pays auparavant pauvres, il aura de moins en moins de chances d’éviter le conflit. Et pas seulement, donc, parce que le nouvel espace supranational commun que l’UE ne nous a pas garanti sera créé. Mais parce que c’est la première base pour mener à bien la tentative ambitieuse, brillamment élaborée par Luigi Ferrajoli, d’une constitution pour la Terre (Pour une Constitution de la Terre, Feltrinelli, 2022) capable de garantir la paix et de sauver la biosphère de l’effondrement.
Et ce n’est pas tout. Enfin, l’Italie pourrait retrouver un statut perdu après la Seconde Guerre mondiale : la souveraineté (Luciano Canfora, Sovranità limitata, Laterza, 2023). Imaginez combien de temps il faudrait, dans les conditions actuelles, pour un gouvernement populaire cherchant à taxer sévèrement les grandes fortunes et les loyers fonciers, à stopper le pillage des villes et des territoires, à nationaliser les services stratégiques, etc. La fuite des capitaux exploserait immédiatement, le chantage des groupes financiers commencerait, les campagnes de diffamation se multiplieraient et des attaques terroristes auraient lieu. Nous rappelons donc à tous les démocrates atlantistes que la défaite de l’OTAN en Ukraine et la réduction de l’empire américain sont des conditions essentielles pour que l’Italie retrouve sa souveraineté, cette capacité à décider librement de son propre avenir que les États-Unis lui ont retirée pendant près de 80 ans.
Source : Sinistrainrete
Dans la production sociale de leur vie, les hommes établissent certaines relations nécessaires et indépendantes de leur volonté, relations de production correspondant à une phase déterminée de développement de leurs forces productives matérielles. L’ensemble de ces relations de production forme la structure économique de la société, la base réelle sur laquelle se dresse la superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent certaines formes de conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de la vie sociale politique et spirituelle en général. Ce n’est pas la conscience de l’homme qui détermine son être mais au contraire c’est l’être social qui détermine sa conscience. En arrivant à un stade donné de développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les relations de production existantes ou, ce qui n’est rien d’autre que l’expression juridique de cela, avec les relations de propriété dans lesquelles elles se sont déroulées jusqu’ici. De formes de développement des forces productives, ces relations deviennent des obstacles et ouvre ainsi une ère de révolution sociale.
Karl Marx
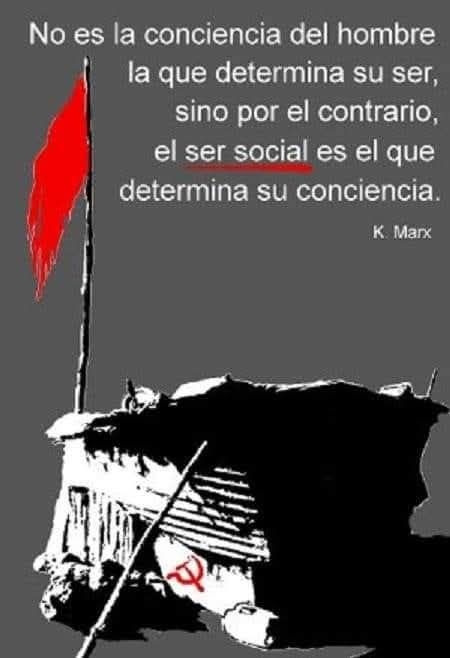
Views: 19