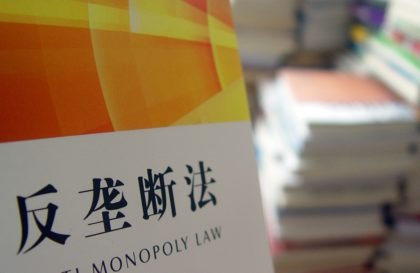Voici le dernier chapitre des tentatives sans fin et dérisoires de l’Amérique pour remodeler le Moyen-Orient à son image. Dans le cadre des descriptions du jour de la vanité des « élites » impérialistes, il ne faudrait oublier le revers de la médaille d’Israël, la corruption parallèle du monde arabe, d’Erdogan aux saoudiens autour de Daech. Et bien sur tout un chapitre devrait être consacré au rôle de la France, de Sarkozy à Macron, sans oublier Hollande, pas un pour sauver l’autre… (note et traduction de danielle Bleitrach)
par Leon Hadar13 novembre 2025

Le spectacle surréaliste d’Ahmed al-Sharaa se promenant dans la Maison-Blanche – saluant ses partisans, jouant au basket avec des responsables militaires américains et bavardant avec les dirigeants du Congrès – aurait été considéré comme un fantasme fiévreux il y a seulement deux ans.
Pourtant, nous sommes là, à regarder un ancien affilié d’Al-Qaïda, autrefois pourchassé par les forces américaines en Irak, recevoir le traitement royal d’un président américain qui l’a décrit comme un « jeune homme séduisant » avec un « passé très fort ».
Bienvenue dans le dernier chapitre des tentatives interminablement futiles de l’Amérique pour remodeler le Moyen-Orient à son image.
La visite d’Al-Sharaa à Washington le 10 novembre – la première d’un président syrien à la Maison Blanche – représente un remarquable revers de fortune pour un homme qui a passé des années dans des centres de détention américains et dont la tête était mise à prix de 10 millions de dollars.
L’administration Trump a maintenant suspendu les sanctions de la loi César pendant 180 jours et l’a retiré de la liste de désignation terroriste, tout cela dans le but d’enrôler la Syrie dans la coalition anti-ISIS et d’étendre potentiellement les accords d’Abraham.
Mais soyons clairs sur ce qui se passe ici : ce n’est pas un triomphe de la diplomatie américaine. C’est un résultat prévisible de l’habitude éternelle de Washington de passer en revue les hommes forts du Moyen-Orient, d’embrasser ceux qui semblent utiles à ce moment-là tout en oubliant commodément leurs histoires gênantes.
Suspects habituels, scénario habituel
Le consensus de Beltway s’est déjà formé autour de « l’ouverture » d’al-Sharaa. Les poids lourds de la région, l’Arabie saoudite et la Turquie, font pression en son nom, désireux de combler le vide laissé par l’Iran et la Russie en Syrie.
Les délégations du Congrès rompent le pain avec lui. L’administration serait en train d’établir une présence militaire sur la base aérienne de Mezzeh à Damas. Toute la machinerie familière de l’engagement américain au Moyen-Orient bourdonne. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?
Ceux qui ont la mémoire plus longue se souviendront peut-être d’enthousiasmes similaires : Saddam Hussein comme rempart contre le fondamentalisme iranien dans les années 1980 ; les moudjahidines afghans en tant que combattants de la liberté contre la tyrannie soviétique ; Les rebelles libyens en tant que réformateurs démocratiques. À chaque fois, Washington s’est convaincu d’avoir trouvé des partenaires authentiques qui partageaient les valeurs et les intérêts américains. À chaque fois, la réalité s’immisçait avec vengeance.
Le dilemme du réaliste
Pour être juste, s’engager avec la Syrie a un certain sens de sang-froid. La Banque mondiale estime que la Syrie a besoin d’au moins 216 milliards de dollars pour la reconstruction, de l’argent qui ne vient pas d’ailleurs.
Le gouvernement d’Al-Sharaa, quelles que soient ses origines, contrôle Damas et a montré sa capacité à mener des opérations contre les cellules de l’EIIS. L’alternative à l’engagement n’est pas une Syrie démocratique immaculée qui renaît de ses cendres ; C’est le chaos continu, les flux de réfugiés et l’instabilité régionale.
Mais reconnaître ces réalités n’a pas besoin de l’étreinte théâtrale à laquelle nous assistons. Il y a un vaste terrain d’entente entre traiter la Syrie comme un État paria et dérouler le tapis rouge à un dirigeant dont la transformation de djihadiste en homme d’État reste, au mieux, un travail en cours.
Le problème fondamental de la politique américaine à l’égard de la Syrie – et du Moyen-Orient au sens large – n’est pas qu’elle s’engage avec des personnages peu recommandables. Les relations internationales nécessitent souvent de traiter avec des acteurs de mauvais goût.
Le problème est que l’Amérique surestime constamment sa capacité à façonner leur comportement, interprète mal leurs intentions et ignore la probabilité que le partenaire stratégique d’aujourd’hui devienne le casse-tête stratégique de demain.
La Syrie est beaucoup plus importante pour l’Europe que pour les États-Unis, compte tenu de la proximité géographique et de la crise des réfugiés.
Pourtant, une fois de plus, Washington prend les devants tandis que les capitales européennes suivent timidement. Cette tendance – selon laquelle l’Amérique supporte les coûts et les risques des enchevêtrements au Moyen-Orient qui affectent principalement l’Europe – a persisté pendant des décennies, malgré les promesses périodiques de partage du fardeau transatlantique.
Une approche véritablement réaliste reconnaîtrait que la reconstruction, la stabilité et l’intégration de la Syrie devraient être principalement des responsabilités européennes, l’implication américaine se limitant à de véritables intérêts de sécurité. Au lieu de cela, nous reprenons notre rôle d’hégémon régional, avec des bases militaires, des initiatives diplomatiques et les inévitables déceptions qui s’ensuivent.
La distraction de l’EI
La justification ostensible de la cour d’al-Sharaa est d’amener la Syrie dans la coalition anti-EI. À l’arrivée d’al-Sharaa à Washington, la Syrie a lancé des raids visant des cellules de l’EI dans plusieurs villes – un moment opportun qui suggère une coordination minutieuse.
Mais ne prétendons pas que l’EI représente une menace existentielle nécessitant une participation syrienne dramatique. Le groupe s’est considérablement dégradé et la Syrie a déjà tout intérêt à réprimer les restes de l’EI à l’intérieur de ses frontières.
Le véritable ordre du jour est plus large : normaliser les relations avec Damas, intégrer la Syrie dans les cadres régionaux, négocier potentiellement des arrangements israélo-syriens et contrer l’influence iranienne.
Ce sont des intérêts légitimes, mais ils doivent être poursuivis avec un œil lucide sur les coûts, les limites et les résultats probables – et non enveloppés dans les fioritures rhétoriques sur la lutte contre le terrorisme qui ont justifié tant d’aventures douteuses au Moyen-Orient.
Al-Sharaa a effectué 20 voyages à l’étranger depuis qu’il s’est nommé président en janvier, menant une offensive de charme diplomatique digne de tout dirigeant ambitieux en quête de légitimité internationale et d’aide économique.
Il a habilement joué ses cartes, rompant avec la Russie et l’Iran tout en cultivant des relations avec l’Arabie saoudite, la Turquie et maintenant les États-Unis.
Mais les offensives de charme ne constituent pas une transformation démocratique. Al-Sharaa est arrivé au pouvoir par la force, et non par les élections. Son pays est confronté à des défis monumentaux de réconciliation sectaire, de reconstruction institutionnelle et de reconstruction économique.
L’idée que la Syrie sortira de ce processus en tant que partenaire stable et pluraliste aligné sur les intérêts américains nécessite une foi en l’alchimie politique que l’histoire du Moyen-Orient ne soutient pas.
Une proposition modeste
À quoi ressemblerait une politique syrienne véritablement réaliste ? Il s’agirait de :
- L’engagement conditionnel était axé sur des objectifs étroits et réalisables : coopération antiterroriste, retour des réfugiés et stabilité régionale
- S’appuyer principalement sur les acteurs européens et régionaux, et non sur la présence militaire américaine
- Scepticisme à l’égard des grands projets de démocratie syrienne ou de transformation régionale
- Volonté d’accepter la Syrie comme un État fonctionnel sans prétendre qu’elle devient une démocratie modèle
- Reconnaître que la réduction de l’influence iranienne et russe est une bonne chose, mais pas au prix de la création de nouveaux engagements américains
Plus important encore, cela éviterait le piège de la personnalisation de la politique autour d’al-Sharaa lui-même. Le partenaire pragmatique d’aujourd’hui a l’habitude d’être le problème de demain. L’objectif devrait être de maintenir les relations minimales nécessaires avec le gouvernement qui contrôle Damas, et non de parier la crédibilité américaine sur les réformes promises par le dernier homme fort du Moyen-Orient.
Motif têtu
La triste réalité est que l’establishment de la politique étrangère américaine apprend peu de ses mésaventures au Moyen-Orient.
Les mêmes groupes de réflexion, chroniqueurs et responsables qui ont défendu les interventions précédentes expliquent maintenant pourquoi s’engager dans al-Sharaa représente une realpolitik astucieuse. La même tendance à surestimer l’influence américaine et à sous-estimer la complexité régionale persiste.
Comme l’a noté un analyste, « les États-Unis prennent un gros pari sur Ahmed al-Sharaa et la Syrie », ce qui est précisément le problème. L’Amérique prend de grands paris au Moyen-Orient depuis des décennies, et la maison gagne généralement.
La visite d’al-Sharaa pourrait en effet marquer un nouveau chapitre dans les relations américano-syriennes. Mais à moins que Washington n’aborde cette relation avec beaucoup plus de modestie sur ce qu’il peut accomplir, et beaucoup plus de réalisme quant aux coûts d’une implication plus profonde, nous finirons par considérer ce moment comme une autre étape importante sur la route de la déception.
Le Moyen-Orient a une façon d’humilier les ambitions américaines. Le parcours d’Ahmed al-Sharaa, de la désignation terroriste à l’invité de la Maison Blanche, est peut-être remarquable, mais il n’est pas sans précédent. Et si l’on se fie à l’histoire, l’enthousiasme de novembre 2025 peut sembler assez différent si l’on se fie à novembre 2030.
Peut-être que la vraie question n’est pas de savoir si l’Amérique doit s’engager avec la Syrie, mais si elle est capable de le faire sans les attentes grandioses et les inévitables engagements excessifs qui ont caractérisé la politique américaine au Moyen-Orient au cours des trois dernières décennies.
Les premiers signes ne sont pas encourageants.
Cet article a été publié à l’origine dans le Global Zeitgeist de Leon Hadar et est republié avec l’aimable autorisation. Devenez abonné ici.
Views: 0