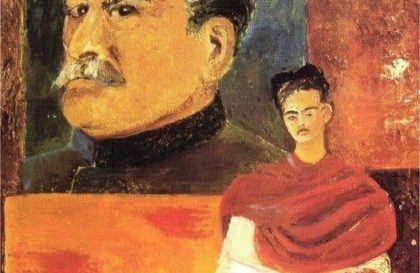3 novembre 2025
Qu’est-ce qui a le plus joué dans l’élection du maire de New York ? dans le refus de céder à toutes les attaques contre l’islamiste communiste y compris dans l’électorat juif progressiste : est-ce la description du banquet donné dans son palace de Floride par Trump sur le thème de Gasby le Magnifique… est-ce le refus des guerres de l’Empire alors que le peuple connaît la faim et la dégradation générale de ses conditions de vie ? le cirque ne fait plus recette même si l’hirondelle ne fait pas le printemps et le maire de New York ne suffit pas à faire basculer les Etats-Unis et leurs alliés dans le socialisme et la paix… Il dit aussi ce qui ne fait plus recette.. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
Sur FacebookGazouillerRedditCiel bleuMessagerie électronique

Source de la photographie : Missvain – CC BY-SA 4.0
Le gouvernement des États-Unis est aux prises avec l’un de ses plus longs déficits de financement de l’histoire. La fermeture du gouvernement en cours s’est déjà prolongée au-delà de 30 jours et maintenant, la sécurité alimentaire de millions d’Américains est menacée alors que le financement du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) se tarit et que les responsables de Trump ont refusé de puiser dans les fonds de prévoyance. Environ 42 millions de personnes par mois dépendent des prestations SNAP et devraient les perdre à partir du 1er novembre.
Pourtant, alors que l’aide nationale est confrontée à une grave crise de financement, la poussée de l’administration Trump vers l’escalade militaire contre le Venezuela, impliquant l’accumulation d’immenses ressources navales dans les Caraïbes, coûte des millions de dollars par jour. Dans la matinée du 31 octobre, deux grandes publications américaines, le Miami Herald et le Wall Street Journal, ont affirmé ce que beaucoup craignaient : les États-Unis cherchent à mener des frappes militaires sur le territoire vénézuélien, un geste sans précédent dans l’histoire des deux pays.
Les priorités de l’administration sont claires : l’austérité à l’intérieur, et des dépenses militaires illimitées dans le but d’un changement de régime à l’étranger.
Le coût de la guerre : 18 millions de dollars américains par jour
Une vaste force navale américaine, que l’administration prétend être destinée aux opérations de lutte contre les stupéfiants, a été déployée dans les eaux proches du Venezuela. La véritable nature de ce déploiement est signalée par sa composition et son coût : il s’agit d’une force construite pour l’invasion. L’escalade militaire est aiguë et dangereuse, marquée par les frappes extrajudiciaires en cours dans les Caraïbes et le Pacifique et les menaces explicites de frappes terrestres. À ce jour, au moins 60 personnes ont été tuées dans au moins quatorze attaques de ce type depuis le début du mois de septembre. Il a été confirmé que les victimes étaient des citoyens du Venezuela, de la Colombie et de Trinité-et-Tobago. L’administration a accusé les victimes d’être des « narcoterroristes » sans fournir de preuves concrètes. Dans plusieurs cas, des membres de leur famille ont affirmé que les personnes tuées étaient des pêcheurs.
La force déployée dans les Caraïbes comprend le groupe aéronaval Gerald R. Ford, sophistiqué et extrêmement coûteux. Le coût d’acquisition initial du navire amiral, qui est le plus grand porte-avions au monde, l’USS Gerald R. Ford (CVN-78), s’élevait à environ 13,3 milliards de dollars américains. Le groupe aéronaval qui l’accompagne a un coût d’exploitation quotidien estimé entre 6 et 8 millions de dollars américains.
Le déploiement est encore renforcé par des navires de guerre tels que le destroyer de classe Arleigh Burke USS Jason Dunham, dont le coût d’exploitation quotidien s’élève à environ 2 millions de dollars américains. De plus, un grand navire d’assaut amphibie tel que l’Iwo Jima (un navire de classe Wasp), conçu pour transporter et déployer des milliers de marines faisant partie de la force navale, coûte entre 1 et 3 millions de dollars américains supplémentaires par jour lorsqu’il est déployé.
L’escalade et l’attrait du pétrole vénézuélien
Les menaces militaires sont plus qu’une simple démonstration de force ; il s’agit d’une escalade active qui a notamment donné lieu à des frappes meurtrières contre des navires dans les Caraïbes, qui ont déjà coûté la vie à des dizaines de personnes. Le déploiement du groupe aéronaval Gerald Ford et la décision de frapper des cibles militaires sur le sol vénézuélien représentent un changement qualitatif, passant des sanctions et de la rhétorique à une intervention militaire directe.
Le principal moteur stratégique de cette agression est les réserves massives de pétrole du Venezuela. Pendant des décennies, le contrôle de l’approvisionnement énergétique mondial a été un élément central de la politique étrangère américaine. Le président Trump, comme Biden et Obama avant lui, a considéré le gouvernement socialiste de Nicolás Maduro comme un obstacle direct à la prise de contrôle des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. En déstabilisant le pays et en mettant en place un régime conforme soutenu par les États-Unis, l’administration cherche à s’assurer une position stratégique sur un marché mondial clé de l’énergie.
La doctrine Monroe réaffirmée : géopolitique et hégémonie
La confrontation actuelle avec le Venezuela n’est pas un incident isolé ou une question de pétrole ; c’est un exemple clair des objectifs géopolitiques plus larges des États-Unis dans la région. L’administration Trump opère ouvertement dans l’esprit de la doctrine Monroe, la politique du XIXe siècle qui a proclamé l’hémisphère occidental, et plus particulièrement l’Amérique latine, comme une sphère exclusive d’influence américaine.
L’objectif est de réaffirmer la domination et de dicter l’orientation politique et économique des nations d’Amérique latine. La résistance du Venezuela aux modèles économiques néolibéraux américains et ses alliances avec d’autres puissances mondiales (y compris la Russie et la Chine) sont considérées comme une menace idéologique inacceptable. Le déploiement naval sert d’instrument contondant pour façonner la politique latino-américaine, punir les adversaires idéologiques et envoyer un signal clair à tous les États voisins sur les limites de l’indépendance souveraine.
La pression militaire continue, soutenue par des sanctions dévastatrices, est destinée à étouffer le pays économiquement et à provoquer un effondrement politique. Le déploiement d’un groupe aéronaval est le fondement militaire de cette stratégie, garantissant qu’en cas d’échec des pressions économiques et politiques, l’option d’une intervention militaire reste viable.
Une question de volonté politique
La juxtaposition de la famine intérieure et de l’agression militaire étrangère est l’ultime réquisitoire contre le système politique américain. D’une part, l’administration prétend qu’elle ne peut pas se permettre de maintenir des filets de sécurité fondamentaux comme SNAP, ce qui a un impact sur la capacité de millions de citoyens à nourrir leurs familles pendant une fermeture du gouvernement. De l’autre, il fait preuve d’une volonté politique immédiate et inébranlable de dépenser 18 millions de dollars toutes les 24 heures pour maintenir une flotte capable d’initier un conflit régional à des centaines de kilomètres de la frontière américaine.
Les implications sont claires : le gouvernement américain donne la priorité à ses objectifs de changement de régime, de contrôle du pétrole et d’affirmation violente de l’hégémonie régionale sur les besoins humains fondamentaux de ses propres citoyens. Pour les travailleurs des États-Unis, l’agression contre le Venezuela n’est pas un acte de nécessité, mais une dépense colossale et inutile de ressources et de vies au service d’une dangereuse ambition impériale.
Cet article a été produit par Globetrotter.
Manolo De Los Santos est un chercheur et un militant politique. Pendant 10 ans, il a travaillé dans l’organisation de programmes de solidarité et d’éducation pour défier le régime de sanctions et de blocus illégaux des États-Unis. Basé à Cuba depuis de nombreuses années, Manolo a travaillé à la construction de réseaux internationaux de mouvements et d’organisations populaires. En 2018, il est devenu le directeur fondateur du People’s Forum à New York, un incubateur de mouvements pour les communautés ouvrières afin de construire l’unité au-delà des lignes de division historiques au pays et à l’étranger. Il collabore également en tant que chercheur avec l’Institut Tricontinental de recherche sociale et est boursier Globetrotter/Peoples Dispatch.
Views: 3