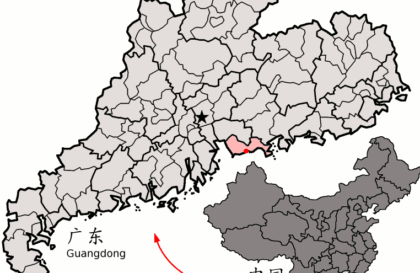L’innovation de la Chine n’est pas un réveil anormal, mais plutôt la réaffirmation d’une tradition interrompue par les canonnières, l’opium et le colonialisme. Il y a en occident trois écoles qui sympathisent avec la Chine, la première est celle des capitalistes réalistes qui mesurent à quel point dans l’instabilité générée par l’ancien maitre, la Chine est un passage obligé quitte à plaider pour un G2 en notant que Trump lui-même semble s’y résigner. Non sans certains ébranlements devant la crainte que la Chine ne devienne trop socialiste et que derrière la Russie se profile un peuple nostalgique de l’URSS, sans parler de la Corée du nord, Cuba et les autres. La seconde est celle des anciens « maoïstes » qui ne sont pas passés du col Mao au Rotary club mais continuent à voir en toutes choses la pensée de Mao s’appliquer, ils voient l’essentiel mais pas toujours les nouvelles conditions de la bataille géopolitique. Et enfin, il y a les amoureux de la Chine éternelle qui comme ici notent que la Chine se contente de fermer la parenthèse de l’humiliation… Ils ont le mérite incontestable de nous faire comprendre qu’en Asie la Chine pour le meilleur comme pour le pire (exploité par les USA) la Chine retrouve sa position millénaire de suzerain. En suivant Marx, comme nous l’avons fait dans notre livre, nous avons dû tenir compte des trois approches et de la capacité de synthèse dont fait preuve la Chine, son gouvernement, son peuple et que le pays longtemps suzerain de l’Asie réussit à faire partager à toute l’aire asiatique, alors que le Japon réfractaire une fois de plus fait « le mauvais choix » et voit sa « fenêtre » se fermer. La relation aux forces productives est déterminante pour cette dialectique avec ses temporalités différentes. La Chine elle-même y tient, le choix du socialisme est une lente maturation, une sagesse qui interdit de copier les Etats-Unis et ses vassaux, au moment où ils font justement la preuve de leur échec pour eux comme pour la planète mais sa stratégie est désormais une inconnue avec des corrections rapides sur de longues anticipations. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
par Richard Ghiasy4 novembre 2025

De nombreux observateurs occidentaux considèrent comme surprenantes les progrès rapides de la Chine dans des domaines de haute technologie tels que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, les véhicules électriques et l’énergie verte. Longtemps considérée comme un imitateur, la Chine n’est reconnue qu’à contrecœur comme un innovateur dans certaines parties de l’Occident collectif.
Pourtant, ce cadrage méconnaît l’histoire. Pendant des millénaires, depuis les Zhou et les Qin et a prospéré en particulier sous les dynasties Han, Tang, Song et Ming, la Chine s’est tenue au sommet mondial de l’innovation ou presque.00:0000:00
Ce à quoi nous assistons aujourd’hui n’est pas un réveil créatif anormal rendu possible par le capitalisme mondial, mais plutôt la réaffirmation d’une tradition chinoise interrompue par les canonnières, l’opium et le colonialisme.
L’héritage de la Chine en matière d’innovation, c’est-à-dire la création et la diffusion de nouvelles connaissances, technologies ou systèmes qui transforment les sociétés, est profondément ancré dans la civilisation mondiale. Dans les contextes préindustriels, l’innovation et l’invention chinoises étaient plus floues, car de nombreuses avancées étaient à la fois nouvelles et appliquées, prenant diverses formes.
.
Celles-ci allaient du génie civil et des technologies appliquées aux systèmes de connaissances, mais sans atteindre la forme et l’ampleur de l’innovation industrielle observée en Europe après 1750, en particulier au cours du siècle dernier. La révolution industrielle a certes été unique par son ampleur et ses conséquences, mais elle n’a pas effacé ni annulé les millénaires de capacité d’innovation qui l’ont précédée en Chine.
L’historien britannique Joseph Needham a démontré que la Chine a été à la pointe de l’innovation et des technologies appliquées pendant des siècles, bien qu’elle n’ait pas connu de révolution industrielle au sens occidental du terme.
L’échelle et la forme matérielle diffèrent, mais le principe est le même : prendre le savoir et l’intégrer dans des systèmes qui remodèlent les économies et les vies. Traiter les canaux et le mécanisme d’horlogerie comme incomparables au code et aux puces, c’est passer à côté du fait que les deux étaient des technologies de pointe de leur époque.
Les quatre grandes inventions chinoises célèbres – le papier, l’imprimerie, la boussole et la poudre à canon – en sont des exemples typiques, mais elles ne reflètent que les marqueurs les plus reconnaissables d’un rôle technologique plus large. Les inventions chinoises comprennent également le football (reconnu par la FIFA comme l’un des premiers ancêtres), le sismoscope, le forage profond (souvent >1 km pour la saumure et le gaz naturel), les fusées, les semoirs et les billets de banque, entre autres.
À travers les dynasties, la Chine a apporté des contributions significatives à l’ingénierie hydraulique, à la sériciculture textile, aux dispositifs d’horlogerie, aux instruments astronomiques, aux automates mécaniques et aux processus métallurgiques sophistiqués. Les érudits, les artisans et les organismes d’État fonctionnaient comme des nœuds dans un réseau de connaissances qui itérait, mettait en œuvre et améliorait les inventions au fil des siècles.
Comme c’est le cas en Chine aujourd’hui, l’écosystème de l’innovation a souvent été intégré à la gouvernance, les gouvernements parrainant des observatoires astronomiques, normalisant les mesures, développant des systèmes de contrôle des inondations, faisant progresser la science calendaire et faisant progresser la métallurgie.
Au-delà des inventions intellectuelles et technologiques, la tradition d’innovation de la Chine s’est également manifestée dans des prouesses d’ingénierie à l’échelle de la civilisation, à une échelle et avec une continuité rares ailleurs avant l’ère moderne. Le Grand Canal, long de 1 800 kilomètres, dont les origines remontent au Ve siècle avant notre ère, a relié les bassins du fleuve Jaune et du fleuve Yangtsé, créant ainsi l’épine dorsale de l’intégration nord-sud de la Chine.
Pour le construire, les ingénieurs impériaux ont mobilisé de vastes forces de travail non seulement pour creuser et draguer, mais aussi pour couper littéralement à travers les collines et aplatir les montagnes afin de maintenir une pente navigable. Ces entreprises, ainsi que les 21 000 km de la Grande Muraille, témoignent d’une maîtrise du génie hydraulique et civil qui remodèlent les paysages pour relier et protéger l’empire. Ce sont des exemples d’innovation non seulement dans les dispositifs, mais aussi dans la mobilisation et l’échelle.
L’importation de techniques étrangères n’a jamais été étrangère à ce système ; Historiquement, la Chine a absorbé, adapté, amélioré puis « exporté » les innovations. Plus récemment, la Chine a beaucoup emprunté aux écosystèmes d’innovation modernes occidentaux, englobant le capital-risque, le droit de la propriété intellectuelle et les partenariats entre universitaires et industriels. Ceux-ci ont été des accélérateurs absolument essentiels dans la réémergence de la Chine. De même, un paradigme populaire de l’Asie de l’Est du capitalisme dirigé par l’État a été repris des Quatre Tigres.
L’inverse, bien sûr, s’est également produit. Les nations européennes ont emprunté substantiellement à l’artisanat chinois, du bleu de Delft néerlandais imitant la porcelaine chinoise à l’espionnage industriel réel. Dans les années 1840, la Compagnie britannique des Indes orientales a chargé Robert Fortune de voyager en Chine, déguisé, dans de nombreux cas, pour faire passer en contrebande des théiers vivants, des graines et des connaissances en matière de transformation.
Sa mission a effectivement brisé la primauté de longue date de la Chine dans la culture et la transformation du thé, contribuant ainsi à la naissance de l’industrie moderne du thé en Inde. Il ne s’agissait pas de cas isolés ; La soie et les techniques métallurgiques ont également été systématiquement copiées ou imitées en Europe.
L’effondrement créatif de la Chine n’a commencé qu’au milieu du XIXe siècle, avec l’arrivée des canonnières occidentales, les guerres de l’opium, les traités coloniaux, les rébellions internes et la fragmentation politique. Les institutions et les flux de capitaux qui soutenaient l’innovation ont été détruits ou gravement affaiblis.
L’élan créatif de la Chine a été remplacé par les urgences de la survie nationale. Toute la faute ne peut être attribuée aux puissances occidentales : une Chine Qing stagnante était devenue complaisante et était entravée par la rigidité bureaucratique confucéenne, l’inertie institutionnelle et le refus de s’adapter au capitalisme industriel et au nouveau monde.
La Chine créative d’aujourd’hui retrouve sa capacité créative grâce à de nouveaux modèles technologiques et paradigmes économiques. Les preuves sont convaincantes. En 2025, la Chine est entrée pour la première fois dans le Top 10 de l’Indice mondial de l’innovation, ce qui est inhabituel pour une économie à revenu intermédiaire.
L’ampleur de l’activité actuelle en matière de brevets est stupéfiante. La Chine représentait environ un quart de toutes les demandes de brevets dans le monde en 2024. Plusieurs entreprises et instituts de recherche chinois ont publié des milliers de familles de brevets en une seule année. L’impact des citations a fortement augmenté dans plusieurs domaines tels que l’IA, les matériaux, la fintech et l’énergie verte, même si la qualité reste globalement inégale.
De plus, la Chine n’est pas seulement active sur le plan national : elle cherche de plus en plus à obtenir une protection par brevet étranger, en particulier dans les domaines où les économies avancées déposent également des brevets. Ce modèle n’est pas le signe de l’imitation, mais de l’innovation dans les domaines à plus forte valeur ajoutée.
Il convient de noter en particulier que la Chine a déposé plus de brevets dans le domaine de l’IA générative que tout autre pays au cours de la dernière décennie. Entre 2014 et 2023, la Chine a déposé plus de 38 000 brevets liés à l’IA générative, contre « à peine » plus de 6 000 aux États-Unis. Les brevets ne se traduisent pas automatiquement par des produits ou des services, mais l’accent est mis sur la frontière technologique.
Une telle échelle exige que nous changions la façon dont nous encadrons l’histoire de l’innovation en Chine. Trop souvent, l’avance technologique de la Chine est décrite comme un rattrapage, un transfert de technologie, un vol de propriété intellectuelle ou une ingénierie inverse. Cependant, les données racontent une autre histoire : l’innovation et l’inventivité de la Chine atteignent de nouveaux sommets. Le pays est bien placé pour surpasser dans presque tous les domaines de la prochaine génération.
Pourtant, pourquoi la surprise persiste-t-elle ? De multiples biais sont en jeu. Premièrement, le récit dominant de la modernisation privilégie l’Occident comme point d’origine du progrès. L’innovation non occidentale est souvent présentée comme dérivée ou réactive.
Comme l’a montré Tonio Andrade dans « L’âge de la poudre à canon », la Chine a été à l’avant-garde de l’innovation militaire pendant des siècles avant l’essor de l’Europe. Deuxièmement, de nombreux analystes fonctionnent avec des fenêtres de 20 à 30 ans, traitant les perturbations comme la norme plutôt que comme l’exception. Les 150 dernières années sont interprétées comme la « ligne de base » dans cette analyse limitée. Troisièmement, les régimes de propriété intellectuelle et les normes mondiales ont imposé aux Occidentaux des définitions de l’innovation, qui faussent les perceptions de ce qui constitue l’innovation et l’invention.
Reconnaître que l’innovation de la Chine est une norme mondiale restaurée, et non une aberration, a des implications à plusieurs égards. L’innovation reflète toujours sa frontière technologique : la métallurgie du bronze à l’époque, l’IA aujourd’hui. Les deux ont transformé les économies et la géopolitique.
D’un point de vue stratégique, il est périlleux de sous-estimer la capacité créative de la Chine. Les politiques fondées sur le statut de suiveur de la Chine risquent d’être dépassées. Dans les cadres commerciaux, technologiques et d’alliance, les acteurs doivent supposer que la Chine n’est plus un aspirant perpétuel.
En fait, nous devrions nous habituer de plus en plus à ce que la Chine redevienne un innovateur de classe mondiale, à une échelle que l’on voit autrement principalement aux États-Unis et, de différentes manières, en Europe et au Japon.
Si la Chine a toujours contribué à l’histoire, les normes mondiales doivent s’adapter aux traditions intellectuelles, aux modèles industriels et aux voies de développement alternatifs. Le monde doit mettre fin aux biais d’interprétation qui tendent à centrer l’originalité occidentale.
La question n’est pas de savoir si la Chine est innovante, mais comment les autres réagissent. Les innovations, rarement confinées à l’intérieur des frontières, ont tendance à profiter non seulement à quelques-uns, mais au plus grand nombre. Une Chine plus innovante peut contribuer à l’expansion des biens publics mondiaux.
Surprenant? La plus grande surprise aurait dû être que l’une des plus anciennes civilisations continues du monde ait jamais connu un bref arrêt innovant. Le monde devrait se préparer à la Chine non pas comme un retardataire, mais comme un innovateur civilisationnel qui revient en forme.
Richard Ghiasy est le directeur de GeoStrat, une société de conseil en géopolitique et une académie aux Pays-Bas
Views: 4