Le Japon, l’Australie et le Royaume-Uni ont présenté leurs objectifs, les plus ambitieux à ce jour, tandis que les insulaires du Pacifique s’inquiètent de la lenteur des progrès. Il est encourageant le fait que désormais un nombre grandissant de pays a renoncé à agir en fonction des foucades de Trump (mais aussi des dirigeants européens qui ne sont pas en reste en matière de provocations et de propos non suivis d’effets). Face à l’urgence, il y a la nécessité de l’action voire de coordinations « hors système ». C’est le thème que nous abordons aujourd’hui en montrant qu’au delà des narratifs qui participent du bluff occidental, il y a les FAITS qui relèvent de l’économie réelle et dans ce domaine la Chine est devenu un véritable leader écologique, non seulement parce qu’elle produit tout ce qui est susceptible de lutter en ce sens mais parce qu’elle a orienté en ce sens sa propre politique y compris en se servant de l’IA pour définir les choix les plus opportuns, en contrôlant les effets. Il s’agit de pistes qui mériteraient investigation pour comprendre ce monde déjà là au-delà de l’épuisant piétinement sur place dont nos « élites politico-médiatiques » paraissent porteuses et qui se contentent de radoter ce que l’idéologie dominante (qui est toujours celle de la classe dominante) impose comme gangue d’ignorance réactionnaire à nos esprits, il existe un monde réel dont nous ignorons les actions transformatrices, les difficultés mais aussi les réussites. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
par Shannon Gibson24 octobre 2025

Dans les îles Marshall, où la terre n’est en moyenne que de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, les gens sont très conscients du changement climatique.
Leurs ancêtres vivent sur ce chapelet d’îles du Pacifique depuis des milliers d’années. Mais à mesure que le niveau de la mer augmente, les tempêtes inondent plus facilement les communautés et les terres agricoles d’eau salée.
Le réchauffement de l’eau des océans a déclenché des épisodes de blanchissement massif des coraux, nuisant aux habitats importants pour le tourisme et les poissons dont dépend l’économie des îles.
Si le monde ne parvient pas à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique, des études suggèrent que des îles basses comme celles-ci pourraient être inhabitables d’ici des décennies.

Le changement climatique n’est pas seulement un problème pour les îles. Les pays du monde entier connaissent des tempêtes qui s’intensifient, des vagues de chaleur dangereuses et une montée des mers à mesure que les températures mondiales augmentent.
Pourtant, après 30 ans de négociations internationales sur le climat, 10 ans d’un traité mondial promettant de contrôler les températures et des milliards de dollars de dégâts, le monde n’est toujours pas sur la bonne voie pour arrêter la hausse des températures mondiales. Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records en 2024, et ce fut l’année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.
J’étudie la dynamique de la politique environnementale mondiale, y compris les négociations climatiques des Nations Unies. Et mon laboratoire et moi-même avons suivi les derniers engagements climatiques des pays – connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national, ou CDN – pour voir quels pays ont intensifié leurs efforts, lesquels ont reculé et qui a des idées qui peuvent offrir un monde plus sûr pour tous.
Alors que l’administration Trump a fait pression sur les pays pour qu’ils renoncent à leurs engagements climatiques – et a réussi à retarder le vote de l’Organisation maritime internationale sur un plan mondial visant à taxer les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime après avoir menacé d’autres pays de sanctions, de restrictions de visa et de frais portuaires s’ils le soutenaient – de nombreux pays continuent d’aller de l’avant.
Trump s’agite, mais de nombreux pays sont inébranlables
Le président américain Donald Trump, dont l’administration est entrée en fonction en promettant d’éliminer les réglementations climatiques et de stimuler l’industrie des combustibles fossiles, s’est moqué des inquiétudes concernant le changement climatique dans son discours du 23 septembre 2025 à l’Assemblée générale des Nations unies. Il a qualifié le changement climatique de « plus grande escroquerie jamais perpétrée » et a ridiculisé l’énergie verte et la science du climat.

Cependant, le langage de Trump ne surprend plus les dirigeants mondiaux. Plus de 100 autres pays ont annoncé de nouveaux engagements climatiques lors d’un sommet de haut niveau quelques jours plus tard.
La Chine, qui est actuellement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, a été félicitée pour avoir atteint ses objectifs en matière d’énergie verte cinq ans plus tôt. L’expansion rapide de ses énergies renouvelables à faible coût et de la fabrication de véhicules électriques a permis de réduire la pollution dans les villes chinoises tout en stimulant son économie et en étendant l’influence du gouvernement dans le monde.
Le président chinois Xi Jinping a annoncé le premier objectif absolu de réduction des émissions du pays lors du sommet, s’engageant à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 % à 10 % par rapport aux niveaux maximaux d’ici 2035. La Chine s’est également engagée à presque tripler sa capacité d’énergie solaire et éolienne et à étendre ses efforts de reforestation.
Alors que les défenseurs et d’autres gouvernements espéraient une annonce plus forte de la part de la Chine, les nouveaux objectifs marquent un changement important par rapport aux objectifs antérieurs du pays en matière d’intensité carbone, qui visaient à réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité de production économique, tout en permettant aux émissions d’augmenter au fil du temps.

L’Union européenne n’a pas encore soumis ses nouveaux engagements, mais le groupe des 27 pays européens a remis une lettre d’intention, affirmant qu’il s’engagerait à une réduction collective de 66 % à 72 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990. L’Europe a connu une augmentation rapide des énergies renouvelables, en forte hausse depuis que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en péril l’approvisionnement en gaz naturel du continent.
L’UE a également fait des vagues en étendant ses règles de tarification du carbone au-delà de ses frontières.
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE, qui devrait entrer en vigueur en janvier 2026, sera le premier système à facturer l’impact climatique des marchandises importées en Europe en provenance de pays qui n’ont pas de prix du carbone similaires à ceux de l’UE. Cette mesure, qui vise à uniformiser les règles du jeu pour les industries de l’UE, crée un précédent mondial en matière de lien entre les émissions de carbone et le commerce.
Cependant, les plans climatiques de l’UE sont également confrontés à des vents contraires. Son parlement s’oriente vers un assouplissement des nouvelles exigences en matière de durabilité des entreprises après la pression des entreprises. Et il pourrait faire face à des appels de certains pays membres pour retarder un nouveau marché du carbone destiné à réduire les émissions du transport routier et des bâtiments, a rapporté Politico.
L’UE s’est engagée à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros (environ 350 milliards de dollars) pour soutenir la transition mondiale vers une énergie propre dans les pays en développement.
Le Royaume-Uni, le Japon et l’Australie ont présenté leurs objectifs les plus ambitieux à ce jour. Tous les trois les mettent sur la voie d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, ce qui signifie que tous les gaz à effet de serre qu’ils émettent seront compensés par des projets qui évitent les émissions de carbone ou éliminent le carbone de l’atmosphère.
En Australie, l’annonce récente du Queensland selon laquelle il prolongerait l’utilisation des centrales à charbon existantes jusqu’aux années 2030 et 2040 pourrait ralentir les progrès nationaux. Mais le Queensland soutient également l’expansion des énergies renouvelables et vise toujours des émissions nettes nulles d’ici 2050.
La Norvège s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 70 % d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990, ce qui s’alignerait sur l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir les émissions mondiales en dessous de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit). Cependant, elle prévoit de rester un important exportateur de pétrole et de gaz.
De nombreux pays en développement ont également renforcé leurs engagements.
Le Brésil s’est engagé à réduire ses émissions nettes de 59 % à 67 % d’ici 2035 et maintient son objectif de zéro émission nette pour 2050. Le gouvernement a également été critiqué pour avoir approuvé des projets d’exploration pétrolière près de l’embouchure du fleuve Amazone.
Passager clandestin et se mettre à l’abri derrière les États-Unis
Cependant, si certains nouveaux engagements climatiques signalent un élan important dans la lutte contre le changement climatique, le bras de fer entre l’ambition mondiale de ralentir le changement climatique et les intérêts stratégiques était palpable lors du sommet de New York. Les réactions aux remarques de Trump ont révélé à la fois des critiques voilées et une décélération de l’action climatique par certains gouvernements.
La Chine a critiqué le recul de certains pays, sans citer de noms.
Le Brésil a profité du sommet pour interpeller les pays qui ont tardé à soumettre leurs engagements climatiques actualisés. Seulement un tiers environ avaient soumis leurs engagements actualisés à ce moment-là.
Bien qu’il soit difficile d’analyser les motivations de chaque pays – le stress économique, les guerres et l’influence politique peuvent tous jouer un rôle – de nombreux chercheurs craignent que le recul des États-Unis n’amène d’autres pays à réduire leurs engagements climatiques, et certains engagements récents semblent le confirmer.
De nombreux pays producteurs de pétrole n’ont pas respecté la date limite de l’engagement de l’ONU. Le Qatar, qui a récemment offert aux États-Unis un avion à réaction à l’usage de Trump et dont l’économie est largement soutenue par l’industrie pétrolière et gazière, n’a pas mis à jour son engagement depuis 2021. L’objectif moyen de réduction des émissions du Conseil de coopération du Golfe, composé de six membres, est encore plus bas que celui du Qatar, à environ 21,6 % d’ici 2030.
De même, l’Argentine, l’un des principaux détenteurs mondiaux de réserves de pétrole et de gaz de schiste, n’a pas publié ses engagements actualisés. Les progrès réalisés par rapport à son engagement précédent ont été sapés par des changements politiques depuis l’élection du président Javier Milei en 2023.
Milei a d’abord promis d’abandonner complètement le programme 2030 et de se retirer de l’Accord de Paris, bien que son administration ait ensuite fait marche arrière. Son rejet du changement climatique comme un « mensonge socialiste » a étroitement aligné l’Argentine sur Trump, culminant dans un programme d’aide de 20 milliards de dollars des États-Unis à l’Argentine et soulevant des questions sur la question de savoir si la position climatique de l’Argentine reflète une véritable politique ou une stratégie géopolitique.
L’Inde, le Mexique, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite ont également pris des engagements. L’Angola a affaibli son engagement climatique, invoquant le manque de financement international.
Une nouvelle façon de prendre des engagements climatiques ?
Alors que de nombreux pays promettent des progrès pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les engagements officiellement soumis au 20 octobre étaient encore bien en deçà du niveau nécessaire pour empêcher les températures mondiales d’augmenter de 2 ° C (3,6 ° F), sans parler de 1,5 ° C.

Pour aider à stimuler les efforts nationaux et la responsabilisation, le Brésil a proposé une nouvelle approche qu’il appelle une contribution déterminée à l’échelle mondiale. Contrairement au cadre du protocole de Kyoto de 1997, qui fixait des objectifs fixes de réduction des émissions spécifiques à chaque pays sur la base de bases de référence historiques, et à l’instar du système d’engagement à la carte de l’Accord de Paris de 2015, il établirait des objectifs mondiaux alignés sur les objectifs de température de l’Accord de Paris.
Ainsi, une contribution déterminée à l’échelle mondiale pourrait affirmer, par exemple, que le monde triplera sa production d’énergie renouvelable et inversera la déforestation d’ici 2030. Un tel objectif donne aux pays une voie d’action plus claire. Le nouveau format permettrait également aux actions de la ville et de l’État d’être comptées séparément, ce qui les inciterait davantage à agir.
En tant qu’hôte des négociations sur le climat de la COP30 du 10 au 21 novembre 2025, le Brésil est particulièrement bien placé pour défendre ce concept. En l’absence de leadership américain, la proposition pourrait offrir aux pays une occasion rare de renforcer collectivement leurs engagements et de remodeler le libellé du traité d’une manière jamais vue auparavant, laissant ouverte la possibilité de progrès.
Shannon Gibson est professeure d’études environnementales, de sciences politiques et de relations internationales à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Wila Mannella, assistante de recherche et étudiante diplômée en études environnementales à l’USC, a contribué à cet article.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.
Views: 4





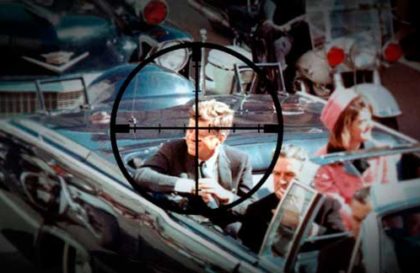

slassia
Il n’est pas certain que l’article réponde à la question de Chabian …
Les promesses des uns et des autres sont un bon début !
Mais bon ?
Depuis le temps !
La réponse technologique est-elle suffisante ?
Pour baisser les émissions de dioxyde de carbone …
Et atteindre les objectifs des 2 degrés …
La transition énergétique ne serait-elle pas qu’un leurre ?
Un slogan ?
Si l’on se reporte aux travaux de Jean-Baptiste Fressoz.
Les énergies étant reliées les unes aux autres.
Dans une sorte de symbiose …
Une accumulation,
Un additionnel d’énergies.
Les renouvelables croissent,
Leurs couts diminuent,
Grace à l’économie de marché socialiste de la RPC …
Mais la consommation des fossiles diminue t-elle ?
Le bois ou le charbon ont-ils été remplacé ?
Ou en consomment-on encore plus ?
Et le tout électrique ?
Est-ce possible ?
Autant de questions que seule une société qui trace la voie du socialisme est en mesure de répondre.
Il n’est pas à en douter.
Le capitalisme où la production est ajustée au profit n’en est pas capable !
Sa raison d’être n’est pas de produire ce qui est utile …
Pour le plus grand nombre.
En fonction des ressources disponibles,
Et du dérèglement climatique qu’il a causé !
Un ¨vert¨ne peut qu’être rouge …
https://www.youtube.com/watch?v=iafyW3ZSu-U