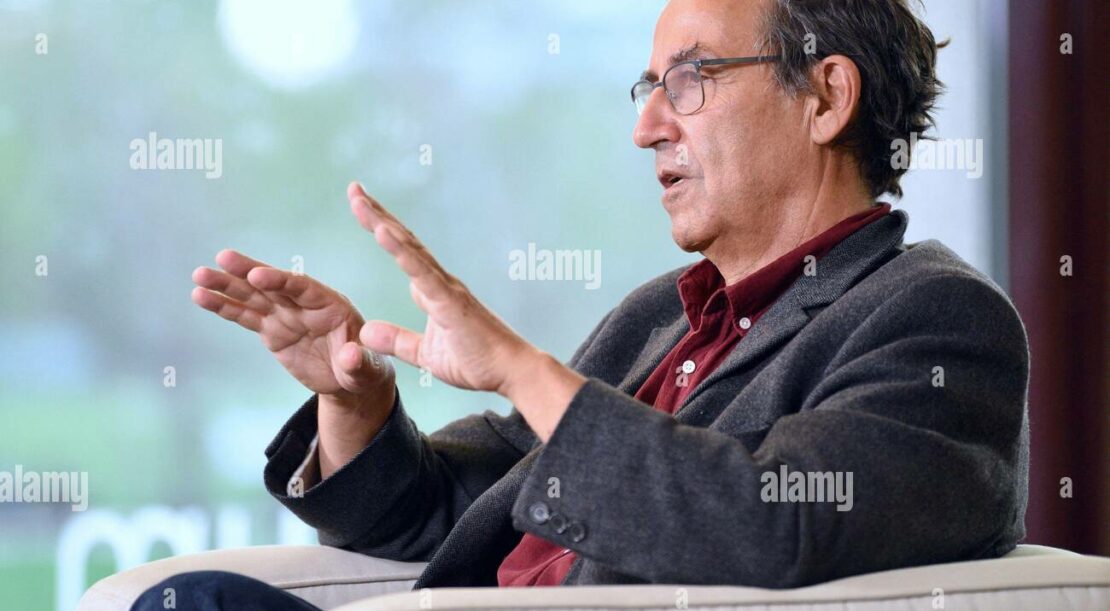Cette préface évoque beaucoup de choses, et pointe un certain nombre de questions qu’il me semble important d’approfondir. Effectivement, cela rejoint nos analyses, sur le caractère indépassable de l’avance industrielle et technologique de la Chine. Nous sommes allés plus loin, je pense. Autour de la Chine émerge un monde plus développé, une nouvelle génération complète du système productif qui a la capacité concrète de faire accéder l’ensemble de l’humanité au développement économique. Cela est radicalement nouveau.
Les USA n’avaient pas l’intention de faire accéder le monde au développement. Au contraire, sous leur hégémonie, les plans d’ajustements du FMI, les déréglementations avaient pour but de mettre en place un véritable plafond de verre. L’URSS a essayé, mais ses moyens étaient limités. Son propre développement était encore très inégal, même dans les années 1970 et 1980. L’ensemble de ses alliés étaient confrontés à des problèmes de développement encore plus importants.
Comme nous l’expliquons dans le livre, Deng Xiaoping a tiré parti de la force du capitalisme occidental et de sa crise, retournant cette force et ce besoin de sortir de la crise des capitalistes pour en faire le point d’appui du développement des forces productives de la Chine à une hauteur inouïe.
La direction socialiste de l’état chinois a produit une stratégie de développement de long terme alimentée par la main d’œuvre chinoise de qualité, par les investissements constants dans les infrastructures et le développement et par l’apport des capitaux inemployés de l’occident.
Ce développement a engendré une spirale vertueuse : les forces productives chinoises se sont développées à un rythme sans précédent depuis l’URSS et sur une échelle supérieure, renforçant l’attractivité de la Chine pour l’exportation occidentale de capitaux. La Chine a développé son économie par cercles concentriques en partant des régions côtières, puis elle a été en situation de développer les pays voisins (exemple : le Vietnam), puis les autres continents, Afrique, Amérique du Sud et Asie centrale.
La Chine constitue ainsi un écosystème productif, dont elle occupe le centre, c’est à dire que c’est en Chine qu’a lieu l’accumulation des forces productives les plus sophistiquées, celles du plus haut degré de complexité, les plus avancées. Cela inclut, comme nous l’avons noté aussi, à la fois la capacité de recherche et développement la plus avancée (la Chine est le premier producteur mondial d’articles de recherche scientifique) mais aussi la capacité à industrialiser les marchandises les plus complexes au niveau le plus large en termes d’échelles de production.
Quelle est la place de l’occident dans ce nouveau monde en train d’émerger, et en particulier des USA et de l’Europe, mais aussi quelle est la place de la Russie, alliée stratégique de la Chine et héritière de l’URSS ? Ces questions nous concernent directement.
Au tournant des années 1970, les velléités d’autonomie stratégiques des grands pays d’Europe (France, Grande Bretagne notamment) arrivent à leur terme. Les anciens empires sont dissous, même si subsistent des zones d’influence. Les crises des années 1970 révèlent un capitalisme européen qui se laisse distancer et les années 1980 vont voir l’acceptation de la désindustrialisation massive par ces deux grands pays, leur intégration au système financier et capitaliste états-unien. La libre circulation des capitaux, les privatisations, les déréglementations aboutissent à ce que les capitaux franco-britanniques vont s’investir sur les zones de production les plus profitables, de moins en moins sur leur territoire : l’Allemagne et le Japon, puis la Corée et Taïwan vont tirer d’abord parti de cette situation, avant d’être rattrapés et distancés par la Chine. L’effondrement du pacte de Varsovie et le démantèlement de l’URSS va offrir à ces capitaux de nouveaux débouchés, proches et rentables. Les pays socialistes d’Europe de l’Est bénéficient également d’une main d’œuvre bien formée et bon marché. La destruction précipitée des économies socialistes ouvre en plus des possibilités d’appropriation rapide des outils de production les plus avancés, l’accès à des matières premières bon marché et l’ouverture de nouveaux marchés par la destruction considérable des outils de production les moins performants.
Mais à l’inverse de la Chine, ces pays se sont enfoncés dans un trou noir politique, qui empêcha la mise en place d’une stratégie de développement cohérente, livrant des millions de travailleurs à l’exploitation de court terme. Un bon exemple est le sous-développement des réseaux ferroviaires à l’est de l’Europe. 18 ans après l’entrée de la Roumanie dans l’UE, le trajet en train entre Vienne et Bucarest, deux villes distantes d’environ 1000 km prend plus de 18h. Le trajet en train entre Prague et Varsovie, distantes de 600 km prend 8 h. La Chine, de son côté, a bâti en 20 ans un réseau de lignes à grande vitesse qui s’étend sur plus de 46 000 km en septembre 2024, représentant 87 % du total mondial et desservant 96 % des villes chinoises de plus de 500 000 habitants. Aujourd’hui, ce sont des sociétés ferroviaires chinoises qui bâtissent la ligne modernisée entre Budapest et Belgrade (avec l’objectif d’une vitesse de circulation entre 160 km/h et 200 km/h), avec un financement de l’UE pour la partie hongroise et un financement chinois pour la partie serbe.
L’UE avait promis aux pays de l’Europe Orientale que la fin du système socialiste apporterait la prospérité (une richesse équivalente à celle des grands pays occidentaux) et la souveraineté. Le bilan n’est pas celui-là. De nombreux habitants de ces pays ont été contraints de fuir à l’ouest, où ils occupent des emplois sous-payés, pour obtenir un meilleur niveau de vie. C’est le cas par exemple de 20% des bulgares. Dans certaines régions de Bulgarie ou de Roumanie, il est devenu presque impossible de trouver un médecin, ceux-ci étant parti exercer en France, Allemagne ou Angleterre. Il existe ainsi un « sud global » européen. Des pays qui servent de réservoir de main d’œuvre pour les capitaux occidentaux, avec une répartition du travail et une hiérarchie des niveaux de vie qui leur est très défavorable, ainsi qu’une domination politique indirecte par les élites des grands pays européens. A l’instar de la crise de désindustrialisation et de relégation subie par de nombreux territoires en France, cela alimente la progression de forces nationalistes et réactionnaires dans la plupart de ces pays, quoique selon des proportions et des rythmes variables. Dans la régression généralisée de l’Europe Orientale des années 1990 et 2000, l’Ukraine est le pays qui a subi le plus fort recul, sans réussir à rebondir, allant de crise politique en crise politique, instrumentalisé par les forces extérieures pour en faire une base d’attaque et d’affaiblissement de la Russie. Cette politique affaiblit encore davantage l’Ukraine, conduisant à un nouvel exode et menaçant le pays de disparition pure et simple dans la tragique guerre par procuration « jusqu’au dernier ukrainien » qu’imposent les forces néo-nazies et les « soutiens » occidentaux.
A l’inverse, la Russie, après une décennies catastrophique dans les années 1990 a repris un chemin axé sur le développement à partir des années 2000, en suivant en partie le plan établi par Primakov avant son éviction du poste de 1er ministre : la ré-étatisation des principales sociétés exploitant les ressources énergétiques, la création d’un fond d’investissement. Cela est allé de pair avec la stabilisation du système politique et la forte influence du parti communiste (le KPRF est le premier parti d’opposition et tout en état écarté du pouvoir direct, il parvient souvent à faire entendre ses propositions) dans le sens de la planification du développement. Cela n’est pas sans rappeler la situation de la France entre 1947 et 1974, où le PCF est exclu du pouvoir mais continue à jouer un rôle très important par son influence idéologique et sociale.
La guerre en Ukraine vient sanctionner cet échec majeur du projet occidental de domination de l’ensemble de l’espace européen. Là où les grands pays européens pensait facilement mettre la Russie à genoux, elle fait mieux que résister. Inéluctablement, la division économique se mue en division politique et l’influence occidentale glisse vers la domination pure et simple, au mépris de la souveraineté pourtant promise. Les manipulations électorales récentes (Roumanie, Moldavie), les ingérences régulières, le mépris, alimentent des forces nationalistes dans l’ensemble de ces pays, faute d’une relégitimation des partis communistes.
Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant de voir fleurir dans tous l’espace est-européen des forces que l’UE qualifie de pro-russes, alors qu’il s’agit surtout de forces ayant un discours critique vis à vis de l’UE. C’est cette dynamique qu’il faut saisir concrètement et resituer dans une perspective de réappropriation collective du socialisme, tant comme expérience que comme perspective. Ce qui manque à mon sens dans la préface de Todd.
Views: 1