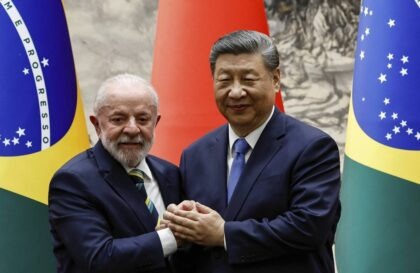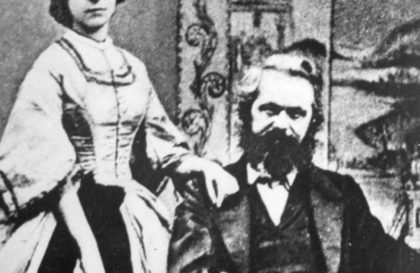La Mer de Chine est l’un des points chauds les plus turbulents au monde entre les États-Unis et la Chine, mais la diplomatie tranquille de l’ASEAN est en train de calmer les eaux troubles. L’auteur de l’article est un intellectuel de Malaisie c’est-à-dire l’un des pays qui a choisi d’appuyer la voie chinoise et de refuser ce que les Etats-Unis voulaient faire de l’ASEAN (1) : une coalition anti-chinoise. La Chine ne se contente pas d’un discours sur la paix, elle applique une politique qui fait un contraste saisissant avec celle de Trump qui ne fait que prolonger le « pivot » d’Obama. Cela dit, la diplomatie tranquille n’est pas synonyme de passivité. Il s’agit d’une stratégie active de retenue, de dialogue et de résolution de problèmes en coulisses. La mer de Chine méridionale est plus qu’un théâtre de rivalités. C’est l’artère par laquelle transite un tiers du commerce mondial. Nous sommes dans un temps où se rendre compte de cette situation d’un côté bouleverse des certitudes établies par l’impérialisme depuis des décennies mais qui en s’attachent à des problèmes et à leur solution peut déboucher sur des rassemblement beaucoup plus larges. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)

par Phar Kim Beng 18 août 2025

Depuis plus de deux décennies, la mer de Chine méridionale est le point central de revendications concurrentes, de frictions maritimes et de diplomatie délicate.
Ce qui était autrefois envisagé comme un cadre stabilisateur – le Code de conduite (CdC) – est lui-même devenu un symbole de la lutte de l’ASEAN pour trouver un équilibre entre souveraineté et pragmatisme.
Depuis l’adoption de la Déclaration sur la conduite des parties par l’ASEAN et la Chine en 2002, les négociateurs ont travaillé sur plusieurs projets de code contraignant, pour ensuite passer 23 ans à les synthétiser en un seul texte.
La question aujourd’hui n’est plus de savoir s’il existe un projet de loi, mais si son contenu peut prévenir de manière significative les affrontements en mer et atténuer les différends territoriaux en ébullition.
Contraignante ou simplement déclaratoire ?
Le point d’achoppement non résolu reste le caractère juridiquement contraignant du CdC. Si le document finit par devenir une déclaration politique, il sera vulnérable à une conformité sélective et facile à ignorer au moment voulu.
Un code contraignant, en revanche, obligerait tous les signataires à se conformer à des règles clairement définies, créant ainsi une prévisibilité dans un domaine maritime contesté.
La distinction peut paraître technique, mais ses conséquences sont profondes. Sans applicabilité, le CdC risque de devenir un autre geste diplomatique, attrayant sur le papier mais vide dans la pratique.
Le problème est aggravé par la portée du CdC. S’appliquera-t-il étroitement aux éléments contestés tels que les récifs et les hauts-fonds, ou couvrira-t-il le vaste domaine maritime à l’intérieur de la revendication de la Chine sur la « ligne en neuf traits » ?
Pour les États demandeurs de l’ASEAN tels que le Vietnam, les Philippines et la Malaisie, il ne s’agit pas d’une question académique – c’est la différence entre protéger les droits souverains ou les concéder à des négociations entre grandes puissances.
Une autre source de tension réside dans les opérations de liberté de navigation (FONOPS). Pour Washington, le principe est clair : aucune revendication maritime excessive ne doit entraver le commerce mondial ou le passage militaire.
Pourtant, pour Pékin, les FONOPS américains sont des manœuvres intrusives et délibérément provocatrices qui défient son autorité dans des eaux qu’il considère comme siennes. Entre ces pôles, les États de l’ASEAN se trouvent pris dans un dilemme.
Ils ont besoin du FONOPS pour protéger les voies maritimes ouvertes vitales pour le commerce, mais ils craignent aussi d’être entraînés dans les spirales de la confrontation entre Washington et Pékin.
C’est là que réside l’essence du dilemme de l’ASEAN : s’assurer que les règles mondiales de navigation restent intactes sans permettre aux puissances extérieures de militariser son arrière-cour.
Diplomatie stratégique et tranquille
Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a insisté à juste titre pour que l’ASEAN poursuive ce qu’il appelle un « ordre silencieux » – une diplomatie quiescente et non bruyante. Discret, pas théâtral.
En mer de Chine méridionale, une diplomatie bruyante fait souvent exacerber les tensions au lieu de les désamorcer. Les déclarations qui cherchent à marquer des points politiques, ou les manœuvres militaires diffusées pour une publicité maximale, ont tendance à durcir les positions plutôt qu’à les adoucir.
Cela dit, la diplomatie tranquille n’est pas synonyme de passivité. Il s’agit d’une stratégie active de retenue, de dialogue et de résolution de problèmes en coulisses.
Elle permet aux activités nécessaires – patrouilles, exercices, voire FONOPS – de se dérouler sans devenir des spectacles politiques. Elle donne également à la Chine et aux États-Unis la possibilité de s’engager mutuellement sans transformer les eaux de l’ASEAN en scènes de rivalité.
L’Australie et le Japon, tous deux de plus en plus actifs dans le domaine de la sécurité régionale, feraient bien d’adopter cette approche. Leurs intérêts à la haute mer et à la stabilité du commerce sont légitimes.
Mais en menant leurs activités de manière discrète et non conflictuelle, ils peuvent rassurer les États de l’ASEAN sur le fait que leur présence est source de soutien plutôt que d’escalade.
Recadrer les exercices militaires
Traditionnellement, les exercices militaires en mer ont été rédigés dans le langage de la dissuasion. Pourtant, la dissuasion peut facilement se transformer en provocation, surtout lorsqu’elle se déroule à proximité d’eaux contestées.
L’ASEAN doit donc trouver des moyens de recadrer ces exercices afin qu’ils contribuent à la sécurité sans exacerber les tensions.
L’Indonésie offre un modèle instructif. Ses exercices navals intègrent souvent des dimensions humanitaires : simulations de secours en cas de catastrophe, exercices de recherche et de sauvetage et scénarios d’évacuation médicale.
Ces activités sont non seulement moins conflictuelles, mais aussi profondément pertinentes dans une région sujette aux typhons, aux tremblements de terre et aux tsunamis.
Une flotte navale qui se prépare à sauver des vies, plutôt qu’à simplement projeter de la puissance, démontre une valeur tangible au public et favorise des habitudes de coopération, même entre marines rivales.
Si l’ASEAN pouvait institutionnaliser de tels exercices humanitaires, cela transformerait le récit de la présence navale. Les exercices permettraient toujours d’affiner les compétences et de montrer la préparation, mais ils renforceraient également la confiance au-delà des divisions.
Les exercices humanitaires offrent une plate-forme rare au personnel naval chinois, américain et de l’ASEAN pour interagir dans des contextes non hostiles – une mesure de confiance souvent absente dans le domaine de la sécurité.
Grand terrain de jeu puissant
La mer de Chine méridionale est plus qu’un théâtre de rivalités. C’est l’artère par laquelle transite un tiers du commerce mondial.
Les approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient vers l’Asie du Nord-Est passent par ses eaux, tout comme les composants essentiels de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Pour l’ASEAN, les enjeux sont existentiels. La stabilité en mer de Chine méridionale sous-tend non seulement la souveraineté, mais aussi la survie économique.
Cela fait de la centralité de l’ASEAN non pas un slogan diplomatique abstrait, mais une nécessité structurelle. Sans l’ASEAN en tant que rassembleur, la mer de Chine méridionale risque de devenir un terrain de jeu pour les puissances extérieures.
Le rôle de l’ASEAN doit être d’insister sur une gestion inclusive et fondée sur des règles des différends, tout en veillant à ce que ses États membres ne deviennent pas des pions dans une compétition géopolitique plus large.
Le défi consiste maintenant à mettre ces principes en pratique. Un code de conduite contraignant est la première étape, mais il doit être complété par des habitudes de diplomatie discrète et de coopération humanitaire.
Toutes les parties, y compris les États-Unis, la Chine, l’Australie et le Japon, doivent reconnaître que les postures bruyantes et combatives sont contre-productives. La diplomatie discrète n’efface pas les différends, mais elle empêche ces différends d’éclater en affrontements.
La tragédie de la mer de Chine méridionale est qu’une erreur de calcul – une collision accidentelle, une réponse trop zélée – pourrait dégénérer en un conflit plus large et dévastateur. L’antidote n’est pas la diplomatie du mégaphone, mais un engagement patient et discret.
Comme Anwar l’a fait valoir, le meilleur ordre pour l’ASEAN est celui qui est calme, tranquille et sans prétention. Derrière le calme se cache la force : la capacité de canaliser les différends en dialogue, de gérer la concurrence sans catastrophe et de renforcer la résilience par la coopération.
Sang-froid en mer
Pour éviter de nouveaux affrontements en mer de Chine méridionale, comme ceux entre la Chine et les Philippines, il ne s’agit pas de faire taire les préoccupations légitimes, mais d’y répondre avec sang-froid.
Un code de conduite juridiquement contraignant, associé à une diplomatie discrète et à une coopération navale humanitaire, offre à l’ASEAN et à ses partenaires la meilleure chance de préserver la stabilité.
Le monde doit reconnaître que la mer de Chine méridionale n’est pas simplement un territoire contesté. C’est une bouée de sauvetage partagée. Pour la protéger, il ne faut pas de bravade, mais un équilibre par la force tranquille.
En fin de compte, c’est l’art du silence – discipliné, délibéré et déterminé – qui pourrait s’avérer être l’outil le plus puissant de l’ASEAN pour assurer la paix en haute mer.
Phar Kim Beng est professeur d’études de l’ASEAN à l’Université islamique internationale de Malaisie et directeur de l’Institut d’internationalisation et d’études de l’ASEAN (IINTAS).
Views: 0