12 août 2025
Comme nous ne cessons de vouloir non sans difficulté le faire partager aux communistes qui eux-mêmes au plan international se croient encore soit dans la période de la guerre froide, soit dans celle de l’abdication eurocommuniste, nous sommes entrés dans une ère nouvelle y compris sur le plan stragtégique, et les Etats-Unis qui tentent de rejouer des tactiques qui ont réussi jadis se heurtent à un monde nouveau, sauf dans l’UE où il existe une combinaison de soumission à l’atlantisme avec pour seule opposition de façade une extrême-droite et de pseudo-radicalismes qui jouent le clientélisme de division. Quand la France s’éveillera à la Chine et participera à la longue marche pour un monde multipolaire elle comprendra mieux le mouvement réel partout et même en son sein. Peut-être nos idéologues passéistes découvriront-ils que le travail de sape qu’ils ont accompli en prétendant en finir avec le marxisme et toute vision progressiste s’est traduit par une situation qui veut que dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, l’idéologie compte moins que l’investissement et le commerce ou pour les peuples l’emploi, le salaire, l’avenir des enfants et la paix. C’est sur ces bases que la Chine et d’autres peuples qui avec le socialisme n’ont jamais renoncé à une perspective sur le long terme reconstruisent et pas sur les oppositions idéologiques datant de la guerre froide (note et traduction de Danielle Bleitrach histoire et société).
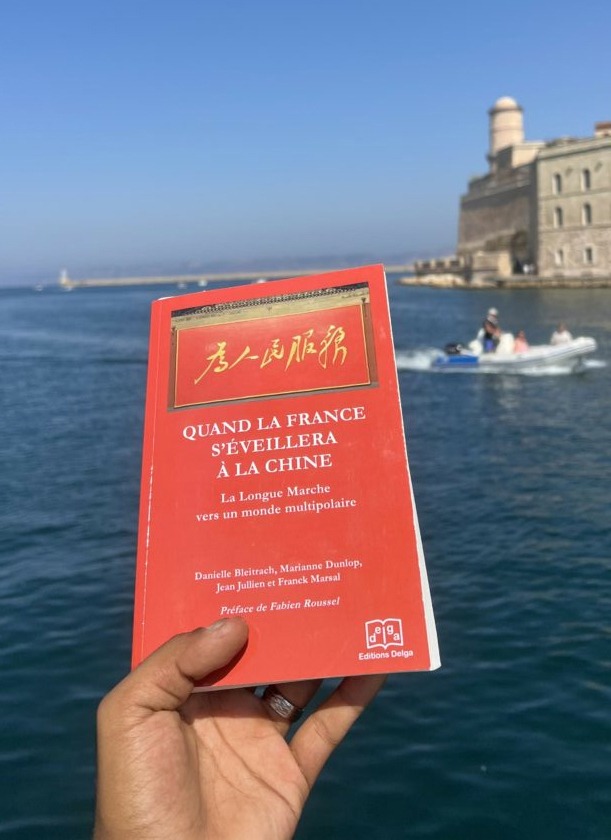
Michelle Ellner – Megan Russell
Sur FacebookGazouillerRedditCiel bleuMessagerie électronique
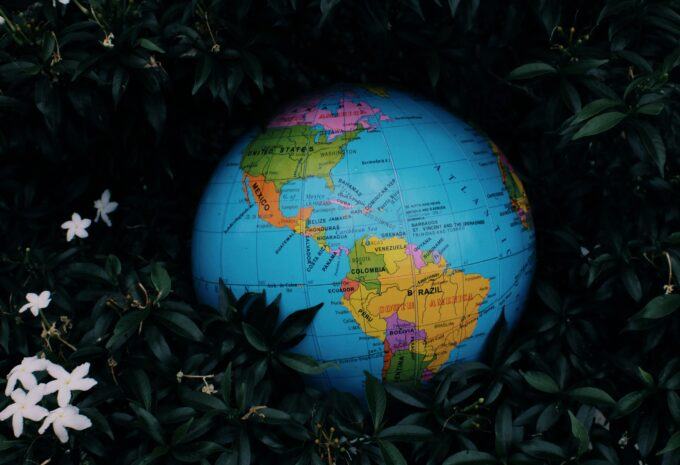
Image de Road Ahead.
La doctrine Monroe 2.0 de Trump rencontre un hémisphère multipolaire
Un article récent publié dans The Hill a célébré la renaissance de la doctrine Monroe sous Donald Trump en suggérant que la pression américaine écarte la Chine de l’Amérique latine. Mais ce point de vue interprète mal à la fois la nature de l’influence américaine et la dynamique politique et économique qui façonne la région. Ce que nous voyons n’est rien de moins que la coercition d’un empire qui tente d’assurer son emprise déclinante sur un hémisphère de plus en plus multipolaire et pragmatique dans ses politiques économiques.
Enoncée pour la première fois en 1823, la doctrine Monroe était une déclaration de politique étrangère des États-Unis avertissant les puissances européennes de ne pas interférer dans l’hémisphère occidental. Bien qu’elle ait été conçu à l’origine comme une mesure de protection contre le colonialisme, cette référence est rapidement devenue le fondement idéologique de l’interventionnisme américain en Amérique latine, justifiant des dizaines d’invasions militaires, d’opérations secrètes et de changements de régime tout au long du XXe siècle. À la fin du siècle et à l’aube de la guerre froide, il était de plus en plus admis que la doctrine Monroe n’avait plus d’utilité. Les efforts de Trump pour relancer ce cadre, en le positionnant comme un contrepoids à la présence croissante de la Chine, ne reflètent pas un engagement envers les valeurs démocratiques, mais une tentative stratégique de réaffirmer la domination régionale des États-Unis dans un paysage de plus en plus concurrentiel et multipolaire.
La politique de l’ère Trump en Amérique latine s’est fortement appuyée sur les menaces économiques : tarifs douaniers punitifs, suspensions de l’aide et sanctions destinées à forcer les gouvernements à réduire leur engagement avec la Chine. Bien que ces tactiques aient pu décourager certains accords bilatéraux, elles reflètent une faiblesse fondamentale de la politique étrangère américaine : Washington n’est plus en mesure de rivaliser par des moyens constructifs, en particulier sur le front économique. Contrairement à la Chine, qui propose des projets d’infrastructure et des financements de développement alignés sur les priorités régionales, les États-Unis offrent peu d’alternatives viables. Au lieu d’investir dans des partenariats mutuellement bénéfiques, ils ont recours par défaut à la coercition.
L’approche de Trump repose sur l’hypothèse que les États-Unis peuvent compter sur leurs alliances historiques avec les élites politiques et économiques d’Amérique latine pour contrer l’influence chinoise. Mais ce calcul ne tient pas compte d’un changement clé : dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, l’idéologie compte moins que l’investissement et le commerce.
L’idée que l’Amérique latine s’alignera naturellement sur les États-Unis en raison de valeurs politiques partagées ou de loyautés à la guerre froide ne tient plus. Même les gouvernements de droite, supposés alliés de Washington, maintiennent et, dans certains cas, approfondissent leurs liens avec Pékin lorsque cela profite à leurs économies.
En Argentine, le président Javier Milei s’est présenté sur un programme anti-chinois farouche, mais les réalités économiques ont rapidement remodelé sa position : en 2025, son gouvernement a prolongé un échange de devises crucial de 5 milliards de dollars avec la Chine, reflétant ainsi la façon dont la nécessité financière l’emporte souvent sur la rhétorique idéologique. Au Salvador, le président Nayib Bukele, bien qu’il se soit aligné sur les États-Unis, a adopté d’importants investissements chinois, notamment la construction d’un nouveau stade national et d’une méga-bibliothèque moderne située dans la capitale. Et au Pérou, la présidente conservatrice Dina Boluarte a effectué une visite d’État en Chine en 2024 pour élargir la coopération en matière de commerce et d’infrastructures, tandis que des entreprises chinoises ont achevé un immense port en eau profonde à Chancay, qui devrait désormais rivaliser avec Valparaíso au Chili en tant que plaque tournante commerciale clé du Pacifique.
Aucun de ces cas ne suggère un alignement idéologique avec Pékin. Ce qu’ils révèlent est un schéma clair : les gouvernements, quelle que soit leur orientation politique, réagissent à qui apporte des avantages matériels. Et pour l’instant, ce n’est pas Washington.
Les États-Unis continuent de s’appuyer sur leur présence militaire dans la région et de l’étendre, par le biais de bases, de programmes d’entraînement et d’accords de sécurité, estimant que cela suffira pour conserver leur influence. Après tout, la Chine ne projette pas de puissance militaire dans l’hémisphère.
Mais l’avenir de l’Amérique latine n’est pas décidé par des mouvements de troupes ou des pactes de défense. Il est construit par le biais de ports, de chemins de fer, de réseaux énergétiques et de routes commerciales. Vous ne pouvez pas contenir la transformation économique avec du matériel militaire.
Le Panama est l’un des rares endroits où l’approche coercitive de Trump a donné un résultat visible. Mais c’est aussi un cas qui souligne pourquoi la stratégie est difficile à reproduire. Après avoir faussement prétendu que la Chine « exploitait » le canal et menacé de le « reprendre », Washington a poussé le Panama à examiner les opérations portuaires liées à la Chine, ce qui a abouti à leur vente à un consortium dirigé par les États-Unis. Cependant, le Panama est un petit pays fortement dépendant du commerce avec une longue histoire d’intervention américaine ; sa dépendance stratégique et économique à l’égard de Washington rendait la conformité plus probable. Cette dépendance n’est toutefois pas la norme en Amérique latine, où les grandes économies dotées de partenariats diversifiés sont beaucoup moins sensibles aux pressions américaines.
Les États-Unis s’efforcent de repousser la Chine hors d’Amérique latine, non seulement pour maintenir leur propre domination économique et politique dans leur soi-disant « arrière-cour », mais aussi dans le cadre de leurs préparatifs plus larges en vue d’une guerre potentielle avec la Chine, cherchant à couper Pékin de ses principaux marchés, ressources et alliés diplomatiques. De plus en plus de pays refusent d’être complices du programme de guerre de Washington, choisissant plutôt de poursuivre des politiques étrangères indépendantes qui servent leur peuple plutôt que d’alimenter le militarisme américain. Cela reflète l’émergence d’un nouvel ordre mondial multipolaire dans lequel le pouvoir est partagé entre de nombreuses nations, créant ainsi de plus grandes opportunités de dialogue, de coopération et de paix. En outre, divers partenariats économiques au-delà des chaînes d’approvisionnement traditionnelles dominées par l’Occident offrent un potentiel croissant de changement de la division mondiale du travail et offrent de nouvelles voies vers le développement et la prospérité.
Le défaut fondamental de la renaissance de la doctrine Monroe de Trump est son incapacité à reconnaître la nature de l’ordre mondial actuel. L’Amérique latine n’est plus une périphérie passive. C’est une région qui navigue dans un paysage complexe et multipolaire, en équilibre entre les États-Unis, la Chine, l’UE et la coopération Sud-Sud croissante à travers des blocs comme la CELAC et les BRICS+. La présence croissante de la Chine est le résultat logique d’un développement mondial inégal, de flux de capitaux et d’une politique étrangère américaine qui a donné la priorité à la militarisation plutôt qu’au partenariat à long terme. Si les États-Unis ont perdu du terrain, c’est parce qu’ils n’ont pas réussi à rivaliser dans les domaines qui comptent le plus : les infrastructures, le crédit, le commerce et l’investissement.
L’une des justifications académiques les plus citées pour faire revivre la doctrine Monroe provient de la théorie réaliste, en particulier des travaux du politologue John Mearsheimer, qui soutient que les grandes puissances sont contraintes de dominer leurs sphères d’influence régionales. Selon cette logique, il est impératif pour les États-Unis de chercher à prendre le contrôle incontesté de l’Amérique latine. Mais la contradiction est claire : si cette logique se maintient, alors la Chine aurait également droit à sa propre sphère en Asie de l’Est, y compris Taïwan, la mer de Chine méridionale, la péninsule coréenne, les Philippines et le Japon, toutes des zones où les États-Unis maintiennent une forte présence militaire et politique.
Ce double standard doctrinal expose la moralité sélective de la grande stratégie américaine : ce qui est présenté comme défensif lorsqu’il est fait par les États-Unis est considéré comme belliqueux lorsqu’il est poursuivi par d’autres. Contrairement aux États-Unis, cependant, la Chine n’a pas mené de guerre depuis 1979 et a investi dans le financement du développement et les infrastructures par le biais de l’initiative Belt and Road, et non dans des alliances militaires ou des guerres par procuration. Alors que les États-Unis relancent les cadres de contrôle du XIXe siècle, la Chine promeut un ordre multipolaire basé sur le bénéfice mutuel.
Les dirigeants politiques, y compris le président colombien Gustavo Petro, ont appelé à plusieurs reprises à des relations fondées sur des avantages mutuels plutôt que sur les liens subordonnés longtemps imposés par les États-Unis. Petro a insisté pour que l’Amérique latine et les Caraïbes soient considérées comme le « centre du monde » plutôt que comme sa périphérie, et a souligné l’importance de travailler avec d’autres nations pour faire face à la crise climatique. La Chine est devenue le premier pays à proposer des solutions à grande échelle au changement climatique, offrant des opportunités pour les technologies vertes dont l’Amérique latine et les pays du Sud ont un besoin urgent, étant donné qu’ils font partie des régions les plus vulnérables à ses impacts. Environ 90 % de toutes les technologies éoliennes et solaires de la région ont été produites par des entreprises chinoises, et de nombreuses grandes villes dépendent désormais du transport électrique en provenance de Chine. Au Chili, des projets d’énergie propre soutenus par la Chine ont poussé le pays bien au-delà de son objectif d’énergie renouvelable pour 2025. Aujourd’hui, environ 30 % du pays est alimenté par de l’énergie propre. Ces partenariats illustrent pourquoi de nombreux gouvernements considèrent la Chine comme un partenaire pratique dans la construction d’infrastructures et la réalisation d’objectifs de développement urgents, avec lesquels la renaissance de la doctrine Monroe de Washington ne peut rivaliser.
La doctrine Monroe fonctionnait dans un monde où Washington n’avait pas à faire face à une concurrence sérieuse. Ce monde n’existe plus. L’Amérique latine navigue aujourd’hui dans un système international plus complexe, avec la capacité de choisir et la mémoire des interventions passées pour guider ces choix.
Parce que ce changement ne concerne pas seulement le fait que la Chine intervienne là où les États-Unis ont échoué, il reflète un modèle structurel plus profond. Pendant une grande partie de leur histoire, les pays d’Amérique latine ont été piégés dans le rôle désavantageux des exportateurs de matières premières et des importateurs de produits finis, avec peu de marge de manœuvre pour façonner leurs propres trajectoires économiques. Sous la domination américaine, cette relation était synonyme de dette, d’austérité et de dépendance. L’essor de la Chine n’inverse pas ce système, mais il modifie l’équilibre des forces en son sein.
Comme l’économiste marxiste Samir Amin l’a soutenu dans Accumulation à l’échelle mondiale (1970), le système capitaliste mondial attire les économies périphériques dans des rôles qui servent les besoins des puissances dominantes, les maintenant dépendantes et sous-développées. Leurs ressources et leur main-d’œuvre sont extraites pour alimenter la croissance économique dans les pays du centre, et non les leurs. En offrant des infrastructures, des crédits et des échanges commerciaux sans les mêmes conditions politiques, la Chine donne aux gouvernements de la région plus de pouvoir de négociation, plus de marge de manœuvre pour négocier, se diversifier et affirmer leur autonomie économique. Ce changement dans le pouvoir de négociation est ce que la renaissance de la doctrine Monroe par Washington est censée contenir.
L’approche de Trump à l’égard de l’Amérique latine n’est pas en train de remodeler la région. Elle met en évidence le peu de place qu’il reste pour un contrôle unilatéral. La tentative de pousser la Chine vers la sortie ne réussira pas par le biais de tarifs douaniers et de menaces. Ce type d’intimidation ne fera qu’aliéner davantage les partenaires régionaux et révéler la vacuité de la rhétorique américaine sur la démocratie, la prospérité et la liberté.
Si Washington veut être un acteur sérieux dans la région, il doit abandonner la logique de la doctrine Monroe et adopter une véritable politique de bon voisinage, qui réinvestit dans sa propre capacité économique et engage l’Amérique latine sur un pied d’égalité, non pas comme une sphère à contrôler, mais comme une communauté de nations souveraines choisissant leur propre chemin.
La doctrine Monroe pourrait à nouveau faire les gros titres. Mais pour beaucoup dans la région, c’est une histoire usée par le temps.
Michelle Ellner est coordinatrice de la campagne CODEPINK pour l’Amérique latine. Elle est née au Venezuela et est titulaire d’une licence en langues et affaires internationales de l’Université La Sorbonne Paris IV, à Paris. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé pour un programme de bourses internationales à partir de bureaux à Caracas et à Paris et a été envoyée en Haïti, à Cuba, en Gambie et dans d’autres pays dans le but d’évaluer et de sélectionner les candidats.
Megan Russell est coordinatrice de la campagne « La Chine n’est pas notre ennemi » de CODEPINK. Elle est diplômée de la London School of Economics avec une maîtrise en études des conflits. Avant cela, elle a étudié les conflits, la culture et le droit international. Megan a passé un an à étudier à Shanghai et plus de huit ans à étudier le chinois mandarin. Ses recherches portent sur l’intersection entre les affaires américano-chinoises, la consolidation de la paix et le développement international
CounterPunch+
Views: 1


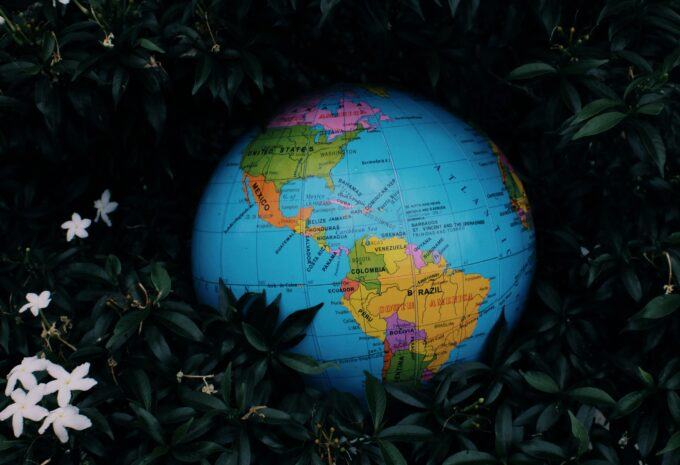


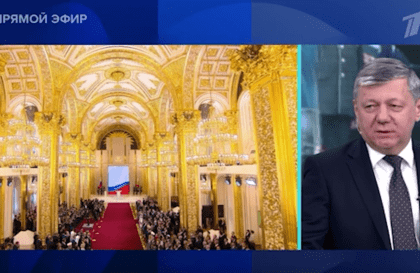

admin5319
Xuan
Il faut être matérialiste et non idéaliste, les rapports sociaux de production et les intérêts matériels des classes définissent leurs choix.
Mais il faut dire que depuis très longtemps les communistes et les progressistes se sont vus infliger une éducation idéaliste, où les étiquettes servent de vade mecum théorique et de bréviaire.
En particulier les concepts parlementaires bourgeois sont l’alpha et l’oméga de tout raisonnement.
Sans tenir compte des intérêts bourgeois dans tout le sud global.