Ce constat de la part d’un universitaire de Cambridge dit ce que nul ne peut désormais ignorer : c’est la chute de l’empire américain. L’article a le mérite, s’il attribue à Trump ce qui achève la superpuissance Etats-Unis d’être tout à fait conscient d’un choc géopolitique dans un contexte d’innovation scientifique et technologique. Dans une crise profonde qui crée des incertitudes pour tous les décideurs et investisseurs, on ne peut de surcroit pas faire confiance aux proclamations mensongères du pouvoir et des médias qui le suivent. Inutile de dire que nous ne partageons pas les choix fondamentaux de ce « libéral » capitaliste mais il a au moins conscience de l’ampleur du bouleversement, et il n’est pas loin de notre diagnostic : Trump syndic de faillite et sur la nature de l’impact que dans son sillage l’UE et la France risquent de subir, c’est pour cela que nous avons proposé d’envisager d’écouter réellement ce que la Chine nous propose. . (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et societe)
Ce qu’une ère d’incertitude économique signifiera pour le monde
Mohamed A. El-Erian
14 juillet 2025
MOHAMED A. EL-ERIAN est président du Queens’ College de l’Université de Cambridge et professeur de pratique Renee Kerns à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. De 2007 à 2014, il a été chef de la direction de Pacific Investment Management Company.
L’économie mondiale est, c’est le moins qu’on puisse dire, en pleine mutation. Avant les dernières élections américaines, elle était déjà secouée par les chocs géopolitiques et la perspective d’innovations technologiques transformatrices. Mais aujourd’hui, elle doit également faire face à une volatilité politique inhabituellement élevée de la part du pays le plus puissant du monde. Le résultat a été des montagnes russes non seulement pour les obligations et les actions, mais aussi pour les prévisionnistes économiques et les décideurs.
À un niveau plus profond, cette tourmente a remis en question les récits consensuels sur les États-Unis. Les hypothèses de longue date qui sous-tendent les choix des ménages, des entreprises et des investisseurs ont disparu. Les règles empiriques sont devenues beaucoup moins utiles. Les mesures de la confiance des consommateurs et des producteurs ont chuté de plein fouet. Les attentes d’inflation, quant à elles, ont bondi à des niveaux observés pour la dernière fois en 1981.
Au milieu de cette profonde incertitude, les prévisionnistes ont eu du mal à prédire où l’économie américaine finira par atterrir. Mais deux visions principales s’articulent autour d’un ensemble dispersé et instable de projections individuelles. Dans le premier, les États-Unis sont dans un parcours cahoteux qui culminera avec une restructuration économique semblable à celles qui ont eu lieu sous le président américain Ronald Reagan et le premier ministre britannique Margaret Thatcher, où ils émergeront avec moins de dettes et un secteur privé plus efficace et où ils commerceront dans un système international plus juste. Dans le deuxième scénario, le pays glisse lentement dans la stagflation et, comme cela s’est produit sous le président américain Jimmy Carter, pourrait se retrouver dans une profonde récession, peut-être avec une instabilité financière prononcée.
Quoi qu’il en soit, il aura des effets en chaîne ramifiés internationaux. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’économie et le système financier des États-Unis sont au centre des marchés mondiaux. Washington exerce une grande influence dans les institutions multilatérales. Les États-Unis ont longtemps été le seul moteur fiable de la croissance économique mondiale, et ils sont à la pointe du développement et de l’adoption de la plupart des innovations améliorant la productivité, telles que l’intelligence artificielle, les sciences de la vie et la robotique. De nombreux investisseurs étrangers ont externalisé la gestion de leur épargne et de leur patrimoine sur les marchés financiers américains, grâce à leur grande liquidité et à leur architecture solide. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Si les États-Unis glissent dans la stagflation, d’autres parties de la planète risquent de les suivre.
La plupart des gouvernements semblent le savoir. C’est pourquoi les pays du monde entier cherchent à se protéger de l’instabilité politique émanant de Washington. L’Europe, par exemple, s’efforce d’améliorer sa position régionale tout en forgeant de nouvelles relations économiques plus solides avec l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. La Chine, quant à elle, voit une occasion de se positionner comme la superpuissance économique la plus fiable. Pourtant, jusqu’à présent, ces efforts se heurtent à des vents contraires. Il n’y a tout simplement aucun autre pays qui soit aussi riche ou assez puissant pour se mettre à la place des États-Unis.
Avec peu de perspectives de stabilité, les gouvernements, les entreprises et les investisseurs devront faire davantage pour s’assurer contre les dommages potentiels. Ils doivent être agiles et flexibles. Ils ont besoin de capital et de résilience humaine pour pouvoir absorber les revers et financer de nouvelles initiatives. Et ils doivent être ouverts à de nouvelles façons de penser et de se comporter. Si ces acteurs peuvent devenir plus agiles, ils survivront à la volatilité et en sortiront peut-être meilleurs. Mais s’ils gèlent, ils compromettront le bien-être des générations actuelles et futures.
UNE PAUSE POUR L’EXCEPTIONNALISME
Les États-Unis sont toujours le pays le plus puissant et le plus prospère du monde, et ils ont des institutions matures. Mais en termes économiques et financiers, le pays ressemble parfois à une nation en développement. À l’instar des pays dont les systèmes fiscaux sont immatures et qui ont désespérément besoin de revenus, Washington a soudainement imposé des droits de douane élevés sur la plupart des biens extérieurs. Il a ensuite glissé dans une approche de concessions de fromage suisse, exemptant des produits et des secteurs d’une manière apparemment arbitraire. Elle a fait tout cela alors que son déficit ne cessait d’augmenter. En effet, il semble parfois que les responsables américains aient adopté une approche de l’élaboration des politiques plus proche de ce qui s’est passé dans certaines parties de l’Amérique latine que de ce que l’on pourrait attendre de l’économie la plus puissante du monde.
Plus ce comportement se poursuit, plus le risque est grand que l’économie américaine soit assaillie par des problèmes plus communs aux pays en développement. Déjà, il y a des signes de sorties de capitaux et d’une plus grande hésitation de la part des investisseurs extérieurs, et on s’inquiète de l’indépendance de la banque centrale. Les marchés américains, après des décennies de domination, ont sous-performé au début de 2025. Le dollar, autrefois puissant, perd de sa valeur, même si les rendements obtenus en le détenant augmentent. Il y a même eu une forte réduction des visites touristiques.
Et il est peu probable que les turbulences se dissipent. Le président américain Donald Trump s’est présenté aux élections de 2024 en promettant de bouleverser l’économie américaine et mondiale, de retirer le parapluie de sécurité de Washington et de répartir plus équitablement le coût de la fourniture de biens publics mondiaux clés tels que l’aide et la défense. Il tient ses promesses et il n’y a aucune raison de penser qu’il s’arrêtera de sitôt. En fait, la question est de savoir jusqu’où il ira et à quelle vitesse il se déplacera.
Aujourd’hui, les États-Unis ressemblent parfois à un pays en développement.
D’autres pays pourraient espérer qu’en fin de compte, l’approche politique actuelle de Washington ne déstabilisera que modestement l’ordre économique. Mais les tarifs douaniers, l’affaiblissement du dollar, le risque d’instabilité financière et les suggestions selon lesquelles les États-Unis pourraient essayer de forcer certains de leurs créanciers extérieurs à prolonger l’échéance de leurs avoirs en obligations du Trésor américain ont laissé le monde sur les nerfs, même les observateurs chevronnés ayant du mal à donner un sens à ce que l’avenir leur réserve. En termes simples, Washington a ébranlé les fondements mêmes de l’ordre mondial, et il n’y a pas de chef d’orchestre de confiance pour guider les pays et les entreprises à travers la transition compliquée vers ce qui va suivre.
La liste des incertitudes est longue et intimidante. Il n’est pas clair, par exemple, si Washington peut bouleverser le commerce mondial sans bouleverser les flux de capitaux mondiaux. Les experts ne savent pas si l’effet des tarifs sur les prix s’avérera être une affaire ponctuelle ou si cela alimentera un cycle inflationniste. On ne sait pas comment les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale américaine, géreront l’équilibre délicat entre maîtriser les prix et éviter une forte contraction économique. (La tension entre Trump et Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, ne fait qu’ajouter à l’incertitude et met en péril l’indépendance, l’efficacité et la crédibilité de la banque.) Personne ne peut prédire les conséquences à long terme des perturbations de la chaîne d’approvisionnement de la pandémie, que les tensions géopolitiques ont exacerbées. Et plusieurs pays attendent toujours de savoir s’ils seront contraints de choisir entre la Chine et les États-Unis alors que les tensions dans le Pacifique montent.
Ces questions ouvertes rendent évidemment la vie difficile aux gouvernements. Mais ils compliquent aussi les choses pour les entreprises et les investisseurs. Les corrélations historiques de longue date entre les classes d’actifs, notamment les prix des actions et des obligations, constituaient autrefois le fondement de la stratégie d’investissement. Aujourd’hui, ces relations sont à la fois inhabituelles et instables. Les refuges traditionnels, quant à eux, ne sont plus réellement sûrs. Les éléments de base de toute approche d’investissement – rendements attendus, volatilité et corrélation – sont aussi incertains qu’ils l’ont été depuis des décennies. Par conséquent, les investisseurs ont du mal à répartir leurs actifs et à atténuer les risques. Ils savent qu’ils doivent faire évoluer leur approche, mais il est loin d’être clair vers quoi ils devraient évoluer.
DE DEUX ESPRITS
En essayant de prédire ce qui va se passer, les prévisionnistes économiques ont généralement été tiraillés dans l’une des deux directions extrêmes. La première est optimiste quant à la direction que prendra le parcours cahoteux actuel. Selon cette vision, l’administration Trump réussirait à réduire la bureaucratie, à éliminer les réglementations inutiles et à réduire les dépenses, créant ainsi un gouvernement plus efficace qui serait moins encombré de dettes à mesure que la croissance s’accélérerait. L’économie sortirait de la tourmente actuelle avec un secteur privé déchaîné qui serait en mesure de mieux saisir les innovations passionnantes qui améliorent la productivité dans des domaines où les États-Unis sont déjà en tête, tels que l’intelligence artificielle, les sciences de la vie, la robotique et (à terme) l’informatique quantique. Washington pourrait encore avoir des tarifs douaniers plus élevés qu’avant l’arrivée au pouvoir de Trump. Mais ces tarifs auraient produit un système commercial plus équitable, dans lequel d’autres pays auraient démantelé leurs droits de douane plus élevés et leurs barrières non tarifaires onéreuses tout en assumant une plus grande part du coût de la fourniture de biens publics mondiaux. Ce scénario n’est pas seulement une réminiscence des réformes du début des années 1980 menées par Reagan et Thatcher. Cela va au-delà. Cela impliquerait une réinitialisation non seulement de l’ordre économique national, mais aussi de l’ordre mondial.
Pour arriver à ce résultat, bien sûr, il faudrait que beaucoup de choses se passent bien. Plus important encore, une croissance plus élevée devrait se matérialiser rapidement pour atténuer le surendettement qui se forme. Les marchés financiers devront faire preuve de patience, en absorbant les incertitudes concernant le dollar et les obligations d’État américaines. Sur le plan international, les pays devraient avoir confiance dans le fait que Washington s’en tiendrait à ce qu’il a convenu en matière de commerce et de tarifs. Ils devraient devenir plus à l’aise avec leurs avoirs encore importants en dollars et en bons du Trésor. Et ils devraient naviguer dans ce qui sera probablement des tensions persistantes entre la Chine et les États-Unis, les deux superpuissances économiques du monde.
Ensuite, il y a la Réserve fédérale. Dans un monde où la productivité est plus élevée, où l’inflation est plus faible et où les déficits et la dette sont moins menaçants, la banque centrale devrait se sentir plus disposée et être plus en mesure de réduire considérablement les taux. Mais pour y arriver, Trump et Powell devraient résoudre leurs différends, soit Powell démissionnerait, soit Trump ferait preuve de plus de patience jusqu’en mai, date à laquelle le mandat de Powell devrait se terminer.
C’est un monde dans lequel la volatilité reste élevée.
Trump pourrait également obtenir une baisse de taux dans un scénario plus pessimiste, mais pas de la manière qu’il souhaite. Dans ce monde, Washington n’arrive pas à maîtriser ses déficits croissants. La confiance dans les institutions continue de s’éroder, alors que les inquiétudes concernant l’État de droit et les excès de pouvoir de l’exécutif augmentent. Les États-Unis montrent de moins en moins d’intérêt à la fois pour l’établissement et le respect des normes et réglementations mondiales. D’autres pays reconsidèrent leur rôle dans l’ordre mondial. Au minimum, ils sont contraints de s’auto-assurer davantage, cherchant à faire preuve d’une plus grande résilience nationale face à un monde en mutation. Ils pourraient même finir par former des alliances multinationales qui inquiéteraient les États-Unis non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la sécurité nationale.
Ce scénario répéterait en fait une grande partie de ce que le monde a connu dans les années 1970, lorsque l’économie mondiale était également aux prises avec des chocs d’offre, une hausse des prix des produits de base et des erreurs politiques. Ce serait sombre pour toutes les personnes concernées. Les entreprises devraient jongler avec la hausse des coûts et l’affaiblissement de la demande. Les investisseurs auraient du mal à obtenir des rendements dans un environnement où les obligations et les actions étaient vulnérables. Et les ménages auraient moins de pouvoir d’achat et de sécurité d’emploi. Le monde entier pourrait alors basculer dans une récession, laissant des cicatrices sur une génération qui a déjà moins de résilience financière et humaine. Les générations futures, qui héritent déjà d’un monde caractérisé par une dette élevée, des inégalités et des crises climatiques, en souffriraient également.
À l’heure actuelle, les bons et les mauvais scénarios sont plausibles, tout comme de nombreux points de la gamme qu’ils délimitent. En fait, au début de l’année 2025, divers indicateurs de prix du marché suggéraient qu’il y avait environ 80 % de chances de changement pour le mieux et 20 % de chances de changement pour le pire. Les perspectives pour le bon scénario sont tombées à moins de 50 % début avril, lorsque Trump a annoncé des droits de douane beaucoup plus élevés que ce que les marchés avaient anticipé. Il est devenu plus favorable à la fin du mois, les traders et les investisseurs devenant plus confiants dans le fait que son retard de 90 jours se traduirait par des tarifs gérables et qu’il n’y aurait pas de choc majeur pour le système commercial mondial. Mais ce mélange est intrinsèquement fluide et risque de continuer à changer, du moins dans un avenir proche.
SE PRÉPARER À L’IMPACT
Même s’ils le souhaitent, il y a très peu d’acteurs publics ou privés, voire aucun, qui peuvent se protéger pleinement de la volatilité économique actuelle. Mais il existe des stratégies qu’ils peuvent adopter pour s’en sortir.
L’une d’entre elles consiste simplement à garder le cap et à parier qu’en fin de compte, le monde ne sera pas très différent de ce qu’il était en janvier. Après tout, les marchés se sont déjà remis des déclarations commerciales radicales de Trump, les principaux indices boursiers établissant de nouveaux records. Alors que le président parle et négocie avec différents pays, la désescalade pourrait prévaloir. Et quoi qu’il arrive, les États-Unis finiront par conserver leur dynamisme du secteur privé, leur innovation et leur esprit d’entreprise. Il sera le leader mondial en matière de développement technologique et biologique. Certains économistes vont jusqu’à affirmer qu’un marché des bons du Trésor américain instable et volatil n’a pas besoin de contaminer un secteur des entreprises solide. Pour eux, on peut être une bonne maison dans un quartier instable.
D’autres pays, quant à eux, pourraient résoudre leurs propres problèmes économiques, forcés de le faire par le retrait de la couverture de sécurité américaine. L’Europe pourrait stimuler davantage la croissance en rationalisant son système réglementaire complexe, en encourageant l’innovation et la diffusion, et en favorisant ainsi la productivité. Cela serait soutenu par de meilleurs efforts à l’échelle régionale pour achever l’architecture de l’UE, qui dépend trop de son union monétaire et a désespérément besoin de progrès dans ses unions budgétaire et bancaire.
Pendant ce temps, en Asie, Pékin pourrait limiter ses exportations afin que les pays ne s’inquiètent pas du dumping de produits chinois sur leurs marchés, comme le Japon l’a fait il y a quelques décennies avec ses restrictions volontaires à l’exportation. La Chine pourrait également réorganiser fondamentalement son modèle de croissance, en remplaçant les moteurs traditionnels des exportations et de l’investissement public par la libération de la consommation intérieure privée et de l’investissement privé.
Un écran montrant le président américain Donald Trump, New York, juin 2025
Jeenah Moon / Reuters
Pourtant, compte tenu des incertitudes, ni les entreprises ni les gouvernements ne souhaitent parier la ferme sur une issue aussi heureuse. Si le rôle des États-Unis dans les systèmes économiques et financiers mondiaux est devenu intrinsèquement plus incertain et chaotique, les décideurs doivent se préparer à un monde plus fragmenté avec des risques plus fréquents et plus violents. C’est un monde où la volatilité induite par les politiques politiques reste élevée, les chaînes d’approvisionnement mondiales instables et les marchés de la dette financière nerveux. Les pays pourraient tenter de réduire davantage les risques, en initiant un découplage plus profond. La concurrence entre Pékin et Washington s’intensifierait. Une poignée d’États pivots importants, à savoir le Brésil, l’Inde, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pourraient entretenir de bonnes relations avec les deux gouvernements. Mais la plupart des pays devraient choisir.
Dans ce cas, les décideurs devront faire beaucoup plus pour reprendre le contrôle de leur destin économique et financier. Dirigée par une Allemagne plus intéressée par la défense et les infrastructures, l’Europe devrait surmonter son hésitation de longue date à émettre de la dette commune, déléguer plus d’autorité à Bruxelles et entreprendre de nombreuses autres initiatives régionales, y compris dans le domaine de la défense. La Chine devrait être moins hésitante à sacrifier la croissance à court terme dans la poursuite d’une refonte fondamentale de son économie. Les grands pays en développement, comme le Brésil et l’Inde, deviendraient également plus réformateurs et feraient sortir leurs économies du piège tenace du revenu intermédiaire.
Heureusement pour eux, le comportement de Washington pourrait donner exactement l’élan nécessaire pour faire de tels changements. L’Europe, en particulier, peut utiliser l’instabilité actuelle comme couverture aérienne pour poursuivre les réformes proposées par l’ancien Premier ministre italien Mario Draghi, qui visent à remédier au manque d’innovation, de croissance de la productivité et de financement interne dans la région. L’Europe pourrait également créer des marchés de capitaux plus homogènes capables d’absorber les investissements excessifs du continent dans les actifs américains.
Mais les changements radicaux, comme le maintien du cap, comportent également des risques. Si l’avenir reste incertain, les décideurs politiques ne voudront peut-être pas opérer de grands changements irréversibles. Au lieu de cela, ils voudront peut-être emprunter une sorte de voie médiane. Ils pourraient, par exemple, réduire leur exposition aux États-Unis, mais à la marge, de manière modifiable. Ils pourraient le faire discrètement, pour éviter de déclencher la colère de Washington.
Les décideurs doivent éviter de tomber dans des pièges comportementaux.
Choisir entre ces différents parcours ne sera pas chose aisée. Chaque acteur devra décider ce qui a le plus de sens pour lui. Mais à mesure que le chaos géopolitique augmente, chaque acteur devra apprendre à s’adapter rapidement, y compris ceux qui pensent que le monde changera peu. Cela signifie que les acteurs doivent s’efforcer de développer une résilience financière, humaine et opérationnelle considérable.
Les entreprises et les investisseurs, par exemple, devraient détenir plus de liquidités et renforcer leurs bilans, diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et leurs portefeuilles, investir davantage dans le développement des employés à l’aide d’outils innovants et communiquer plus efficacement. Les décideurs doivent également faire un meilleur travail pour jouer les scénarios futurs, tester leurs stratégies et identifier les vulnérabilités potentielles. Cela signifie donner aux unités locales, aux responsables et aux individus les moyens de planifier les matchs et de tester les politiques.
Enfin, les décideurs doivent éviter de tomber dans les pièges comportementaux. En période d’incertitude, les gens sont plus sujets que d’habitude aux biais cognitifs qui mènent à de mauvaises décisions. Cette tendance va au-delà du déni que le changement est en cours. Souvent, cela implique ce que les spécialistes du comportement appellent « l’inertie active » : lorsque les acteurs reconnaissent qu’ils doivent se comporter différemment mais finissent par s’en tenir à des modèles et des approches familiers malgré tout.
Le destin de l’ancien grand IBM en est un bon exemple. Au début des années 1980, l’accent mis par l’entreprise sur l’informatique centrale était de plus en plus menacé par l’essor de l’ordinateur personnel. En réponse, le conseil d’administration et la direction ont tous deux approuvé ce qui était, fondamentalement, la bonne décision stratégique : réaffecter des ressources humaines, financières et d’innovation à la production d’ordinateurs personnels. Pourtant, la tentative de l’entreprise de changer de cap a déraillé lorsque les dirigeants ont eu du mal à éloigner les travailleurs et les finances de ce qui leur était familier. En conséquence, la société a rapidement été éclipsée par de nouvelles entreprises, et elle a dû se retransformer, essentiellement, en une société de services pour survivre. Elle n’a jamais retrouvé sa position dominante dans l’industrie.
ÊTRE PLUS AUDACIEUX
Le monde est confronté à une grande insécurité. Il y a peu de principes, de règles ou d’institutions sur lesquels les responsables et les investisseurs peuvent compter. L’économie américaine devient moins stable et Washington est moins engagé dans la coordination des politiques mondiales. Après près de 80 ans, le système commercial mondial risque d’être fragmenté. Il n’y a pas de paris sûrs sur l’avenir.
Ce fait n’est pas mauvais en soi. Mais cela signifie que les décideurs doivent être hypervigilants. Les choix que les gens feront dans les mois à venir auront de profondes conséquences sur l’avenir de l’économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. Les responsables gouvernementaux doivent faire preuve d’humilité, mais ce n’est pas non plus le moment de faire preuve de timidité. C’est plutôt le moment de l’audace, de la créativité, de la planification de scénarios imaginatifs et de la remise en question de la sagesse conventionnelle.
Les tâches qui nous attendent sont difficiles. Ils nécessitent une refonte fondamentale de la façon de gérer les économies, les entreprises et les investissements. Mais si les dirigeants sont capables de relever le défi – et ils devraient l’être, soutenus par la diffusion prochaine d’innovations passionnantes – le monde peut faire plus que simplement naviguer dans la tempête. Elle peut en sortir plus forte et plus prospère qu’elle ne l’était auparavant.
Views: 2


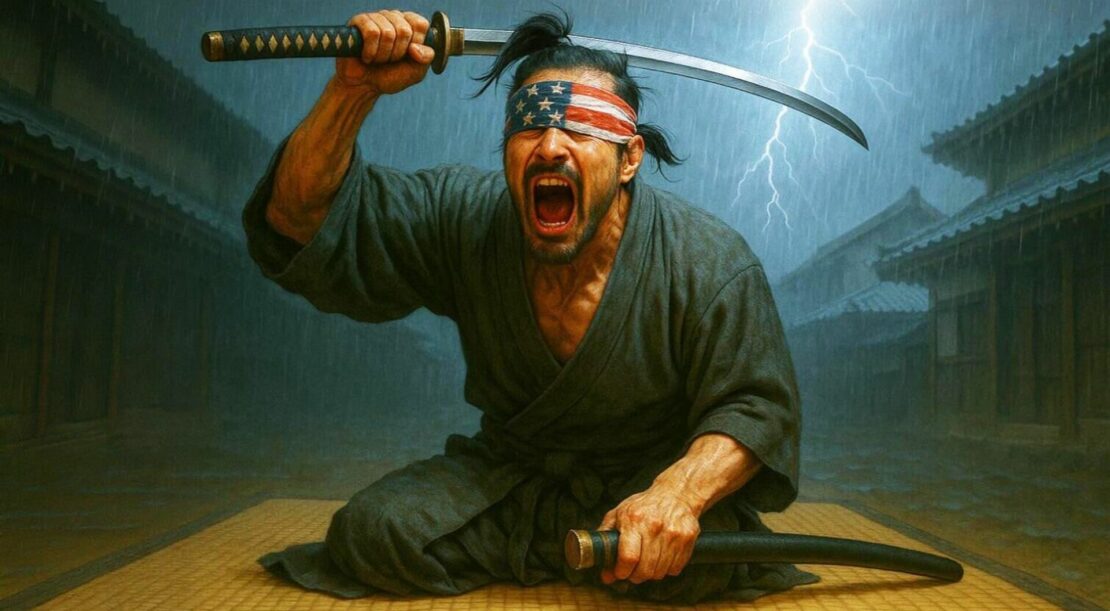




LA MONTÉE DE L’EXTRÊME DROITE AU JAPON : ICI AUSSI ÉCLAIREUR ET REPOUSSOIR AU SERVICE DE L’IMPÉRIALISME US, par Danielle Bleitrach – Histoire et société
[…] Cet article devrait être lu avec ceux du courant pro-atlantiste qui prend acte de la crise profonde de l’impérialisme US en espérant des « portes de sortie ». cet article pourrait utilement être lu avec celui que nous publions par ailleurs sur : L’Amérique est-elle en train de briser l’économie mondiale ? ou le désarroi de ceux qui y cro… […]