L’essentiel est là : le fait que le pragmatisme américain n’implique pas la cession gratuite de n’importe quel bien, surtout celui dont la partie russe a tant besoin. C’est pourquoi Trump ne veut pas céder l’Ukraine, mais la vendre. Ou, pour être plus précis, l’échanger contre une concession de la part de la Russie. Et comme Moscou et Washington ne se sont pas mis d’accord sur le prix à ce jour, les deux parties s’efforcent de le modifier. La Russie fait tout son possible pour faire baisser le prix de l’actif (en intensifiant les frappes de missiles et de bombes sur les installations militaires et industrielles ukrainiennes, et en démontrant sa détermination à atteindre ses objectifs quoi qu’il arrive, avec ou sans l’aide des États-Unis), tandis que Washington tente de l’augmenter ou de le maintenir à son niveau actuel. C’est pourquoi il continue de soutenir Kiev, mais sans s’impliquer lui-même dans la guerre.Et pour l’instant, Trump n’obtient pas ces concessions. Il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que toutes les exigences russes dans le cadre de l’opération militaire en Ukraine ne sont pas des caprices du pouvoir russe, mais des questions existentielles pour la Russie. C’est pourquoi il est mécontent et se dit « très déçu ». En conséquence, les parties se livrent à nouveau à un bras de fer : Trump tente de convaincre la Russie que ses souhaits sont irréalisables, tandis que la Russie tente de convaincre Trump qu’elle fera tout sans son aide. Elle tente également de lui faire comprendre que plus il refusera d’accepter ces exigences, plus il y aura de chances que de nouvelles exigences apparaissent. (note et traduction de Marianne Dunlop pour histoireetsociete)
https://vz.ru/opinions/2025/7/7/1343147.html
Texte : Gevorg Mirzayan
La conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump s’est tenue, selon l’avis de la partie russe, à un niveau professionnel. Les présidents ont échangé leurs points de vue sur l’Ukraine, l’Iran et les relations russo-américaines. Ils ont même abordé la coopération dans le domaine du cinéma.
Cependant, dans le récit de Trump, tout n’était pas aussi rose. Le dirigeant américain a déclaré qu’il était « très déçu par la conversation d’aujourd’hui avec le président Poutine, car… il n’est pas disposé à mettre fin au conflit ». Trump n’a pas menacé de sanctions ou d’autres mesures, mais il est clair qu’aucune décision décisive n’est attendue dans les négociations russo-américaines dans un avenir proche.
Cela pourrait être une mauvaise surprise pour les optimistes russes. Ceux qui espéraient qu’avec l’arrivée au pouvoir d’un président pragmatique aux États-Unis, les problèmes superficiels, inutiles et même nuisibles dans les relations russo-américaines disparaîtraient. Que Moscou et Washington pourraient vraiment repartir à zéro.
Cependant, pour les réalistes, il n’y a aucune surprise. Car ils comprennent parfaitement ce que signifie le pragmatisme américain.
Oui, Donald Trump a procédé à une révision de la politique étrangère américaine à l’égard de la Russie. À l’issue de celle-ci, il a apparemment décidé qu’il n’avait pas besoin de conflits avec la Russie. Qu’ils n’apportaient aux États-Unis aucun bénéfice supplémentaire par rapport à ceux déjà obtenus (distanciation de l’Europe vis-à-vis de la Russie, occupation de Moscou par des questions économiques internes pour les années à venir). Qu’ils détournent l’attention des États-Unis de questions bien plus importantes en Asie de l’Est et au Proche-Orient. Qu’une Russie hostile non seulement distraira l’attention, mais compliquera également le travail des États-Unis dans ces régions (par exemple, si elle aide l’Iran ou la Chine à contenir l’Amérique). Une Russie non hostile, quant à elle, ne fera au moins pas obstacle.
Il a également décidé, de toute évidence, que la principale cause des conflits était la politique trop active des États-Unis dans l’espace post-soviétique. Une région qui n’a pas d’importance cruciale pour les États-Unis, mais qui constitue en même temps un tampon de sécurité historique pour la Russie. Celle-ci perçoit de manière critique toute ingérence extérieure dans la région (sans parler de l’organisation de révolutions colorées). Et si les États-Unis réduisent considérablement leur activité dans cette région, la plupart des conflits avec Moscou disparaîtront d’eux-mêmes.
Et Trump a en partie réduit cette activité. Par exemple, sous son mandat, les États-Unis ont cessé d’inciter la Géorgie à ouvrir un deuxième front contre Moscou (ce que faisait l’administration Biden). On ne voit pas d’activité américaine dans le soutien aux actions russophobes de la présidente moldave Maia Sandu. Dans les affaires arméniennes et azerbaïdjanaises, ce n’est pas Washington qui mène la danse, mais respectivement Paris et Londres (dans ce dernier cas par l’intermédiaire d’Ankara).
Cependant, sur le front principal, celui de l’Ukraine, Trump n’a pas réduit son activité. Même si l’Ukraine est déjà un passif du point de vue des intérêts américains, même si ses relations avec le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, sont carrément froides, Trump n’a pas abandonné l’Ukraine. Il continue de rencontrer Zelensky, de lui apporter son soutien politique et ne lève pas le petit doigt pour obliger l’Europe à cesser d’alimenter le régime de Kiev en armes et en argent.
C’est ce qui contrarie les optimistes. Cependant, le problème est qu’ils ne voient qu’une partie de l’approche pragmatique américaine, celle qu’ils veulent voir. Ils ne veulent pas voir l’autre partie.
Par exemple, le fait que le pragmatisme américain n’implique pas la cession gratuite de n’importe quel bien, surtout celui dont la partie russe a tant besoin. C’est pourquoi Trump ne veut pas céder l’Ukraine, mais la vendre. Ou, pour être plus précis, l’échanger contre une concession de la part de la Russie. Et comme Moscou et Washington ne se sont pas mis d’accord sur le prix à ce jour, les deux parties s’efforcent de le modifier. La Russie fait tout son possible pour faire baisser le prix de l’actif (en intensifiant les frappes de missiles et de bombes sur les installations militaires et industrielles ukrainiennes, et en démontrant sa détermination à atteindre ses objectifs quoi qu’il arrive, avec ou sans l’aide des États-Unis), tandis que Washington tente de l’augmenter ou de le maintenir à son niveau actuel. C’est pourquoi il continue de soutenir Kiev, mais sans s’impliquer lui-même dans la guerre.
- L’OTAN devra choisir entre deux options
- La volonté de l’Europe de nuire à la Russie se heurte aux intérêts des États-Unis
- L’Ukraine a détruit des stocks militaires américains
En outre, le pragmatisme américain implique non seulement la conclusion effective d’un accord, mais aussi sa formalisation ostensible. Donald Trump ne peut pas renoncer complètement à l’Ukraine, même en échange de certaines concessions de la part de la Russie : il a également besoin de concessions dans le texte même de l’accord de paix russo-ukrainien. Il faut que la Russie renonce à au moins une partie de ses exigences : la désoccupation de tous les nouveaux territoires russes, la non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, le renoncement du régime de Kiev à toute coopération militaire avec l’Occident, la dénazification, etc. Dans le cas contraire, Trump n’obtiendra pas le prix Nobel de la paix, mais l’image d’un président faible qui s’est rendu à Poutine (car les concessions de la part de la Russie dans le cadre de la politique mondiale américaine ne seront probablement pas publiques, et encore moins écrites).
Et pour l’instant, Trump n’obtient pas ces concessions. Il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que toutes les exigences russes dans le cadre de l’opération militaire en Ukraine ne sont pas des caprices du pouvoir russe, mais des questions existentielles pour la Russie. C’est pourquoi il est mécontent et se dit « très déçu ». En conséquence, les parties se livrent à nouveau à un bras de fer : Trump tente de convaincre la Russie que ses souhaits sont irréalisables, tandis que la Russie tente de convaincre Trump qu’elle fera tout sans son aide. Elle tente également de lui faire comprendre que plus il refusera d’accepter ces exigences, plus il y aura de chances que de nouvelles exigences apparaissent.
Enfin, le pragmatisme américain suppose un travail d’équipe. Et il ne s’agit pas seulement du Congrès (qui doit voter la levée d’une série de sanctions anti-russes, ce sur quoi Moscou insistera lors de la conclusion d’un accord global avec les États-Unis). Le président américain peut mépriser autant qu’il le souhaite ses partenaires européens et leur montrer leur place, mais il ne peut ignorer complètement leurs intérêts dans le conflit ukrainien. De plus, une telle ignorance n’est pas judicieuse, même dans le cadre d’un éventuel accord russo-américain. En effet, Moscou a besoin que ses conditions soient acceptées non seulement par les États-Unis, mais aussi par l’UE. Elle veut que l’Europe cesse d’armer, de financer et d’alimenter idéologiquement le régime de Kiev. Il y a donc là aussi un blocage : Trump doit trouver des arguments pour convaincre les Européens. Moscou ne se contente pas d’attendre, mais agit (y compris sur le champ de bataille) pour que, si ce n’est Bruxelles, au moins les gouvernements nationaux européens regardent la situation avec lucidité.
C’est pourquoi il n’y aura pas d’accord entre les États-Unis et la Russie pour l’instant. Le réalisme et le pragmatisme invitent tout le monde à attendre.
Views: 3


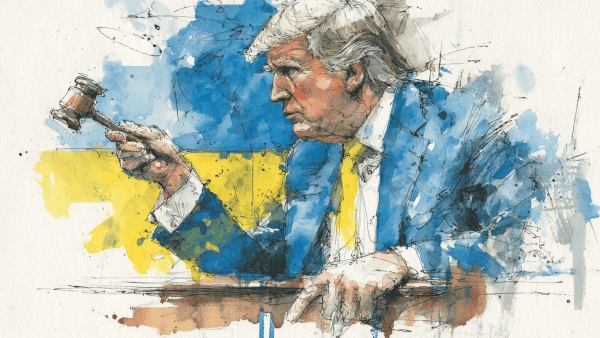




Chabian
Je me méfie un peu de l’expression usitée de « menaces existentielles ». Israël démontre l’usage qui peut en être fait, et les démarches douanières de Trump parte de la même logique, celle de la victimisation (du dominant, du coupable, du manipulateur narcissique, etc.). C’est là un argument subjectif qui se réclame d’une fausse objectivité. Il y a d’un point de vue matérialiste des rapports de force et aussi des « jeux de domino » pour affaiblir ou renforcer des « alliances ». Eloigner l’Otan de ses frontières est un argument pour la Russie, mais limité. Conserver l’isolement de l’Ukraine par rapport à l’Occident est un objectif distinct. Affaiblir la composante fasciste d’un pays est un objectif tiers, de même que l’appuyer (Musk appuyant l’ AfD…).