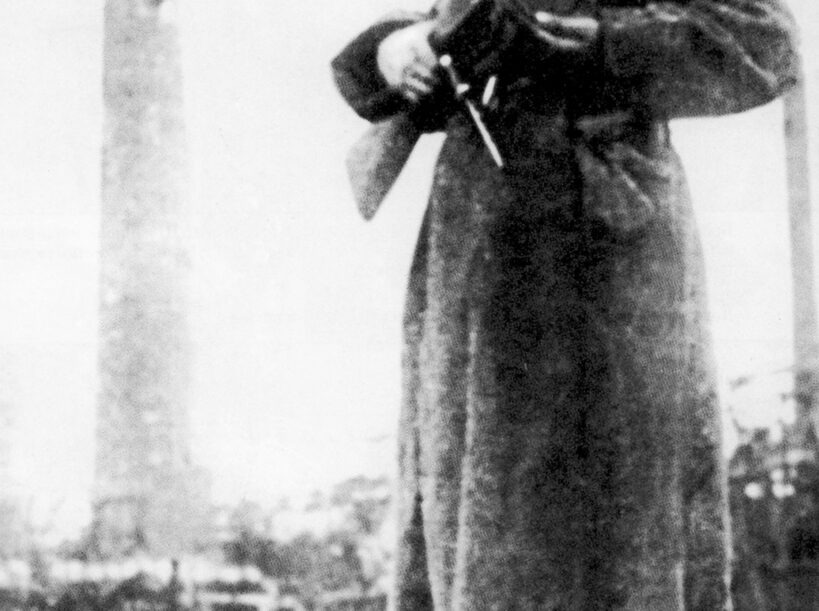La propagande à laquelle les Français et les peuples occidentaux sont soumis consiste à créer l’anomie (l’impossibilité à former collectif) en attaquant la mémoire historique. Ce travail qui produit chez les individus des souffrances et des traumatismes monstrueux a pris une ampleur inouïe. Il s’est déroulé sur des décennies, avec le maccarthysme, les répressions ouvrières de la guerre froide mais il est devenu à partir des années soixante et dix, de la crise du capitalisme avec la répression chilienne, le néolibéralisme de Thatcher, Reagan assumé par Mitterrand et une gôche anticommuniste. L’eurocommunisme devenu liquidation antisoviétique au sein des partis est devenu après la chute de l’URSS, un des vecteurs, exigeant des communistes eux-mêmes ce travail de négation. Il est poursuivi en retrait depuis le 38e Congrès par le secteur international du PCF, la presse dite communiste et bien des commissions, qui avec l’état de désorganisation du parti, prétendent en déterminer la ligne par censure et confusion. Le parti communiste russe sous la direction de Ziouganov qui avait été interdit, réprimé a su au contraire activer la mémoire et est aujourd’hui un des piliers du patriotisme russe face à l’impérialisme, sans chauvinisme, ni xénophobie à partir des intérêts du peuple russe (note de Danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop)

https://gazeta-pravda.ru/issue/48-31685-612-maya-2025-goda/kogda-narod-i-vlast-ediny
La Pravda N° 48 (31685) 6-12 mai 2025 (page 4)
Auteur : Jean TOCHENKO.
Jean TOCHENKO, membre correspondant de l’Académie russe des sciences, s’entretient avec Viktor KOZHEMIAKO, chroniqueur politique du journal Pravda
Pourquoi et comment l’Union soviétique est-elle devenue la grande vainqueure de la plus grande guerre de l’histoire de l’humanité ? Cette question, qui se pose depuis les jours de mai 1945, n’a rien perdu de son actualité. On pourrait croire que des réponses exhaustives ont déjà été données, mais la vie nous oblige à revenir sans cesse sur ce sujet. En effet, dans la lutte idéologique mondiale, qui est loin d’être terminée, les anticommunistes et les russophobes tentent avec acharnement de réécrire et de falsifier radicalement l’histoire de la Grande Guerre patriotique dans le but (imaginez un peu !) de voler à notre pays sa Grande Victoire.
C’est pourquoi les travaux des scientifiques les plus honnêtes et les plus intègres, qui défendent la vérité sur cette épopée inoubliable du XXe siècle, revêtent une valeur particulière. Bien sûr, les historiens, les politologues, les économistes, les philosophes, les géopoliticiens, les sociologues, etc. ont leur propre point de vue professionnel sur ce travail indispensable. Aujourd’hui, notre journal donne la parole à l’une des plus grandes figures de la sociologie soviétique et russe, Jean Terentievitch Toshchenko, que les lecteurs de Pravda connaissent bien grâce à ses nombreuses publications.
À travers le prisme du « contrat social »
— J’ai été très heureux, cher Jean Terentievitch, de recevoir récemment le livre sur lequel, pour autant que je sache, vous avez travaillé pendant de nombreuses années : « Le destin du contrat social en Russie : évolution des idées et leçons de la mise en œuvre ». Près d’un millier de pages de recherche scientifique sérieuse, mais que je lis, en tant que non-spécialiste, avec beaucoup d’intérêt.
— Merci, je reçois principalement des commentaires élogieux.
— Mais aujourd’hui, je voudrais mettre en évidence, parmi tout le vaste corpus de cette monographie, ce que je considère comme le plus actuel : la période de la Grande Guerre patriotique, le chemin vers la Grande Victoire. Dans votre ouvrage, vous examinez toutes les étapes historiques à travers le prisme du « contrat social », ce qui constitue déjà une particularité de votre approche scientifique.
— C’est exact, c’était précisément l’objectif fixé. Le concept même de « contrat social » est entré dans la science sociologique à partir des travaux des penseurs du siècle des Lumières, à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Il convient toutefois de préciser d’emblée à nos lecteurs qu’il ne s’agit pas d’un document portant ce nom. Il s’agit plutôt d’un certain état de la société, d’un niveau de concordance entre les intérêts du peuple ou de la majorité du peuple et ceux de l’État.
— En d’autres termes, l’accent est mis sur les relations entre le peuple et le pouvoir.
— Oui, ce qui est toujours d’une importance capitale pour chaque pays. Si l’on parle d’une période d’épreuve aussi extraordinaire que la guerre, l’importance de ces relations augmente encore davantage. Est-il nécessaire de prouver à qui que ce soit que la guerre menée contre le pays soviétique par le fascisme allemand et tous ses satellites a été une épreuve extrêmement dure ?
— Malheureusement, par ignorance ou délibérément, beaucoup ignorent encore aujourd’hui que l’Union soviétique n’a pas seulement dû lutter contre l’Allemagne nazie, mais pratiquement contre toute l’Europe.
Comme Hitler avait effectivement réussi à mettre presque tous les pays européens à son service, cela a renforcé sa détermination à attaquer l’Union soviétique. Il comptait également sur l’effondrement du système soviétique de l’intérieur. Du fait de l’opposition entre le pouvoir établi dans le pays après la révolution et la partie de la population qui avait souffert et s’était sentie « lésée » à la suite de la révolution.
— Adolf s’est donc trompé.
— Et comment ! Les envahisseurs, en pénétrant sur le sol soviétique, ont été confrontés à une situation sociale à laquelle ils ne s’attendaient pas. Même les personnes fortement « lésées » ne se sont souvent pas empressées de se mettre au service des occupants…
— Quand on aborde ce sujet, je repense toujours à la pièce talentueuse du patriarche de la littérature soviétique Leonid Leonov, « L’Invasion », et au film tourné pendant la guerre, dans lequel le rôle principal était magnifiquement interprété par l’éminent acteur soviétique Oleg Zhakov.
— La situation y est révélatrice. Un homme libéré par les Allemands d’une prison soviétique où il était apparemment détenu pour des raisons « politiques » refuse non seulement de servir les envahisseurs, mais sacrifie même sa vie dans un affrontement avec eux.
— Vous avez mené cette étude sur le thème « Le peuple et le pouvoir pendant la Grande Patrie ». Avant de poursuivre notre conversation, pourriez-vous résumer brièvement votre conclusion principale ?
— En si peu de temps (moins d’un quart de siècle s’était écoulé entre la révolution de 1917 et le début de la guerre !), grâce à des efforts conjoints, à un travail considérable, ciblé et multiforme, une cohésion sans précédent s’est établie entre le peuple et le pouvoir soviétique, une atmosphère de coopération et de prise en compte mutuelle des intérêts a vu le jour, ainsi qu’une étonnante stabilité de la nouvelle société.
C’est précisément cette stabilité, qui s’est avérée véritablement inébranlable, qui a largement contribué à la Grande Victoire.
Ce qui est essentiel dans la vie est devenu commun au peuple et à l’État
— Essayons d’abord de formuler sur quoi reposait, dès les premiers jours de la guerre, cette unité du peuple et du pouvoir dans le pays soviétique dont nous parlons.
— Cela avait déjà été formulé à l’époque. Le 22 juin 1941, l’appel le plus important pour tous les Soviétiques a été lancé de manière extrêmement claire et précise : « Tout pour le front, tout pour la victoire ! ». Et cet appel, devenu la loi suprême du pays en temps de guerre, a été appliqué sans relâche jusqu’à la victoire, qui avait été définie dès le premier jour de la guerre comme l’objectif principal de l’État soviétique et de toute notre société. Il n’y avait aucune divergence entre le pouvoir et le peuple (ou sa majorité).
— Et pourtant, vous ne niez pas que le début de la guerre a posé avec acuité la question de la viabilité de notre système, créé à la suite de la Grande Révolution d’Octobre.
— Nous avons déjà souligné que l’épreuve était très dure. Compte tenu de toutes les circonstances historiques complexes de l’époque, il ne pouvait en être autrement. La menace d’une guerre totale du monde capitaliste contre le premier pays socialiste de la planète pesait comme une épée de Damoclès. Et l’Union soviétique se préparait de toutes ses forces à repousser ses ennemis, tout en s’efforçant de retarder autant que possible le début des hostilités. C’est précisément ce qui a motivé les actions des autorités soviétiques sur la scène internationale, telles que les tentatives de coopération avec la Grande-Bretagne et la France (par exemple, en relation avec l’occupation des États voisins par l’Allemagne), puis la signature du pacte de non-agression avec l’Allemagne en 1939, la guerre contre la Finlande dans le but de repousser la frontière nationale loin de Leningrad, et d’autres actions.
— Mais le moment fatidique est tout de même arrivé. Qu’est-ce qu’il a exigé en premier lieu du pouvoir et du peuple ?
— Une restructuration radicale de toute la vie du pays sur un pied de guerre, et avant tout, la mise de l’économie sur les rails de la guerre. Il fallait mobiliser de toute urgence toutes les ressources de l’État, ce qui a été rendu possible grâce à l’action conjointe par le « haut » et le « bas ». Il faut reconnaître qu’une volonté sans précédent de vaincre s’est manifestée chez la grande majorité des dirigeants, qui avaient été nommés et formés par le pouvoir soviétique, ainsi que chez les masses populaires, qui ont sans réserve et activement soutenu les représentants de leur État populaire.
— Vous avez déjà évoqué le fait que la guerre a été un test particulier pour l’État soviétique au cours de ses 24 années d’existence. Veuillez poursuivre votre réflexion.
— Mais c’est une évidence, à mon avis ! Au cours de ces années, qui n’ont pas été si longues, des changements qualitatifs radicaux se sont produits dans tous les domaines de la vie du pays. Il est devenu tout à fait indéniable que l’État soviétique s’était constitué et consolidé. De plus, le monde entier a pu constater non seulement ses immenses victoires dans les domaines économique, social et culturel, mais aussi sa plus grande réussite : l’homme soviétique.
Et c’est précisément à lui, à ce nouveau type de personnalité, qu’il revenait de supporter le poids principal de la lutte acharnée contre le fascisme. Et l’homme soviétique s’en est sorti avec honneur, prouvant de manière convaincante que sa fermeté politique et morale était supérieure à celle des agresseurs fascistes.
— Mais cela a-t-il été prouvé uniquement sur le front ? Et à l’arrière, dans le mouvement partisan ?
— Sans aucun doute ! C’est pourquoi je voudrais proposer que nous nous arrêtions aujourd’hui avant tout sur les principaux acteurs de la société soviétique pendant la guerre, c’est-à-dire les forces sociales qui ont assuré la Grande Victoire. Mais il faut tout de même commencer (à juste titre) par le front, c’est-à-dire par nos forces armées.
L’Armée rouge
— Combien de soldats de l’Armée rouge ont combattu ?
— Dès le premier jour de la guerre, des centaines de milliers de personnes se sont présentées aux bureaux de recrutement : ouvriers, paysans, intellectuels, étudiants et même lycéens, prêts à partir immédiatement au front. Le sens du devoir envers la patrie soviétique les a poussés à se lever pour la défendre, et ce, en première ligne.
— Une telle mobilisation massive était-elle sans précédent ?
— Bien sûr. Et elle en dit long. Selon les données officielles, 34 476 700 soldats et officiers ont combattu dans les rangs de l’Armée rouge entre 1941 et 1945. Ce sont eux qui ont constitué la force principale qui a écrasé un ennemi puissant.
— Qu’est-ce qui caractérise les soldats de l’Armée rouge ?
— Tout d’abord, malgré les privations et les difficultés, les soldats de l’Armée rouge ont fait preuve d’une loyauté massive envers les meilleures idées du passé historique et du présent soviétique. Même si les conditions dans lesquelles ils ont combattu, en particulier pendant les premières années de la guerre, étaient extrêmement difficiles. Même sur le plan matériel. En effet, au front, ils vivaient le plus souvent dans des abris, des huttes, des tentes, dans des « terriers de renard » creusés à la hâte, et passaient souvent la nuit, bien sûr, à la belle étoile.
La guerre a engendré de graves épreuves socio-psychologiques. Car qui a obligé les soldats de l’Armée rouge, avant d’être fusillés à Babi Yar près de Kiev, à crier : « Vive Staline ! », « Vive l’Armée rouge ! », « Vive le communisme ! » ? En rapportant ces témoignages, l’écrivain Anatoli Kouznetsov, devenu plus tard dissident antisoviétique, ne pouvait toutefois s’empêcher de reconnaître : « Ils croyaient mourir pour le bonheur universel ». Autrement dit, même sous la menace de la mort, ils restaient fidèles aux idées qu’ils avaient adoptées comme les leurs.
La fidélité idéologique et la fermeté étaient à la base de l’héroïsme, jusqu’au sacrifice, dont faisaient preuve les combattants sur terre, sur mer et dans les airs. Et cela dès les premiers jours de la guerre.
— Nous sommes, Jean Terentievitch, des « enfants de la guerre » et nous connaissions les noms des tout premiers héros glorifiés de cette guerre.
On a beaucoup écrit et parlé à l’époque, par exemple, du taran (abordage volontaire) nocturne dans le ciel de la banlieue de Moscou, mené par le pilote Viktor Talalikhine.— Au total, environ six cents raids tarans ont été menés pendant la Grande Guerre Patriotique.
Le tout premier a été réalisé par le pilote I.I. Ivanov le 22 juin 1941 à 4 h 55 du matin dans le ciel ukrainien. Puis, quatre jours plus tard, le 26 juin, dans le ciel biélorusse, Nikolaï Gastello a répété son exploit en dirigeant son avion endommagé et en feu vers une colonne de véhicules allemands. Notons la composition internationale de l’équipage, qui comprenait le Biélorusse N. Gastello, l’Ukrainien A. Bourdeniouk, le Nénets A. Kalinine et le Russe G. Skorobogat.
L’héroïsme se manifestait souvent par le sacrifice de soi. Quand on écrit ou parle de l’exploit d’Alexandre Matrossov, qui a couvert de son torse l’embrasure d’un bunker ennemi, on ne mentionne pas toujours qu’il y a eu des centaines d’actes héroïques ou de gestes similaires. Même selon les données officielles, l’exploit de Matrossov a été répété par 412 soldats de l’Armée rouge (sept héros ont miraculeusement survécu).
— C’est tout à fait vrai. Cependant, l’ampleur de la guerre était telle et les situations parfois si complexes que de nombreux véritables héros sont restés inconnus. Ce qui est regrettable, bien sûr.
— Bien sûr ! J’ai été personnellement très impressionné par un épisode. En me promenant un jour dans la forêt près de Moscou, je suis arrivé près d’un village, près de la gare de Povarovka, où se trouvait un modeste monument avec l’inscription : « Ici sont enterrés trois soldats de l’Armée rouge morts au combat en octobre 1941 ». Et aucun nom. J’ai décidé d’entrer dans ce village pour en savoir plus sur ce qui s’était passé. Seule une femme âgée, qui était encore enfant cette année-là, a pu me raconter quelque chose.
En octobre de cette année-là, trois soldats de l’Armée rouge ont engagé le combat avec une compagnie de motocyclistes qui se dirigeait vers Moscou. Le combat a duré environ trois heures, jusqu’à ce que le dernier des soldats soviétiques restants tombe au combat. Selon elle, lorsque les Allemands sont partis, un vieil homme (décédé depuis longtemps) a organisé leurs funérailles et a récupéré les documents trouvés sur eux. Il les a conservés chez lui pendant de nombreuses années. Elle ne sait pas ce qu’ils sont devenus par la suite.
Ce qui m’a impressionné dans cet événement, c’est la fidélité des soldats à leur serment. Ils auraient pu se réfugier dans la forêt, chercher des compagnons ou une unité militaire. Personne ne leur aurait fait de reproches. Mais ils ont décidé de se battre et ont retardé l’ennemi de plusieurs heures. Combien y a-t-il eu de combats similaires ? C’est grâce à tous ces combats que l’ennemi n’a pas pu prendre Moscou et a été rapidement vaincu.
— Vous savez, j’ai aussi en mémoire des épisodes similaires racontés par des vétérans. Il ne reste plus beaucoup de vétérans de cette guerre, mais heureusement, des chercheurs continuent leur noble travail dans différentes régions. Ce sont eux qui ont particulièrement besoin du soutien total de la société et de l’État !
— Soulignons qu’il est très important que les actions des soldats de l’Armée rouge aient été appréciées par ceux contre qui ils ont combattu. On trouve d’ailleurs des aveux honnêtes dans les mémoires d’anciens commandants hitlériens. Dans le chapitre « La bataille de Moscou », le général allemand Günther Blumentritt écrit : « Le comportement des troupes russes […] se distinguait de manière frappante de celui des Polonais et des troupes des Alliés occidentaux dans des conditions de défaite. Même encerclés, les Russes ne reculaient pas de leurs positions. »
Voici la conclusion à laquelle est parvenu le général E. Raus, qui a combattu les Russes à deux reprises, en 1914 et en 1941 : « La différence entre l’armée impériale russe pendant la Première Guerre mondiale et l’Armée rouge, même dans les tout premiers jours de l’invasion allemande, était tout simplement colossale. Dans la guerre précédente, c’était une masse amorphe, peu mobile et sans initiative. En 1941, c’était une armée animée d’un élan spirituel colossal. Sa ténacité et sa persévérance étaient motivées par la foi dans les idées du communisme ».
Sur les 427 pages de ces mémoires, qui décrivent directement les combats, 12 sont consacrées à une bataille de deux jours contre un seul char soviétique près de la ville de Raseiniai, dans les pays baltes. Raus a été clairement impressionné par l’équipage de ce char. Qu’est-il donc arrivé ? Le char KV, dont l’équipage était composé de quatre personnes, a « échangé » sa vie contre douze camions, quatre canons antichars, un canon antiaérien, plusieurs chars et des dizaines de soldats allemands tués. Un résultat que l’on peut véritablement qualifier d’exceptionnel.
— Il convient sans doute, lorsque nous décrivons l’Armée rouge, de nous attarder sur l’internationalisme qui s’est manifesté lors des combats de cette guerre.
— Absolument. Il ne fait aucun doute que la victoire dans la Grande Patrie a été remportée par le peuple soviétique, composé de représentants des nationalités les plus diverses.
Bien que les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses aient constitué le gros des troupes (83 %), les rangs de l’Armée rouge comptaient, au milieu de l’année 1943, 194 000 Kazakhs, 135 000 Ouzbeks, 129 000 Arméniens, 118 000 Géorgiens, 98 800 Azerbaïdjanais, 45 000 Kirghizes, 27 000 Turkmènes et 25 000 Tadjiks.
Cet internationalisme des peuples de l’Union soviétique et de son armée était le fruit des années précédentes de la politique de l’URSS, fondée sur les idées d’égalité sociale, qui correspondaient aux valeurs et à la vision du monde de tous les peuples de l’Union soviétique. C’est précisément le soutien apporté aux cultures nationales, depuis l’élaboration de leur écriture jusqu’à la création de maisons d’édition nationales, qui a permis à la plupart des nations et des peuples de s’unir pour repousser l’agression fasciste.
— Les combattants étaient généralement issus de différentes nationalités, n’est-ce pas ?
— Oui, ce qui renforçait encore plus la compréhension mutuelle, le soutien réciproque et le dévouement. Le sort de la célèbre division Panfilov, formée en Kirghizie et composée de 11 % de Kirghizes, 11 % de Kazakhs, 67 % de Russes, 8 % d’Ukrainiens et 3 % de représentants d’autres nationalités de l’URSS, est caractéristique. Leur combat contre les chars allemands près de Volokolamsk, qui est entré dans l’histoire comme l’exploit des 28 Panfilovtses, est un exemple frappant de leur dévouement à la patrie soviétique.
Il est absurde de douter qu’une telle bataille ait eu lieu. Mais les amateurs de démolition de tout ce qui est soviétique, de tout ce qui est sacré, ont lancé une attaque massive pour discréditer cette bataille et les Panfilovistes eux-mêmes. C’est précisément grâce aux efforts de hauts responsables antisoviétiques, dont l’ancien chef des archives d’État Mironenko, qu’une interprétation « comptable » de cet événement a vu le jour : étaient-ils 28 ou plus ? Sont-ils tous morts ? Qui figurait exactement sur cette liste ? Bref, tout a été brouillé au maximum.
Je citerai les mots d’un document officiel, le rapport du commandant du 1075e régiment d’infanterie, I.V. Karpov : « Ce jour-là, près du croisement de Dubosekovo, la 4e compagnie, qui faisait partie du 2e bataillon, a combattu contre des chars allemands. Et elle s’est vraiment battue héroïquement. Plus de 100 hommes de la compagnie ont été tués, et non 28 comme l’ont écrit les journaux ». Il y a donc bien eu un exploit, et un exploit héroïque : presque toute la compagnie a été tuée, sans laisser passer l’ennemi et en détruisant un grand nombre de chars. Mais le correspondant du journal Krasnaïa Zvezda, Krivitski, qui a rapidement rendu compte de cette bataille, n’a cité aucun nom, se contentant de donner ce chiffre, probablement en se référant à une conversation dans le contexte des conditions de guerre qui changeaient rapidement.
Cependant, cela ne change rien à l’essence même de l’exploit ! Et celle-ci reste fondamentale : le comportement altruiste des soldats de l’Armée rouge dans des conditions de combat extrêmement difficiles.
La conviction d’avoir raison s’est manifestée dans un trait de comportement propre au contrat social, à savoir la solidarité.
Elle s’est développée non seulement à la suite d’appels officiels à lutter contre le fascisme, mais aussi grâce aux actions des dirigeants du pays et à leur exemple personnel. En effet, ils ont fait preuve de dévouement aux idées communes pendant les périodes les plus critiques de la guerre. En décidant de ne pas quitter Moscou pendant les jours tragiques d’octobre 1941, Staline a prouvé sa fidélité à son devoir militaire et civique en toutes circonstances. Et comment sous-estimer un facteur aussi inspirant que le défilé sur la Place Rouge le 7 novembre 1941 en présence des dirigeants du pays ? Il était également important que les enfants de Staline, Mikoyan, Khrouchtchev, Frunze et d’autres dirigeants du parti et de l’État aient participé directement aux combats.
Nous parlons maintenant de l’état du moral des combattants de l’Armée rouge. C’est sans doute le moment de souligner tout particulièrement la position des communistes et des membres du Komsomol, qui ont toujours manifesté leur attachement au choix soviétique, aux idées du socialisme, et qui sont restés fidèles aux fondements idéologiques et politiques du contrat social. C’est un fait historique que la grande majorité d’entre eux ont été pour tous un exemple de courage, de bravoure et de fidélité au devoir militaire.
— Oui, le Parti communiste est devenu un véritable parti combattant. Il a organisé, inspiré et armé idéologiquement le peuple soviétique pour lutter contre un ennemi redoutable. Et dès la fin de 1941, 1,3 million de communistes combattaient dans les rangs de l’Armée rouge, soit 40 % de l’effectif total du parti. Leurs rangs ne cessaient de grossir, de se renouveler : pendant les années de guerre, plus de 5,3 millions de personnes ont adhéré au parti.
Il convient de noter que les communistes étaient souvent concentrés sur les secteurs particulièrement difficiles du front.
— Exactement ! Ainsi, au moment de la contre-offensive près de Moscou (décembre 1941), le nombre de communistes atteignait environ 200 000 personnes, c’est-à-dire que près d’un soldat sur quatre qui défendait la capitale était communiste. Dans la 62e armée qui défendait Stalingrad (commandée par V.I. Tchouïkov), il n’y avait pas une seule compagnie sans organisation du Parti, et certains bataillons étaient pratiquement entièrement composés de communistes et de membres du Komsomol.
Ce sont eux, les communistes et les membres du Komsomol, qui ont été les premiers à passer à l’attaque et, bien sûr, les premiers à mourir, mais ils ont inspiré les autres à accomplir leurs missions de combat. Au cours des années de guerre, environ 2 millions de communistes et environ 4 millions de membres du Komsomol ont donné leur vie pour la victoire.
Les travailleurs politiques de l’Armée rouge, les commissaires, les directeurs politiques (et à partir de 1943, les adjoints politiques) avaient un devoir particulièrement élevé. N’est-ce pas ?
— Tout à fait. Ils étaient un exemple de bravoure et de sacrifice dans les situations les plus difficiles. Les Allemands le comprenaient. C’est pourquoi ils étaient les premiers à être fusillés parmi les prisonniers. Voici une autre confession du général allemand E. Raus, que j’ai déjà cité : « Le fait que les soldats de l’Armée rouge aient continué à se battre dans les situations les plus désespérées, sans se soucier de leur propre vie, peut être attribué en grande partie au comportement courageux des commissaires. »
Les partisans
— Un seul article de journal, même le plus long, ne saurait rendre compte, ne serait-ce que brièvement, des actions de tous les acteurs sociaux qui, ensemble, ont assuré la Grande Victoire. Mais notre thème — l’unité du peuple et du pouvoir pendant la Grande Patrie — nous oblige à évoquer les forces principales de cette lutte. Il faut noter qu’outre l’Armée rouge régulière, des partisans ont également combattu les envahisseurs.
— Bien sûr ! Et ils se sont battus héroïquement, ce dont je parle avec une immense satisfaction en tant que natif de la région de Briansk, c’est-à-dire d’une région qui, avec quelques autres, a mérité d’être qualifiée de partisane.
— Il est important de souligner, je pense, que les partisans n’ont pas été mobilisés, mais se sont engagés de leur plein gré. Un véritable mouvement populaire s’est développé ! Et il a défendu non seulement la patrie, mais aussi le pouvoir soviétique.
— Tout à fait vrai. Et ce mouvement a pris une ampleur considérable. C’est pourquoi, dès le 30 mai 1942, un état-major central du mouvement partisan a été créé, réunissant les détachements de résistance dispersés qui s’étaient manifestés dès les premiers jours de la guerre.
Les données suivantes témoignent de l’ampleur de ce front de lutte contre l’ennemi. Au total, entre 1941 et 1944, 6 200 groupes et unités de partisans ont opéré sur le territoire occupé de l’URSS, et le nombre de partisans et de membres de la résistance est estimé à plus d’un million de personnes. Au cours des années de guerre, ils ont mis hors de combat 1,5 million de soldats et d’officiers ennemis, fait sauter 20 000 trains et 12 000 ponts, détruit 65 000 véhicules, 2 300 chars, 1 200 avions et 17 000 km de lignes de communication.
Je me souviens de l’admiration avec laquelle étaient accueillis les articles de journaux et les reportages radio sur les actions des partisans. Le monde entier était alors stupéfait par l’ampleur et l’efficacité sans précédent de notre mouvement partisan, qui mobilisait des centaines de milliers de travailleurs soviétiques ayant le courage de combattre l’ennemi dans son arrière-pays dans des conditions de vie incroyablement difficiles, surtout en hiver, lorsque les abris dans les forêts et les marécages étaient leur seul refuge.
Dans nos seules forêts de Briansk, plus de 80 000 personnes ont combattu à toutes les étapes de la guerre. La prose difficile et très dure des jours de la guérilla est racontée de manière convaincante dans de nombreux documents et œuvres littéraires. C’est le cas, par exemple, de la nouvelle Le comité régional clandestin en action d’Alexeï Fedorov, qui décrit les exploits des partisans dans les régions de Tchernigov et de Briansk, et le célèbre livre De Poutivl aux Carpates de Sidor Kovpak, qui raconte l’héroïsme de l’armée partisane qui a traversé les lignes ennemies depuis le nord de l’Ukraine jusqu’aux Carpates.
Je tiens à souligner tout particulièrement les œuvres poignantes de l’écrivain biélorusse Vasil Bykov, notamment les romans « Dans le brouillard », « La carrière », « Les centeniers » et « Le pont ». Dans la description de destins humains dramatiques, la valeur suprême – la fidélité à son devoir, à son peuple, à son pays – n’a jamais été remise en question, malgré toutes les péripéties de la vie personnelle des personnages.
— Oui, quelle conviction il fallait avoir et croire fermement à la victoire pour ces centaines de milliers de personnes qui sont parties dans la guérilla et ont combattu l’ennemi dans des conditions inhumaines !
Et comment était notre arrière-front ?
— En parlant des acteurs de la Victoire, on ne peut passer sous silence l’arrière-front, ses travailleurs héroïques, leur stoïcisme étonnant et impressionnant. Il s’agissait d’un dévouement désintéressé dans l’accomplissement de leur devoir civique de la part de millions de Soviétiques, y compris de très jeunes adolescents, qui travaillaient sans aucune limite, accomplissant et dépassant leurs quotas de production, passant leurs nuits dans les ateliers et autres lieux de travail.
L’épopée sans précédent de l’évacuation des entreprises industrielles de l’ouest vers l’est du pays a joué un rôle important. Les chiffres sont fantastiques : à la fin de 1941, 2 593 entreprises avaient été évacuées et 10,4 millions de personnes déplacées. Tout était fait pour que les usines et les fabriques déplacées puissent immédiatement commencer à produire pour le front. Le résultat a dépassé les attentes les plus folles. L’année suivante, en 1942, l’industrie soviétique produisait déjà beaucoup plus de chars et d’avions que l’Allemagne nazie (24 400 chars contre 9 000, 21 700 avions contre 1 500).
— Dans tout le pays, la mobilisation du travail a été mise en œuvre, pour ainsi dire, instantanément. Presque toute l’industrie a été convertie à la production militaire. Il fallait rattraper le retard accumulé au cours des premiers mois de la guerre. Dès le début du conflit, la journée de travail a été prolongée à 10, voire 12 heures. Les congés et les jours de repos n’existaient pas. Mais c’est précisément grâce au travail dévoué des travailleurs de l’arrière que l’armée en guerre a pu être approvisionnée en tout ce dont elle avait besoin. Entre 1941 et 1945, de nombreuses nouvelles formes d’activité professionnelle se sont développées (les « deux cents », les « mille », les « multi-opérateurs », etc.).
— Quels ont été les résultats finaux ?
— Pendant toute la guerre, l’arrière a fourni aux troupes plus de 10 millions de tonnes de munitions, 16 millions de tonnes de carburant, environ 40 millions de tonnes de vivres et de fourrage, plus de 70 millions de kits d’uniforme. Les transports ferroviaires militaires ont dépassé les 19 millions de wagons. Le transport routier a acheminé 625 millions de tonnes et le transport aérien environ 140 millions de tonnes de matériel. Les troupes ferroviaires et routières, en collaboration avec la population, ont construit et réparé environ 100 000 km de routes et environ 120 000 km de voies ferrées. Plus de 6 000 aérodromes ont été équipés pour les besoins de l’aviation. Le service médico-militaire et les établissements de santé ont remis sur pieds plus de 72 % des blessés et 91 % des malades après leur guérison. Dès le 27 juin 1941, les deux premiers « Katioucha » (BM-13) ont été assemblés. Il s’agissait de lanceurs de roquettes qui ont joué un rôle important, voire décisif, au cours de nombreuses batailles.
Le travail des paysans, que j’ai vu dans mon enfance dans la région de Riazan, était tout aussi dévoué. Il a également largement contribué à garantir l’approvisionnement du front en denrées alimentaires essentielles.
Mais ce n’est pas tout ! Vous vous souvenez certainement que les achats individuels et collectifs d’avions, de chars et d’autres équipements militaires avec leurs propres fonds sont devenus une réalité. Ainsi, en 1942, le kolkhozien Ferapont Petrovitch Golovaty a envoyé ses économies personnelles pour la construction d’un avion Yak-3, sur lequel son compatriote, le pilote Boris Nikolaïevitch Eremin, a ensuite combattu. D’ailleurs, Golovaty avait reçu deux avions en cadeau : le premier en 1942 et le second en 1944. Il l’avait payé en collectant des fonds auprès de ses proches. Cet avion, sur lequel est inscrit « De Ferapont Petrovitch Golovaty, deuxième avion. Pour la défaite définitive de l’ennemi », se trouve aujourd’hui dans un musée américain, à Santa Monica. En 1991, un contrat a été signé pour prêter cet avion au musée californien pour une durée de quatre ans, mais il s’y trouve toujours à ce jour.
De nombreux kolkhoziens ont envoyé leurs économies au fonds de défense : Ivan Pavlovitch Bolotine a versé 120 000 roubles, Koulach Baimagametov 325 000 roubles, Souleiman Amir Kar-ogly 250 000 roubles. Il n’était pas rare que des kolkhozes entiers organisent des collectes. Ainsi, les kolkhoziens de la région de Tambov ont collecté en deux semaines 43 millions de roubles sur leurs fonds personnels pour la construction d’escadrilles d’avions et de colonnes de chars.
Il faut saluer tout particulièrement la participation des femmes à l’aide apportée à l’armée et à la marine. De 1941 à 1945, le nombre de femmes ayant appris le métier de tourneur a doublé, celui de mécanicien a triplé et celui de conductrices a été multiplié par huit. Même les métiers masculins les plus difficiles, comme celui de mineur, ont été appris avec succès par des femmes. Dans le Kouzbass, en 1941, après la perte du bassin houiller de Donetsk, plus de 40 000 femmes travaillaient comme mineuses, et en 1942, année la plus difficile pour la région, elles étaient plus de 60 000.
— Vous avez déjà évoqué le travail des adolescents. J’ajouterai quelques détails. Par exemple, à l’usine Staline de construction de moteurs n° 19 de Perm, qui produisait des moteurs pour avions de chasse, des pistolets mitrailleurs Shpagin (PPSh), des détonateurs pour mines et des fusées pour obus de mortier « Katyusha », environ 8 000 adolescents travaillaient à l’époque. La plupart avaient entre 14 et 16 ans, mais certains étaient encore plus jeunes : dès l’âge de 11 ans, on les embauchait pour des travaux auxiliaires non qualifiés.
— Parmi les réalisations de l’arrière, il faut également mentionner le travail de groupes spécifiques tels que l’armée du travail, qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes au cours de la guerre. Dans l’histoire contemporaine et la presse, l’armée du travail est principalement associée aux Allemands soviétiques. Mais en réalité, la mobilisation du travail ne se limitait pas à eux. Souvent, ces personnes ne faisaient que changer de lieu de travail ou étaient déplacées à l’intérieur d’une même région. D’autre part, de nombreuses personnes d’origines ethniques diverses travaillaient à l’arrière, notamment en provenance d’Asie centrale, du Caucase et d’Extrême-Orient. Les personnes qui construisaient des centrales électriques et des usines, qui travaillaient dans les mines et dans les forêts, ont enduré d’énormes privations. Mais leurs efforts ont également contribué de manière significative à la victoire sur le plus redoutable ennemi militaire de l’histoire nationale.
Les fondements spirituels et moraux de la Grande Victoire
— Vous conviendrez que dès le début de la guerre, sans parler des années suivantes, l’activité de pratiquement tous les représentants de la vie spirituelle de la société — scientifiques, hommes de lettres et d’art, médias — a apporté une contribution énorme, inspirante et mobilisatrice à la réalisation de l’objectif du contrat social : « Tout pour le front, tout pour la victoire ! ».
— Oui, ils ont manifesté les traits les plus profonds du patriotisme et un sentiment d’appartenance à une nouvelle couche sociale, l’intelligentsia soviétique, qui, dans sa grande majorité, a fait preuve de caractéristiques fondamentalement particulières de préservation et de défense des traditions, associées à une nouvelle vision du monde et à la volonté de défendre les idéaux de la société soviétique établie.
— Bien sûr, la science a joué un rôle essentiel dans la défense du pays.
— C’est évident. Dès les premiers jours de la guerre, les scientifiques russes, comme ceux des autres républiques de l’URSS, se sont activement mobilisés pour lutter contre le fascisme. Lors d’une réunion extraordinaire élargie du Présidium de l’Académie des sciences de l’URSS le 23 juin 1941, à laquelle ont participé 60 des plus éminents scientifiques du pays, sous la présidence du vice-président de l’Académie des sciences de l’URSS, l’académicien O. Yu. Schmidt, une résolution a été adoptée appelant à unir toutes les forces scientifiques pour lutter contre les envahisseurs fascistes allemands dans la « guerre sacrée et nationale qui venait de commencer, une guerre pour le progrès humain, pour la culture des peuples de l’URSS et de tous les peuples du monde ».
Et les scientifiques de tout le pays, répondant à cet appel, se sont immédiatement mis à réorganiser leurs recherches scientifiques et ont concentré tous leurs efforts sur les travaux de défense pouvant être immédiatement mis en pratique. Ils se sont également engagés activement dans la mobilisation spirituelle du peuple soviétique pour lutter contre le fascisme : ils ont pris la parole dans la presse et à la radio, appelant le public soviétique et étranger à « unir toutes les forces dans la lutte contre le fascisme pour défendre la civilisation contre les barbares hitlériens ».
— D’après ce que je sais, les scientifiques de l’époque étaient également impatients de partir au front.
— Le futur directeur scientifique du projet atomique soviétique, I.V. Kourtchatov, et l’éminent physicien théoricien, membre correspondant de l’Académie des sciences de l’URSS, Ya.I. Frenkel, ainsi que des centaines de jeunes scientifiques ont déposé leur candidature auprès des commissariats militaires régionaux. Les demandes de Kourtchatov et Frenkel ont été rejetées, mais dès le 27 juin 1941, 30 employés du célèbre LFTI étaient dans les rangs de l’Armée rouge, et un mois plus tard, leur nombre était passé à 130. 39 employés de l’Institut de physique chimique, 14 de l’Institut du radium, 17 de l’Observatoire astronomique principal, futurs créateurs de la science et de la technologie atomiques K.A. Petrzhak, K.I. Shchelkin, pionnier de la technologie spatiale Y.V. Kondratyuk et bien d’autres. Un grand nombre d’enseignants universitaires et de chercheurs, y compris ceux qui avaient été réprimés, ont rejoint l’armée.
— Le gouvernement a-t-il rapidement pris conscience du danger que représentait la perte de ces scientifiques ?
— Oui, et le 15 septembre 1941, le Comité d’État pour la défense a décidé d’interdire catégoriquement l’enrôlement au front et l’emploi à des fonctions autres que celles pour lesquelles ils avaient été formés de tous les enseignants universitaires et chercheurs. Ils ont été rappelés de l’armée à la demande des commissariats et des ministères.
— Ces nouvelles tâches complexes ont-elles nécessité une réorganisation en profondeur de la recherche scientifique et des méthodes de travail ?
— Tout à fait. Un regroupement des forces scientifiques a rapidement été mis en place afin de résoudre plus efficacement les problèmes urgents. Les formes organisationnelles et les thèmes des travaux scientifiques ont été modifiés, élaborés et ajustés en étroite collaboration avec les autorités militaires et les institutions du front, en tenant compte de l’expérience acquise dans l’utilisation du matériel militaire en conditions de combat. Presque tous les instituts de physique, de chimie et de technique se sont consacrés exclusivement à des thèmes militaires. Une grande partie des scientifiques ont été transférés à la production. Des équipes de scientifiques ont mis en œuvre leurs développements directement dans les usines
— Comment le Comité d’État pour la défense (GKO), présidé par I.V. Staline, assurait-il la direction centralisée des domaines militaire, économique, technique, diplomatique et socio-économique du pays dans les conditions d’une guerre extrêmement violente ?
— Il s’appuyait sur l’appareil du Conseil des ministres de l’URSS, les représentants du Comité d’État pour la défense (50 personnes). Une sorte d’état-major scientifique, un conseil scientifique et technique, a été créé auprès du GKO. Le Conseil était en liaison avec le commandement de l’Armée rouge, les commissaires du peuple, les instituts de recherche et de conception, les universités et les organisations publiques, et a fait appel à de grands spécialistes militaires, ce qui « a facilité et accéléré l’élaboration et la mise en œuvre des innovations, en supprimant les barrières entre les départements ». Le conseil coordonnait les recherches sur les problèmes scientifiques et techniques les plus importants, aidait les instituts de recherche scientifique à établir des liens avec les organisations militaires, identifiait les tâches les plus urgentes et assurait la mise en œuvre la plus rapide possible des résultats de la recherche scientifique dans la production.
— Ces actions conjointes ont-elles accéléré la résolution de problèmes importants ?
— De manière très significative ! Les travaux théoriques dans le domaine de l’aérodynamique menés par S.A. Chaplyguine, M.V. Keldysh et S.A. Khristianovitch ont conduit à la création de nouveaux modèles d’avions militaires. L’équipe scientifique dirigée par A.F. Ioffe a inventé les premiers radars soviétiques. En 1943, les travaux de création d’armes nucléaires ont commencé en URSS. Après avoir résolu un problème mathématique complexe, le membre correspondant de l’Académie des sciences de l’URSS N.G. Chetayev a déterminé la pente optimale des rayures des canons, ce qui garantissait une précision maximale et l’impossibilité pour les projectiles de se retourner en vol.
La théorie de l’académicien M.M. Lavrentiev a permis d’augmenter la puissance de pénétration du projectile cumulatif tout en réduisant sa taille. Le développement de la nomographie, une branche des mathématiques qui qui étudie la théorie et les méthodes de construction d’un type de dessins appelés nomogrammes, qui permettent de gagner du temps dans les calculs et de les simplifier, ce qui a été réalisé dans un bureau spécial du Institut de mathématiques de l’Université d’État de Moscou sous la direction de N.A. Glagolev. L’idée du « Katyusha », qui a vu le jour dans les laboratoires de mécanique mathématique de l’Université d’État de Moscou sous la direction de I. Gai, a été mise en pratique dès le début de la guerre, donnant à l’armée l’une des armes légendaires de cette guerre.
— Quel était le soutien de l’État aux activités des scientifiques ?
— Pour mobiliser leurs forces, de nouveaux centres scientifiques et instituts ont été créés : l’Académie des sciences de l’artillerie, l’Académie des sciences médicales, la branche ouest-sibérienne de l’Académie des sciences de l’URSS à Novossibirsk. Des académies républicaines des sciences ont été ouvertes au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan et en Arménie.
— Le front culturel a également joué un rôle colossal.
— Bien sûr ! Toute la vie culturelle du pays, l’activité des écrivains et de tous les autres représentants des arts ont contribué à renforcer le moral du peuple soviétique. Elle est devenue un immense facteur de mobilisation morale, car même dans les premiers jours les plus difficiles de la guerre, les acteurs culturels n’étaient pas seulement au front en tant que correspondants ou membres des services politiques, mais ils créaient également des œuvres dont l’importance mobilisatrice est difficile à surestimer.
En ce qui concerne les écrivains, presque tous les littéraires connus ont travaillé comme correspondants de guerre. Tout en décrivant le déroulement des combats, ils ont créé des œuvres qui ont inspiré les gens. Ainsi, M.A. Cholokhov a publié son ouvrage « La science de la haine » et des chapitres de son roman « Ils se sont battus pour la patrie », A.T. Tvardovsky a écrit des histoires poétiques saisissantes sur Vasily Tiorkine, V.S. Grossman a écrit « Les Chroniques de Stalingrad ». Les poèmes de K.M. Simonov ont connu une popularité sans précédent, tout comme les vers d’A.A. Surkov, A.A. Akhmatova, O.F. Bergholz, M.V. Isakovsky et d’autres. Dans le même temps, l’héritage artistique du passé était également très apprécié. Ainsi, le 5 décembre 1941, alors que les fascistes étaient encore aux portes de Moscou et que l’Armée rouge venait tout juste de passer à la contre-offensive, le roman de L.N. Tolstoï « Guerre et Paix » fut publié à 100 000 exemplaires !
— Quel fait marquant, voire symbolique…
— Le cinéma, qui avait le public le plus large, a joué un rôle mobilisateur énorme. Les actualités cinématographiques ont pris le devant de la scène, puis les « films de combat » et les « concerts pour le front ». Les films « Le secrétaire du comité régional » (réalisé par I.A. Pyriev), « Elle défend la patrie » (F.M. Ermlér), « Un gars de notre ville » (A.B. Stolper) et d’autres étaient empreints d’un grand pathos patriotique. Il convient également de noter le détail suivant : le 17 septembre 1941 (pendant les jours les plus difficiles, lorsque les nazis se ruaient sur Moscou), le nouveau film « Mascarade », consacré au 100e anniversaire de la mort de M.I. Lermontov, fut projeté. Et à la fin de l’automne 1941, peu avant la contre-offensive de l’Armée rouge, la comédie « La bergère et le berger » (avec M. Ladynina, V. Zeldine, N. Kryuchkov), dont certaines scènes ont été tournées à l’Exposition agricole pan-soviétique à l’époque où Moscou était déjà bombardée. Cette œuvre musicale et d’esprit tout à fait pacifique a battu tous les records du box-office et a été l’un des exemples inspirants de la mobilisation des sentiments patriotiques au front et à l’arrière.
— Les théâtres ont également travaillé d’arrache-pied pour la Victoire.
— Oui, ils ont continué à fonctionner dans la plupart des villes.
— Comment oublier l’exploit de D.D. Chostakovitch, qui a composé sa Septième Symphonie « Leningrad » (jouée le 9 août 1942 dans Leningrad assiégée) ? D’autres musiciens exceptionnels ont également apporté une grande contribution à la victoire, tels que S.T. Richter, M.V. Yudin, les solistes du Bolchoï, du Kirov (aujourd’hui Mariinsky) et d’autres théâtres, qui donnaient régulièrement des concerts dans les unités militaires et les hôpitaux. D’ailleurs, les brigades d’artistes du front ont été créées avec la participation de pratiquement tous les théâtres du pays.
— Il faut également souligner le travail remarquable des artistes. Cela s’est particulièrement manifesté dans l’art de l’affiche (I.M. Toidze, « La mère patrie appelle ! ») et de la caricature (les artistes Kukryniksy : M.V. Koupriyanov, P.N. Krylov, N.A. Sokolov, B.E. Efimov, etc.). Les éditions quotidiennes des « Fenêtres de TASS » — des affiches accompagnées de légendes incisives sur des sujets d’actualité — ont connu un immense succès.
— Soulignons qu’aux côtés de l’intelligentsia russe, les représentants de l’intelligentsia des autres peuples de l’URSS ont également apporté une contribution importante à la mobilisation de toutes les forces pour lutter contre le fascisme allemand. Rappelons-nous par exemple le poème émouvant « Leningradiens, mes enfants ! », écrit par le poète kazakh Dzhambul en septembre 1941 et dédié aux défenseurs de Leningrad.
Sur le front spirituel de la lutte contre le fascisme, la radio et les journaux, complétés par divers numéros spéciaux et tracts, ont été des moyens efficaces et massifs de mobilisation du peuple. Le Sovinformburo (Bureau d’information soviétique), créé le 24 juin 1941, a joué un rôle particulier. C’est précisément à ce service qu’incombait l’essentiel du travail de propagande pendant la guerre. Il était chargé de rédiger des bulletins pour la radio, les journaux et les magazines sur la situation sur les fronts, le travail à l’arrière, le mouvement partisan, et d’informer la population sur de nombreux autres événements importants. Quant à la radio pendant la guerre, elle est largement associée au nom du présentateur de la radio pan-soviétique Y.B. Levitan, qui diffusait les informations les plus importantes, orientant et soutenant la conviction des gens dans notre victoire.
En ce qui concerne les médias, notamment les journaux, il convient de noter que c’était aux journalistes de tous les départements qu’incombait la lourde responsabilité d’informer régulièrement les différentes couches de la population sur les événements qui se déroulaient au front et à l’arrière. Les journaux et leurs éditions spéciales parvenaient dans tous les coins du pays, là où il n’y avait pas de radio et où, à de rares exceptions près, aucun autre moyen de communication n’était accessible : littérature, cinéma, théâtre et peinture. En d’autres termes, l’unité morale et politique du peuple et du pouvoir était maintenue partout par des actions très diverses, à première vue insignifiantes, mais qui avaient un immense pouvoir mobilisateur.
Ainsi, pendant les années de guerre, plus de 255 millions d’exemplaires de livres et de brochures ont été envoyés au front, ainsi que 256 000 bibliothèques spécialement constituées. Des brochures, des tracts et des journaux étaient largués par avion aux partisans et aux résistants. Les bibliothèques, les salons-lectures et les clubs organisaient des lectures collectives. Il y avait des cas où des livres étaient fabriqués artisanalement, lorsque les enfants écrivaient les récits des héros de la guerre, les mettaient en page et les reliaient. De nombreux témoignages ont été conservés sur la façon dont, pendant la Grande Guerre patriotique, les gens avaient besoin de livres qui leur apportaient espoir et confiance en la victoire. Pendant le siège de Leningrad, le poète N.S. Tikhonov a écrit dans son journal : « Dans la ville, les livres sont très demandés… Les librairies sont pleines de clients. Tous ceux qui arrivent du front se précipitent avidement pour acheter des livres. » À mon avis, ce sont là des témoignages tout simplement stupéfiants de l’esprit extraordinaire du peuple soviétique dans les moments les plus difficiles de son histoire !
— Un autre domaine de la culture populaire a également connu un essor fulgurant pendant la Grande Patrie : la chanson. Elle reflétait l’unité des efforts de l’intelligentsia artistique (poètes, compositeurs, artistes) et les convictions populaires, c’est-à-dire les émotions, les espoirs et les malheurs de millions de Soviétiques. Des vers et des mélodies immortels ont été créés, exprimant avec profondeur les différentes facettes des pages héroïques et tragiques de cette grande guerre. La particularité de cette création était qu’elle reflétait sans exception tous les aspects de la conscience publique de masse. Mais le plus fort, bien sûr, était la conviction populaire de la victoire sur le fascisme.
Il faut sans doute commencer par une chanson qui reste gravée dans la mémoire populaire, « La guerre sacrée » : « Lève-toi, immense pays, / lève-toi pour le combat mortel / contre la force fasciste obscure, / contre la horde maudite ».
— Oui, ces vers, écrits par le poète V. Lebedev-Kumach dans les tout premiers jours de la guerre et mis en musique par le compositeur A. Alexandrov, sont devenus un appel à tous les peuples du pays des Soviets. Ces paroles ont inspiré les gens, les ont mobilisés pour donner toute leur énergie à la lutte contre l’ennemi, ont renforcé leur foi en la victoire sur les intentions étrangères d’asservir le peuple soviétique. En d’autres termes, cette œuvre musicale puissante s’adressait à la conscience civique de l’individu et, par sa profondeur et sa sincérité, ralliait le peuple soviétique face à un danger mortel. La mélodie ample et chantante de la composition, associée à la marche imposante, inspirait et élevait le moral et l’esprit combatif tant des soldats de l’Armée rouge que des travailleurs de l’arrière. Nos ennemis, je le remarque, n’avaient rien de tel !
— L’élément personnel, individuel, est indissociable du collectif dans les meilleures chansons des années de guerre. Ce sont des paroles de grande qualité, d’une sincérité et d’une profondeur rares. C’est pourquoi ces chansons sont vivantes et le resteront toujours.
En effet, les soldats de l’Armée rouge étaient inspirés non seulement par ce qui reflétait leur fidélité au devoir militaire et civil, mais aussi par une autre idée, tout aussi touchante, intime, personnelle et en même temps exaltante, qui s’incarnait par exemple dans la chanson sur des paroles d’A. Surkov et une musique de K. Listov : « Le feu brûle dans le poêle exigu, / La résine coule comme des larmes sur les bûches, / Et l’accordéon chante dans la cabane / Ton sourire et tes yeux… Chante, accordéon, pour défier la tempête, / Appelle le bonheur égaré. / Dans la cabane glaciale, je suis réchauffé / Par ton amour inextinguible ». Ou encore la célèbre chanson du compositeur N. Bogoslovsky et du poète V. Agatov « Nuit sombre ». Je vous rappelle : « Comme j’aime la profondeur de tes yeux tendres, / Comme j’aimerais y presser mes lèvres maintenant ! / La nuit sombre nous sépare, ma bien-aimée, / Et une steppe noire et inquiétante s’étend entre nous ».
Authentiques, viriles et en même temps tendres, séduisantes par leur sincérité, ces chansons ont suscité une réaction immédiate et bienveillante dans le cœur des combattants et ont aidé ceux qui travaillaient à l’arrière. Ces paroles reflétaient la foi en la victoire, associée aux sentiments personnels les plus intimes et, en même temps, à la fidélité à son devoir, à la compréhension du lien entre le patriotisme social et les convictions personnelles profondes.
« Nous nous souvenons bien, Jean Terentievitch, que ces chansons étaient chantées par tout le pays et du succès remporté par « Le foulard bleu » (musique de E. Peterbougski, paroles de Ya. Galitski et M. Maximov) interprétée par K. Shulzhenko, « Dans la forêt près du front » (compositeur M. Blanter, paroles de M. Isakovsky), « Soirée sur la rade » (compositeur V. Soloviev-Sedoy, paroles de A. Tchourkine) — chanson écrite en 1941 et également connue sous les titres « Chantons, mes amis ! » et « Adieu, ville bien-aimée ! »… Comment les énumérer toutes !
— Les chansons liées à des activités particulières ont joué un rôle mobilisateur et inspirant non négligeable. Il s’agit de la chanson connue sous les titres « Souviens-toi, camarade, de la neige blanche » ou « Baksanskaïa frontovaïa », écrite au début de l’année 1943 par un groupe de militaires alpinistes sur le air d’un tango populaire d’avant-guerre « Que les jours passent » du compositeur B. Terenteïev. Parmi les auteurs des paroles figurent les alpinistes A. Gryaznov, L. Korotaeva, N. Persianinov, B. Grachev, A. Nemchinov, G. Sulakvelidze et N. Morenev. C’est une chanson populaire au sens propre du terme ! Et il y en avait beaucoup d’autres.
Rendons hommage au talent des interprètes de ces chansons. Pendant la guerre, le peuple les aimait particulièrement : L. Utyosov et K. Shul-Zhenko, L. Ruslanova et M. Bernes, V. Bunchikov et V. Netchaev, ainsi que beaucoup d’autres.
Notre cause est juste, tel est le fondement idéologique de la lutte populaire
« Notre cause est juste, l’ennemi sera vaincu, la victoire sera nôtre ! » Telle est la phrase finale de l’appel au peuple soviétique que le vice-président du Conseil des Commissaires du peuple de l’URSS, V. M. Molotov, a lu à midi le 22 juin 1941, jour du début de la Grande Patrie.
« Ces mots, comme nous l’avons déjà dit, ont été mis à rude épreuve : les idées du socialisme sont-elles devenues une essence intérieure, une véritable conviction idéologique du peuple soviétique ? Il est apparu clairement que la majorité des ouvriers, des paysans et de l’intelligentsia défendaient consciemment leur patrie soviétique, leur patrie socialiste, ce qui leur donnait une force morale supplémentaire par rapport à l’idéologie fasciste, qui visait à asservir d’autres pays et d’autres peuples. En d’autres termes, l’idéologie soviétique a montré son avantage colossal par rapport à la prédication de la grandeur du soi-disant peuple aryen et de sa domination sur les autres.
— Une cause juste et équitable a démontré la solidité et la stabilité du contrat social en URSS, peut-on dire ?
— Oui, la solidité des convictions et des orientations idéologiques de la majorité des Soviétiques, qui se résumaient à défendre les acquis du socialisme, à protéger leur héritage historique, leur conception d’une nouvelle vie (qui leur convenait), ce qui a été prouvé sur les champs de bataille, à l’arrière et dans les territoires occupés. L’État soviétique et l’absolue majorité du peuple étaient unis par la certitude qu’ils possédaient ce qu’ils avaient acquis, ce dont ils étaient fiers et ce à quoi ils aspiraient, ce qu’ils pouvaient atteindre.
— Comment fonctionnaient les relations quotidiennes entre le « haut » et le « bas » pendant la guerre ?
— Oh, on y accordait une attention toute particulière ! Dès les premiers jours de la guerre, une communication aussi rapide que possible a été mise en place entre les plaintes et les suggestions de la population et la réaction des autorités officielles. J’ai été personnellement frappé par les règles établies pour récompenser immédiatement (je souligne : extrêmement rapidement !) ceux qui avaient atteint ou dépassé les objectifs de production dans les usines du pays, sous forme de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. La récompense morale était encore plus importante, voire massive. Environ 11,5 millions de personnes ont reçu des distinctions nationales pour leurs exploits militaires et leurs efforts au travail pendant la Grande Guerre patriotique : 6 603 960 ont reçu des médailles et 4 875 695 ont reçu des distinctions. Parmi eux, 38 658 personnes ont été récompensées pour leurs mérites professionnels. Les plus de 11 millions de distinctions restantes ont été décernées pour des exploits militaires et des distinctions au combat.
Le nombre de Héros de l’Union soviétique ayant reçu ce titre pour leurs exploits pendant la Grande Guerre patriotique s’élève à 11 739, dont 3 051 à titre posthume. En ce qui concerne l’arrière, 198 personnes ont reçu le titre de Héros du travail socialiste pour leurs mérites particuliers dans le domaine du travail, et 16 millions de personnes ont reçu la médaille « Pour le travail courageux pendant la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 ».
« Nous, les « enfants de la guerre », savions et comprenions bien ce que signifiait alors la récompense de la Patrie. Les gens étaient légitimement fiers de leur décoration et de leur médaille…
— On peut affirmer sans exagération que la plupart des Soviétiques, tels des Atlantes, portaient sur leurs épaules un fardeau incroyable. Ils travaillaient souvent dans des conditions extrêmement dangereuses, chacun contribuant à sa manière à la victoire sur l’ennemi. Mais revenons-en au sujet qui nous intéresse. Sur leurs maigres revenus, les gens donnaient une partie de leurs moyens pour soutenir le front par le biais d’emprunts publics, sans parler de la collecte de divers types d’aide pour l’armée en guerre. Il y a un fait remarquable : la participation du peuple à la cause commune par le paiement d’impôts plus élevés, par des emprunts, par des dons au Fonds de défense, qui ont représenté un tiers des revenus de l’État pendant la guerre. Selon les données officielles de la Banque centrale de la Fédération de Russie, deux roubles sur trois des dépenses militaires de l’État ont été payés directement par les citoyens du pays grâce à une forte augmentation des impôts, au gel des dépôts, à des emprunts publics et à des dons volontaires.
Pendant les années de guerre, le pays a travaillé d’arrache-pied, c’est pourquoi l’aide du peuple, sous toutes ses formes, était inestimable.
— Bien sûr ! Au total, 17,5 milliards de roubles ont été collectés, plus 1,8 milliard de roubles en or (130 kg), en platine (12 kg) et en argent (10 tonnes). Cet argent a permis de construire 31 000 chars (30 % du total), 2 500 avions, 18 torpilleurs, 7 sous-marins, environ 10 trains blindés, etc.
La vie réelle a montré que la grande majorité des Soviétiques croyaient sincèrement aux idéaux du socialisme, à la beauté et à la valeur de la vie dans le pays soviétique et manifestaient leur patriotisme dans les moments critiques. Et ce n’étaient pas quelques-uns, mais des millions. Rappelez-vous au moins les aveux déjà cités de nos ennemis, pour qui le phénomène de l’homme soviétique a été un choc.
Certes, il existe encore aujourd’hui des personnages qui, dans leur tentative d’expliquer le héroïsme massif du peuple soviétique et incapables d’en comprendre l’essence, en sont arrivés à cette conclusion : il ne s’agirait là que d’un « héroïsme de fourmilière », c’est-à-dire « une disposition au sacrifice aveugle pour des objectifs collectifs ».
— Qu’est-ce qu’on n’a pas inventé ! Les ennemis, cachés ou déclarés, s’efforcent de toutes leurs forces de déformer l’exploit soviétique.
— C’est pourtant un véritable sacrilège.
Non, résumons ainsi : la stabilité du contrat social dans le pays soviétique a été pleinement prouvée au cours de cette épreuve historique difficile, lorsque les objectifs de l’État, la mémoire historique du peuple et la vision socialiste bien établie se sont unis.
Views: 2