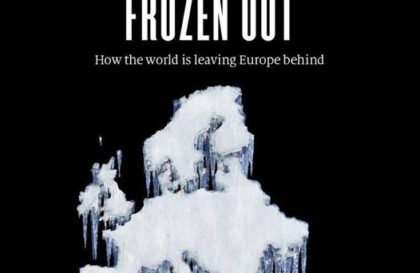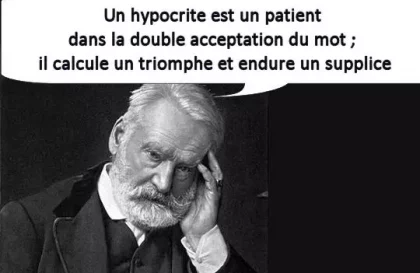La montée de l’extrême-droite et ses solutions simplistes est une tendance forte partiellement contredite par l’aspect désastreux et désordonné de la politique de Trump. Et on en revient aux fondamentaux de la crise de l’hégémonie en son cœur même les USA, la stagnation des salaires, de la productivité qu’est-ce qui en est la cause, cela ne démarre pas avec l’ère de la mondialisation de l’Alena (Mexique.USA.Canada) ni même avec la montée en puissance de la Chine… En macroéconomie, il est très difficile d’isoler la cause et l’effet, car il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Les décennies entre 1973 et 1994 en fait sont celles de la stagnation des salaires et elles ont été marquées par deux chocs pétroliers, une inflation majeure, deux grands changements dans le régime monétaire mondial, plusieurs récessions majeures, des changements dans les déficits commerciaux et les importations, et bien plus encore. L’interprétation de l’auteur revient au « choc pétrolier » ; et s’il s’agissait face à la baisse tendancielle du taux de profit de la nécessité de la transformation du mode de production, la tentative néolibérale de son maintien?
par Noah Smith 19 mai 2025

Il y a une semaine, j’ai écrit un article affirmant que la mondialisation n’a pas vidé la classe moyenne américaine de sa substance (comme beaucoup de gens le croient) :
Après avoir écrit l’article, John Lettieri de l’Economic Innovation Group a écrit un excellent fil de discussion qui soutient fortement mon argument. Il a montré que le moment de la stagnation des salaires aux États-Unis – en gros, de 1973 à 1994 – ne correspondait tout simplement pas bien à l’ère de la mondialisation qui a commencé avec l’ALENA en 1994. En fait, les salaires américains ont recommencé à augmenter juste après l’adoption de l’ALENA.

En fait, la croissance des salaires depuis l’ALENA a été presque aussi forte que dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale !
Maintenant, je pense que c’est peut-être une vision trop simple. Bien qu’il y ait eu beaucoup de bruit et d’agitation politique au sujet de l’ALENA, la plupart des Américains ne pensent probablement pas que c’est la concurrence du Mexique qui a vidé la classe moyenne américaine de sa substance – ils pensent que c’est la Chine.
Et bien que les économistes pensent que l’ALENA a nui à certaines industries manufacturières spécifiques dans quelques endroits spécifiques, ils concluent généralement que cet accord a aidé la plupart des Américains ; c’est le choc chinois, après l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001, que de nombreux économistes pensent avoir été globalement préjudiciable à la classe ouvrière.
Et si vous ajoutez le choc chinois à la chronologie de Lettieri, vous voyez qu’à certains égards – mais pas à d’autres – il y a une deuxième ère, plus courte, de stagnation des salaires qui s’y aligne assez bien. J’ai modifié les graphiques de Lettieri pour montrer le choc chinois :

Vous pouvez voir que les salaires médians se sont stabilisés entre 2003 et 2015, tandis que les gains horaires moyens des travailleurs de la production et des non-cadres continuent d’augmenter.
De toute évidence, la Grande Récession est le facteur le plus important après 2007 (et de nombreux économistes pensent que le choc chinois n’a duré que jusqu’en 2007). Mais l’argument selon lequel la concurrence chinoise a maintenu les salaires américains à un bas niveau pendant quelques années dans les années 2000 reste crédible.
Et au cas où vous vous poseriez la question, voici la répartition pour les hommes et les femmes :

Et Lettieri a d’autres e graphiques montrant que l’histoire est la même pour la classe ouvrière que pour la classe moyenne.
Je pense donc que l’histoire est plus nuancée que ce que Lettieri le prétend. L’augmentation des salaires de la classe moyenne et de la classe ouvrière à la fin des années 1990 a peut-être eu lieu malgré quelques petits vents contraires de l’ALENA, et le choc chinois a peut-être exercé un frein sur les salaires américains au cours des années 2000.
Mais ce que ces graphiques racontent, c’est que la plus grande stagnation des salaires de l’histoire moderne des États-Unis s’est produite avant l’ère de la mondialisation – de 1973 à 1994 environ.
Quelle était la cause de cette stagnation épique ? En macroéconomie, il est très difficile d’isoler la cause et l’effet, car il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Les décennies entre 1973 et 1994 ont été marquées par deux chocs pétroliers, une inflation majeure, deux grands changements dans le régime monétaire mondial, plusieurs récessions majeures, des changements dans les déficits commerciaux et les importations, et bien plus encore.
Il s’est passé tellement de choses qu’il est possible que la stagnation des salaires n’ait été qu’une série de chocs négatifs qui ont duré longtemps – « juste une putain de chose après l’autre », comme le dit le proverbe.
Mais dans un premier temps, nous pouvons examiner certaines des théories sur les raisons pour lesquelles cette stagnation s’est produite, et voir si elles correspondent à la chronologie.
Stagnation de la productivité
Une partie de la stagnation des salaires était due à l’augmentation des inégalités. Si nous regardons la rémunération horaire moyenne par rapport à la rémunération horaire médiane (qui comprend des avantages tels que l’assurance maladie et les cotisations de contrepartie de retraite), nous voyons que la moyenne a moins stagné que la médiane :

Mais vous pouvez toujours voir clairement que du début des années 1970 au milieu des années 1990, la valeur moyenne a également stagné. Cela suggère qu’il y avait quelque chose de systémique qui se passait – ce n’était pas seulement la classe moyenne qui était touchée.
Une partie de ce « quelque chose » était une stagnation de la productivité. Si vous regardez la rémunération horaire moyenne par rapport à la productivité moyenne du travail (production par heure travaillée), vous voyez une divergence modeste, mais le ralentissement de la productivité du début des années 1970 au milieu des années 1990 est clairement visible, et il s’aligne exactement avec la stagnation des salaires :

Personne ne sait exactement pourquoi la productivité a ralenti pendant deux décennies, mais à mon avis, la principale explication est que le choc pétrolier de 1973 a inauguré une ère de pénurie d’énergie qui a forcé les économies industrielles à s’éloigner d’une croissance énergivore.
Est-il également possible que les mêmes changements sous-jacents qui ont fait ralentir la productivité au cours de ces deux décennies aient également provoqué une augmentation des inégalités et une baisse de la part du travail dans le revenu de 63 % à 61 % au cours de la même période ? Cela semble plausible, car le timing s’aligne si parfaitement. Mais je ne connais pas de bonne théorie sur la façon dont un changement technologique pourrait causer toutes ces choses à la fois.
Financiarisation
Une théorie courante est que dans les années 1970 et 1980, la politique industrielle américaine – y compris la politique commerciale – a cessé de favoriser l’industrie manufacturière et a commencé à favoriser le secteur financier. C’est, par exemple, la thèse de Judith Stein « Pivotal Decade : How the United States Traded Factories for Finance in the Seventies ». Mais si vous regardez la croissance de l’industrie financière en pourcentage de l’économie américaine, il s’agit d’une augmentation plus ou moins ininterrompue de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au tournant du siècle :

Et si l’on considère les bénéfices financiers, leur part dans le total a en fait diminué dans les années 70, avant de remonter dans les années 80, puis à nouveau à la fin des années 90 et au début des années 00 :

Le timing ici ne correspond pas vraiment. Il n’y a pas de mesure claire de la financiarisation qui coïncide spécifiquement avec le début des années 1970 jusqu’au milieu des années 1990. L’explosion des profits financiers dans les années 1980 pourrait expliquer une partie de la stagnation des salaires, si elle est venue du fait que les financiers faisaient pression sur les entreprises pour supprimer les salaires.
Mais cela ne peut pas expliquer la stagnation des salaires dans les années 1970, ni la réaccélération de la fin des années 90 et du début des années 2000 (lorsque les bénéfices financiers ont explosé mais que les salaires se sont bien comportés).
Le déclin des syndicats
De nombreuses recherches suggèrent que les syndicats réduisent les inégalités économiques (bien que les chercheurs ne soient pas d’accord sur l’ampleur exacte de l’effet). Farber et al. (2021) écrivent :
L’inégalité des revenus aux États-Unis a varié à l’inverse de la densité syndicale au cours des cent dernières années… Nous développons une nouvelle source de microdonnées sur l’appartenance syndicale remontant à 1936, des données d’enquête provenant principalement de Gallup (N ≈ 980 000), afin d’examiner la relation à long terme entre les syndicats et les inégalités… À l’aide de décompositions distributives, de régressions de séries chronologiques, de régressions état-année, ainsi que d’une nouvelle stratégie de variables instrumentales basée sur la légalisation des syndicats en 1935 et le War Labor Board de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, nous trouvons des preuves cohérentes que les syndicats réduisent les inégalités, expliquant une part significative de la baisse spectaculaire des inégalités entre le milieu des années 1930 et la fin des années 1940.
Voici une image de cette relation :

Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’inégalité salariale – la divergence entre la rémunération moyenne et la rémunération médiane – est responsable d’une partie de la stagnation des salaires de la classe moyenne, mais pas de la totalité.
Mais le moment ne semble pas convenir ici non plus. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les syndicats sont en déclin depuis le milieu des années 1950. Le déclin a été un peu plus rapide dans les années 1980, ce qui pourrait expliquer en partie la stagnation des salaires au cours de cette décennie. Mais dans l’ensemble, ça s’est plutôt bien passé. Cela ne correspond pas à la stagnation salariale de 20 ans qui a commencé au début des années 70 et s’est terminée au milieu des années 90.
Inflation
Le graphique des salaires réels des travailleurs de la production et des travailleurs non cadres montre un ralentissement spectaculaire entre 1973 et 1994 environ. Mais un graphique des salaires nominaux de ces mêmes travailleurs – c’est-à-dire le nombre réel de dollars qu’ils gagnaient par heure – ne montre pas un tel ralentissement, sauf peut-être un très léger aplatissement dans les années 1980 :

La différence, bien sûr, c’est l’inflation. De 1973 à 1983 environ, les prix ont augmenté à un rythme rapide :

La régularité de la croissance des salaires nominaux soulève la possibilité que la croissance des salaires nominaux soit très persistante – que les travailleurs soient en mesure de négocier à peu près le même nombre de dollars supplémentaires d’une année à l’autre, malgré de grandes variations du pouvoir d’achat d’un dollar.
Encore une fois, le moment ici ne correspond pas à l’ère de la stagnation des salaires. Mais je suppose que cela pourrait expliquer la première moitié de celle-ci.
Commerce avec l’Europe et le Japon
Enfin, nous revenons au commerce et à la mondialisation. Certes, les Américains s’inquiétaient beaucoup de la concurrence des entreprises européennes et japonaises, surtout au début des années 1980. Les industries japonaises et européennes de l’automobile et des machines-outils ont vraiment soumis les entreprises américaines à une pression concurrentielle intense à partir des années 1970.
Mais il est très difficile de voir cet effet dans les statistiques globales. La pénétration des importations a augmenté dans les années 1970, mais s’est stabilisée dans les années 1980 et au début des années 1990 :

Quant au déficit commercial, il était nul dans les années 1970 et a connu une hausse brève mais temporaire dans les années 1980 :

Certains de mes interlocuteurs semblent penser que la stagnation des salaires a commencé à la suite de l’abolition du système monétaire de Bretton Woods en 1971-1973. Mais ce changement, qui a mis fin au rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve officielle du monde, a entraîné une dépréciation du dollar américain, ce qui a rendu les exportations américaines plus compétitives et a en fait découragé les importations.
Le dollar a ensuite connu une nouvelle hausse au début des années 80 et s’est effondré à la fin des années 80 après l’accord du Plaza (un accord visant à affaiblir le dollar)

Et le yen japonais s’est renforcé plus ou moins régulièrement par rapport au dollar pendant toute la période de stagnation des salaires.
Le commerce avec l’Europe et le Japon ne correspond donc pas non plus à la stagnation des salaires en termes de calendrier. Si l’on pense que la pénétration globale des importations est la mesure clé de la mondialisation, alors le commerce a peut-être eu un effet dans les années 1970 ; si l’on pense que les déficits commerciaux sont une meilleure mesure, alors le commerce a peut-être eu un effet dans les années 1990. Mais le déficit commercial et les importations ont tous deux augmenté à la fin des années 1990, lorsque la stagnation des salaires a pris fin.
Quoi qu’il en soit, le mystère reste entier. La seule tendance macroéconomique qui corresponde parfaitement à la grande stagnation des salaires de 1973 à 1994 est le ralentissement de la productivité, mais il n’existe pas de bonne théorie expliquant comment cela pourrait expliquer la totalité de la stagnation des salaires, étant donné que la productivité a augmenté plus que les salaires. Par ailleurs, la désyndicalisation, la financiarisation, l’inflation et le commerce avec l’Europe et le Japon ne peuvent, au mieux, expliquer que certaines sous-périodes de la stagnation des salaires, et non l’ensemble.
En fait, la grande stagnation des salaires pourrait être due à un ensemble de causes : d’abord l’inflation et l’augmentation des importations dans les années 70, puis l’accélération de la désyndicalisation et de la financiarisation et l’effondrement des exportations dans les années 80, la stagnation de la productivité jouant un rôle corrosif tout au long de cette période.
Mise à jour : Certaines personnes m’ont demandé si la stagnation des salaires de 1973 à 1994 pouvait être due à l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail américain. Voici le taux d’emploi (également appelé « ratio emploi-population ») des femmes américaines :

Vous pouvez constater que la première partie de la chronologie ne correspond pas à la réalité. Lorsque la stagnation des salaires a commencé, les femmes américaines entraient déjà sur le marché du travail à un rythme régulier depuis 25 ans. (Le taux de participation des femmes à la population active est à peu près le même).
En outre, les preuves empiriques suggèrent tout au plus un faible effet de l’offre de main-d’œuvre féminine sur les salaires masculins – et si vous regardez la répartition entre les hommes et les femmes, vous voyez que la stagnation pour les hommes a été pire que pour les femmes entre 1973 et 1994.
Et théoriquement, l’entrée massive des femmes sur le marché du travail ne devrait pas se traduire par une baisse globale des salaires. Tout comme l’immigration ou un baby-boom, l’entrée des femmes sur le marché du travail est à la fois un choc positif de l’offre de main-d’œuvre et un choc positif de la demande de main-d’œuvre – lorsque les femmes gagnent plus, elles dépensent la plupart de ce qu’elles gagnent, pour des choses qui nécessitent de la main-d’œuvre pour produire. 1 Il ne faut donc pas s’attendre à ce que l’arrivée des femmes dans la main-d’œuvre freine les salaires.
Ainsi, cette théorie ne s’aligne pas non plus sur le moment de la stagnation, et il n’est pas clair pourquoi nous nous attendrions à ce qu’il s’agisse d’un facteur majeur en premier lieu.
Cet article a été publié pour la première fois sur Noahpinion Substack de Noah Smith et est republié avec l’aimable autorisation. Devenez abonné à Noahopinion ici.
Views: 2