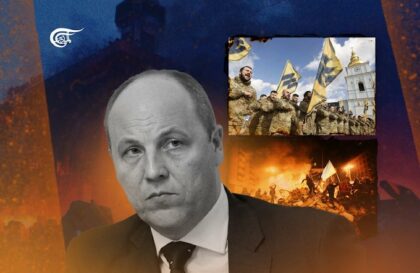Ce dont nous tentons de convaincre nos lecteurs dans notre livre sur la Chine et la longue marche vers un monde multipolaire est que ce monde est déjà là et son existence est irréversible. La grande conséquence en est que nous Français, comme les autres occidentaux qui ne voyons de l’Histoire de l’Humanité que ce qui passe par nous et fait de nous les seuls acteurs du changement, nous ne voyons pas que le monde est entré dans une véritable révolution culturelle. Nous sommes désormais des protagonistes parmi d’autres, et si nos invasions et pillages expliquent beaucoup de choses, il est entre les peuples des relations qui nous échappent. Ainsi en est-il de la relation entre les Turcs et les Russes. Marianne qui a traduit cet article et qui en tant que linguistique a fait son diplôme d’étude supérieure sur la présence du turc dans le russe et moi en tant qu’historienne sommes fascinées par ces relations de voisinage qui surgissent dans le multipolaire (note de Danielle Bleitrach traduction de Marianne Dunlop)
https://vz.ru/opinions/2025/5/11/1330621.html
Tout voyageur expérimenté vous dira que le meilleur moyen de découvrir un pays est de visiter des endroits peu touristiques, où les étrangers ne sont pas considérés comme une source de revenus et où l’on ne se montre aimable que lorsque cela sert les intérêts commerciaux.
Le paradoxe de la Turquie réside dans le fait que la capitale du pays, Ankara, est justement un endroit peu touristique. Nos vacanciers n’ont rien à faire ici, et les amateurs d’antiquités préfèrent également d’autres itinéraires. En revanche, Ankara abrite la Maison russe, et c’est précisément pour cette raison que des écrivains participant au projet « Poètes russes du nouveau printemps » de Rossotrudnichestvo se sont retrouvés ici.
En discutant avec des turcologues expérimentés tels qu’Alexandre Sotnichenko, directeur de la Maison russe à Ankara, on comprend qu’on ne pourra jamais connaître et ressentir ce pays aussi profondément qu’eux. Et pourtant, un regard fugace, amateur, mais direct, est plus utile que des raisonnements théoriques, et c’est particulièrement vrai dans le cas de la Turquie.
Le fait est que notre perception de ce pays est extrêmement contradictoire. Non seulement les opinions divergent d’une personne à l’autre, mais une même personne peut avoir une opinion positive de la Turquie le matin et une opinion beaucoup plus négative le soir. Et cela ne tient pas seulement au fameux « double jeu » du président Erdoğan. Il semble que nous n’ayons tout simplement pas encore déterminé quelle place occupe la Turquie dans notre esprit.
La République turque est-elle une amie ou une ennemie ? D’un côté, les Turcs sont des ennemis archétypaux pour les Russes, car une douzaine de guerres depuis le XVIe siècle ne s’effacent pas sans laisser de traces dans la mémoire historique. La « turcité » est l’image la plus frappante et la plus amère de l’étranger. « Se turquiser » signifie trahir sa foi, trahir son peuple.
Et aujourd’hui, la Turquie est membre de l’OTAN et un acteur international très dynamique qui défend ses intérêts, souvent en concurrence avec la Russie. Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas compter l’État turc parmi nos amis. Cela est confirmé, entre autres, par le fait qu’il n’existe qu’une seule maison russe en Turquie, alors qu’une telle institution serait tout à fait appropriée à Istanbul ou à Antalya. Et par le fait que la marche du « Régiment immortel » n’a été autorisée que sur le territoire de l’ambassade de Russie. Et d’une manière générale, la coopération, par exemple pour perpétuer la mémoire des victimes des guerres russo-turques, est difficile.
D’un autre côté, nous avons des amis en Turquie, et cela se ressent constamment à Ankara. Notre soirée poétique, à laquelle ont participé, outre moi-même, Andreï Polonski, Maria Vatoutina et Alexandre Pelevin, a attiré des personnes qui ne connaissent pas le russe, des étudiants qui font leurs premiers pas dans cette matière. Ils sont ensuite venus vers nous, ont demandé des autographes et nous ont adressé des paroles chaleureuses. Cela signifie que les Turcs veulent nous comprendre.
Des rencontres fortuites dans les bars ou dans la rue en témoignaient également. Lorsque les gens apprennent que vous êtes russe, un sentiment de fraternité spontanée s’installe immédiatement.
Au cours de ce voyage, j’ai trouvé une formule pour décrire cela. Nous sommes tous les héritiers de l’Empire byzantin, mais les Turcs ont hérité de son corps, tandis que les Russes ont hérité de son âme. C’est pourquoi nous nous rapprochons les uns des autres afin de combler nos lacunes mutuelles.
À Ankara, il n’y a pratiquement rien d’exotique pour un Moscovite. De plus, dans les années 90, de nombreux bâtiments ont été construits à Moscou selon des projets turcs, si bien que dans certains quartiers d’Ankara, on se croirait dans les ruelles près de l’Ostozhenka. Mais l’esprit russe vit ici dans les endroits les plus inattendus, pour ainsi dire au cœur même de l’État turc. Ainsi, en entrant dans l’ancienne forteresse d’Ankara, qui est en fait le Kremlin local, on découvre immédiatement un musée privé consacré à l’amitié turco-russe, créé à ses frais par Erol Ugurlu, un descendant des émigrants blancs.
Une découverte encore plus surprenante attend le visiteur du principal sanctuaire de Turquie, le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. Dans le musée du mausolée, nous voyons des dioramas militaires (« Les Turcs repoussent l’attaque des troupes britanniques »), de nombreux tableaux (« Atatürk penché sur une carte », « Atatürk s’entretient avec le peuple », « Les punisseurs grecs tuent des civils turcs », etc. Tout cela semble vaguement familier. Le mystère est résolu lorsque l’on apprend que ces dioramas et ces tableaux, y compris le portrait équestre canonique du fondateur de la Turquie moderne, ont été réalisés par un groupe d’artistes russes sous la direction de Sergei Prissekine.
La boutique du musée propose de nombreux souvenirs sur le thème d’Atatürk, des t-shirts habituels aux figurines du chien préféré du leader. Mais le plus surprenant pour nous a été le puzzle-mosaïque « Assemble Atatürk toi-même ». Il serait sans doute incomplet de dresser le portrait de la Turquie moderne sans rappeler que ce pays est « né d’une révolution ».
- L’Europe menace tout gaz russe
- Erdogan a discuté avec Trump de la situation en Ukraine
- La Turquie, le Japon et la Corée du Sud se retranchent en Asie centrale
À l’époque ottomane, le mot « Turc », comme on nous l’a dit, était plutôt péjoratif et désignait le petit peuple musulman. Mustafa Kemal a réhabilité ce mot, lui a donné une connotation fière, de sorte que l’État turc qu’il a proclamé était un défi révolutionnaire à la tradition, tout comme l’« État des ouvriers et des paysans » de Lénine.
Le concept de la nouvelle nation turque créé par Atatürk était contradictoire. D’une part, il définissait le Turc à la fois selon un critère linguistique et religieux : un Turc devait parler turc et être musulman. D’autre part, Atatürk construisait un État laïc et, à l’instar de Lénine, s’efforçait d’éliminer la religion de la vie sociale. C’est pourquoi l’équivalent turc de nos disputes entre « rouges » et « blancs » est la contradiction entre les laïcs et les religieux.
Naturellement, la capitale est essentiellement laïque, les femmes voilées y sont presque moins nombreuses qu’à Moscou. Néanmoins, si chez nous, le mode de vie laïque est la norme, en Turquie, il a toujours une connotation provocatrice. Ici, un homme peut consommer de l’alcool non pas simplement pour le plaisir, mais pour montrer qu’il est libre, tandis que les « femmes libérées de l’Orient » s’habillent souvent de manière très provocante. Le nombre important de femmes qui fument est également frappant.
Le panturquisme en Turquie est dicté par la langue elle-même, car en turc, « turc » et « turk » sont le même mot. Chez nous, c’est l’inverse : les mots « russe » et « russien » ont la même signification pour le reste du monde, mais à l’intérieur du pays, nous faisons la distinction entre les deux. En turc, il existe également un mot qui signifie « originaire de Turquie, mais pas turc », et comme chez nous le mot « russien », beaucoup ne l’aiment pas.
Une comparaison s’impose entre le « monde turc » et le « monde russe ». D’une part, en dehors de la Turquie, vivent de nombreuses personnes qui, selon la « formule d’Atatürk », peuvent être considérées comme turques, et d’autre part, sur le territoire même de la Turquie, il y a beaucoup de citoyens (principalement des Kurdes) qui ne veulent pas se considérer comme turcs. Cependant, contrairement à la Turquie, la Russie n’a jamais tenté de construire un État-nation et, ces derniers temps, elle se tourne de plus en plus vers une synthèse entre la tradition impériale et l’internationalisme soviétique. Et ici, malgré toutes les fractures tragiques du passé, notre tradition politique s’avère plus profonde et plus cohérente que celle de la Turquie.
Quoi qu’il en soit, la Russie et la Turquie ont eu le temps de se battre l’une contre l’autre. Mais elles ne se sont jamais disputées. Et notre héritage historique commun constitue un bon point de départ pour cette conversation.
Views: 0