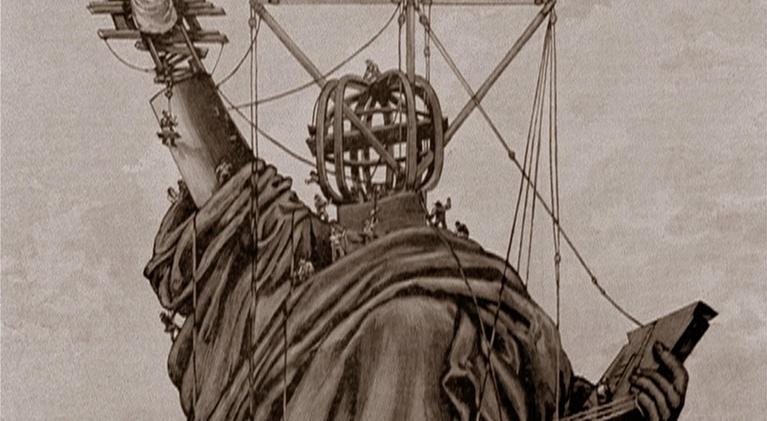Les États-Unis ne peuvent pas revenir à une hégémonie mondiale incontestée. Cependant, ils peuvent rester une puissance mondiale sans pareille s’ils suivent la bonne grande stratégie réaliste. Voici un article en provenance de « l’adversaire » mais qui explique clairement ce que nous ne cessons de répéter : 1) Trump est un syndic de faillite de l’hégémon et qui tente de sauver les meubles de ce qui peut l’être. 2) la politique qui semble effrayer nos commentateurs a été menée dès Obama, Biden, en particulier les guerres et l’affaiblissement de l’UE, de l’Allemagne 3) A ce titre, il ne s’agit même plus de vaincre mais de conserver des zones d’influence régionales. 4) la grosse lacune de ce raisonnement c’est qu’il attribue au monde multipolaire la même logique que la sienne (note et traduction de Danielle Bleitrach histoireetsociete)
Y a-t-il une grande stratégie derrière tous ces mouvements spectaculaires au cours des près de 100 jours de mandat du président Trump ? Malgré les apparences et ce que de nombreux experts en politique étrangère affirment, la réponse est oui. Reste à savoir si cette doctrine Trump sera couronnée de succès. Pourtant, ses principes sont solides et ils sont fondés sur la tradition réaliste bien établie de la politique étrangère américaine, illustrée par Alexander Hamilton, Theodore Roosevelt et Richard Nixon.
La grande stratégie de l’administration Trump repose sur trois principes réalistes : un système international dominé par la concurrence entre grandes puissances, une politique étrangère de realpolitik fondée sur l’intérêt national (ou ce qu’ils appellent « l’Amérique d’abord »), et une puissante appréciation de la géoéconomie et du rôle de la puissance financière dans la politique mondiale.
Après une brève période (l’ère dite de l’après-guerre froide) d’amitié internationale générale et de faibles niveaux de tension entre les grandes puissances, il est évident que nous sommes à nouveau dans une nouvelle ère où la pensée et le comportement réalistes dominent la politique mondiale, de la concurrence militaire aux relations commerciales en passant par les progrès technologiques. Au cours de la dernière décennie, deux tendances géopolitiques ont émergé. Premièrement, la Chine est en quête d’hégémonie régionale et, éventuellement, mondiale. Deuxièmement, l’invasion de l’Ukraine par la Russie déstabilise la sécurité européenne et l’économie mondiale.
En particulier depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2013, l’objectif de Pékin de repousser les États-Unis loin de leur rôle de principal garant de la sécurité de l’Asie de l’Est est devenu plus évident. Comme l’a déclaré Xi en 2014, « en dernière analyse, c’est aux peuples d’Asie de gérer les affaires de l’Asie, de résoudre les problèmes de l’Asie et de défendre la sécurité de l’Asie ». Il continue également de réaffirmer la nécessité pour la Chine de réaffirmer son contrôle sur ce qu’elle considère comme ses propres territoires, notamment Hong Kong, Taïwan et la mer de Chine méridionale. S’exprimant à l’occasion du 110e anniversaire de la révolution chinoise de 1911 en 2021, M. Xi a déclaré que « la tâche historique de la réunification complète de la patrie doit être accomplie et le sera certainement ».
Pendant ce temps, les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie ont sans doute atteint leur point le plus bas depuis les pires jours de la guerre froide, le Pentagone s’étant engagé dans une guerre par procuration contre les forces russes en Ukraine et Washington imposant des sanctions massives à l’économie russe. De plus, les deux grandes puissances rivales de l’Amérique se sont rapprochées de plus en plus.
D’une manière générale, un pays dans la position des États-Unis – la seule grande puissance sans rivaux stratégiques dans sa propre région – devrait se concentrer sur le maintien de ce statu quo favorable aussi longtemps que possible. Pour ce faire, elle maintient son contrôle régional et empêche une autre grande puissance de devenir une puissance hégémonique régionale dans des régions stratégiques clés du monde : l’Asie de l’Est, l’Europe et le Moyen-Orient. Dans l’environnement actuel, seule la Chine a la capacité de devenir une hégémonie régionale ; La Russie et l’Iran, les autres prétendants, n’ont pas les moyens car des voisins plus riches les entourent.
Par conséquent, l’accent mis par l’administration Trump sur le double objectif de rétablir la domination américaine sur l’hémisphère occidental d’une part et de contenir la montée en puissance de la Chine d’autre part représente exactement les principales priorités que l’on attendrait d’un réaliste. De même, les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et à négocier un accord nucléaire avec l’Iran sont des stratégies cohérentes visant à réduire les engagements des États-Unis sur les deux théâtres d’importance désormais secondaire, l’Europe et le Moyen-Orient.
Pour atteindre ces objectifs stratégiques, l’administration suit un deuxième principe de réalisme : la realpolitik. Selon les mots de l’homme d’État anglais réaliste du XIXe siècle, Lord Palmerston, le pays de Trump « n’a pas d’alliés éternels, et nous n’avons pas d’ennemis perpétuels… Seuls nos intérêts sont éternels et perpétuels. » Lorsque le vice-président JD Vance ou le secrétaire à la Défense Pete Hegseth critiquent l’OTAN et les alliés d’Europe occidentale, l’équipe Trump ne fait que suivre ce dicton bien établi.
Il réoriente la diplomatie et les alliances américaines loin des anciens partenariats en faveur de nouveaux. Il est stratégiquement judicieux pour les États-Unis de prêter attention au Groenland et au Panama afin de renforcer leur contrôle géopolitique de l’hémisphère occidental, ainsi que de se concentrer sur la réduction des engagements de l’alliance sur les théâtres secondaires afin de les renforcer dans la région Asie-Pacifique et de contenir la quête d’hégémonie de la Chine.
Alors que les anciens partenariats perdent de leur pertinence, il est tout aussi important d’en forger de nouveaux, et aucun défi géopolitique n’est plus épineux pour les États-Unis que la rupture de l’alliance naissante entre les deuxième et troisième grandes puissances concurrentes. Au lieu de les regrouper comme une menace idéologique commune, la meilleure approche pour briser l’alliance russo-chinoise émergente est d’adopter une stratégie réaliste de détente vis-à-vis de Moscou, le partenaire le plus faible, et de creuser un fossé stratégique entre eux.
La première étape, et la plus urgente, pour empêcher la consolidation d’un axe Moscou-Pékin est de parvenir à une solution diplomatique durable à la crise ukrainienne qui laisserait la Russie et les États-Unis dans une situation à partir de laquelle les relations futures pourraient s’améliorer de manière réaliste. À plus long terme, Washington doit finalement offrir aux dirigeants russes suffisamment de garanties de sécurité pour que leur sphère d’influence « proche » sur le flanc européen soit sécurisée. Ensuite, Moscou pourra recentrer ses énergies sur l’Asie centrale et l’Extrême-Orient, l’arrière-cour de la Chine, et amener la Russie à un statut au moins neutre dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine.
Au fur et à mesure que le système passe de l’unipolarité à la multipolarité, la nature de l’ordre mondial sera controversée et réaliste ; elle ne peut plus être libérale, comme c’était le cas sous l’hégémonie américaine à l’époque unipolaire. Dans la mesure où un ordre international émergera de la concurrence entre grandes puissances, ses principaux principes seront centrés sur la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine et un espace étroit pour la coopération multilatérale par le biais d’institutions mondiales. Le secrétaire d’État Marco Rubio avait donc raison, lors de son audition de confirmation, de qualifier l’ordre mondial libéral d’« illusion dangereuse » et d’appeler à une politique étrangère qui serve l’intérêt national.
Le troisième pilier, mais peut-être le plus vital sur le plan stratégique, de la grande stratégie de Trump est d’apporter du réalisme dans le domaine de la politique économique et technologique pour contrer la guerre économique et le techno-nationalisme de la Chine qui lui ont permis de rattraper ou même de surpasser les pays occidentaux dans ces dimensions de la puissance mondiale. Dans le monde d’aujourd’hui, des questions telles que les accords commerciaux, les stratégies d’investissement, la gestion des ressources énergétiques et le développement de technologies futuristes sont mieux comprises à travers le prisme de la concurrence pour l’influence stratégique entre les grandes puissances plutôt qu’en termes de simple recherche d’efficacité économique ou de progrès scientifique.
De même, les tarifs douaniers sont plus qu’un moyen de lutter contre la fraude économique ou de protéger les intérêts nationaux. Ils devraient principalement être considérés comme une arme économique contre la Chine qui peut faire avancer les intérêts géoéconomiques de l’Amérique et dissuader les entreprises américaines et occidentales d’investir en Chine. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une confrontation géopolitique qui s’apparente à une guerre froide, et pas simplement dans une « concurrence » de la même manière que les États-Unis et l’UE pourraient l’être dans certains domaines du commerce international ou des normes technologiques.
Comme l’a souligné Oren Cass dans un article de Foreign Affairs, de nombreux décideurs politiques de Washington et dirigeants de Wall Street oublient souvent ce fait géopolitique crucial. Ils supposent à tort que les États-Unis et la Chine peuvent encore avoir une relation économiquement symbiotique malgré leurs objectifs stratégiques globaux incompatibles. Par conséquent, l’approche réaliste exige que l’administration Trump passe à un découplage économique progressif mais néanmoins intentionnel et cohérent avec la Chine. Les versions plus faibles de cette mesure, telles que la « réduction des risques », ne suffisent pas. Les tarifs élevés que Trump a imposés à Pékin sont un excellent premier pas dans cette direction.
L’administration Trump a également pris des mesures dans le sens d’une approche nationaliste de la politique technologique. L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, affirme que le facteur décisif dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine sera ce qu’il appelle le « pouvoir d’innovation ». Par conséquent, en plus des obstacles au commerce et aux flux de capitaux, des outils tels que l’augmentation du financement public de la recherche et des subventions économiques aux industries stratégiques de haute technologie, la coopération avec les alliés pour établir des normes internationales de communication et le financement des investissements dans les infrastructures sont nécessaires d’une manière qui n’a pas été le cas depuis les premiers jours de la guerre froide.
Pour gagner la nouvelle guerre technologique contre la Chine et maintenir leur position géopolitique actuelle, les États-Unis doivent également adapter leur approche de l’innovation et de la fabrication nationales, du financement de la science et de la technologie, des contrôles à l’exportation, de la promotion des normes techniques internationales et des investissements dans les infrastructures afin d’empêcher Pékin de dominer les principales technologies émergentes du futur.
Le secteur de l’énergie est un dernier terrain clé de la concurrence géoéconomique contre la Chine. Les réserves de pétrole et de gaz sont utilisées comme outils de concurrence géopolitique depuis des décennies, et la récente guerre en Ukraine n’a fait que rappeler les liens essentiels entre la sécurité énergétique et la grande stratégie. Une politique énergétique réaliste part du fait que les États-Unis sont dotés d’énormes quantités de pétrole et de gaz. Combiné à un savoir-faire industriel de classe mondiale dans les secteurs de l’extraction d’énergie, du raffinage et du transport, Washington peut atteindre non seulement l’indépendance et la sécurité énergétiques, mais aussi la domination mondiale de l’énergie.
Par conséquent, la principale priorité devrait être d’utiliser cet avantage concurrentiel dans le secteur du pétrole et du gaz pour faire valoir ses intérêts sur le marché mondial émergent de l’énergie après l’Ukraine, un marché caractérisé davantage par la concurrence géopolitique que par les marchés libres, ainsi que par un retour à la dépendance aux combustibles fossiles. Une fois de plus, l’administration Trump, par le biais d’une série de décrets, a fait les premiers pas appropriés dans cette direction, réintégrant la politique énergétique dans le cadre plus large de la grande stratégie américaine.
Les États-Unis ne peuvent pas revenir à l’hégémonie mondiale incontestée dont ils jouissaient dans les années 1990. Cependant, il peut rester une puissance mondiale sans égal pour les décennies à venir si ses dirigeants suivent la bonne grande stratégie réaliste. La doctrine Trump a toutes les caractéristiques d’une telle approche. C’est maintenant à l’administration de le mettre en œuvre sans distractions inutiles, comme l’épisode du « Signalgate ». Si l’administration est capable de rester concentrée sur le respect des trois principes réalistes décrits ci-dessus, Trump sera probablement considéré comme l’un des présidents les plus astucieux sur le plan géopolitique des États-Unis.
À propos de l’auteur :
Ionut Popescu est professeur agrégé de sciences politiques à l’Université d’État du Texas et l’auteur du nouveau livre No Peer Rivals : American Grand Strategy in the Era of Great Power Competition (University of Michigan Press, 2025), dont cet essai est adapté. Avant de rejoindre l’État du Texas, M. Popescu a travaillé comme boursier postdoctoral au Clements Center for National Security de l’Université du Texas à Austin. Il a obtenu son doctorat en sciences politiques et en relations internationales de l’Université Duke en 2013, et il est un ancien lauréat de la bourse d’écriture de livres de la Fondation Smith Richardson Strategy and Policy Fellows.
Views: 1