FIGAROVOX/TRIBUNE – Si la critique de l’Europe en Amérique est bien plus ancienne que Donald Trump, tout est fait pour nous convaincre que son discours marque néanmoins une rupture inédite dans la façon d’envisager les relations transatlantiques, c’est la démonstration que fait ici Patrick Chamorel, professeur à l’université de Stanford. Notez que cette démonstration fonctionne selon la rhétorique dite du fétichiste ; Je sais bien que le capitalisme n’a ni allié, ni patrie, mais a un bras armé les Etats-Unis autour du dollar et de l’OTAN dont il n’a jamais laissé le commandement à un pays européen, mais il faut que je croie que c’est une aberration de ce président là, un simple accident de l’histoire. Pourtant c’est bien parce que les Etats-Unis étaient ce qu’il sont et l’Otan leur instrument exclusif que De Gaulle était sorti de ce commandement. En fait l’Europe a toujours été sous contrôle atlantiste et l’euro qui pourtant avait suscité des espoirs n’a jamais été une alternative et certainement pas sur un mode démocratique. Encore récemment, les Etats-Unis ont fait la preuve de la piètre estime qu’ils avaient pour les intérêts français avec Alstom puis la rupture du contrat avec l’Australie. A ces événements révélateurs, il faudrait ajouter la perte d’indépendance de la France en Afrique, au Moyen Orient et dans la plupart de ses zones d’influence traditionnelle où de plus en plus elle a relayé les intérêts des USA. Dès Mitterrand mais avec une accélération sous Sarkozy, Hollande, Macron. Mais malgré ces FAITS, Patrick Chamorel pour établir que Trump représenterait une « rupture », une « anomalie », se lance dans les supposées transformations « idéologiques » du parti républicain. S’agit-il bien d’un isolationnisme ou comme nous le répétons souvent d’une réforme radicale, rendue nécessaire par la crise profonde et durable de « l’hégémonisme » ? Faut-il psychologiser – une autre forme d’idéologisation de la crise impérialiste – la politique de Trump pour éviter sa dimension de classe et donc sa permanence ? de la réponse à ces questions dépend la conception que l’on peut avoir ou non de la nécessité de l’intervention populaire… en vue d’un choix de souveraineté nationale totalement différent face au monde multipolaire qui est déjà là et dont l’existence provoque la manœuvre plus ou moins désespérée et autodestructrice actuelle du président des USA (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison Blanche, le 24 février 2025.© Brian Snyder / REUTERS
L’animosité de Trump l’égard de l’Europe s’est intensifiée depuis le début de son second mandat, tant dans la rhétorique que dans les politiques mises en œuvre. Trump est même allé jusqu’à déclarer que «la raison d’être de la construction européenne avait toujours été de torpiller les intérêts américains !» Son vice-président JD Vance n’est pas en reste, ayant qualifié d’«erreur» le projet d’attaque américaine contre les Houthis du Yémen au motif que les Européens en tireraient aussi un bénéfice : «J’en ai assez de payer pour les Européens… dont 40% du commerce passe par le canal de Suez, contre 3% pour les États-Unis» a-t-il dit. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth dit partager la «détestation» de Vance pour «l’habitude européenne de se reposer sur les États-Unis», la jugeant même «pathétique». Dans le même échange, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz relaie la demande de Trump de «faire payer aux Européens le coût de cette opération». Lors d’une visite au Groenland le week-end dernier, JD Vance a réitéré la détermination de Trump d’annexer ce territoire.
Certains soutiens de Trump en France ont beau jeu de rappeler que les États-Unis n’ont pas attendu Trump pour nuire aux intérêts français : détention d’un cadre d’Alstom pour forcer la vente à General Electric, amende de 10 milliards d’Euros infligée a la BNP Paribas pour violation des sanctions extraterritoriales américaines sous Obama, ou encore torpillage du contrat de sous-marins français à l’Australie sous Biden. Les critiques de l’insuffisante contribution financière de l’Europe à sa propre défense («burden-sharing») remontent à la création même de l’Otan et ont été le fait des présidents démocrates autant que républicains. L’immixtion des États-Unis dans la politique intérieure des États européens n’est pas non plus une nouveauté depuis la lutte contre le communisme d’après-guerre, et la diplomatie américaine a toujours privilégié les relations bilatérales aux arcanes de Bruxelles.
C’est pourtant à une rupture profonde et radicale de la politique américaine vis-à-vis de l’Europe que nous assistons sous la présidence Trump. Cette rupture est l’aboutissement de la transformation idéologique et sociologique du Parti républicain depuis la première élection de Trump en 2016. Elle tranche avec les critiques adressées à l’Europe depuis la création, sous impulsion américaine, du plan Marshall, de l’Otan et de la Communauté européenne. Au vu de la crise de Suez, du Gaullisme et de l’Ostpolitik, Kissinger a su injecter une dose de Realpolitik dans la vision américaine d’une Europe fédérale dont les intérêts et la culture politique étaient censés converger avec ceux des États-Unis. Dans les années 1960-70, les États-Unis ont mesuré le risque d’une Europe anti-américaine dominée politiquement par la France. Sous Reagan, le pacifisme allemand dans la crise des missiles SS20 a constitué un défi supplémentaire. Reagan a ensuite rejoint Margaret Thatcher dans la dénonciation d’une soi-disant «forteresse commerciale européenne».
Sous Jacques Delors et à la suite du traité de Maastricht en 1992, les États-Unis ont perçu l’Europe comme un État en gestation doté de sa propre constitution et de sa propre monnaie, dont les intérêts ne manqueraient pas, à terme, de diverger avec ceux de l’Amérique. C’est aussi à partir de cette époque que les conservateurs britanniques ont alerté leurs alliés politiques à Washington sur le risque d’absorption de leur plus proche allié dans une Europe dirigiste et anti-américaine. Après le 11 septembre, c’est une autre inspiration conservatrice, celle des néo-conservateurs, qui a conduit à la dernière campagne anti-européenne –et largement anti-française – avant Trump. L’Europe fut mise en cause pour son incapacité à intégrer sa population musulmane (les principaux auteurs des attaques du 11 septembre avaient vécu en Europe). Sur le plan stratégique, elle était jugée militairement trop faible et politiquement trop anti-américaine pour servir d’alliée utile aux États-Unis ; en revanche, elle faisait figure d’obstacle aux ambitions américaines au Moyen-Orient, surtout pour son rôle au Conseil de sécurité de l’ONU. À l’objectif louable d’instaurer la démocratie au Moyen-Orient, les Européens préféraient prétendument les contrats pétroliers de Saddam Hussein!
Jusqu’à une période récente, les voix les plus critiques de l’Europe se recrutaient surtout dans les cercles conservateurs, mais ceux-ci étaient internationalistes, anti-communistes, antirusses, partisans d’une hégémonie américaine mondiale et d’un leadership américain incontesté au sein de l’OTAN. Seule une frange isolationniste et populiste inspirée par Pat Buchanan dans les années 1990 laissait présager les politiques trumpiennes. De même, le protectionnisme et le dirigisme étaient dénoncés au nom du libéralisme économique et du libre-échange dont les États-Unis s’étaient montrés les champions dans les cycles de négociations du GATT et de l’OMC. Les rôles sont aujourd’hui inversés puisque ce sont désormais les Européens qui s’opposent à la Russie et prennent la défense de l’Otan et du libre-échange face à Trump.
L’anti-Européanisme de Trump s’inscrit donc dans le contexte nouveau d’une résurgence de l’isolationnisme, avec comme corollaire le rejet des alliances et du multilatéralisme. L’Europe est vilipendée pour avoir abusé des États-Unis en matière de défense et de commerce extérieur ; elle n’est ni alliée ni ennemie et appartient par sa géographie à la sphère d’influence russe. Trump ne se désintéresse pas pour autant de l’Europe sur le plan politique et culturel. Comme aux États-Unis, il y condamne la gauche wokiste et immigrationniste suspectée de restreindre la liberté d’expression chère à Elon Musk. Trump encense le conservatisme culturel propre à l’Europe de l’Est et à la Russie. Il soutient Viktor Orbán, Nigel Farage, Giorgia Meloni et autres populistes d’extrême droite en espérant une Europe plus trumpienne.
Trump renoue avec les traditions isolationniste, protectionniste, populiste et nativiste interrompues depuis 1945. Il emprunte à l’histoire européenne la politique de la canonnière et associe paradoxalement à son isolationnisme un penchant impérialiste avec ses visées sur le Canada, le Groenland et Panama. Dans l’imaginaire américain de l’Europe où l’idéalisme s’oppose aux intérêts des puissants ; la démocratie à l’autoritarisme et la transparence à la diplomatie secrète, l’Amérique de Trump semble ressembler davantage à l’Europe. Un véritable renversement de rôles !
Views: 1







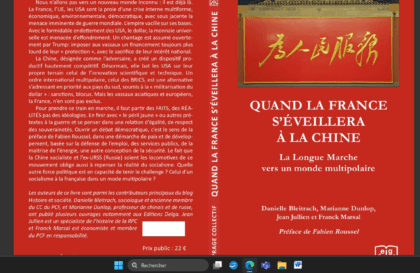
SCHALOM DANIEL
L’ Europe de l’automobile et de l’aéronautique a détruit la suprématie de Ford et Boeing,Trump est revanchard
Etoilerouge
En réalité pour l’aéronautique et donc airbus , le capital des multinationales usa y est bien présent et nombre des éléments nécessaires à Airbus st fabriqués aux USA. Les capitalistes même alliés restent en concurrence ne l’oublions pas comme l’ont démontré puissamment Marx et Lénine. Trump n’est un revanchard qu’en paroles, en idéologie. En fait c’est un GD patron et qui cherche à élargir ses parts de marché au détriment d’autres.