Trump lance une nouvelle ère turbulente pour l’économie mondiale, un renversement total des alliances et un calcul assez primaire des coûts et avantages que l’on retrouve dans beaucoup de « mesures » occidentales à commencer par le PIB. Ce qui, comme le craint l’auteur de l’article, risque d’avoir un effet boomerang sur les USA pièce centrale du dispositif hégémonique occidental. En revanche, il faut également noter quelque chose d’essentiel que la Russie, la Chine, le Mexique ont parfaitement intériorisé à savoir qu’il s’agit d’une attitude de bluff du négociateur qui fait une offre destinée à se présenter en position d’avantage. Le seul problème est de savoir qui est en situation de « tenir » le temps de la déstabilisation et de l’incertitude avec les dégâts réels sur l’économie et les « souffrances » populaires que cela engendre comme dans toute guerre. Tout a été fait pour faire des Français et des autres « coalisés » de parfaits dupes et la « gauche » dans toutes ses obédiences n’a pas été la dernière à priver de défense notre pays, ce que Fabien Roussel a malgré tout compris à savoir que la « défense » d’un pays passe non seulement par son armée mais par son économie et à quel point l’acceptation de la destruction du tissu industriel français y compris par les destructions boursières mais aussi la privatisation de l’énergie et des services publics était la clé de la perte de souveraineté. Tandis que les autres jouent à s’affronter sur « l’immigration », les dames patronnesses contre les « sécuritaires » ou à inventer que Trump est un « méchant » en rupture avec le gentil Biden, non c’est le syndic de faillite obligé de jouer dans la mondialisation multipolaire chinoise avec son respect de chaque légalité nationale du marché… (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
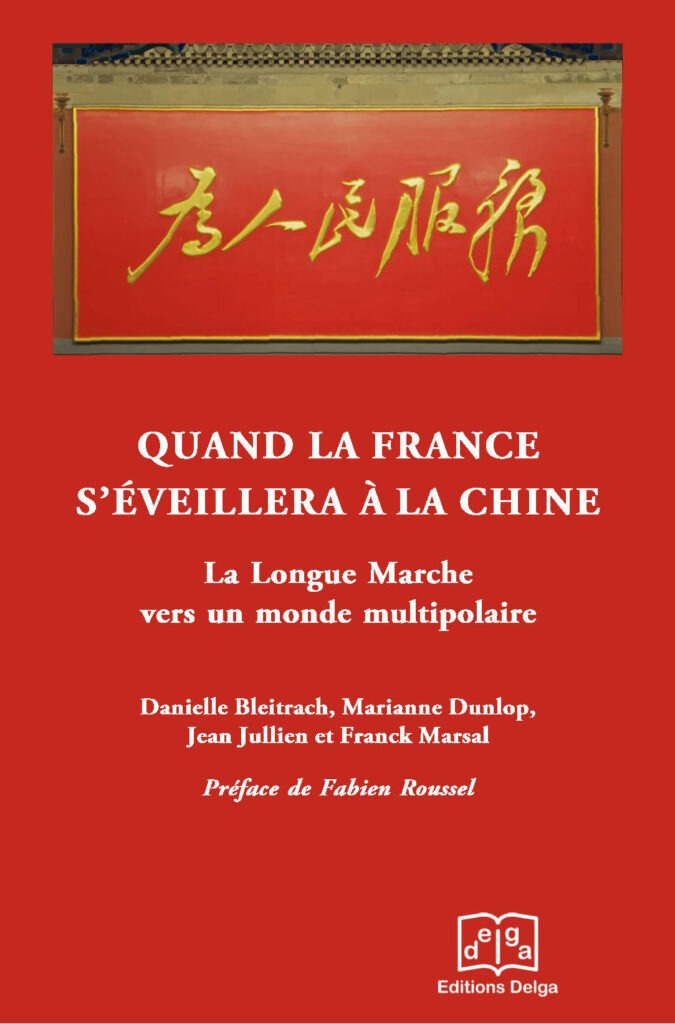
Eswar Prasad
3 avril 2025

ESWAR PRASAD est professeur à la Dyson School de l’Université Cornell et Senior Fellow à la Brookings Institution.
L’ère du commerce international de plus en plus libre et étendu, construit sur un système fondé sur des règles que les États-Unis ont contribué à créer, a pris fin abruptement. Le 2 avril, lors d’un événement théâtral à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a mis en place une série de droits de douane massifs qui affecteront presque tous les pays étrangers. D’une certaine manière, son annonce n’a pas été une surprise : dès son entrée en fonction, les entreprises et les analystes financiers savaient que Trump augmenterait les barrières commerciales. Mais l’ampleur et la portée des tarifs ont confirmé leurs pires craintes. D’un seul coup, Washington a sévèrement restreint le commerce international.
Pour justifier cette nouvelle ère de droits de douane, Trump a fait valoir que les États-Unis sont victimes de pratiques commerciales déloyales. Comme pour beaucoup d’idées de Trump, il y a plus qu’un noyau de vérité dans ses affirmations. La Chine, par exemple, a profité des règles de l’Organisation mondiale du commerce pour avoir accès aux marchés d’autres pays pour ses exportations, tout en limitant l’accès à ses propres marchés. Pékin a également utilisé d’importantes subventions et d’autres mesures pour stimuler la compétitivité mondiale des entreprises chinoises, notamment en forçant les entreprises étrangères à céder de la technologie.
Mais plutôt que de corriger les règles dont certains partenaires commerciaux des États-Unis ont profité, Trump a choisi de faire exploser l’ensemble du système. Il a pris la hache de guerre pour commercer avec pratiquement tous les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, n’épargnant ni alliés ni rivaux. La Chine est maintenant confrontée à des droits de douane élevés, oui, mais c’est aussi le cas du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan. Les relations économiques et les alliances géopolitiques de longue date et mutuellement bénéfiques ont peu compté.
Beaucoup de gens espèrent que les tarifs douaniers de Trump s’avéreront éphémères – que, confronté à la chute des actions et à la hausse des prix, Washington lèvera les restrictions. Il est possible que la Maison-Blanche baisse certains de ses taux, d’autant plus que les pays font pression pour obtenir des exemptions. Mais la réalité est qu’il est peu probable que l’ère du libre-échange revienne. Au lieu de cela, tout marchandage entre Trump et d’autres États façonnera un système économique émergent défini par le protectionnisme, les tensions et les transactions. Il n’en résultera pas plus d’emplois, comme Trump l’a promis. Ce sera des turbulences pour tous, et pour les années à venir.
Selon Trump, les États-Unis ont besoin de tarifs douaniers massifs pour corriger leurs déséquilibres commerciaux. Il y a peu de logique à cette notion. Il est vrai que les États-Unis enregistrent des déficits commerciaux avec la plupart des pays, mais il n’y a rien de mal à cela. Au lieu de cela, cela signifie simplement que d’autres pays sont efficaces pour produire les biens que les consommateurs américains veulent, de sorte que les Américains achètent plus chez eux que l’inverse. Pourtant, Trump croit que tout pays qui affiche un excédent commercial bilatéral avec les États-Unis est, par définition, de la triche et que des tarifs réciproques sont nécessaires pour équilibrer les choses.
Pour décider des tarifs douaniers à imposer, Trump a ostensiblement calculé toutes les façons dont les pays trichent – y compris par le biais de droits de douane, de barrières non tarifaires et de manipulations monétaires – pour estimer le total des « droits de douane » que chaque pays a imposés aux États-Unis. En pratique, cela signifiait diviser le déficit commercial des États-Unis avec un pays par la quantité de biens qu’il exportait vers les États-Unis. (Ces calculs excluent commodément le commerce des services, comme le tourisme, l’éducation et les services aux entreprises, dans lequel les États-Unis enregistrent un excédent avec la plupart de leurs partenaires commerciaux). Trump a ensuite généreusement accordé à chaque pays une réduction de 50 %, imposant des droits de douane réciproques sur les importations de biens équivalant à la moitié de cette mesure.
Pour voir comment cela fonctionne, en pratique, regardez la Chine. En 2024, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 295,4 milliards de dollars avec ce pays, et ils ont importé pour 438,9 milliards de dollars de produits chinois. Trump a ainsi calculé que la Chine a un taux de droits de douane effectif de 67 % sur les importations en provenance des États-Unis, soit 295,4 milliards de dollars divisés par 438,9 milliards de dollars. Trump a donc fixé les droits de douane réciproques sur les importations américaines en provenance de Chine à 34 % (la moitié de 67 %). Ce chiffre semble s’ajouter aux droits de douane de 20 % déjà en place, ce qui équivaut à un taux tarifaire total de 54 % sur les importations en provenance de Chine, mais qui compte ?
Les États-Unis et la Corée du Sud ont un accord de libre-échange, mais la Corée du Sud a un excédent commercial avec les États-Unis. Par conséquent, selon la logique de Trump, ils doivent tricher. Selon les calculs de la Maison Blanche, la Corée du Sud applique des droits de douane d’environ 50 % sur les exportations américaines. En conséquence, Trump a imposé des droits de douane de 26 % sur les importations en provenance de Corée du Sud.
Trump a fait exploser l’ensemble du système commercial.
Qu’en est-il des pays contre lesquels les États-Unis ont un excédent commercial ? Les États-Unis exportent plus de biens vers l’Australie et le Royaume-Uni qu’ils n’en importent de ces pays. Cela montre certainement que les États-Unis sont les tricheurs dans ces deux relations. Mais de l’avis de la Maison-Blanche, seuls les autres pays trichent. En fait, ces deux pays étaient encore frappés par des droits de douane de dix pour cent. On peut se demander pourquoi appliquer des droits de douane dans de tels cas. La réponse, semble-t-il, est : Pourquoi pas ?
Les tarifs douaniers à eux seuls n’effaceront pas le déficit commercial global des États-Unis, à moins que le pays ne se coupe complètement du commerce international. En effet, le déficit commercial est, en fait, l’écart entre l’épargne intérieure et l’investissement. Les États-Unis restent un bon endroit pour investir, mais leur taux d’épargne privée est faible et le gouvernement accuse d’énormes déficits budgétaires. Si Trump voulait vraiment équilibrer le compte commercial, il ferait mieux de poursuivre des mesures visant à promouvoir l’épargne nationale. Et même si les États-Unis n’avaient pas de déficit commercial global, ils auraient probablement des déficits commerciaux avec certains pays et des excédents avec d’autres. Les déséquilibres commerciaux bilatéraux sont tout simplement la nature du commerce international.
Trump considère également les tarifs douaniers comme un outil pour relancer l’industrie manufacturière américaine. Mais cet avantage est spéculatif, se produirait dans un avenir lointain et est compensé par les coûts évidents. Les tarifs douaniers de Trump englobent un si large éventail de produits et de partenaires commerciaux qu’ils auront inévitablement des effets négatifs sur l’économie américaine, les coûts des perturbations étant supportés par les consommateurs et les entreprises américains dans pratiquement tous les secteurs.
Les industries dont les chaînes d’approvisionnement sont complexes et qui traversent plusieurs pays, comme la construction automobile, seront les plus durement touchées. Mais toute entreprise qui a bénéficié de chaînes d’approvisionnement efficaces et rentables (c’est-à-dire la plupart d’entre elles) devra maintenant réduire ses activités afin de réduire son exposition aux risques de politique commerciale et géopolitiques. Cela fera inévitablement grimper les prix pour les consommateurs, car les entreprises privilégient la résilience plutôt que l’efficacité. Même les produits agricoles, les machines et l’équipement, ainsi que les produits de haute technologie que les États-Unis exportent seront affectés négativement, en raison des tarifs de rétorsion imposés par les partenaires commerciaux de Washington.
POINT DE NON-RETOUR
Le reste du monde réagit toujours à l’annonce de Trump. Mais les pays répondront probablement par une combinaison de représailles, d’apaisement et de diversification. Chacune de ces approches comporte des défis.
Considérez, d’abord, les représailles contre les États-Unis. De nombreux pays ont déjà promis d’appliquer des droits de douane sur les produits fabriqués aux États-Unis en réponse aux provocations de Trump. Leurs citoyens, eux aussi, sont en colère. Les consommateurs canadiens boycottent les produits américains, et les touristes du reste du monde sont susceptibles d’éviter les États-Unis. Mais les représailles ont leur propre coût, car elles augmentent l’incertitude concernant le commerce mondial, ce qui nuit aux investissements des entreprises.
L’apaisement comporte moins de risques, et il est certainement dans l’intérêt de chaque pays frappé par des tarifs douaniers de négocier avec Trump. Le commerce bilatéral ne peut pas être équilibré du jour au lendemain, mais les pays pourraient promettre d’acheter davantage de biens aux États-Unis et de réduire les obstacles à ces importations. Trump a justifié les précédentes séries de droits de douane par des raisons de sécurité nationale plus larges, les utilisant comme un outil pour amener les pays à limiter l’immigration illégale et les afflux de drogues illicites ; Les partenaires commerciaux des États-Unis pourraient proposer de prendre des mesures audacieuses pour empêcher ces fléaux d’atteindre les côtes américaines. Trump aime les accords, après tout, donc chaque pays devra trouver des moyens de lui permettre de revendiquer la victoire (ce qu’il fera de toute façon). Pourtant, même si d’autres pays promettent d’acheter davantage de produits américains, il est peu probable que leurs excédents commerciaux avec les États-Unis diminuent assez rapidement pour plaire au président, ce qui les exposerait à des mesures punitives supplémentaires. Et si l’économie américaine commence à s’effondrer à cause des droits de douane, Trump rejettera inévitablement encore plus de blâme sur le reste du monde.
Les États-Unis sont à l’origine d’une résurgence du protectionnisme.
D’autres pays, en particulier ceux qui ont déjà des relations commerciales solides, pourraient peut-être contourner complètement les États-Unis. Par exemple, la Chine, le Japon et la Corée du Sud pourraient tenter de se protéger collectivement des effets des tarifs américains en intensifiant leurs liens commerciaux mutuels. Mais chacun de ces pays dépend fortement des exportations pour alimenter son économie et est confronté à une faible demande intérieure. L’énorme capacité excédentaire de la Chine et la faiblesse de la demande d’importations, en particulier, menacent les deux autres économies. En conséquence, ces pays risquent d’être réticents à l’idée d’ouvrir pleinement leurs marchés aux exportations de l’autre. Les Européens, pour leur part, ont signalé qu’ils étaient prêts à travailler avec d’autres États sur le commerce. Mais ils ne veulent pas devenir un dépotoir pour les exportations d’autres pays.
Néanmoins, face à l’accès restreint aux marchés américains et à la baisse de la demande des consommateurs américains, le reste du monde se tournera vers la diversification des marchés d’exportation, des accords commerciaux excluant les États-Unis et d’autres approches pour se protéger contre une guerre commerciale mondiale imminente. Mais la réalité est qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose. En fait, même si les États-Unis se retirent des tarifs douaniers généralisés et substantiels annoncés par Trump, le mal a été causé à la confiance des entreprises et des investisseurs. Washington a jeté un voile sur l’investissement des entreprises et la demande de consommation, ce qui pourrait faire basculer l’économie américaine dans une récession et entraîner le reste de l’économie mondiale avec elle.
Les États-Unis ont cédé leur rôle de bastion du libre-échange et sont plutôt à la tête d’une résurgence du protectionnisme qui nuira aux consommateurs et aux entreprises du monde entier. Ces tarifs, s’ils restent en place, définiront l’héritage de Trump non pas comme un homme d’affaires avisé, mais comme un obstacle destructeur et irritable au progrès économique.
Views: 4


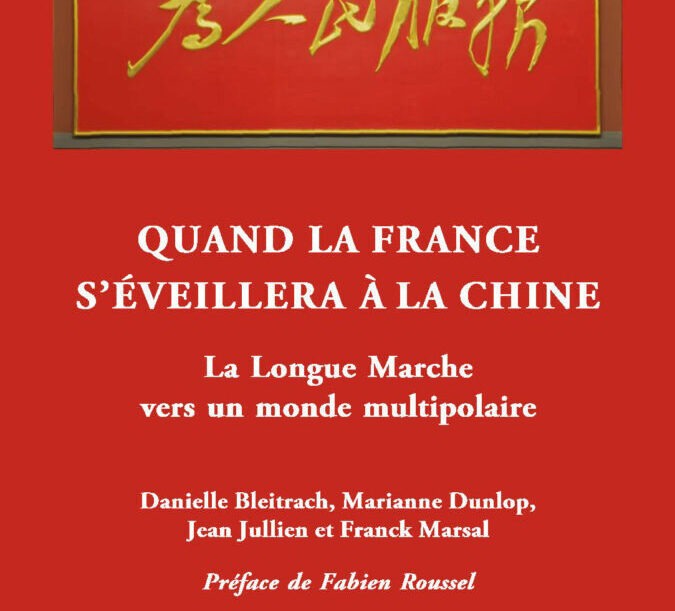




Michel BEYER
Le trumpisme en nazi de notre temps ? C’est la question posée par Yotros MITRAILLAS dans un article publié sur LGS( le grand soir). C’est vrai qu’il y a beaucoup de similitudes entre les 2 régimes. Mais personnellement je n’irais pas jusque là :
https://www.legrandsoir.info/le-trumpisme-en-nazisme-de-notre-temps.html
Hier, Histoire et Société a publié un texte qui démontrait la sérénité, le calme des dirigeants russes et chinois par rapport à l’excitation de Trump et son équipe. Trump n’est pas un diplomate, c’est un homme d’action habitué a ce que ses ordres soient exécutés vite fait vite dit. La diplomatie n’aime pas les temps courts. Le temps long peut être un atout sur les problèmes délicats à traiter. Discuter d’un « cessez le feu » fait partie de ces problèmes délicats. La Russie, avec V.Poutine ne veut pas être piégée. Le » cessez le feu » sur les installations énergétiques n’ a pas été respecté par la partie ukrainienne. Si l’on récapitule le nombre de fois ou la parole des occidentaux n’a pas été respectée, parole donnée à Gorbatchev que l’OTAN ne progresse pas vers les frontières de la Russie, accord de Minsk 1 et Minsk 2 non respectés par les pays signataires garantissant l’application des accords (France, Allemagne), les presqu’accords du printemps 2022 sabotés par Boris Johnson, Il est aisé de comprendre l’attitude de la Russie.
Et puis, il y a une part de cinema de la part de Trump. C’est dur pour lui de se rendre compte que les USA ne sont plus les maîtres du monde. Par instant, il fait comme si….Cela pour impressionner surtout les américains. Russes et Chinois en ont vu d’autres!!!
Etoilerouge
Trump n’est pas un homme d’action mais très grand patron . Le fascisme ne provient pas d’abord de dirigeants politiques imposant telle ou telle loi mais de l’accentuation des raisons permanentes et profondes de l’économie capitaliste impérialiste accentuée par des contingences nlles, enfin nlles depuis au moins 30 ans , le développement de l’économie socialiste de marché sur le terrain même du capital. La crise est telle que les classes impériales capitalistes états uniennes et alliées ont besoin d’imposer à la classe ouvrière mondiale et à l’ensemble du monde du travail les coûts de cette crise, les régressions qu’elle porte, et cherche à reprendre l’expansion accumulation du capital par l’écrasement des travailleurs, des mesures contre les autres pays allant jusqu’à la guerre pour prendre voler s’assurer des richesses capitalistiques d’autres nations et capitalistes. En soi c’est une guerre mondiale sur divers plans. Le fascisme n’est donc pas la conséquence de trump ou marine le Pen ou meloni ou van der leyen mais la seule possibilité pour l’impérialisme de faire face à la baisse du taux de profit, à la perte de marches, aux difficultés de concentration du capital. Danielle a vu juste depuis très longtemps. Nous voyons sous nos yeux ébahis se multiplier les contradictions ds une spirale d’effondrement du capital impérialisme. Il faut que le PCF puisse l’analyser , le digérer, prendre les orientations évitant à notre pays notre peuple sa classe ouvrière de couler avec le Titanic anglo saxons. Pas d’autres choix que le socialisme à la française ds l’amitié et l’entente avec les brics