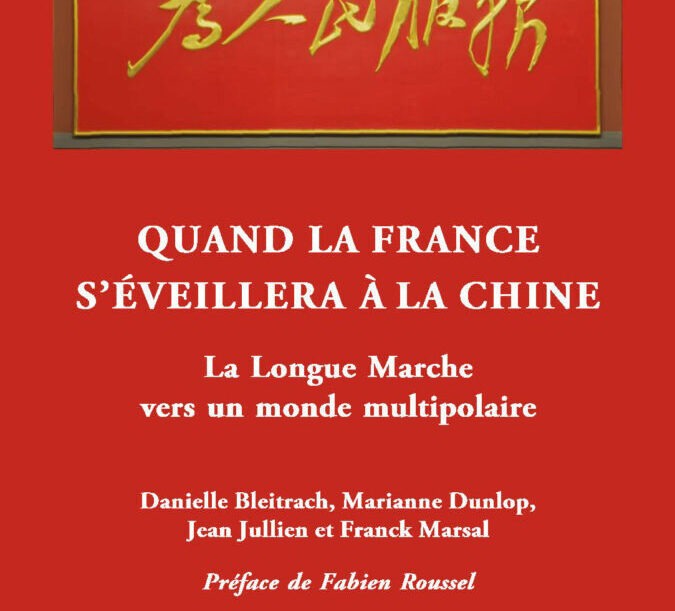Il me semble que ce qui bloque la perception de la réalité des rapports de force et le caractère quasiment désespéré et suicidaire de la politique de Macron est l’incapacité à mesurer à quel point l’impérialisme occidental est dans une mauvaise passe. Nous ne cessons de répéter que Trump n’est pas un fou, un traitre mais un syndic de faillite qui d’une part est contraint à la négociation en Ukraine et d’autre part comme le montre cet article tout entier en faveur du « libéralisme », il tente de s’en sortir en adoptant ou croyant adopter « le manuel économique de Pékin ». La seule chose réellement intéressante n’est pas le cirque dérisoire de Macron, Zelenski et autre loosers mais bien d’essayer, si faire se peut, de faire comprendre où en est le monde et de ce point de vue, souvent les publications de l’adversaire sont mille fois plus intéressantes et pertinentes que celles des pseudos spécialistes qui soit haïssent le socialisme chinois, soit prennent leurs désirs pour des réalités, en tous les cas ne perçoivent pas l’accélération et la mobilité stratégique d’une telle bataille. Simplement il faut une lecture critique qui nous fait franchement nous moquer premièrement de l’idée que l’impérialisme jouerait franc jeu, ne serait-ce que la manière dont il utilise le dollar et l’extraterritorialité, alors que la Chine adopte la règle de chaque pays et donc crée ses règles en Chine même et joue avec l’attrait du marché chinois. De surcroit elle a la planification, alors que Trump lui au contraire laisse la bête sauvage des intérêts privés de plus en plus libre et dévastatrice. Donc nous allons essayer à la fois de tenter y compris avec des publications impérialistes de vous faire percevoir les enjeux, de tenter de comprendre ce que des communistes français, des progressistes, des gens de gauche peuvent tirer de ce champ élargi, et dans le même temps essayer de ne pas négliger celui dans lequel nous sommes contraints d’agir au jour le jour, déblayer la montagne de débris et ruines qui se sont accumulés et qui nous bloquent dans notre capacité à nous rassembler. Avec la phrase de Xuan: tenons compte de notre faiblesse, ne la prolongeons pas inutilement. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
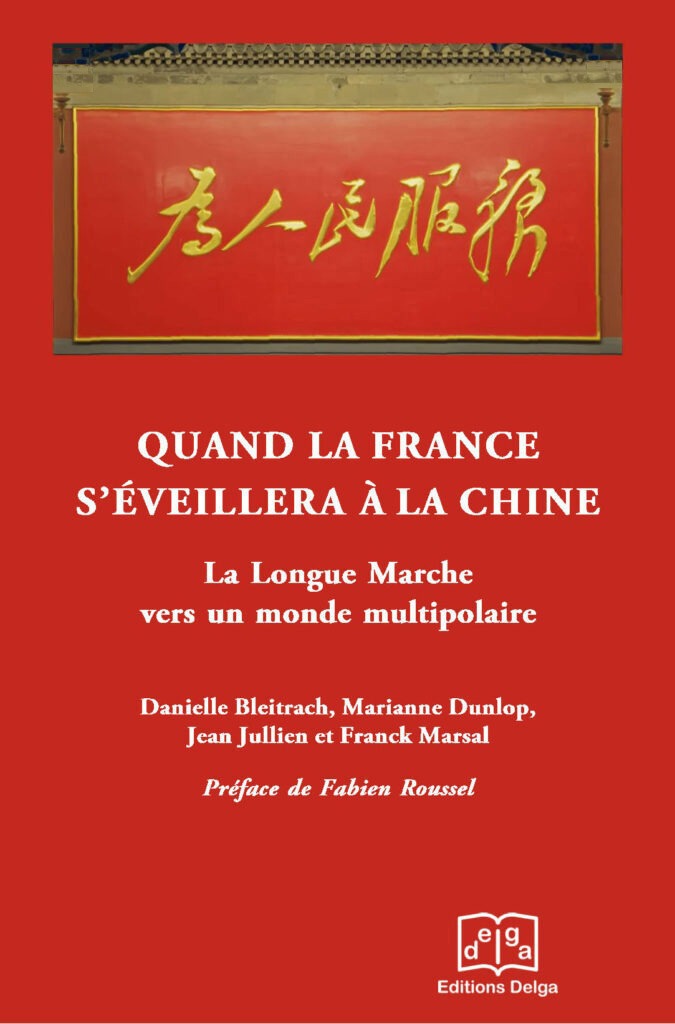
Comment le monde a adopté le manuel économique de Pékin
Michael B. G. Froman
25 mars 2025

MICHAEL B. G. FROMAN est président du Council on Foreign Relations. Il a été représentant américain au commerce de 2013 à 2017 et conseiller adjoint à la sécurité nationale pour les affaires économiques internationales de 2009 à 2013.
Au début de février, alors qu’il volait à bord d’Air Force One au-dessus du plan d’eau qu’il avait récemment rebaptisé le golfe d’Amérique, le président Donald Trump a déclaré qu’il imposerait des droits de douane sur tous les importations d’acier et d’aluminium. Deux semaines plus tard, il a publié un mémorandum présidentiel établissant de nouvelles directives pour le filtrage des investissements des entreprises chinoises aux États-Unis et des entreprises américaines en Chine. Et tout au long des premières semaines de son administration, Trump a souligné l’importance de ramener l’industrie manufacturière chez lui, en disant aux entreprises que, pour éviter les droits de douane, elles devraient fabriquer leurs produits aux États-Unis.
Droits de douane et protectionnisme, restrictions à l’investissement, mesures conçues pour stimuler la production nationale : la politique économique de Washington ressemble soudain beaucoup à la politique de Pékin au cours de la dernière décennie – comme une politique chinoise à l’américaine.
La stratégie d’engagement des États-Unis avec la Chine reposait sur le principe que, si les États-Unis intégraient la Chine dans le système mondial fondé sur des règles, la Chine deviendrait plus semblable aux États-Unis. Pendant des décennies, Washington a sermonné Pékin sur l’évitement du protectionnisme, l’élimination des obstacles à l’investissement étranger et la discipline de l’utilisation des subventions et de la politique industrielle, avec un succès modeste. Néanmoins, on s’attendait à ce que l’intégration facilite la convergence.
Il y a effectivement eu un certain degré de convergence, mais pas de la manière dont les décideurs politiques américains l’avaient prédit. Au lieu de voir la Chine ressembler aux États-Unis, les États-Unis se comportent davantage comme la Chine. Washington a peut-être forgé un ordre ouvert et libéral fondé sur des règles, mais la Chine a défini sa prochaine phase : le protectionnisme, les subventions, les restrictions sur les investissements étrangers et la politique industrielle. Soutenir que les États-Unis doivent réaffirmer leur leadership pour préserver le système fondé sur des règles qu’ils ont établi, c’est passer à côté de l’essentiel. Le capitalisme d’État nationaliste de la Chine domine désormais l’ordre économique international. Washington vit déjà dans le monde de Pékin.
Abonnez-vous à Foreign Affairs This Week
Les coups de cœur de nos rédacteurs, livrés gratuitement dans votre boîte de réception tous les vendredis.S’enregistrer
S’OUVRIR ?
Dans les années 1990 et au début de ce siècle, tout indiquait que la Chine était sur une marche inexorable vers la libéralisation économique. S’appuyant sur un processus qui a débuté à la fin des années 1970 sous le dirigeant chinois Deng Xiaoping, la Chine s’est ouverte aux investissements étrangers. Le président Jiang Zemin et le premier ministre Zhu Rongji ont ensuite maintenu la Chine sur la voie des réformes économiques remarquables, bien que douloureuses. Ils ont restructuré les entreprises d’État et licencié des dizaines de millions de leurs employés, créé plus d’espace pour l’activité du secteur privé, permis aux entreprises d’ajuster les prix en réponse aux conditions du marché et inauguré l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce.
Jiang et Zhu ont déclaré à plusieurs reprises que la Chine continuerait inévitablement à s’ouvrir. Beaucoup en Occident sont allés jusqu’à croire que cette libéralisation économique conduirait à la libéralisation politique de la Chine, qu’une société capitaliste deviendrait plus démocratique au fil du temps. Cette supposition s’est avérée fausse. Les dirigeants chinois n’ont jamais sérieusement envisagé de réforme politique, mais les progrès économiques de la Chine n’en étaient pas moins impressionnants. Le PIB du pays est passé de 347,77 milliards de dollars en 1989 à 1,66 billion de dollars en 2003 et à 17,79 milliards de dollars en 2023, selon la Banque mondiale. L’espoir était grand que l’intégration de la Chine dans le système commercial fondé sur des règles pourrait conduire à un monde plus pacifique et plus prospère. La mondialisation a sorti plus d’un milliard de personnes de la pauvreté, un exploit stupéfiant. Mais les avantages de ces progrès n’ont pas été partagés équitablement, et certains travailleurs et communautés dans les pays industrialisés ont fini par payer le prix de l’essor du reste.
Puis le président Hu Jintao est entré en scène, suivi par le président Xi Jinping. La trajectoire économique de la Chine s’est avérée moins linéaire et moins inévitable que prévu. Sous Hu, la Chine s’est davantage appuyée sur l’intervention de l’État dans l’économie en visant à créer des « champions nationaux » dans des secteurs stratégiques par le biais de subventions massives. En d’autres termes, le gouvernement a élargi son rôle plutôt que de poursuivre la libéralisation des marchés. Dans le même temps, un flot d’importations chinoises bon marché a accéléré la tendance à la désindustrialisation aux États-Unis, et ce à un rythme que peu de gens, voire aucun, n’avaient pleinement anticipé. La Chine est devenue l’usine de fabrication du monde, dépassant les géants manufacturiers du Japon et de l’Allemagne au cours de la première décennie de ce siècle. En 2004, la Chine représentait 9 % de la valeur ajoutée manufacturière mondiale, passant à 29 % en 2023, selon la Banque mondiale.
COMMENT LA CHINE A GAGNÉ
Washington a fait pression sur Pékin pour qu’elle mette en œuvre son programme de réformes tout au long de cette période, exhortant la Chine à ouvrir ses marchés et à s’abstenir d’imposer des droits de douane élevés et d’autres barrières sur les produits exportés des États-Unis. Il a plaidé pour que les entreprises américaines soient autorisées à investir en Chine sans être exclues de certains secteurs ou obligées de former des coentreprises avec des entreprises locales et de transférer la technologie américaine à celles-ci. Et Washington a exigé que le gouvernement chinois cesse de subventionner la production et l’exportation de biens, ce qui déformait le marché mondial. Mais cette litanie de plaintes a été largement ignorée.
En 2009, l’administration Obama a mené un effort pour mettre fin au cycle de Doha, une négociation commerciale multilatérale sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce lancée en 2001. Il l’a fait en grande partie parce que l’accord qui en aurait résulté aurait inscrit de façon permanente la Chine en tant que « pays en développement » selon les règles de l’OMC. Cela aurait permis à la Chine de bénéficier d’un « traitement spécial et différencié », ce qui signifie qu’elle aurait pu éviter d’assumer le même niveau d’obligations et de disciplines – sur l’accès aux marchés, la protection des droits de propriété intellectuelle et d’autres questions – que les États-Unis et d’autres pays industrialisés. Washington a fait l’objet de critiques quasi universelles à l’époque pour avoir encouragé une refonte des prémisses de la négociation. Mais il était déjà clair à l’époque que, si rien n’était fait, les pratiques économiques de la Chine perturberaient considérablement le système commercial mondial.
Les États-Unis vivent déjà dans le monde chinois.
Des préoccupations similaires ont motivé l’administration Obama à poursuivre le Partenariat transpacifique, un accord commercial de haut niveau négocié entre 12 pays du pourtour du Pacifique. Cette initiative a été conçue pour offrir aux pays de la région Asie-Pacifique une alternative attrayante au modèle proposé par la Chine. Il a rassemblé un groupe de pays divers qui étaient prêts à mettre en place de solides mesures de protection du travail et de l’environnement, à limiter l’utilisation des subventions, à imposer une discipline aux entreprises d’État et à répondre à diverses préoccupations spécifiques à la Chine, telles que la protection des droits de propriété intellectuelle. Cependant, au moment où les négociations du PTP ont été achevées en 2015, les accords commerciaux – même ceux conçus pour contrebalancer la Chine – étant devenus politiquement toxiques chez eux, les États-Unis ont fini par se retirer de l’accord.
De 2009 à 2017, j’ai d’abord occupé le poste de conseiller adjoint à la sécurité nationale pour les affaires économiques internationales, puis celui de représentant américain au commerce. Pendant ce temps, j’ai constamment averti mes homologues chinois que l’environnement international bénin qui avait permis le succès de la Chine disparaîtrait à moins que Pékin ne modifie ses politiques économiques prédatrices. Au lieu de cela, la Chine a largement maintenu sa ligne de conduite. Au contraire, elle a redoublé d’efforts dans son approche. Lorsque Xi est arrivé au pouvoir en 2012, il a effectivement mis fin à l’ère de « réforme et d’ouverture » qui s’était déjà arrêtée sous Hu, a mis la Chine sur la voie de la domination des technologies critiques, a augmenté la production jusqu’à la surcapacité et s’est engagé dans une croissance tirée par les exportations. Aujourd’hui, comme l’a noté l’économiste Brad Setser, le volume des exportations chinoises augmente à un rythme trois fois plus rapide que le commerce mondial. Dans le secteur automobile, il est en passe d’avoir la capacité de produire les deux tiers de la demande automobile mondiale. Et sa domination s’étend au-delà des voitures. La Chine produit également plus de la moitié de l’approvisionnement mondial en acier, en aluminium et en navires.
Finalement, même les entreprises américaines, qui avaient toujours été le lest dans les relations bilatérales, se sont détériorées face à la Chine lorsque leur propriété intellectuelle a été volée ou concédée sous licence forcée, que leur accès au marché chinois a été sévèrement restreint ou retardé, et que les subventions et les préférences de la Chine pour les entreprises nationales ont grugé leur opportunité. Sans aucun semblant de réciprocité, la relation s’est détériorée. Les politiciens des deux partis et le public américain ont durci leur position sur la Chine. L’Europe et les principales économies émergentes sont également devenues hostiles à la politique de Pékin. Bref, l’environnement international favorable a disparu.

Washington, n’ayant pas réussi à convaincre Pékin de changer ses politiques économiques prédatrices ou d’aller de l’avant avec un bloc commercial alternatif pour contrebalancer la Chine, s’est retrouvé avec une option : les États-Unis devaient ressembler davantage à la Chine. Après avoir réprimandé pendant des décennies la Chine pour avoir imposé des droits de douane élevés et d’autres restrictions aux exportations américaines, les États-Unis érigent maintenant les mêmes barrières. Selon les calculs de l’économiste Chad Bown, Trump a imposé des droits de douane qui ont fait passer le taux moyen sur les importations en provenance de Chine de 3 % à 19 % lors de sa première administration, couvrant les deux tiers de toutes les importations en provenance de Chine. Le président Joe Biden a maintenu ces droits de douane et a ajouté des droits de douane sur d’autres produits chinois, notamment les équipements de protection individuelle, les véhicules électriques, les batteries et l’acier, augmentant légèrement les droits de douane moyens sur les importations en provenance de Chine. Moins de deux mois après le début de sa deuxième administration, Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 20 % sur toutes les importations américaines en provenance de Chine – une mesure plus importante que les tarifs de sa première administration et de l’administration Biden réunis.
De même, les États-Unis ont changé d’approche, passant d’un obstacle opposé à la plupart des flux d’investissement bilatéraux à une restriction sévère des investissements chinois aux États-Unis et des investissements américains dans certains secteurs sensibles en Chine. Les investissements annuels chinois aux États-Unis ont chuté de 46 milliards de dollars en 2016 à moins de 5 milliards de dollars en 2022, selon le Rhodium Group. Et après avoir exhorté Pékin à abandonner les subventions et les politiques industrielles, Washington lui-même s’est lancé dans la politique industrielle sous l’administration Biden, dépensant au moins 1,6 billion de dollars pour la loi de 2021 sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, la loi de 2022 sur les puces et la science et la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation.
SI VOUS NE POUVEZ PAS LES BATTRE, REJOIGNEZ-LES
Pour aller plus loin dans l’approche chinoise, il faudrait adopter un outil clé dans la boîte à outils de Pékin : exiger des entreprises chinoises qui investissent à l’étranger qu’elles établissent des coentreprises avec des entreprises nationales et s’engagent dans des transferts de technologie. Une telle stratégie pourrait améliorer non seulement la compétitivité industrielle américaine, mais aussi celle d’autres pays touchés négativement par la surcapacité de la Chine, y compris de nombreux pays en Europe.
Prenons l’exemple évident du secteur de l’énergie propre. Les constructeurs chinois de véhicules électriques innovent plus rapidement et produisent des véhicules de haute qualité beaucoup moins cher que les entreprises américaines. Certains véhicules chinois sont jusqu’à 50 % moins chers que leurs équivalents américains, et la Chine représente près de 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques dans le monde. Les producteurs de batteries, les fabricants de panneaux solaires et les entreprises d’équipements d’énergie propre en Chine ont des avantages similaires.
Aux États-Unis, la part de marché de la Chine dans les véhicules électriques est presque inexistante. Les droits de douane actuels et d’autres restrictions sont susceptibles d’empêcher tout afflux futur d’importations. Dans le même temps, les constructeurs automobiles européens, en particulier ceux d’Allemagne, sont pressés par les politiques de préférence intérieure et la compétitivité des entreprises nationales sur le marché chinois, dont ils dépendent pour leur croissance. Et ces derniers temps, la Chine a également fait des percées sur le marché européen. La part de marché européenne des véhicules électriques chinois est passée de pratiquement O% en janvier 2019 à plus de 11% en juin 2024.
Suivant l’exemple des États-Unis, l’Europe a introduit des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine à la fin de l’année dernière. Cela a ralenti la croissance de la part de marché de la Chine. Mais le simple fait d’arrêter une hausse des importations ne résoudra peut-être pas les problèmes de l’industrie automobile européenne. Pour maintenir l’emploi et la capacité de fabrication, l’Europe semble ouverte aux investissements chinois dans la production de véhicules électriques en Europe (en revanche, il n’est pas clair si Trump accueillerait favorablement un tel investissement ou s’il continuerait à interdire les véhicules électriques chinois sur le marché américain en raison de leur potentiel à suivre les mouvements des citoyens ou à fermer la circulation). Si l’Europe veut éviter de devenir une simple destination pour l’assemblage final des véhicules électriques chinois, elle devra peut-être emprunter la tactique à Pékin et exiger des entreprises chinoises qu’elles créent des coentreprises avec des entreprises européennes et leur transfèrent de la technologie et du savoir-faire.
COMMENT SURPASSER LA CHINE
Il n’est pas encore clair si les États-Unis peuvent déjouer la Chine avec leur propre stratégie. Pékin semble avoir une capacité quasi illimitée à mobiliser des capitaux et à manipuler la politique de commerce et d’investissement au service de ses objectifs à long terme. La loi sur la réduction de l’inflation de Washington et la loi CHIPS and Science, quant à elles, étaient plus probablement des anomalies historiques que les premiers pas d’une tendance plus large vers une politique industrielle plus large, compte tenu du malaise des législateurs républicains face à leur adoption. En effet, alors même qu’il cherche à stimuler l’industrie américaine des semi-conducteurs, Trump a appelé à l’abrogation de la loi CHIPS and Science Act, qui prévoit des subventions pour la fabrication de semi-conducteurs. Les subventions fournies par la loi sur la réduction de l’inflation sont également susceptibles de faire face à des défis politiques.
La question de savoir si l’administration Biden a suffisamment profité de sa politique industrielle fait l’objet d’un débat animé au-delà de quelques secteurs clés. Les investissements américains dans le secteur manufacturier ont bondi et, sans doute, la capacité industrielle s’est accrue. Mais comme l’économiste Jason Furman l’a souligné dans Foreign Affairs plus tôt cette année, la proportion de personnes travaillant dans le secteur manufacturier est en baisse depuis des décennies et n’a pas remonté, et la production industrielle nationale globale reste stagnante – en partie parce que l’expansion budgétaire supervisée par Biden a entraîné une hausse des coûts, un dollar plus fort et des taux d’intérêt plus élevés. Tous ces facteurs ont créé des vents contraires pour les secteurs manufacturiers qui n’ont reçu aucune subvention spéciale de la législation qu’il a défendue. Quelle que soit l’étape de ce débat, une chose est claire : même dans les secteurs subventionnés par l’administration Biden, tels que les semi-conducteurs et l’énergie verte, le chemin vers le retour au leadership mondial est long et incertain.
Les États-Unis peuvent jouer le jeu protectionniste aussi bien que d’autres, mais bientôt, l’inflation, la hausse du coût de la vie et les pertes d’emplois dans les industries ou les secteurs touchés par les représailles d’autres pays commenceront à se faire sentir. Trump semble croire qu’un mur de droits de douane – ainsi que l’incertitude quant à savoir si les droits de douane sont activés ou désactivés à un moment donné – est une puissante incitation pour les entreprises à localiser leur production aux États-Unis, où elles peuvent être sûres que leurs produits ne seront pas soumis à des droits de douane. Mais en règle générale, les entreprises qui envisagent de faire les investissements nécessaires pour stimuler la production industrielle aux États-Unis recherchent des environnements politiques prévisibles, et non des tarifs imposés le matin et retirés l’après-midi. La plupart d’entre eux peuvent décider de rester à l’écart, de garder leur poudre sèche, jusqu’à ce qu’il devienne plus clair quels tarifs entrent en vigueur, contre qui et pour combien de temps.
Après avoir réprimandé Pékin pour ses restrictions, Washington érige les mêmes barrières.
Le bilan historique des tarifs douaniers qui ont entraîné une augmentation de la production et des emplois manufacturiers aux États-Unis est loin d’être définitif. Prenons, par exemple, les droits de douane imposés par Trump en 2018 sur les importations chinoises. Comme l’a constaté un article publié en 2024 par les chercheurs de la Réserve fédérale Aaron Flaaen et Justin Pierce, « les augmentations tarifaires promulguées depuis le début de 2018 sont associées à des réductions relatives de l’emploi manufacturier aux États-Unis et à des augmentations relatives des prix à la production. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur manufacturier, la hausse des coûts des intrants et les tarifs de rétorsion expliquent cette relation négative, et la contribution de ces canaux compense largement un léger effet positif de la protection contre les importations. Certaines recherches ont suggéré que 75 000 emplois manufacturiers en aval ont été perdus en conséquence directe des tarifs, sans parler des pertes supplémentaires dues aux tarifs de représailles. Les experts économiques Benn Steil et Elisabeth Harding ont également constaté que la productivité de l’industrie sidérurgique américaine a chuté alors que la productivité dans d’autres secteurs a augmenté depuis que Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d’acier en mars 2018. La production horaire de l’industrie sidérurgique américaine a chuté de 32 % depuis 2017.
Peut-être que l’approche de Trump visant à ramener la production aux États-Unis portera ses fruits, mais pour que cela se produise, le gouvernement américain devrait autoriser les entreprises étrangères à faire de tels investissements. Biden et Trump se sont tous deux opposés à l’acquisition d’U.S. Steel par la société japonaise Nippon Steel, et les décideurs politiques américains débattent toujours de la question de savoir si le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite peut acquérir une participation majoritaire dans le PGA Tour, qui organise des tournois de golf aux États-Unis, ce qui n’est guère une industrie critique.
Les États-Unis et d’autres imitent la Chine en grande partie parce que la Chine a réussi d’une manière inattendue. Son succès dans le domaine des véhicules électriques et des technologies propres n’est pas venu de la libéralisation des politiques économiques, mais des interventions de l’État sur le marché au nom d’objectifs nationalistes. Que les États-Unis puissent ou non rivaliser avec la Chine sur le terrain de jeu chinois, il est important de reconnaître une vérité fondamentale : les États-Unis fonctionnent maintenant en grande partie conformément aux normes de Pékin, avec un nouveau modèle économique caractérisé par le protectionnisme, les contraintes sur les investissements étrangers, les subventions et la politique industrielle – essentiellement un capitalisme d’État nationaliste. Dans la guerre pour savoir qui doit définir les règles de la route, la bataille est terminée, du moins pour l’instant. Et la Chine a gagné.
Views: 1