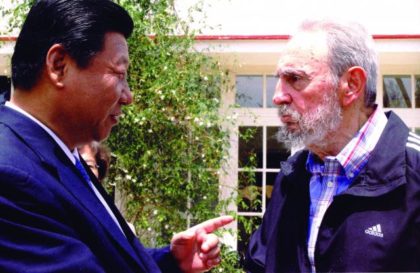Caviar, contre-culture et renaissance du culte de Staline… Un très bel article reportage sur la légendaire Volga qui nous a été proposé par notre collaboratrice londonienne Catherine Winch. C’est un article comme nous les aimons, une mise à distance de l’actualité mais en même temps l’apport de faits du quotidien qui montre comment la « taupe » de l’histoire creuse ses galeries dans le fracas du quotidien. Ici comment les Russes vivent au jour le jour sanctions et guerre en sortant des périmètres établis aux journalistes et correspondants de guerre supposés. Merci Catherine de cette plongée dans la mystérieuse Russie comme dans un film de Konchalovsky, type les Nuits blanches du facteur (note de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete).
Cet article a bénéficié du soutien du Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Pour les observateurs occidentaux, la Russie est redevenue une terre lointaine, mystérieuse et hostile. Il semble invraisemblable, à l’ère des médias sociaux, que l’on sache si peu de choses sur le pays qui a fait voler en éclats l’ordre international, mais les ombres qui entourent la Russie n’ont fait que croître depuis l’époque de l’Union soviétique. Bien sûr, c’est une chose d’observer le pays de l’extérieur, c’en est une autre d’essayer de comprendre comment les Russes vivent la guerre et réagissent aux sanctions de l’intérieur, et ce qu’ils espèrent de l’avenir. Si la Russie semble être devenue une autre planète, c’est en grande partie parce que son régime a également fait la guerre aux journalistes étrangers, les empêchant de sortir des périmètres établis.

Au cours de l’été, dans l’espoir de faire précisément cela, j’ai passé un mois à descendre la Volga. Dans un pays de grands fleuves, la Volga est le fleuve. Elle coule des collines de Valdai jusqu’au pays des Tchouvaches, des Tatars, des Cosaques, des Kalmouks, et se jette dans la mer Caspienne. C’est là que l’Europe et l’Asie se rencontrent ou se séparent, se rejoignent ou se bloquent, selon que la boussole de l’histoire russe pointe vers l’est ou vers l’ouest. C’est là que tout a commencé, après tout, que l’empire a pris racine : le long du fleuve, on trouve de nombreuses villes qui ont établi la culture et la foi russes, d’Oulianovsk, la ville natale de Lénine, à Stalingrad (aujourd’hui Volgograd), le site du tristement célèbre siège de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire pèse lourdement sur l’identité russe d’aujourd’hui, alors que le pays continue de regarder en arrière, passant au crible son passé glorieux pour y trouver de nouveaux mythes de grandeur. Il semble prêt à résister et à souffrir, des actes dans lesquels les Russes ont toujours excellé, et à se résigner à un avenir fait d’isolement, d’autocratie et peut-être même d’autodestruction.

Avant de commencer à descendre le fleuve, j’ai rencontré Mikhaïl Piotrovski, une vieille connaissance et le directeur du musée national de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, dans son bureau au rez-de-chaussée du musée, où il s’est taillé un espace parmi des piles de livres, des piles de papier et diverses sculptures. Les photographies qui encombrent la pièce, le montrant en compagnie d’éminents dirigeants occidentaux – Tony Blair souriant et la reine Élisabeth – sont désormais elles-mêmes des reliques, à l’instar de la tapisserie de la Grande Catherine suspendue au-dessus de son bureau.
Je l’ai interrogé sur le fleuve. « La Volga était tout, et est toujours tout », m’a-t-il dit. « Parce qu’elle vous fait aspirer à la grandeur. Elle a une sorte d’intimité, d’abri et de ciel lumineux, pas comme les grands espaces de la steppe ou les fleuves sibériens, qui vous donnent l’impression d’être un grain de sable dans le cosmos ».
Piotrovsky est un illustre spécialiste des études arabes. Je le connais depuis des années, mais nous parlions habituellement de Canaletto et de Byzance, des grands explorateurs islamiques et de ses vins siciliens bien-aimés. Cette fois, je l’ai trouvé en pleine ferveur guerrière. Et, j’en étais convaincu, ce n’était pas seulement pour défendre sa prestigieuse position : à son âge, soixante-dix-neuf ans, il pouvait facilement garder la tête baissée et continuer tranquillement, comme la plupart des Russes ont choisi de le faire. Il parlait avec son calme habituel mais semblait fiévreux, comme si quelque chose le dévorait de l’intérieur.
Piotrovsky, qui est doux et cérébral, et qui portait sa veste relâchée sur ses épaules voûtées, semblait être devenu un guerrier. « La Russie est un peuple multiple, mais une seule nation », affirme-t-il. « La Russie de la Volga a su intégrer tout le monde. L’islam est une religion de la tradition et de l’identité russes au même titre que l’orthodoxie chrétienne. En Europe, en Amérique, vous ne parlez que de multiculturalisme, mais vos villes regorgent de haine. Pour nous, il ne fallait pas grand-chose pour inclure tout le monde, parce que nous sommes une civilisation impériale ». Puis il s’est animé. « Regardez l’Ermitage ! », dit-il en ouvrant les bras vers la salle qui nous entoure et en écarquillant les yeux. « C’est l’encyclopédie de la culture mondiale, mais elle est écrite en russe parce que c’est notre interprétation de l’histoire du monde. C’est peut-être arrogant, mais c’est ce que nous sommes. »
Il prend une grande inspiration et commence à parler de Stalingrad, sa Jérusalem. « Je ne l’appelle pas Volgograd, mais Stalingrad », précise-t-il pour ma gouverne. « C’est plus que jamais notre référence, un symbole inégalé de résistance, le pire cauchemar de nos ennemis. Pendant la Grande Guerre patriotique, nous l’avons utilisée pour défendre la Volga en tant que corridor vital ». Il poursuit l’analogie : « Et il en a été de même ces derniers mois. La Volga et la Caspienne alimentent notre commerce avec l’Iran pour nous opposer aux sanctions, tandis que nous les utilisons pour exporter du pétrole vers l’Inde et importer ce dont nous avons besoin. » Il retire ses lunettes et les nettoie avec sa veste. « Stalingrad est un porte-bonheur, c’est le destin. Si les nazis l’avaient prise, ils auraient coupé la Volga et conquis toute la Russie. Une chose très matérielle qui est devenue spirituelle. Un avertissement. Celui qui s’y essaiera connaîtra la fin de tous les autres : les Suédois, Napoléon, les Allemands et leurs alliés ». Il poursuit . « Les Russes sont comme les Scythes : ils attendent, ils souffrent, ils meurent, puis ils tuent ».
Je repensais souvent à cette rencontre au cours de mon voyage ; après la rivière, je me souvenais de l’étrange regard de Piotrovsky et je ressentais l’écho de ses paroles. En fait, lorsque j’ai visité un élevage d’esturgeons à Astrakhan, dans le delta de la Volga, j’ai constaté que son point de vue était, à certains égards, exact. Olesia Sergeeva, biologiste à la tête de la société propriétaire de l’élevage, a rappelé l’importance des échanges commerciaux entre l’Iran et la Russie. À sa manière – et ce n’est qu’une façon de parler : Sergeeva fournit le Kremlin en caviar – elle a contourné les sanctions en achetant des aliments pour animaux en Iran plutôt qu’en Europe, comme elle l’avait fait auparavant. Elle en parle comme s’il s’agissait d’un fait de notoriété publique. « Tout passe par ici », dit-elle. « Ils construisent de nouveaux quais sur le delta pour les porte-conteneurs et les pétroliers.
Mme Sergeeva m’a emmenée voir les quartiers juifs, arméniens et iraniens d’Astrakhan. Une exposition de photographies mettant en valeur les volontaires civils soutenant l’armée était installée à l’extérieur d’un parc. Au coucher du soleil, l’élégant bord de la rivière était envahi de familles et de groupes de jeunes gens qui parlaient et riaient à voix basse. Des couples assis sur des balustrades mangeaient de la pastèque tandis que des stands de nourriture projetaient des lumières multicolores sur la Volga. L’atmosphère avait quelque chose de fin de siècle : des volutes de fumée s’échappaient des grilles des shashlik, une brise tiède faisait entendre la plainte d’un violon lointain. Pas d’uniformes militaires en vue.
Les façades des cafés et les balcons en fer forgé me rappellent la Nouvelle-Orléans. Sergeeva me fait remarquer les rénovations le long du canal qui traverse la vieille ville, indiquant les villas en bois du XIXe siècle qui deviendront bientôt des hôtels et des maisons de luxe. « Elles semblaient destinées à s’écrouler », dit-elle. « Mais maintenant que l’argent circule, Astrakhan est à nouveau la porte d’entrée de la Russie européenne, de l’Asie centrale et de l’Inde. C’est ainsi pour l’instant. Plus tard, nous verrons.

Sur le delta, qui s’étend sur une soixantaine de kilomètres avant d’atteindre la mer Caspienne, des paires d’avions de chasse passent à basse altitude. J’ai essayé d’apercevoir la douane du port commercial, mais je ne pouvais pas voir au-delà des postes de contrôle, et le port touristique était fermé. Même le ferry n’était plus en service. Mais on pouvait encore voir des grues charger et décharger une douzaine de cargos, et trois barges qui attendaient au point le plus large. Le canal Volga-Don, d’une longueur de 60 km, a été construit sous Staline avec le travail de soixante-quinze mille prisonniers et a été inauguré en 1952. Il fait partie de la voie navigable qui relie la Volga à Rostov sur le Don, d’où l’on peut rejoindre Marioupol, aujourd’hui contrôlée par les Russes. Au sud de Volgograd, j’ai tenté d’emprunter un chemin de terre menant à l’embouchure du canal, mais j’ai été intimidé par la présence d’un hélicoptère planant à quelque 300 pieds au-dessus de moi. J’ai préféré cueillir des fraises sauvages.
À Astrakhan, le bruit courait que les Iraniens avaient investi des milliards dans le développement du corridor Caspienne-Volga-Don. Il était question de trafic de produits agricoles et de pétrole, mais aussi de turbines, de pièces mécaniques de rechange, de médicaments et de composants nucléaires. Je n’ai pas pu le vérifier, mais il est clair qu’Astrakhan est au cœur des efforts du bloc économique anti-occidental pour se tourner vers l’Est.
Le caviar de Mme Sergeeva est raffiné et produit sans cruauté. Elle explique que c’est le résultat d’un processus qu’elle a inventé : elle extrait les œufs de l’esturgeon à l’aide d’une petite incision, sans le tuer. Cette procédure peut être réalisée trois fois sur le même poisson. Elle s’est efforcée de faire en sorte que la production et la vente de son caviar restent identiques à ce qu’elles étaient avant la guerre. « En Russie, il n’y a pas de vraie fête s’il n’y a pas de caviar », dit-elle – et même, apparemment, dans la situation actuelle. Elle m’a expliqué que depuis que la Russie a interdit la pêche à l’esturgeon sauvage dans la mer Caspienne, les fermes de cette région de la Volga ont proliféré, leur nombre passant de trois à soixante au cours des cinq dernières années.
Mme Sergeeva a beaucoup voyagé et est largement connue pour son expertise en matière d’aquaculture. Elle pourrait trouver un emploi n’importe où, me semble-t-il, alors pourquoi rester ? « Je suis née ici, j’ai étudié ici, mon mari est russe, mon fils est russe, je suis russe », dit-elle. « Je ne dirais pas que je suis une patriote, et je ne veux pas exprimer ce que je pense de Poutine et de la guerre. Mais je peux vous assurer que ma vie n’a pas changé. Pas le moins du monde. » Elle rougit en parlant, comme si le sujet la mettait mal à l’aise. « Les Russes réagissent aux sanctions de manière extraordinaire, malgré la faiblesse du rouble et l’inévitable inflation. Les prix des produits de première nécessité sont restés stables. Et maintenant, nous consommons des produits meilleurs et plus sains qu’avant la guerre, même des fromages exceptionnels. »
Je n’aurais jamais imaginé que l’essor de l’alimentation hyperlocale serait l’un des thèmes récurrents de ce voyage. Mais il semble que les sanctions occidentales et l’économie de guerre aient intensifié un mouvement traditionnel de la gastronomie russe. Les produits occidentaux ont conquis le palais des Russes urbains moyens et les producteurs locaux tentent de combler leur vide, en proposant fièrement du camembert et du prosciutto fabriqués en Russie, comme pour fournir une preuve matérielle du Russki Mir [monde russe, NdT], l’idéologie de Poutine sur la suprématie de la Russie. Lorsque j’ai dîné le long de la Volga, les menus indiquaient souvent les fermes d’où provenaient les ingrédients. Les restaurants servaient des svekolnik et des okroshka, de simples soupes froides d’été, en exaltant la qualité des radis locaux cultivés sans engrais occidentaux.
La pêche a largement cessé à Rybinsk, ville autrefois connue comme la pêcherie du tsar. La région s’est réinventée pour devenir une sorte de four de Moscou. Chaque jour, des camions remplis de pains chauds partent pour la capitale. Les boulangeries abondent : la culture du blé et du seigle dans la région a augmenté de 40 %.
Parmi les premiers à avoir allumé un four, Andrei Kovalev, 54 ans, qui ne connaissait rien à la cuisson du pain il y a encore trois ans. « J’ai appris à utiliser la zakvaska, une levure de pain », m’a-t-il dit dans sa grande boulangerie située sur la place Rouge de Rybinsk, où une statue de Lénine a remplacé celle d’Alexandre II et trône depuis lors. Kovalev était populaire parmi les habitants : il distribuait des échantillons aux passants, portant une barbe et une tunique grossière faite de lin et de toile de jute. Il considérait l’ouverture d’une boulangerie comme un acte politique, un acte de sauvetage des valeurs rurales russes « contre le consumérisme copié sur l’Amérique », comme il le dit lui-même. « Au cours des trente dernières années, les gens ont détesté le pain russe », a-t-il déclaré, « ils pensaient qu’il était indigne d’eux. Ils voulaient des baguettes, ces petits morveux ! Les miennes sont de vieilles recettes, qui datent de bien avant la perestroïka, de l’époque où nous étions heureux ».
Sans une énorme affiche surplombant un carrefour isolé dans la steppe, représentant Sergei Kazankov aux côtés de Lénine et de Staline, j’aurais pu passer à côté d’une autre chose tout à fait surréaliste : le revivalisme de l’Union soviétique. En utilisant un VPN pour protéger mes recherches en ligne, j’ai appris que M. Kazankov avait été réélu à la Douma d’État en 2021 en tant que communiste, qu’il avait été sanctionné pour avoir soutenu l’invasion de l’Ukraine et que son père, Ivan Kazankov, était depuis longtemps un courtier en pouvoir communiste. Sergei lui-même a été directeur d’une usine de transformation de la viande et d’un combinat agricole dans le district de Zvenigovsky, propriété de son père.
À ce stade, je voyageais à travers la République de Mari El, à environ 90 miles de Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Plus précisément, je me trouvais dans le district de Zvenigovsky, qui a donné son nom à l’entreprise de Kazankov, Zvenigovsky LLC, connue en ville comme le dernier sovkhoz, ou grande ferme collective. Il m’a suffi de faire un petit détour, de traverser un champ de tournesols et de demander mon chemin à une station-service (« quand vous verrez le monument à Marx, vous y serez presque ») pour arriver à son bâtiment, qui, à première vue, ressemble à un mémorial aux anciens Soviétiques. Le drapeau rouge de l’URSS flotte au-dessus du complexe blanc et jaune. Selon l’entreprise, il est de la même taille que celui qui a été descendu du Kremlin le 25 décembre 1991, lors de la chute du communisme. Les murs de l’usine étaient couverts d’inscriptions rouges marquées par les points d’exclamation que les bolcheviks aimaient tant utiliser : « Honneur et gloire aux ouvriers du combinat de Zvenigovsky » ; « Camarades, luttons pour notre sovkhoze, luttons pour la Russie » ; « Maintenant et pour toujours, guerre au fascisme ».

La route menant à l’entrée était bordée de photographies modernes dans le style Stakhanoviste, présentant, par exemple, un ouvrier comme le meilleur remplisseur de saucisses, un autre comme le meilleur conducteur de tracteur, et un dernier, arborant une moustache et un T-shirt Nike, comme le mécanicien de l’année. Des camions et des camionnettes marqués d’un marteau et d’une faucille sortent des portes. Une statue de Staline présidait le tout, son pantalon rentré dans ses bottes depuis sa place sur un piédestal à quatre niveaux. Sur le côté, un Lénine métallique regardait, les sourcils froncés ; son estrade n’avait que deux niveaux et était partiellement recouverte par les branches d’un bouleau.
L’entrée du bâtiment de la direction, une structure moderniste solide, est dominée par des lettres en bronze indiquant CCCP. Les agents de sécurité à la réception sont en treillis. Je me suis vite rendu compte qu’il s’agissait de l’un des producteurs agricoles les plus prospères de Russie, qui livre chaque année des dizaines de milliers de tonnes de viande et de produits laitiers sur le marché. L’entreprise, créée en 1995, bien après la fin de l’URSS, se définit comme une entreprise communiste-stalinienne.
Ivan Kazankov a quatre-vingt-un ans et un regard gris, comme celui d’un loup. Il est grand et robuste, une large cravate rouge reposant sur son ventre. Il s’est intéressé à ma visite inattendue sans trop de réserve : on sent que c’est un vrai patron, qui n’a de comptes à rendre à personne, le grand manitou de ce Stalingrad agraire, de cet empire rural sur la Volga, paradoxalement inspiré par le plus grand exterminateur de paysans de l’histoire. Son bureau semble avoir été conçu dans le but exprès de désorienter quiconque espère comprendre la Russie de 2023 : des bustes de Staline côtoient des icônes orthodoxes russes, un portrait de Nicolas II surplombe une statuette de Soyouz, une photo de Vladimir Poutine est accrochée à côté d’une image de Saint-André, le saint patron de la Russie. Au chaos de ce panthéon s’ajoutait un sentiment général d’opacité quant à la nature du combinat lui-même, qui m’avait d’abord été présenté comme une « coopérative agricole gérée par l’État, exactement comme à l’époque de l’URSS », mais qui s’était avéré être une exploitation familiale privée. Ivan avait nommé sa fille directrice après le départ de son fils à la Douma. « Ce qui compte, c’est que l’entreprise fonctionne comme avant », explique-t-il. « Les bénéfices sont utilisés pour augmenter les salaires des quatre mille employés et développer l’entreprise ».

À Kazan, ils me diront plus tard qu’au milieu des pillages et de la corruption des années 90, lorsque des racketteurs endurcis ont dérobé des équipements industriels et militaires soviétiques, Kazankov a pris sa part du gâteau. Il avait mis la main sur une ferme délabrée et l’avait habilement transformée en un colosse industriel qui avait adapté le système socialiste de production de moissonneuses-batteuses au marché post-soviétique sauvage. L’oligarque de la saucisse Kazankov sait à quel point les consommateurs russes souffrent encore de la perte du collectivisme d’État.
Depuis, la valeur nette de l’entreprise est devenue légendaire. Mais Kazankov est lui aussi un fervent partisan des sanctions occidentales : « Elles sont un outil de développement incroyable pour la Russie », m’a-t-il dit. « L’Occident aurait dû les imposer dans les années quatre-vingt-dix. Nous serions aujourd’hui la locomotive du monde. C’est dommage. Pour lui, les sanctions sont de l’adrénaline pure, et pour le prouver, il ajoute que son entreprise a copié à la lettre les « moyens de production » italiens, allemands et israéliens : « Nous avons doublé la transformation en un an et nous fournissons près d’un millier de supermarchés dans toute la Russie ». Ivan est convaincu que son « entreprise communiste complète » est le modèle idéal pour « reconstruire une nouvelle Union soviétique avec des aliments locaux et sains provenant de nos terres ».
Il m’a proposé de me montrer leur nouvelle étable, située à une quinzaine de kilomètres de là, où il a reproduit des usines laitières israéliennes. Le troupeau y paît dans de vastes clairières bien délimitées. Son chauffeur nous a transportés dans une Mercedes blindée flambant neuve qui, je le suppose, a été importée du Kirghizistan, itinéraire privilégié de la contrebande allemande. Pour l’excursion, Kazankov a revêtu une casquette de base-ball qui semblait destinée à le faire paraître plus jeune, avec un CCCP cousu en rouge sur le devant et un marteau et une faucille sur le côté. Il a déclaré qu’il envisageait de marquer les vaches de la même manière. « Nous cultivons du fourrage et des céréales sur des milliers d’hectares », explique-t-il en observant sa propriété par la fenêtre teintée. « Nous élevons des vaches laitières et des porcs et nous nous occupons d’eux jusqu’à l’emballage du produit fini, c’est-à-dire des viandes, des fromages, du kéfir. Et même des glaces, bonnes comme celles de mon enfance. Gorbatchev et Eltsine ont ruiné les glaces, ces lâches ».
Les combats en Ukraine, semble-t-il, vont permettre à Kazankov de gagner une montagne de roubles. « La production de fromage a augmenté de 80 %. « Nous remplaçons les fromages français et italiens. Nous continuons à acheter des vaches. Il m’a dit que la production de viande était généralement florissante. Que pense-t-il de la guerre ? « Il est évident que nous allons gagner, parce que nous savons nous battre et parce que nous ne pouvons pas perdre. S’il le faut, nous utiliserons des armes atomiques, nous détruirons la terre, nous détruirons tout ».
À Kazan, j’ai été invité à déjeuner par Farid Khairutdinov, un homme d’affaires de quarante-huit ans qui m’avait été présenté comme un « Tatar très influent de la ville ». Par le biais d’une messagerie cryptée, il m’avait promis une conversation intéressante. Lorsque je suis arrivé à Tatarskaya Usadba, un restaurant local réputé, il m’attendait dans un salon privé avec Mansur Hazrat Jalaletdinov, un mollah de la mosquée Marjani, la seule en activité à Kazan jusqu’en 1990, après quoi une centaine d’autres ont vu le jour. Khairutdinov m’a dit qu’ils avaient récemment accueilli à cette même table Dmitry Medvedev, l’ancien premier ministre et président russe, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité. Il m’a ensuite expliqué qu’il me considérait comme un « ennemi » et m’a dit que personne ne voulait me rencontrer ou répondre à mes questions. Il a ajouté que je ferais mieux de visiter un musée. Il m’a rappelé qu’il avait servi dans le FSB, et le mollah a acquiescé, visiblement satisfait.
Cela dit, dans une démonstration de l’hospitalité des Tatars russes, ils m’ont offert un déjeuner inoubliable : douze plats et trois heures de conversation aussi absurde qu’instructive. Ils ont affirmé que, dans la langue tatare, « il n’y a pas de mot pour retraite », que les Tatars avaient été les meilleurs archers sous Pierre le Grand et que Mikhaïl Koutouzov, le général qui a vaincu Napoléon, était un Tatar. J’ai rappelé que c’est Koutouzov qui avait mis fin à la résistance tatare en Crimée à la fin du XVIIIe siècle. « En fait, il a perdu un œil », a déclaré Khairutdinov, et le mollah a hoché la tête. « Nous aimons faire la guerre. N’ai-je pas raison, Mansur ? »
« C’est vrai », dit-il. « Nous nous battons aussi contre nos démons. » J’espérais poursuivre le sujet, mais Khairutdinov a changé de sujet : « Les sanctions nous ont encore plus unis en tant que peuple ».
Lorsque les brochettes d’agneau sont arrivées, M. Khairutdinov a déclaré qu’avant la guerre, j’aurais mangé de l' »agneau de merde de Nouvelle-Zélande », mais que cette viande, tendre et savoureuse, était russe. De plus, jusqu’à hier, l’agneau avait brouté à quelques kilomètres de là. Il l’avait élevé lui-même, affirmait-il. Son activité consistait à produire de la viande d’agneau et d’oie biologique. Il avait ouvert des magasins dans tout le Tatarstan. « Il n’y a pas de concurrence, c’est incroyable », a-t-il déclaré. « Imaginez, nous avions pris l’habitude d’importer des oies de Roumanie et de France. Aujourd’hui, j’exporte des cuisses d’oie et de la viande séchée en Turquie ».
J’ai demandé pourquoi ils n’avaient pas élevé d’agneaux et d’oies avant la guerre, ou pourquoi la Russie, avec tous ses entrepreneurs intelligents et industrieux, produisait si peu et importait presque tout sans générer de revenus significatifs en dehors de l’industrie du pétrole et du gaz. Le mollah m’a regardé dans les yeux et m’a dit que c’était précisément le génie russe : « Acheter sans produire », a-t-il dit. « Pourquoi devrais-je fabriquer une bicyclette si je peux simplement en acheter une ? Je dépense moins d’argent. C’est facile ».
Il y a plus de trente ans, j’ai écrit sur les premières manifestations du conflit à partir des plages de la Yougoslavie, qui était alors en train de s’effondrer. Je me souviens d’un orchestre de musiciens âgés jouant le fox-trot juste pour moi, seul client d’un grand hôtel de l’île de Rab. À l’époque, des mortiers tombaient et des gens mouraient à quelques kilomètres de la côte dalmate. Ici, le long de la Volga, la guerre et la mort étaient comme des présences spectrales. Les gens dansaient sur de la techno et buvaient des cocktails aux noms improbables : Hiroshima, Guerre russo-japonaise et Allemand ivre. En presque un mois de voyage, je n’ai vu que quatre bombardiers, passant au-dessus de Tver, près de la source de la Volga ; je n’ai senti qu’une seule fois le grondement des avions de chasse, dans le cours inférieur du fleuve ; j’ai croisé quelques soldats non armés en permission ; et j’ai vu une colonne de vingt camions avec des chars recouverts de bâches qui partaient probablement pour le front, à des centaines de kilomètres de là. Pour le reste, c’est la Russie comme d’habitude. Mais une Russie exceptionnellement dynamique, à n’en pas douter. J’ai vu des chantiers et des grues s’activer dans les banlieues, des bâtiments et des églises en cours de restauration, des réparations importantes effectuées sur les routes fédérales (même si les fameux nids-de-poule étaient toujours là), des ouvriers installant de nouvelles canalisations, des équipes de jardiniers dans les parcs, des éboueurs diligents vidant les poubelles. Les voitures envahissent les rues chaque week-end, lorsque les Russes se rendent dans leurs maisons de campagne.
Est-ce du fatalisme ? De l’indifférence ? Ou de l’arrogance, comme Piotrovsky l’avait laissé entendre à l’Ermitage ? J’ai lutté pour trouver une place dans les hôtels ou sur les ferries, qui débordaient tous de touristes contraints de renoncer à la Méditerranée et de se contenter de la Volga. Prenons l’exemple de Tatiana, directrice d’une chaîne de supermarchés et dame d’un certain âge. Lorsque je l’ai rencontrée sur un ferry à Yaroslavl, elle portait un panama, des lunettes de soleil Gucci et des sandales capri ; elle se dirigeait vers l’aval, vers la datcha où elle passait ses étés lorsqu’elle était jeune fille. « J’ai un bateau amarré à Mykonos depuis trois ans et je ne sais pas quand je le reverrai », m’a-t-elle dit. « Je recommence à connaître ma rivière. Je retrouve des amis que je n’ai pas vus depuis trente ans. Des vacances intéressantes ». Je lui ai dit qu’elle avait l’air un peu triste et résignée. « Les Russes sont tristes et résignés depuis des milliers d’années », a-t-elle répondu. « C’est ainsi que nous restons résistants. Je suis contre cette guerre, mais je ne peux rien faire d’autre qu’attendre, comme tout le monde. Ils nous manipulent avec des idées artificielles. De l’ordure. Mais l’Occident nous humilie depuis trop longtemps. N’avons-nous pas aussi le droit d’être ce que nous voulons être sans nous sentir barbares ? »

Penser que les idées anti-occidentales qui coulent dans les veines du pays ne sont que le fruit de l’endoctrinement du régime serait surestimer Poutine et ignorer ce qui a animé la Russie tout au long de son histoire, au moins depuis l’époque de Pierre le Grand : une fascination pour l’Occident, associée à une défense fière et un peu trop autoritaire de son vaste territoire et à une résistance à l’assimilation. Les Russes ont toujours oscillé entre le désir d’intégration et la crainte de la contamination ou de la corruption, entre le complexe d’infériorité et la folie des grandeurs. C’est un conflit qui pourrait être compris en termes de conflit intellectuel entre le pro-occidental Tourgueniev et le slavophile Dostoïevski. Malheureusement, nous ne sommes plus à cette altitude. On peut dire qu’il y a encore moins de débats aujourd’hui qu’à l’époque de l’URSS, et il est clair que les Russes sont maintenant plus pleinement dans une phase Dostoïevski : leur désir de s’enfermer dans un monde petit mais sans limites réapparaît, même parmi ceux qui rejettent le récit revanchard de Poutine et de l’Église orthodoxe.
J’ai rencontré une femme nommée Anna, par exemple, qui se décrivait comme « anti-establishment, pacifiste, écologiste païenne » et déclarait que « nous devons être des zombies pour tuer nos propres frères ». Pourtant, elle défend les « valeurs familiales » et « l’amour des ancêtres ». Sa priorité, dit-elle, est de « préserver la tradition russe ». Elle rejette « la culture occidentale moderne où tout est permis et où tout est facile et amusant. Car il s’agit manifestement d’une imposture ». Elle est allée jusqu’à dire que ce sont des gens comme elle « qui gardent la vieille Russie dans leur cœur, qui sont ceux qui sauvegardent les racines de l’Europe ». Ses cheveux sont longs et blonds comme le blé, ses yeux verts émeraude, elle porte des colliers traditionnels et une longue robe de jade. Elle a trente-quatre ans et vit dans la « Jamaïque de la Volga », au pied des Zhiguli – les seules montagnes de la plaine russe avant l’Oural – qui plongent dans le fleuve et créent d’incroyables effets botaniques, dont la croissance de la marijuana sauvage. Des volontaires viennent de toute la Russie pour la récolter. « Des fêtes mémorables », m’a assuré Anna, « mais maintenant que le gouvernement a pratiquement interdit les rassemblements non officiels, c’est comme si on était en prison ». Elle m’a dit qu’elle était une guérisseuse chamanique, même si son titre officiel est infirmière. « Si je n’avais pas eu quatre enfants, j’aurais certainement été envoyée dans le Donbass », dit-elle. Son compagnon compose et joue du Volga dub, une sorte de reggae russe – la bande-son des pirates pacifistes du fleuve.
Pour rejoindre leur île secrète, je suis parti après le coucher du soleil sur un radeau délabré fait de palettes et de planches de surf. J’ai été accueilli par des habitants du nom de Shukhrat et Albert : ils avaient baptisé l’île « Shubert ». Leur amitié a été changée et approfondie par la guerre – Shukhrat a perdu un fils, Albert a envoyé le sien en Suède. Ils avaient décidé d’abandonner la réalité, s’appropriant une bande de sable qui émergeait magiquement de la Volga au printemps. Ils campent avec leurs familles et sont peu à peu rejoints par d’autres fugitifs. C’est ainsi qu’est née une communauté indépendante avec ses propres règles, dont la principale est d’éviter les informations. Ils organisent des réunions, des cours de yoga, des séances de méditation. Ils chantent des chansons reggae anti-guerre, en utilisant uniquement des instruments traditionnels comme les balalaïkas, les domras et les bayans. Tous les vendredis soirs, des amis et des musiciens arrivent de Kazan, Samara et Togliatti et organisent un festival de musique. « Nous ne nous éloignons pas du monde », explique Albert, ancien ingénieur en systèmes de sécurité, « mais nous créons notre propre monde. C’est notre pays maintenant, fondé sur des valeurs russes authentiques. Tout est effrayant à l’extérieur ».
L’éloignement de l’île de Shubert n’a pas apaisé toutes ses inquiétudes. Il avait noué une relation particulière avec deux YouTubers ukrainiens qui parlaient russe et prévoyait d’aller leur rendre visite à vélo dans le Donbass au cours de ce funeste mois de février 2022. « Ils m’ont laissé des messages vocaux me demandant si j’étais désormais leur ennemi et pourquoi nous les bombardions et les tuions », m’a-t-il raconté. « Je ne sais toujours pas comment nous nous sommes retrouvés de l’autre côté – c’est terrible. Je ne peux que pleurer, mais ma mère avait l’habitude de dire que les garçons ne pleurent pas ». Ce sont les seules larmes que j’ai vues au cours de mon voyage.

Un vendredi soir, à Nijni Novgorod, ville natale de Maxime Gorki, je me suis retrouvé sur l’artère principale qui longe le Kremlin, où j’ai failli être piétiné par une horde de jeunes ivres. Les bars débordent de gens qui dansent sur les trottoirs, un verre à la main. La façade d’un immeuble de six étages était recouverte de la lettre Z, symbole de soutien à la guerre. Je me promenais avec Artiom Fomenkov, historien et professeur de sciences politiques. Je lui ai demandé ce qu’il pensait de la scène, du contraste troublant entre les fêtards et leurs pairs envoyés au front. « Ceux qui se battent ne viennent pas des grandes villes, mais des petites villes », explique-t-il. « Les endroits les plus défavorisés », c’est-à-dire ceux où l’on s’engage uniquement pour l’argent. « Il est peu probable que le gros de la population urbaine se sente directement concerné par la guerre. » Il réfléchit un instant avant d’ajouter : « C’est pour cela qu’ils continuent à vivre comme ça. Ils ne sont pas impliqués et font donc la même chose qu’il y a deux ans, cent ans, deux cents ans, en se complaisant dans leur désespoir. » C’est ce que j’appelle le « syndrome russe », un mélange de nostalgie, de mélancolie et d’affliction. « Poutine n’est que le dernier en date à exploiter cette attitude passive. N’oubliez pas que les Russes sont des acteurs de leur destin, et non des victimes ».
Mais à cinq cents mètres à peine du chaos, nous sommes tombés sur une scène qui donne à réfléchir. Osharskaya Ulitsa est toujours connue comme la rue des maisons closes, en raison de sa réputation à l’époque de Gorki. Un bâtiment qui servait autrefois de bordel est censé abriter aujourd’hui des bureaux militaires. Quiconque y est traîné la nuit a de fortes chances d’être envoyé dans un camp d’entraînement le lendemain matin, puis au front. M. Fomenkov a semblé revenir sur ses propos antérieurs. « Les enfants que vous avez vus sont en fait terrifiés, ils boivent beaucoup plus qu’avant », a-t-il déclaré. « Ils savent qu’il ne faut pas les trouver dans certains endroits, seuls, ivres et sans un alibi solide, ou au moins un nom de famille important. »
Le lendemain, je me suis retrouvé dans une rue sans nom, dans le salon d’une maison bleue assiégée par des poules squelettiques et des carcasses de vieilles voitures transformées en poulaillers. C’était la maison de Pavel, qui est mort dans le Donbass à l’automne 2022, quarante jours seulement après s’être engagé. Sa fille de dix-huit ans, Zarina, était enceinte et me regardait avec des yeux étonnés, verts et jaunes comme l’herbe de la steppe en été. Elle était assise sur un canapé bordeaux à côté de sa mère, Valentina, qui avait l’air épuisée. Elles m’ont raconté que Pavel était chauffeur de taxi et qu’il s’était endetté. Un soir, il est rentré à la maison, ivre, et a dit qu’il s’était engagé. Il a montré le contrat à Valentina, pour un peu plus de deux cent mille roubles par mois. Conduire un taxi lui rapportait cinquante mille roubles au maximum, et certains mois presque rien.
Le plafond est bas et a été peint pour ressembler au ciel. Sur les murs sont accrochées des photos des enfants, dont l’une les montre en train de nager dans la Volga avec leur père. Et puis il y avait Pavel, rayonnant avec son nouveau désherbeur. « C’était un homme bon, respecté », dit Valentina. « Je ne pouvais pas l’arrêter. Il l’a fait pour ses trois enfants, pour payer l’hypothèque ». Dix jours de formation et il est parti. Apparemment, il avait marché sur une mine. « Ils l’ont envoyé en avant pour vérifier le terrain. Mais on ne le saura jamais vraiment », dit Zarina en se mordant la lèvre. Deux officiers de l’armée sont arrivés sur le pas de leur porte pour leur remettre la lettre d’invitation de Poutine et une médaille. Valentina m’a assuré que les gens étaient là pour elle – même des voisins à qui elle n’avait pas parlé depuis des années étaient venus lui apporter du pain et de la vodka. Elle et Pavel s’étaient aimés, m’a-t-elle dit, mais ils ne s’étaient jamais mariés. Valentina poursuivait maintenant sa mère en justice pour obtenir les millions de roubles prévus par l’État pour indemniser les familles des soldats tombés au combat. « À quoi pensait-il ? », dit-elle. « Pavel avait ses propres idées. Il disait qu’il était temps de s’en prendre à tous ceux qui avaient quitté l’URSS ». Mais il est parti pour gagner de l’argent, alors finalement, ce n’était qu’un mercenaire, n’est-ce pas ?
Dans un coin, près de la chaîne stéréo et des CD, des lumières éclairent une petite châsse flanquée du drapeau russe : L’accordéon de Pavel, son chapeau de paille, de faux tournesols, des images de la Madone, qu’il vénérait, et les ours en peluche qu’il avait achetés à Zarina. Et puis, souriant au-dessus de tout cela comme un oncle bienveillant, Staline. « Son Staline bien-aimé », a dit Valentina.

Pour autant que je sache, Staline est devenu le symbole de l’été, une figure totémique à l’instar de Che Guevara. Lénine est peut-être l’une des statues les plus répandues au monde, avec sept mille exemplaires rien qu’en Russie, mais ce n’est plus le bras de Lénine qui indique l’avenir. Staline connaît un second avènement, son nom revenant comme un mantra. Il a même sa propre marque de saucisses. Son plus grand sponsor est peut-être Poutine, qui sait qu’en l’invoquant, il tire sur une corde magique qui réveillera des rêves secrets de gloire.
« Poutine ne peut pas se comparer à Lénine », m’a dit l’historien Dmitry Rusin. « Il était trop intellectuel et complexe en ces temps d’approximations faciles. Trop européen ». Rusin est professeur à l’université d’État d’Ulianovsk. En 1970, ils ont construit un énorme mémorial à Lénine dans le centre de la ville. « Poutine préfère être comparé à Staline, tout comme Staline a puisé son idée impitoyable du pouvoir russe dans Ivan le Terrible », explique le professeur alors que nous nous approchons du mémorial. « Ce n’est pas une idée européenne, mais asiatique, qui ne tient pas compte de la vie de l’individu. Ce retour au culte de Staline, surtout chez les jeunes, m’horripile. Je sens venir la catastrophe ». La fontaine devant le complexe est à sec. « Ils ont fermé le complexe pour rénovation il y a cinq ans », explique M. Rusin. « Il était censé rouvrir en 2020, mais on parle maintenant de 2025. Mais aucun financement ne vient de Moscou. Ils veulent rendre Oulianovsk pauvre ».
La situation est différente à Volgograd. Poutine veut lui redonner le nom de Stalingrad, pour mieux exploiter le symbole de la bataille. « Nous sommes à nouveau menacés par les chars Léopard allemands », a déclaré le président en février 2023, lors de l’inauguration d’un nouveau monument à la gloire de Staline dans le musée consacré au siège de deux cents jours, au cours duquel plus d’un million de soldats soviétiques et allemands ont été tués, blessés, portés disparus ou capturés. « Encore et encore, nous devons repousser l’agression de l’Occident collectif ».
Pourtant, c’est à Samara, à 500 km au nord de Volgograd, que le fantôme de Staline nous fait prendre conscience de l’incompréhension du monde extérieur à l’égard de la Russie. La ville est située à l’endroit où la Volga s’oriente vers l’est, comme si elle était attirée par l’Oural. La ville est généralement connue comme le Chicago russe, en raison de sa grande vitalité industrielle et de sa popularité auprès des marchands et des criminels. Mais en été, Samara devient le Saint-Tropez de la Volga, avec ses plages élégantes et sa promenade fluviale à la mode, qui n’a rien à envier à celle de Sochi. Et tout comme Sochi, elle semble être une destination pour les partisans purs et durs de Poutine. Des jeunes bourgeois parcourent ses rues en scooter, chaussés de baskets américaines hors de prix et vêtus du T-shirt le plus en vogue de la saison, sur lequel figure le visage de Staline et la phrase « Si j’étais ici, nous n’aurions pas à faire face à toute cette merde ».
Staline a construit un bunker secret sous un ancien bâtiment du comité communiste de la ville en 1942, juste après la courte victoire soviétique à la bataille de Moscou. Aujourd’hui, c’est un lieu de pèlerinage. J’ai participé à une visite du bunker, dans laquelle au moins la moitié de mon groupe était composé de personnes âgées d’une vingtaine d’années. Nous sommes descendus pour découvrir la salle de contrôle et l’appartement du chef de l’URSS. Le bunker n’a jamais été utilisé, mais le guide a expliqué qu’il avait été remis à jour lors de la crise des missiles cubains, puis après l’annexion de la Crimée en 2014. Aujourd’hui, il peut accueillir jusqu’à six cents personnes pendant cinq jours et « dispose même d’un service de téléphonie mobile ». Andrei, un ingénieur électricien de vingt-quatre ans venu de Moscou avec trois amis, m’a spontanément dit de Staline que « c’était un gagnant ». Nous étions devant une carte militaire originale de la contre-offensive soviétique. « Pour nous, les jeunes, Staline est le numéro un. Nous devons combattre le mal comme pendant la Grande Guerre patriotique. » Des associations négatives vous sont-elles venues à l’esprit ? « Ils disent beaucoup de choses, mais ce qui compte, ce sont les résultats. « Je pense qu’il y a eu plus de morts dans les années 90 avec les guerres de gangs et l’alcool. C’était notre première expérience de la démocratie, la pire période de notre histoire ».
En ce deuxième été de ce qu’Andrei appelle la « guerre contre le mal », même les dévots les plus zélés se laissent aller au culte de Staline, malgré sa confiscation des biens de l’Église orthodoxe et le fait qu’il ait transformé nombre de leurs cathédrales en prisons, en usines et en casernes. C’est Piotrovsky, à l’Ermitage, qui m’a suggéré de rencontrer un jeune prêtre nommé Mikhail Rodin, qu’il a qualifié de « voix émergente ». Il vivait à Balakovo, a ajouté Piotrovsky, « un endroit oublié par Dieu ».
Le père Rodin, qui a quarante-quatre ans et quatre enfants, appartient à l’Église orthodoxe russe des vieux croyants, née d’un schisme du XVIIe siècle avec l’Église orthodoxe officielle. Une longue histoire de répression et de messes semi-clandestines s’en est suivie. Mais aujourd’hui, le conflit avec l’Église principale, présidée par le patriarche Kirill de Moscou, semble s’être apaisé, les deux factions soutenant la mission sacrée de la Russie en Ukraine.
Je suis arrivé à Balakovo dans la soirée, avec une odeur d’ammoniaque dans l’air. Bien que la ville tourne autour de deux des plus grandes centrales électriques de la Volga, toutes ses routes sont sombres. Le seul signe de vie venait du Lucky Pub, qui accueillait un concert des Kiss, un groupe de rock local populaire – tous les gosses semblaient connaître leurs chansons. En entrant, j’ai eu l’impression d’être dans le Midwest : il y avait des tables de billard, des fléchettes, des frites dans des paniers en papier à carreaux et un panneau indiquant « make love not war » (faites l’amour, pas la guerre).
Batyushka [« petit-père », NdT] Rodin, qui parle un excellent anglais, a expliqué que son église située près de la zone industrielle sordide de Balakovo – un pavillon de luxe avec des rondins de pin odorants, un four pour faire le pain de communion, des icônes offertes par les paroissiens – avait été financée par un certain Robert Stubblebine, un Américain d’origine qui s’est installé à Moscou. Il est connu comme vice-président et premier actionnaire de Yandex, le Google russe, lancé par son partenaire commercial Arkady Volozh, un oligarque qui a qualifié la guerre de « barbare » (probablement dans le but d’être rayé de la liste des milliardaires sanctionnés).

Rodin n’est pas de cet avis. « La guerre est la dernière occasion d’apporter le salut à l’âme humaine », a-t-il déclaré avec un sourire béat. « Dans le Livre des Révélations, Jean l’Apôtre a parlé de ces derniers temps difficiles pour la race humaine, où chacun devra choisir sa propre voie : soit rester avec Dieu, soit aller vers de grandes douleurs et souffrances pour l’éternité. » Son ton n’a pas changé lorsque je l’ai interrogé sur le regain de popularité de Staline. « Je ne veux pas juger, parce que Dieu ne peut pas être retiré du cœur des Russes », a-t-il déclaré. « Personne n’a appelé Staline à l’aide, personne n’a appelé le Parti à l’aide. Tout le monde a crié à Dieu ! «
Je connais assez bien les prêtres russes : ils ont tendance à être rudes et arrogants. Rodin était différent, à la fois moderne et archaïque. Il utilise les médias sociaux et des manières médiévales. Il a un peu voyagé, mais pour lui, il n’y a pas d’endroit comme la Russie. Je lui ai demandé ce que signifiait pour lui le fait d’être russe. « Nous sommes influencés par l’immense néant qui nous entoure et par la rudesse du climat », a-t-il déclaré. « Dans un pays comme celui-ci, il faut avoir un objectif, un rêve. Nous, les Russes, avons besoin d’avoir quelque chose de grand à atteindre. Nous avons rêvé du communisme, de l’égalité et d’une vie où personne n’est exploité par qui que ce soit. Chaque personne est la même que l’autre ». Il poursuit : « Si les Russes croient en quelque chose, ils y croient jusqu’à la fin. Ils croient en Dieu. Ils sont prêts à mourir pour leur foi. Ils croient au communisme. Ils sont prêts à mourir pour cela. Ils croient en la Russie et sont prêts à se sacrifier pour elle ».
Même la bombe atomique, batyushka ?
« Bien sûr », répond-il rapidement. « Nous sommes prêts à nous sacrifier. Parce que si nous ne gagnons pas, nous brûlerons tout. Si nous ne pouvons pas atteindre cet avenir radieux, à quoi bon vivre ? » Il s’enflamme. « Notre président dit ce que tout le monde pense. Si nous n’avons pas la Russie que nous voulons, nous sommes prêts à nous martyriser, à nous sacrifier et à sacrifier le monde entier s’il est injuste et mauvais. On n’a pas besoin d’un monde comme ça. »
J’étais de nouveau dans la rue quand j’ai vu que j’avais un message vocal d’Albert, de l’île de Shubert. Il avait composé une nouvelle chanson reggae : « Au coucher du soleil, la Volga est baignée d’une lumière pure », chantait-il, « quand elle est illuminée par l’amour, mon cœur est le même ».
Source : harpers.org/archive/2024/01/behind-the-new-iron-curtain
Traduit de l’italien par Elettra Pauletto
Views: 2